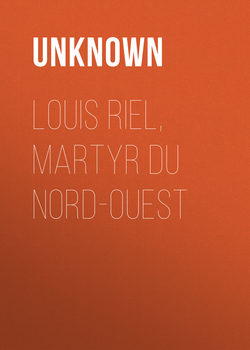Читать книгу Louis Riel, Martyr du Nord-Ouest - Unknown - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IV
L'INSURRECTION
ОглавлениеAu milieu de mars 1885, il se passa un fait au moins étrange.
Tout le monde prévoyait, depuis plusieurs mois, une insurrection; et le gouvernement était seul à n'y avoir point pris garde.
S'il y avait pris garde, il lui eut suffi de se décider à rendre justice aux Métis, pour que l'insurrection n'eut pas lieu.
Or, l'agitation croissait de jour en jour, mais aucun acte de justice n'était intervenu.
Non seulement Riel n'avait pas encore levé le drapeau de la révolte, mais il n'avait pas même renoncé à l'espérance d'une solution pacifique; et il se flattait d'intimider le gouvernement, par des démonstrations, de façon à arracher des concessions aux ministres d'Ottawa, sans être obligé de recourir à une prise d'armes.
Rien n'était donc changé à la situation, au commencement de mars. Il n'y avait pas encore d'insurrection; et il dépendait du gouvernement canadien qu'il n'y en eût jamais. S'il avait fait, à cette date, ce qu'il a été obligé de faire depuis, s'il avait accordé aux Métis les demandes dont le bien fondé a été plus tard reconnu, la paix n'aurait jamais été troublée; nos concitoyens n'auraient pas été condamnés à la dure expédition du Nord-Ouest, et une dépense de plusieurs millions de piastres aurait été épargnée au trésor public.
Chose curieuse! Le gouvernement qui n'avait pas encore trouvé une minute pour lire les réclamations des Métis, s'était, paraît-il édifié à sa manière sur la situation du Nord-Ouest; et il s'était résigné avec un coeur léger à l'idée de la guerre civile, avant que la guerre fut déclarée, avant même qu'elle fut devenue inévitable.
Cette guerre civile, ce fut la police du gouvernement que en prit l'initiative.
Le 27 mars, le major Crozier, de la police à cheval, profitant d'une altercation survenue la veille entre Gabriel Dumont et un nommé MacKay, s'était présenté aux Métis en ennemi, à la tête d'un corps de troupes.
Il avait rencontré Gabriel Dumont, escorté de vingt cavaliers: et il avait tiré le premier coup de feu sur des hommes inoffensifs.
Cette action, dans laquelle la police fut mise en déroute et perdit quatorze hommes, reçut le nom de bataille du lac aux Canards.
Il est important de constater que, ni de part ni d'autre, il n'est nié que les hommes de Crozier aient tiré les premiers.
Par une coïncidence surprenante, à cette même date du 27 mars, avant de connaître l'attaque du major Crozier, le gouvernement, qui s'y attendait évidemment, ordonnait à la batterie A de Québec, et à la batterie B, de Kingston, de former chacune un détachement de cent hommes et de se mettre aussitôt en campagne.
Cette fois-ci, comme en 1870, c'était donc le gouvernement qui avait déclaré la guerre. C'était le gouvernement qui avait entamé les hostilités contre des gens ne demandant qu'à traiter.
La mobilisation se fit rapidement
Dès le 24 mars, le général Middleton était parti pour Winnipeg, afin de se mettre à la portée des opérations éventuelles.
Le 28 mars, deux détachements des Queen's Own, le 10ème Grenadiers Royaux et la compagnie C, de l'infanterie de Toronto étaient appelés au service. Le 65ème Carabiniers de Montréal reçut pareillement son ordre de départ. Le 30 mars, deux nouveaux régiments étaient levés à Winnipeg et un détachement des gardes à pied du gouverneur prenait la route du Nord-Ouest.
Le 31 mars, le 2ème London (Ontario) et le 9ème de Québec étaient appelés au service actif.
Gros-Ours
Ces régiments manquaient de tout. Pour les mettre en mesure de partir, il fallut que le ministre de la milice donnât un blanc seing aux colonels et les autorisât à faire coûte que coûte et d'urgence, toutes les dépenses nécessaires pour compléter l'équipement de leurs corps. On saura sans doute, d'ici peu de temps, combine de millions ce gaspillage suite de plusieurs années d'imprévoyance et d'incurie volontaire, a coûté au trésor public.
La bataille du Lac aux Canards, dont le gouvernement a assumé la responsabilité en ne désavouant pas le major Crozier, devait avoir des conséquences d'une gravité incalculable.
D'abord, elle constituait les Métis à l'état de belligérants. Riel, qui n'avait point assisté à l'engagement et qui avait conservé jusqu'à cette date l'espoir d'une solution pacifique, organisa un conseil de gouvernement, composé de douze personnes.
En même temps, les Sauvages qui n'avaient point encore pris fait et cause pour les Métis, furent enhardis par l'échec de la police, et se décidèrent à prendre part à la lutte. Le 30 mars, Gros-Ours prit le sentier de la guerre; et le lendemain sa bande procédait au massacre du Lac aux Grenouilles. Poundmaker devait plus tard suivre l'exemple de Gros Ours et infliger au colonel Otter la défaite de la montagne du Camp du Corbeau.
PIE-A-POT
Désormais, tout espoir de négociation amiable était perdu et il fallait que le sort des armées décidât.
Il n'entre pas dans le cadre de ce récit de retracer en détail la suite des événements militaires qui ont abouti à la prise de Batoche.
La lumière n'est pas encore faite sur cette partie de notre histoire.
Le Canada peut se dire, avec une légitime fierté, que ses volontaires se sont comportés héroïquement devant le feu de l'ennemi. Mais si la bravoure des soldats est restée au-dessus de tout éloge, il plane encore beaucoup d'incertitude sur le plus ou moins d'habileté des chefs et sur la façon dont les opérations ont été conduites.
D'après le témoignage d'un conservateur du Nord-Ouest, dont les affirmations n'ont jamais été démenties, les insurgés au nombre de 300 à 400, n'auraient jamais eu plus de cent combattants. Même à la plus forte escarmouche, qui fut celle de Batoche, ils n'avaient pas cinquante combattants, et la bataille a duré quatre jours. On a peine à comprendre qu'il ait fallu tant de temps et d'efforts pour aboutir à un si mince résultat.[1]
[Note 1: LA PRESSE, 24 août 1885.]
D'un autre côté, des témoins oculaires affirment qu'étant donnée la façon dont les volontaires avaient été éparpillés, par petites bandes, c'est un véritable miracle qu'ils n'aient pas été massacrés en détail; et c'est l'avis de plusieurs officiers, ayant pris part à la lutte, que si les Métis avaient eu à leur tête un militaire de profession, expérimenté dans la conduite des embuscades, notre jeune armée aurait été exposée à un véritable désastre.
Le parlement a voté néanmoins au général Middleton une récompense pécuniaire, ni plus ni moins que s'il avait gagné une nouvelle bataille de Waterloo; et le gouvernement impérial, auquel les ministres d'Ottawa avaient intérêt à faire prendre la rébellion au sérieux, a gratifié d'une décoration le commandant en chef et le ministre de la Milice.
Après tout, le gouvernement impérial qui avait déjà pris au sérieux les exploits stratégiques du général Wolseley, en 1870, ne pouvait mieux faire que de traiter, en 1885, le général Middleton en triomphateur.
Mais, la lettre adressée à M. F. X. Lemieux, par le révérend Père André, a jeté plus d'une ombre sur cette étoile naissante de l'armée anglaise.
Aujourd'hui, dit le Père André, le gouvernement se glorifie de la victoire et s'applaudit comme d'un grand triomphe d'avoir battu les Métis. Riel est condamné, les principaux Métis de Saskatchewan sont dans les fers; et dans son enthousiasme, le Parlement vote vingt mille piastres au général Middleton; tout le Canada est fier de son succès et de celui des volontaires. Nous sommes heureux comme le reste de la nation que cette rébellion soit finie, nous l'avons vivement combattue, prévoyant tous les malheurs qu'elle entraînerait avec elle. Mais je dois le dire au risque de choquer plusieurs personnes que j'aime et estime; l'armée du général Middleton s'est déshonorée par le pillage éhonté auquel elle s'est livrée, malgré la proclamation du général qui défendait de ne rien toucher, de ne rien prendre. Je ne parle pas d'après les rapports qui m'ont été fait; mais j'ai visité plusieurs fois la contrée qui avoisine Batoche, et je puis affirmer que sur une longueur de 25 milles, toutes les maisons établies sur le côté sud de la Saskatchewan ont été pillées et saccagées, et plus de 20 ont été brûlées et rasées.
Cette contrée jadis si florissante offre un spectacle affreux de désolation et de détresse qui fait mal à voir. Les volontaires ont pillé les habitants et tout ce qu'ils possédaient, leurs chevaux, leurs effets et habillements, et ils n'ont laissé aux malheureux que ce qu'ils avaient sur le dos. Le général été humain et doux à l'égard des habitants, il ne leur a infligé aucun traitement cruel, mais il a assisté impassible à tout le pillage qui se faisait autour de lui, malgré sa proclamation. Et lui-même, comme pour les encourager à piller, s'est approprié un beau cheval et une voiture d'un nommé Manuel Champagne, dont il a fait présent à Thomas Ibouri. Voilà les faits dont je suis certain, et le ministre de la milice peut affecter l'ignorance tant qu'il voudra, ces faits n'en seront pas moins vrais et réels.
Le résultat de tout cela est que nos pauvres Métis sont dans une détresse et un dénuement extraordinaires.
Je regrette que le général Middleton n'ait pas achevé son oeuvre, et qu'au pillage il n'ait ajouté le massacre, au moins il nous aurait épargné le spectacle de cette agonie prolongée que voyons devant nous.
Un tel écrit, émané d'un témoin aussi digne de foi que le Rév. Père André, est de nature à diminuer quelque peu la gloire du général en chef, dont l'unique victoire se réduit à avoir emporté en quatre jours une redoute défendue par cinquante hommes; du général en chef qui n'est parvenu à prendre de vive force qu'un cheval volé à son propriétaire; mais qui n'a pu prendre Riel qu'en lui écrivant une lettre pour le prier de se rendre, et qui, après avoir vainement poursuivi Gros Ours, n'a trouvé finalement d'autre ressources pour s'emparer de sa personne que de mettre sa tête à prix et de provoquer ainsi la trahison d'un des siens.
M. A. N. Montpetit, qui a résumé dans son livre sur Riel à la Rivière du Loup, les principaux événements de la campagne, décrit de la façon suivante les deux derniers exploits du général Middleton pendant cette campagne.
Juin, 9. Le général Middleton au Lac aux Huarts. Il traverse sur un radeau. Il abandonne la poursuite de Gros-Ours. Le pays est infranchissable.
Juin, 22. Le général Middleton, après s'être remis à la poursuite de Gros-Ours, y renonce une seconde fois et décide de renvoyer les volontaires dans leurs foyers.
Ce bulletin d'une concision expressive, ne ressembla pas précisément à un bulletin de la Grande armée, et il nous autorise à ne point porter M. le général Middleton en triomphe.
La personnalité que la campagne du Nord-Ouest a mis hors de pair, ne figure point dans le camp des victorieux, mais dans celui des vaincus: c'est celle de Gabriel Dumont.