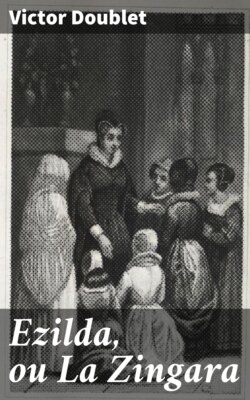Читать книгу Ezilda, ou La Zingara - Victor Doublet - Страница 8
LA VENGEANCE.
ОглавлениеLe soleil rayonnait sur l’étoffe écarlate,
Dont les plis encadraient sa tête délicate,
Et la faisait reluire en reflet enflammé,
Comme un tison d’enfer!.,.
COMME nous l’avons déjà dit dans le chapitre précédent, madame Joanneau était issue d’une famille illustre. Tous ses parens étaient restés attachés à la foi catholique, dont plusieurs même avaient été les défenseurs et les martyrs. Mais cette dame ayant perdu son père et sa mère dans un âge où elle n’était pas encore capable de se diriger seule dans le monde, elle fut confiée aux soins d’un bon oncle, qui lui-même fut tué peu de temps après en combattant contre les huguenots. La tutelle de la pauvre orpheline fut alors déférée à un parent fort éloigné, mais qui, par malheur, s’était laissé aller au vent des nouvelles doctrines, et corrompit l’esprit de sa pupille en lui faisant goûter le fatal poison des nouveautés.
Ce parent jugea à propos de la marier de bonne heure, afin, disait-il, de lui donner un protecteur qui pût mettre sa fortune en sûreté dans ces temps de discorde où rien n’était respecté. Il lui choisit donc pour époux un noble seigneur, fort riche, il est vrai, mais aussi fort attaché au parti protestant; c’était le seigneur De la Ville.
En agissant ainsi, le tuteur avait plutôt consulté l’intérêt du parti qu’il défendait, que celui de sa pupille; car, par ce mariage, il mettait son ami, le sieur De la Ville, en état de faire de grandes entreprises contre les catholiques., puisque sa fortune, jointe à celle de son épouse, le rendait un des plus riches seigneurs du Berry, et, par conséquent, un des plus fermes appuis du parti huguenot.
En effet, dès que De la Ville se vit possesseur d’une aussi immense fortune, il ne craignit plus de faire des sacrifices pour aider à renverser la religion catholique; il arma le peuple de Sancerre, lui fit prêter serment de n’obéir à son roi légitime, qu’autant qu’il permettrait le libre exercice de la religion prétendue réformée, dans tous ses états, avec toutes les franchises qu’on lui avait demandées.
Pendant huit années qu’on les avait laissés tranquilles, les huguenots de Sancerre avaient eu tout le temps, jusqu’en 1569, d’abolir tout-à-fait dans leur ville l’exercice de la religion catholique, et de se fortifier en cas d’attaque. Leur domination dans cette ville avait entraîné la ruine de toutes les églises.
Charles IX, quoique bien déterminé à soutenir la religion catholique, qui subsistait dans le royaume depuis son origine, s’était trouvé fort embarrassé à la vue de tant de villes révoltées contre lui; il avait cru devoir céder au temps. Au mois de janvier 1562, il avait donné un édit par lequel il permettait aux protestans d’avoir des temples, mais seulement hors des villes, et leur ordonnait de restituer les églises, les maisons et les terres dont ils avaient dépouillé les ecclésiastiques.
Les Sancerrois ne s’étaient point conformés à cet édit; ils avaient gardé tous les biens usurpés sur les anciens pasteurs, chapelins et vicaires qu’ils avaient chassés, et s’étaient toujours servi de l’église principale, la seule qu’ils eussent conservée pour y faire leur prêche, sans permettre à un petit nombre de catholiques, qui restèrent toujours dans la ville jusqu’ à sa prise, d’y faire l’exercice public de la vraie religion.
Cet édit avait tranquillisé en quelque sorte les autres protestans du royaume, qui cependant ne s’y étaient conformés qu’en bien peu d’endroits. Le massacre de Vassy, arrivé le premier de mars suivant, avait tout dérangé. Il était pourtant notoire que c’avait été une étourderie de la part des gens de la suite du duc de Guise, et une querelle passagère qui n’avait eu rapport ni à la religion, ni à l’édit du roi; néanmoins les protestans avaient sonné l’alarme et publié partout que c’avait été un complot formé contre eux. Il n’en avait pas fallu davantage pour leur faire reprendre les armes.
Les Sancerrois se rendirent aussitôt maîtres de Bourges, de Nevers et de plusieurs autres villes qui leur furent reprises par les troupes du roi, quelques mois après.
Charles IX, qui craignait d’aigrir les esprits, publia, le 19 mars 1563, un nouvel édit de pacification, par lequel il permettait les prêches dans les villes dont les protestans étaient maîtres avant le 7 du même mois. Les habitans de Sancerre se trouvaient pour lors en règle, quant aux prêches qu’ils avaient établis dans leur ville; mais ils ne voulaient pas entendre parler de la remettre en la puissance du roi, et continuèrent toujours depuis à la fortifier.
La paix paraissait avoir été rétablie par l’édit de pacification; néanmoins les protestans persistaient toujours dans leur révolte. Ils alléguaient pour prétexte, que les gouverneurs des provinces n’observaient pas les édits donnés en leur faveur, et que la cour même n’y était pas assez fidèle. La Reine-Mère, Catherine de Médicis, de son côté, se plaignit, en 1568, aux protestans, qu’ils retenaient toujours les places qui devaient être rendues au roi par le traité qu’il avait fait avec eux, comme Montauban, Sancerre, Castres, Cahors, Milhaud, Vezelay et La Rochelle; que ces villes ne voulaient pas recevoir ses officiers, et continuaient avec ardeur les fortifications qu’elles avaient commencées pendant les troubles. Ces représentations de la Reine-Mère ne produisirent aucun effet, et les choses restèrent dans le même état qu’auparavant.
Le prince de Condé, qui était le chef des huguenots, se sauva, cette année-là, de Noyers pour gagner La Rochelle; il passa la Loire à un gué qu’on lui indiqua proche Sancerre; ce qui ne contribua pas peu à soutenir dans la révolte cette ville dont il laissa le gouvernement entre les mains du seigneur De la Ville, lui enjoignant de venir le trouver à La Rochelle, si les affaires n’allaient pas à son gré, ou s’il éprouvait quelque échec.
En 1588, commença le premier siége de Sancerre; quelque troupes envoyées de Bourges, firent sans succès le prélude de cette entreprise, vers le milieu du mois de novembre. Elles vinrent camper dans le village de Chavignol, à une demi-lieue de Sancerre, avec quelques pièces d’artillerie; mais les Sancerrois ayant à leur tête le fanatique De la Ville, les attaquèrent si vigoureusement et leur tuèrent tant de monde, qu’elles s’enfuirent à Bourges, tout épouvantées, vers le 20 du même mois.
Le roi, après la dernière paix qui avait été faite au mois de mars, avait absolument résolu de se rendre maître de la ville de Sancerre ou de la détruire entièrement. Tous les gouverneurs voisins l’en sollicitaient; ils lui représentaient qu’il était dangereux de laisser au pouvoir des protestans, une ville bâtie sur un roc escarpé, laquelle était inaccessible presque de tous côtés, et dominait sur la Loire. Ils ajoutaient que les Sancerrois, presque tous protestans, avaient donné retraite dans leur ville à un grand nombre de protestans fugitifs, et que tant que cette place serait entre leurs mains, les frontières du Berry et de la Sologne ne seraient point en sûreté.
Frappé de ces raisons; le roi prit d’abord le parti de la modération envers les habitans de Sancerre, et leur ordonna de recevoir garnison dans leur ville. Ils s’en excusèrent sur leur pauvreté, et sur ce qu’étant éloignés des grands chemins et sans commerce, ils n’avaient pas besoin de troupes pour les garder. La chose ayant été examinée dans le conseil du roi, on leur proposa une autre condition, qui était de raser leurs fortifications. Les Sancerrois, qui voulaient se délivrer d’une garnison dont on les menaçait, et qui prévoyaient que la paix ne durerait pas long-temps, y consentirent, pourvu que les comtes de Beuil, leurs seigneurs, le voulussent bien. Par là, ils cherchaient à gagner du temps; car, dans le fond, ils s’embarrassaient fort peu des comtes de Beuil. L’affaire ayant donc traîné en longueur, et les protestans du royaume ayant repris les armes de toutes parts, les Sancerrois, au lieu de démanteler leur ville, déjà très-forte par sa situation, travaillèrent avec ardeur à y ajouter de nouvelles fortifications.
Le roi, indigné qu’une aussi petite ville ne voulût pas rentrer dans le devoir, en ordonna le siége. Sur ses ordres, le comte Sciarra Martinengo, noble vénitien de Brescia, en Lombardie, lequel commandait la garnison de Gien, éloigné d’une journée de Sancerre, François de Balsac d’Entragues, gouverneur d’Orléans, et Claude de La Châtre, gouverneur du Berry, s’étant abouchés, et voulant profiter de l’absence d’Avantigny, gentilhomme du voisinage, habile capitaine, en qui les habitans de Sancerre avaient grande confiance, joignirent ce qu’ils avaient de troupes et marchèrent à Sancerre, où ils arrivèrent au commencement de 1569, avec un corps de 3,000 fantassins et quelque cavalerie, composée des gentilshommes des environs. Ils avaient huit pièces de canon, dont ils commencèrent à battre la porte de Bourges. Il y eut bientôt une large brèche; mais le fossé que les assiégés avaient creusé derrière, et les retranchemens qu’ils avaient faits aux deux côtés, rendaient l’approche très-difficile. Vieux-Pont, sieur d’Aigueville, fils du baron de Neubourg, jeune homme intrépide et hardi, se chargea d’y donner l’assaut. Il le fit avec toute la vigueur possible; mais les Sancerrois, commandés par De La Ville, faisant avec leurs arquebuses un feu continuel sur les assaillans, dont le flanc était découvert, il fut obligé de se retirer après une perte considérable.
Les assiégeans changèrent leur batterie de place, et la dressèrent du côté de Saint-Satur, où ils avaient appris qu’ils éprouveraient moins de difficultés. C’était apparemment un faux avis que les Sancerrois leur avaient fait donner; car ce côté de la ville est un des plus escarpés. Quoiqu’il en soit, on y eut bientôt fait une brèche plus large que celle qui avait été faite du côté de la porte de Bourges. D’Aigueville monta encore à l’assaut; mais les Sancerrois dont le premier succès avait enflé le courage, le repoussèrent avec tant de vigueur, que ce jeune chef et un grand nombre de ceux qu’il commandait, demeurèrent sur la place, et beaucoup d’autres y furent dangereusement blessés.
Depuis ce temps-la, le sieur De La Ville crut ne plus devoir se contenter de se tenir sur la défensive; il osa attaquer les troupes du roi, et il les fatigua extrêmement par de fréquentes sorties.
Sur ces entrefaites, Jacques de Savoie, duc de Nemours, se rendit au siége avec un corps de troupes qu’il avait levées dans le Lyonnais et dans les provinces voisines; il était accompagné du baron Des Adrets, si fameux par ses cruautés, lequel avait servi le parti protestant avec chaleur dans les guerres précédentes, servait le roi dans celle-ci avec un corps de troupes assez considérable, qu’il avait à ses ordres. Des Adrets allait, par ordre exprès du roi, joindre le duc d’Aumale. La Châtre le sollicita vivement de rester quelques jours devant Sancerre, pour lui aider à forcer la place. Des Adrets, qui jugea que le siége serait long, et qui d’ailleurs était pressé par le duc d’Aumale, dont il recevait lettres sur lettres, non-seulement ne voulut pas rester, mais il conseilla de lever le siége. On le fit en effet au commencement de février, après avoir demeuré plus de cinq semaines devant cette place, et y avoir perdu plus de cinq cents hommes.
Nemours tira vers la Lorraine, et les autres s’en retournèrent avec leur canon, chacun dans son gouvernement.
Les Sancerrois qui, pour toute arme, n’avaient que des arquebuses, enflés et enhardis par ce succès, mirent tout le pays à contribution, fortifièrent Saint-Thibaud-sur-Loire, au-dessous de Sancerre, et y mirent bonne garnison. De là, ils faisaient des courses dans le voisinage, et ruinaient tout le commerce en faisant payer de gros droits à tous les bateaux qui passaient devant ce port.
Ce fut en ce temps-là, que le commandant De La Ville fit ravager par ses troupes la riche abbaye de Saint-Satur, dont il se réserva la plus riche partie du butin.
Avec ce surcroît de fortune, il fit une riche dot à sa fille qu’il maria au comte de Bussy, son premier lieutenant, et un des protestans les plus acharnés.
Madame Joanneau, alors son épouse, approuva sa conduite, et voulut qu’à l’occasion du mariage de sa fille unique, toute la ville de Sancerre se livrât à la joie et aux divertissemens. Elle prodigua l’or à pleines mains; elle inventa mille sortes de jeux différens, pour divertir le peuple, et la joie que goûtèrent en ces jours-là les Sancerrois, leur fit oublier tous les désagrémens qu’ils avaient eus à souffrir pendant le siége.
Anna était cette épouse pour le mariage de laquelle on faisait des fêtes si brillantes. Cette jeune fille, pour ne pas attirer sur elle le courroux de ses parens qu’elle aimait tendrement, malgré leurs excès, ne remplissait pas sous les yeux les pratiques de la religion catholique; mais elle gémissait dans le secret de son cœur, de leur funeste aveuglement, et elle conjurait le ciel de leur faire miséricorde, et de faire luire à leurs yeux le céleste flambeau de la véritable foi.
Une servante catholique que sa mère avait prise chez elle pour élever Anna, l’avait instruite des vérités de la religion, et lui avait inspiré du goût pour une multitude de pratiques de dévotion. Mais cette pieuse fille avait recommandé surtout à sa jeune élève, d’invoquer la Mère de Dieu, comme source de toute grâce et de toute consolation. Anna avait suivi le conseil de Marie, sa gouvernante, et chaque jour, elle se prosternait humblement devant l’image révérée de la Mère des Anges, et elle ne terminait jamais sa prière, sans en éprouver les doux fruits.
Mais Marie, qui elle-même n’avait pas la force de se déclarer catholique, se gardait bien d’engager sa jeune maîtresse à faire paraître au-dehors son amour pour cette sainte religion; et, par conséquent, Anna, suivant les conseils de son institutrice dans la foi, ne manifestait aucun signe extérieur qui pût faire découvrir son précieux secret.
La pauvre enfant! combien elle eut lieu de gémir au milieu de ces fêtes tumultueuses où elle se voyait parée comme une idole, de tous les ornemens du culte divin qu’elle adorait dans son cœur!
Oh! combien mieux, mille fois, elle aurait préféré se voir unie à un catholique! Mais précisément, c’était à un des partisans les plus acharnés du parti de la réforme, qu’elle allait appartenir! C’était au comte de Bussy, l’homme le plus fier, le plus inquiet, le plus soupçonneux et le plus vain de tous les calvinistes!... Cette seule pensée la faisait trembler. Aussi, elle seule, au milieu de la joie commune, paraissait triste et affligée. Comme une victime destinée au sacrifice, elle se laissa conduire au temple, sans proférer aucune plainte. Elle connaissait trop bien le caractère violent de son père, surtout lorsqu’il s’agissait de la prospérité de la réforme; elle voulut donc lui épargner... peut-être... un nouveau crime!...
Mais la Providence ne tarda pas à faire justice de l’irréligion du sieur De La Ville; les Sancerrois, trop confians dans leurs propres forces, ne voulurent devoir qu’à eux-mêmes la gloire de se défendre et de braver tous les efforts des armées royales; ils invitèrent donc tous les étrangers qui s’étaient réfugiés chez eux, à aller secourir leurs frères de La Rochelle, qui, en ce moment, se trouvaient vivement pressés parles troupes du roi. On s’y prit d’une manière si honnête, et ont leur fit de si grands présens, pour les remercier des bons services qu’ils avaient rendus pendant le siége, qu’ils n’eurent pas lieu de se plaindre en recevant cet ordre de départ. D’ailleurs ils n’osaient pas même soupçonner, à cette subite résolution des Sancerrois, d’autre motif que celui qui leur avait été donné , puisque le comte de Bussy, le premier lieutenant et le gendre du gouverneur, partait avec eux et allait avoir le commandement de ces nouveaux émigrés.
Le départ s’effectua donc avec une égale satisfaction de part et d’autre; on se promit bien de se revoir aussitôt que la paix serait parfaitement rétablie, et on se souhaita toutes sortes de prospérités.
Dans toute cette émigration, une seule personne paraissait étrangère aux différens sentimens qui animaient les uns et les autres; partagée entre l’amour qu’elle avait pour ses parens, et le devoir qui la retenait attachée à son époux, elle seule versait un torrent de larmes! Il lui resta pourtant une consolation dans ce moment terrible: Marie la suivit...
Ah! si du moins elle avait eu la prescience de tous les malheurs qui allaient fondre sur sa famille et sur son pays, elle aurait béni le ciel qui semblait l’avoir arrachée à temps du sein de sa malheureuse patrie, pour qu’elle n’y fût pas témoin, et peut-être même victime de tant de sanglantes horreurs qui devaient s’y commettre.
En effet, le peuple était à peine reposé des fêtes bruyantes auxquelles il venait de prendre part, qu’il songea à de nouvelles déprédations, au détriment de ses voisins.
Mais les bourgeois des villes de Nevers et de la Charité-sur-Loire, irrités des hostilités des Sancerrois, cherchèrent le moyen de rétablir la liberté de leur commerce sur cette rivière: voici comme ils s’y prirent.
Ils construisirent de longs bateaux qu’ils percèrent aux endroits nécessaires pour leur dessein; ils les recouvrirent de planches, les remplirent de soldats, et mirent par-dessus des marchandises, pour empêcher qu’on ne vît les troupes. En même temps, ils portèrent de la cavalerie en embuscade dans le voisinage de Sancerre.
Tout étant ainsi préparé, ces bateaux passent devant le port de Saint-Thibaud; la garnison sancerroise, persuadée que ce sont des marchandises, leur ordonne de s’arrêter, de venir à bord, et accourt à l’instant pour recevoir les droits.
Dans le même moment, les soldats cachés dans les bateaux, et la cavalerie embusquée dans les environs, se joignent et enveloppent les Sancerrois de tous côtés. Il en reste cinquante sur la place; les autres prennent la fuite, grimpent avec peine la montagne escarpée, et rentrent dans la ville où ils rapportent à leurs concitoyens la nouvelle de leur défaite.
De La Ville se montra furieux d’avoir essuyé cet échec; il forma aussitôt un projet vaste, qui devait non-seulement réparer ses pertes, mais encore exalter sa puissance et la rendre redoutable aux principales forces du royaume. Il ne s’agissait rien moins que de surprendre la ville de Bourges et de la soumettre à la domination des Sancerrois.
Les huguenots avaient excité une sédition à Bourges en 1561, pour y avoir célébré la cène dans la Maison de Ville. Le 27 mai 1562, le comte de Montgomméry entra dans cette ville ets’en rendit maître, à la faveur des protestans qui y étaient cachés, et de ceux du village d’Asnières, qui firent tous ensemble leur prêche dans la cathédrale. Mais le 1er septembre suivant, le roi, après un siége de quinze jours, reprit cette place et en chassa les huguenots, dont une partie se retira à Sancerre.
Les choses restèrent en cet état jusqu’en 1568, que les protestans se révoltant de tous côtés, l’archevêque Jacques le Roi et deux cent trente-six habitans catholiques signèrent, le 18 mai, une ligue pour l’obéissance au roi. La confédération protestante de la province de Berry essaya, sur la fin de l’année 1569, et ne désespéra pas de s’emparer de cette capitale par le moyen des calvinistes qui y étaient encore en assez grand nombre, mais cachés.
L’Espau, Larose, capitaine d’une compagnie de la garnison de Sancerre, et La Grange, un des conseillers de Bourges, mais qui était en fuite à cause de la religion, allèrent trouver le seigneur De La Ville, et lui firent part du projet qu’ils avaient formé, de surprendre la ville de Bourges. Celui-ci entra dans leurs vues, et, pour hâter la réussite de cette entreprise, il fit offrir deux mille écus d’or à Ursin Palus, lieutenant de Marin, gouverneur de la Grosse Tour, pour l’engager à la leur livrer. Palus le leur promit; et c’était, leur disait-il, à la persuasion de Guillaume son frère, qui demeurait à Sancerre. Mais il découvrit tout à Marin, commandant de la tour, et à Claude de La Châtre, gouverneur du Berry, qui l’engagèrent à amuser toujours son frère, de l’espérance de livrer cette forteresse aux confédérés.
Lorsqu’on eut été bien informé du jour fixé par les conjurés pour exécuter leur dessein, on leur dressa des embûches dans la ville, avec des feux d’artifice, des pots pleins d’huile bouillante, des grenades, des lits de poudre que l’on sema en différens endroits, et du canon que l’on disposa de côté et d’autre, pour s’en servir au besoin.
Afin d’ôter tout soupçon, La Châtre passa à des courses de bagues toute la journée du 22 décembre qui précéda la nuit où ils devaient faire leur coup, et, sur le soir, il fit fermer les portes et mettre tout le monde sous les armes, sans bruit.
Le signal convenu ayant été donné par Palus, les conjurés s’arrêtèrent un moment. Palus va au devant d’eux, et les assure que tout est en bon état; qu’ils n’ont qu’à venir et montrer du courage. Aussitôt il entre le premier dans la tour: l’Espau l’y suit avec douze hommes; La Grange avec vingt-cinq; Larose avec cinquante, tous le bouclier d’une main et l’épée nue de l’autre. Pendant ce temps-là, De La Ville s’approchait avec douze cents mousquetaires et treize compagnies de cavalerie. Les mousquetaires ayant passé avec des échelles par-dessus les murs, furent foudroyés par le canon, brûlés et mis en pièces par les poudres auxquelles on mit le feu; et ceux qui étaient entrés dans la tour tombèrent entre les mains de la garnison. Les officiers de ville voulaient qu’on les fit mourir tous comme des traîtres et des rebelles, surtout ceux qui étaient de Bourges; mais le gouverneur La Châtre s’y opposa. Les trois capitaines furent parfaitement bien traités par ce gouverneur; et après qu’on eût payé leur rançon, il les mit en liberté , quoique le parlement lui fit injonction de les lui remettre, sous peine de deux mille marcs d’or.
Le sieur De La Ville n’eut pas le même bonheur; il avait monté sur les échelles, à la tête de ses mousquetaires; et un pot d’huile bouillante l’avait renversé dans le fossé en le maltraitant rudement. Au point du jour, il fut trouvé souffrant quoique ses blessures ne fussent pas très-dangereuses. Ou le conduisit au gouverneur.
La Châtre, qui avait eu plus d’une fois l’occasion de reconnaître en lui le fanatisme le plus aveugle et le plus cruel, pensa qu’il devait seul payer la peine due à tous ses complices, et il le remit aussitôt à la disposition du parlement.
De La Ville fut jugé sur le champ et condamné à souffrir les plus horribles tourmens en punition de tous ses forfaits. On le conduisit par la ville, pieds nus, revêtu d’un cilice, et on le força à s’arrêter devant tous les lieux saints, pour y faire amende honorable de tous les sacriléges qu’il avait commis. Enfin, quand on le vit trop exténué de fatigues pour supporter de plus longs tourmens, on le fit expirer sous le fouet, supplice qu’il avait autrefois infligé à plusieurs pieux ecclésiastiques auxquels, parce barbare traitement, il avait procuré la glorieuse couronne du martyre.
Sa veuve, en apprenant son supplice, devint furieuse: elle revêtit des habits de deuil, et s’étant présentée aux Sancerrois dans la place publique, elle fit éclater toute sa douleur et toute son indignation; elle les supplia de ne point différer la vengeance qu’elle réclamait, et tous jurèrent qu’ils étaient prêts à laver dans le sang de leurs ennemis communs la honte imprimée au protestantisme dans la personne de leur chef auquel on avait fait souffrir un supplice si ignominieux et si barbare.
Ils ne tardèrent pas à trouver l’occasion de satisfaire cette horrible vengeance: Wolfang, duc de Deux-Ponts, appelé par les protestans de France, traversait alors la moitié du royaume à la tête de quatre mille reitres et de six mille lansquenets. Les Sancerrois allèrent le trouvera Pouilly, à deux lieues de Sancerre, sur l’autre rive de la Loire, et l’invitèrent à passer ce fleuve pour venir mettre le siége devant La Charité.
Ce prince allemand, qui ne respirait que combats, afin de rassasier ses troupes du pillage des villes prises, accueillit avec plaisir la prière des Sancerrois, et alla aussitôt assiéger cette ville. Il fit dresser une batterie contre la porte et la tour de Nevers, de l’autre côté de la rivière, et contre le mur qui s’étend jusqu’à la porte Saint-Pierre.
Le brèche fut bientôt faite. Le gouverneur du Castel Chigi, épouvanté, s’enfuit secrètement pendant la nuit, sous prétexte d’aller demander du secours au duc d’Anjou, frère du roi. Les habitans, troublés par cette retraite, et pressés par l’ennemi, demandèrent un pourparler. Pendant qu’on négociait, quelques bourgeois protestans, qui s’étaient cachés, descendirent, à un certain signal, du haut de la muraille, une corde au moyen de laquelle ils firent monter les ennemis les uns après les autres; mais en si grand nombre, que, dès le lendemain, ils se rendirent maîtres de cette ville, qui était encore consternée de la fuite de son commandant.
Le pillage fut accordé aux troupes allemandes, pour leur tenir lieu d’un mois de solde que les protestans de France ne leur avaient pas payé. Nous nous abstiendrons de rapporter ici les horreurs de ce pillage, tristement célèbre dans les annales berruyères.
La veuve du sieur De La Ville, qui avait conduit toute cette affaire d’une manière si heureuse pour les protestans, fut regardée désormais comme le plus ferme appui de la religion réformée dans le Sancerrois; on savait d’ailleurs que ses fréquentes relations avec son gendre, le comte de Bussy, qui était un des principaux capitaines de La Rochelle, lui fournissait les moyens d’obtenir de prompts et puissans secours en cas d’événement. Mais il fallait élire un nouveau chef à la place du sieur De La Ville; et tous les capitaines qui commandaient à Sancerre, ayant un égal mérite aux yeux de leurs compatriotes, et étant tous animés d’une ambition égale, il était difficile que le choix tombât sur l’un d’eux, sans mécontenter les autres, et peut-être même, sans causer quelques divisions, qui ne laisseraient pas d’être bien funestes, si l’on ne se hâtait de trouver un expédient pour prévenir tous les malheurs que l’on prévoyait.