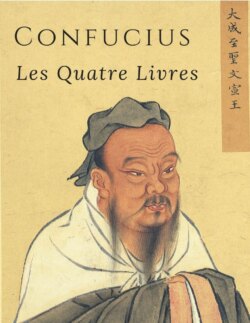Читать книгу Les Quatre Livres de Confucius - Zhongni Confucius - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION.
Оглавление«Toute grande puissance qui apparaît sur la terre y laisse des traces plus ou moins durables de son passage: des pyramides, des arcs de triomphe, des colonnes, des temples, des cathédrales, en portent témoignage à la postérité. Mais les monuments les plus durables, ceux qui exercent la plus puissante influence sur les destinées des nations, ce sont les grandes œuvres de l'intelligence humaine que les siècles produisent de loin en loin, et qui, météores extraordinaires, apparaissent comme des révélations à des points déterminés du temps et de l'espace, pour guider les nations dans les voies providentielles que le genre humain doit parcourir[1].»
C'est un de ces monuments providentiels dont on donne ici la première traduction française faite sur le texte chinois[2].
Dans un moment où l'Orient semble se réveiller de son sommeil séculaire au bruit que font les puissances européennes qui convoitent déjà ses dépouilles, il n'est peut-être pas inutile de faire connaître les œuvres du plus grand philosophe moraliste de cette merveilleuse contrée, dont les souvenirs touchent au berceau du monde, comme elle touche au berceau du soleil. C'est le meilleur moyen de parvenir à l'intelligence de l'un des phénomènes les plus extraordinaires que présente l'histoire du genre humain.
En Orient, comme dans la plupart des contrées du globe, mais en Orient surtout, le sol a été sillonné par de nombreuses révolutions, par des bouleversements qui ont changé la face des empires. De grandes nations, depuis quatre mille ans, ont paru avec éclat sur cette vaste scène du monde. La plupart sont descendues dans la tombe avec les monuments de leur civilisation, ou n'ont laissé que de faibles traces de leur passage: tel est l'ancien empire de Darius, dont l'antique législation nous a été en partie conservée dans les écrits de Zoroastre, et dont on cherche maintenant à retrouver les curieux et importants vestiges dans les inscriptions cunéiformes de Babylone et de Persépolis. Tel est celui des Pharaons, qui, avant de s'ensevelir sous ses éternelles pyramides, avait jeté à la postérité, comme un défi, l'énigme de sa langue figurative, dont le génie moderne, après deux mille ans de tentatives infructueuses, commence enfin à soulever le voile. Mais d'autres nations, contemporaines de ces grands empires, ont résisté, depuis près de quarante siècles, à toutes les révolutions que la nature et l'homme leur ont fait subir. Restées seules debout et immuables quand tout s'écroulait autour d'elles, elles ressemblent à ces rochers escarpés que les flots des mers battent depuis le jour de la création sans pouvoir les ébranler, portant ainsi témoignage de l'impuissance du temps pour détruire ce qui n'est pas une œuvre de l'homme.
En effet, c'est un phénomène, on peut le dire, extraordinaire, que celui de la nation chinoise et de la nation indienne se conservant immobiles, depuis l'origine la plus reculée des sociétés humaines, sur la scène si mobile et si changeante du monde! On dirait que leurs premiers législateurs, saisissant de leurs bras de fer ces nations à leur berceau, leur ont imprimé une forme indélébile, et les ont coulées, pour ainsi dire, dans un moule d'airain, tant l'empreinte a été forte, tant la forme a été durable! Assurément, il y a là quelques vestiges des lois éternelles qui gouvernent le monde.
La civilisation chinoise est, sans aucun doute, la plus ancienne civilisation de la terre. Elle remonte authentiquement, c'est-à-dire par les preuves de l'histoire chinoise[3], jusqu'à deux mille six cents ans avant notre ère. Les documents recueillis dans le Chou-king ou Livre par excellence[4], surtout dans les premiers chapitres, sont les documents les plus anciens de l'histoire des peuples. Il est vrai que le Chou-king fut coordonné par KHOUNG-FOU-TSEU (CONFUCIUS) dans la seconde moitié du sixième siècle avant notre ère[5]; mais ce grand philosophe, qui avait un si profond respect pour l'antiquité, n'altéra point les documents qu'il mit en ordre. D'ailleurs, pour les sinologues, le style de ces documents, qui diffère autant du style moderne que le style des Douze Tables diffère de celui de Cicéron, est une preuve suffisante de leur ancienneté.
Ce qui doit profondément étonner à la lecture de ce beau monument de l'antiquité, c'est la haute raison, le sens éminemment moral qui y respirent. Les auteurs de ce livre, et les personnages dans la bouche desquels sont placés les discours qu'il contient, devaient, à une époque si reculée, posséder une grande culture morale, qu'il serait difficile de surpasser, même de nos jours. Cette grande culture morale, dégagée de tout autre mélange impur que celui de la croyance aux indices des sorts, est un fait très-important pour l'histoire de l'humanité; car, ou cette grande culture morale était le fruit d'une civilisation déjà avancée, ou c'était le produit spontané d'une nature éminemment droite et réfléchie: dans l'un et l'autre cas, le fait n'en est pas moins digne des méditations du philosophe et de l'historien.
Les idées contenues dans le Chou-king sur la Divinité, sur l'influence bienfaisante qu'elle exerce constamment dans les événements du monde, sont très-pures et dignes en tout point de la plus saine philosophie. On y remarqua surtout l'intervention constante du Ciel ou de la Raison suprême dans les relations des princes avec les populations, ou des gouvernants avec les gouvernés; et cette intervention est toujours en faveur de ces derniers, c'est-à-dire du peuple. L'exercice de la souveraineté, qui dans nos sociétés modernes n'est le plus souvent que l'exploitation du plus grand nombre au profit de quelques-uns, n'est, dans le Chou-king, que l'accomplissement religieux d'un mandat céleste au profit de tous, qu'une noble et grande mission confiée au plus dévoué et au plus digne, et qui était retirée dès l'instant que le mandataire manquait à son mandat. Nulle part peut-être les droits et les devoirs respectifs des rois et des peuples, des gouvernants et des gouvernés, n'ont été enseignés d'une manière aussi élevée, aussi digne, aussi conforme à la raison. C'est bien là qu'est constamment mise en pratique cette grande maxime de la démocratie moderne: vox populi, vox Dei, «la voix du peuple est la voix de Dieu.» Cette maxime se manifeste partout, mais on la trouve ainsi formulée à la fin du chapitre Kao-yao-mo, §7 (p. 56 des Livres sacrés de l'Orient):
«Ce que le Ciel voit et entend n'est que ce que le peuple voit et entend. Ce que le peuple juge digne de récompense et de punition est ce que le Ciel veut punir et récompenser. Il y a une communication intime entre le Ciel et le peuple; que ceux qui gouvernent les peuples soient donc attentifs et réservés.» On la trouve aussi formulée de cette manière dans le Ta-hio ou la Grande Étude, ch. X, §5 (page 62 du présent volume):
«Obtiens l'affection du peuple, et tu obtiendras l'empire;
Perds l'affection du peuple, et tu perdras l'empire.»
On ferait plusieurs volumes, si l'on voulait recueillir tous les axiomes semblables qui sont exprimés dans les livres chinois, depuis les plus anciens jusqu'aux plus modernes; et, nous devons le dire, on ne trouverait pas dans tous les écrivains politiques et moraux de la Chine, bien plus nombreux que partout ailleurs, un seul apôtre de la tyrannie et de l'oppression, un seul écrivain qui ait eu l'audace, pour ne pas dire l'impiété, de nier les droits de tous aux dons de Dieu, c'est-à-dire aux avantages qui résultent de la réunion de l'homme en société, et de les revendiquer au profit d'un seul ou d'un petit nombre. Le pouvoir le plus absolu que les écrivains politiques et les moralistes chinois aient reconnu aux chefs du gouvernement n'a jamais été qu'un pouvoir délégué par le Ciel ou la Raison suprême absolue, ne pouvant s'exercer que dans l'intérêt de tous, pour le bien de tous, et jamais dans l'intérêt d'un seul et pour le bien d'un seul. Des limites morales infranchissables sont posées à ce pouvoir absolu; et s'il lui arrivait de les dépasser, d'enfreindre ces lois morales, d'abuser de son mandat, alors, comme l'a dit un célèbre philosophe chinois du douzième siècle de notre ère, TCHOU-HI, dans son Commentaire sur le premier des Quatre Livres classiques de la Chine (voyez chap. X., § 5-6), enseigné dans toutes les écoles et les colléges de l'empire, le peuple serait dégagé de tout respect et de toute obéissance envers ce même pouvoir, qui serait détruit immédiatement, pour faire place à un autre pouvoir légitime, c'est-à-dire s'exerçant uniquement dans les intérêts de tous.
Ces doctrines sont enseignées dans le Chou-king ou le Livre sacré par excellence des Chinois, ainsi que dans les Quatre Livres classiques du grand philosophe KHOUNG-TSEU et de ses disciples, dont nous donnons dans ce volume une traduction complète et aussi littérale que possible. Ces livres, révérés à l'égal des livres les plus révérés dans d'autres parties du monde, et qui ont reçu la sanction de générations et de populations immenses, forment la base du droit public; ils ont été expliqués et commentés par les philosophes et les moralistes les plus célèbres, et ils sont continuellement dans les mains de tous ceux qui, tout en voulant orner leur intelligence, désirent encore posséder la connaissance de ces grandes vérités morales qui font seules la prospérité et la félicité des sociétés humaines.
KHOUNG-FOU-TSEU (que les missionnaires européens, en le faisant connaître et admirer à l'Europe, nommèrent Confucius, en latinisant son nom) fut, non pas le premier, mais le plus grand législateur de la Chine. C'est lui qui recueillit et mit en ordre, dans la seconde moitié du sixième siècle avant notre ère, tous les documents religieux, philosophiques, politiques et moraux qui existaient de son temps, et en forma un corps de doctrines, sous le titre de Y-king, ou Livre sacré des permutations; Chou-king, ou Livre sacré par excellence; Chi-king, ou Livre des Vers; Li-ki, ou Livre des Rites. Les Sse-chou, ou Quatre Livres classiques, sont ses dits et ses maximes recueillis par ses disciples. Si l'on peut juger de la valeur d'un homme et de la puissance de ses doctrines par l'influence qu'elles ont exercée sur les populations, on peut, avec les Chinois, appeler KHOUNG-TSEU le plus grand Instituteur du genre humain que les siècles aient jamais produit!
En effet, il suffit de lire les ouvrages de ce philosophe, composés par lui ou recueillis par ses disciples, pour être de l'avis des Chinois. Jamais la raison humaine n'a été plus dignement représentée. On est vraiment étonné de retrouver dans les écrits de KHOUNG-TSEU l'expression d'une si haute et si vertueuse intelligence, en même temps que celle d'une civilisation aussi avancée. C'est surtout dans le Lûn-yù ou les Entretiens philosophiques que se manifeste la belle âme de KHOUNG-TSEU. Où trouver, en effet, des maximes plus belles, des idées plus nobles et plus élevées que dans les livres dont nous publions la traduction? On ne doit pas être surpris si les missionnaires européens, qui les premiers firent connaître ces écrits à l'Europe, conçurent pour leur auteur un enthousiasme égal à celui des Chinois.
Ses doctrines étaient simples et fondées sur la nature de l'homme. Aussi disait-il à ses disciples: «Ma doctrine est simple et facile à pénétrer[6].» Sur quoi l'un d'eux ajoutait: «La doctrine de notre maître consiste uniquement à posséder la droiture du cœur et à aimer son prochain comme soi-même[7].»
Cette doctrine, il ne la donnait pas comme nouvelle, mais comme un dépôt traditionnel des sages de l'antiquité, qu'il s'était imposé la mission de transmettre à la postérité[8]. Cette mission, il l'accomplit avec courage, avec dignité, avec persévérance, mais non sans éprouver de profonds découragements et de mortelles tristesses. Il faut donc que partout ceux qui se dévouent au bonheur de l'humanité s'attendent à boire le calice d'amertume, le plus souvent jusqu'à la lie, comme s'ils devaient expier par toutes les souffrances humaines les dons supérieurs dont leur âme avait été douée pour accomplir leur mission divine!
Cette mission d'Instituteur du genre humain, le philosophe chinois l'accomplit, disons-nous, dans toute son étendue, et bien autrement qu'aucun philosophe de l'antiquité classique. Sa philosophie ne consistait pas en spéculations plus ou moins vaines, mais c'était une philosophie surtout pratique, qui s'étendait à toutes les conditions de la vie, à tous les rapports de l'existence sociale. Le grand but de cette philosophie, le but pour ainsi dire unique, était l'amélioration constante de soi-même et des autres hommes; de soi-même d'abord, ensuite des autres. L'amélioration ou le perfectionnement de soi-même est d'une nécessité absolue pour arriver à l'amélioration et au perfectionnement des autres. Plus la personne est en évidence, plus elle occupe un rang élevé, plus ses devoirs d'amélioration de soi-même sont grands; aussi KHOUNG-TSEU considérait-il le gouvernement des hommes comme la plus haute et la plus importante mission qui puisse être conférée à un mortel, comme un véritable mandat céleste. L'étude du cœur humain ainsi que l'histoire lui avaient appris que le pouvoir pervertissait les hommes quand ils ne savaient pas se défendre de ses prestiges, que ses tendances permanentes étaient d'abuser de sa force et d'arriver à l'oppression. C'est ce qui donne aux écrits du philosophe chinois, comme à tous ceux de sa grande école, un caractère si éminemment politique et moral. La vie de KHOUNG-TSEU se consume en cherchant à donner des enseignements aux princes de son temps, à leur faire connaître leurs devoirs ainsi que la mission dont ils sont chargés pour gouverner les peuples et les rendre heureux. On le voit constamment plus occupé de prémunir les peuples contre les passions et la tyrannie des rois que les rois contre les passions et la turbulence des peuples; non pas qu'il regardât les derniers comme ayant moins besoin de connaître leurs devoirs et de les remplir, mais parce qu'il considérait les rois comme seuls responsables du bien et du mal qui arrivaient dans l'empire, de la prospérité ou de la misère des populations qui leur étaient confiées. Il attachait à l'exercice de la souveraineté des devoirs si étendus et si obligatoires, une influence si vaste et si puissante, qu'il ne croyait pas pouvoir trop éclairer ceux qui en étaient revêtus des devoirs qu'ils avaient à remplir pour accomplir convenablement leur mandat. C'est ce qui lui faisait dire: «Gouverner son pays avec la vertu et la capacité nécessaires, c'est ressembler à l'étoile polaire, qui demeure immobile à sa place, tandis que toutes les autres étoiles circulent autour d'elle et la prennent pour guide[9].»
Il avait une foi si vive dans l'efficacité des doctrines qu'il enseignait aux princes de son temps, qu'il disait:
«Si je possédais le mandat de la royauté, il ne me faudrait pas plus d'une génération pour faire régner partout la vertu de l'humanité[10].»
Quoique la politique du premier philosophe et législateur chinois soit essentiellement démocratique, c'est-à-dire ayant pour but la culture morale et la félicité du peuple, il ne faudrait pas cependant prendre ce mot dans l'acception qu'on lui donne habituellement. Rien ne s'éloigne peut-être plus de la conception moderne d'un gouvernement démocratique que la conception politique du philosophe chinois. Chez ce dernier, les lois morales et politiques qui doivent régir le genre humain sous le triple rapport de l'homme considéré dans sa nature d'être moral perfectible, dans ses relations de famille, et comme membre de la société, sont des lois éternelles, immuables, expression vraie de la véritable nature de l'homme, en harmonie avec toutes les lois du monde visible, transmises et enseignées par des hommes qui étaient eux-mêmes la plus haute expression de la nature morale de l'homme, soit qu'ils aient dû cette perfection à une faveur spéciale du ciel, soit qu'ils l'aient acquise par leurs propres efforts pour s'améliorer et se rendre dignes de devenir les instituteurs du genre humain. Dans tous les cas, ces lois ne pouvaient être parfaitement connues et enseignées que par un très-petit nombre d'hommes, arrivés à la plus haute culture morale de l'intelligence à laquelle il soit donné à la nature humaine d'atteindre, et qui aient dévoué leur vie tout entière et sans réserve à la mission noble et sainte de l'enseignement politique pour le bonheur de l'humanité. C'est donc la réalisation des lois morales et politiques qui peuvent constituer véritablement la société et assurer la félicité publique, lois conçues et enseignées par un petit nombre au profit de tous; tandis que, dans la conception politique moderne d'un gouvernement démocratique, la connaissance des lois morales et politiques qui constituent la société et doivent assurer la félicité publique est supposée dans chaque individu dont se compose cette société, quel que soit son degré de culture morale et intellectuelle; de sorte que, dans cette dernière conception, il arrive le plus souvent que celui qui n'a pas même les lumières nécessaires pour distinguer le juste de l'injuste, dont l'éducation morale et intellectuelle est encore entièrement à faire, ou même dont les penchants vicieux sont les seuls mobiles de sa conduite, est appelé, surtout si sa fortune le lui permet, à donner des lois à celui dont la culture morale et intellectuelle est le plus développée, et dont la mission devrait être l'enseignement de cette même société, régie par les intelligences les plus nombreuses, il est vrai, mais aussi souvent les moins faites pour cette haute mission.
Selon KHOUNG-TSEU, le gouvernement est ce qui est juste et droit[11]. C'est la réalisation des lois éternelles qui doivent faire le bonheur de l'humanité, et que les plus hautes intelligences, par une application incessante de tous les instants de leur vie, sont seules capables de connaître et d'enseigner aux hommes. Au contraire, le gouvernement, dans la conception moderne, n'est plus qu'un acte à la portée de tout le monde, auquel tout le monde veut prendre part, comme à la chose la plus triviale et la plus vulgaire, et à laquelle on n'a pas besoin d'être préparé par le moindre travail intellectuel et moral.
Pour faire mieux comprendre les doctrines morales et politiques du philosophe chinois, nous pensons qu'il ne sera pas inutile de présenter ici un court aperçu des Quatre Livres classiques dont nous donnons la traduction.
1° LE TA-HIO ou LA GRANDE ÉTUDE. Ce petit ouvrage se compose d'un texte attribué à KHOUNG-TSEU, et d'une Exposition faite par son disciple Thseng-tseu. Le texte, proprement dit, est fort court. Il est nommé King ou Livre par excellence; mais tel qu'il est, cependant, c'est peut-être, sous le rapport de l'art de raisonner, le plus précieux de tous les écrits de l'ancien philosophe chinois, parce qu'il offre au plus haut degré l'emploi d'une méthode logique, qui décèle dans celui qui en fait usage, sinon la connaissance des procédés syllogistiques les plus profonds, enseignés et mis en usage par les philosophes indiens et grecs, au moins les progrès d'une philosophie qui n'est plus bornée à l'expression aphoristique des idées morales, mais qui est déjà passée à l'état scientifique. L'art est ici trop évident pour que l'on puisse attribuer l'ordre et l'enchaînement logique des propositions à la méthode naturelle d'un esprit droit qui n'aurait pas encore eu conscience d'elle-même. On peut donc établir que l'argument nommé sorite était déjà connu en Chine environ deux siècles avant Aristote, quoique les lois n'en aient peut-être jamais été formulées dans cette contrée par des traités spéciaux[12].
Toute la doctrine de ce premier traité repose sur un grand principe auquel tous les autres se rattachent et dont ils découlent comme de leur source primitive et naturelle: le perfectionnement de soi-même. Ce principe fondamental, le philosophe chinois le déclare obligatoire pour tous les hommes, depuis celui qui est le plus élevé et le plus puissant jusqu'au plus obscur et au plus faible; et il établit que négliger ce grand devoir, c'est se mettre dans l'impossibilité d'arriver à aucun autre perfectionnement moral.
Après avoir lu ce petit traité, on demeure convaincu que le but du philosophe chinois a été d'enseigner les devoirs du gouvernement politique comme ceux du perfectionnement de soi-même et de la pratique de la vertu par tous les hommes.
2° LE TCHOUNG-YOUNG, OU L'INVARIABILITÉ DANS LE MILIEU. Le titre de cet ouvrage a été interprété de diverses manières par les commentateurs chinois. Les uns l'ont entendu comme signifiant la persévérance de la conduite dans une ligne droite également éloignée des extrêmes, c'est-à-dire dans la voie de la vérité que l'on doit constamment suivre; les autres l'ont considéré comme signifiant tenir le milieu en se conformant aux temps et aux circonstances, ce qui nous paraît contraire à la doctrine exprimée dans ce livre, qui est d'une nature aussi métaphysique que morale. Tseu-sse, qui le rédigea, était petit-fils et disciple de KHOUNG-TSEU. On voit, à la lecture de ce traité, que Tseu-sse voulut exposer les principes métaphysiques des doctrines de son maître, et montrer que ces doctrines n'étaient pas de simples préceptes dogmatiques puisés dans le sentiment et la raison, et qui seraient par conséquent plus ou moins obligatoires selon la manière de sentir et de raisonner, mais bien des principes métaphysiques fondés sur la nature de l'homme et les lois éternelles du monde. Ce caractère élevé, qui domine tout le Tchoung-young, et que des écrivains modernes, d'un mérite supérieur d'ailleurs[13], n'ont pas voulu reconnaître dans les écrits des philosophes chinois, place ce traité de morale métaphysique au premier rang des écrits de ce genre que nous a légués l'antiquité. On peut certainement le mettre à côté, sinon au-dessus de tout ce que la philosophie ancienne nous a laissé de plus élevé et de plus pur. On sera même frappé, en le lisant, de l'analogie qu'il présente, sous certains rapports, avec les doctrines morales de la philosophie stoïque enseignées par Épictète et Marc-Aurèle, en même temps qu'avec la métaphysique d'Aristote.
On peut se former une idée de son contenu par l'analyse sommaire que nous allons en donner d'après les commentateurs chinois.
Dans le premier chapitre, Tseu-sse expose les idées principales de la doctrine de son maître KHOUNG-TSEU, qu'il veut transmettre à la postérité. D'abord il fait voir que la voie droite, ou la règle de conduite morale, qui oblige tous les hommes, a sa base fondamentale dans le ciel, d'où elle tire son origine, et qu'elle ne peut changer; que sa substance véritable, son essence propre, existe complètement en nous, et qu'elle ne peut en être séparée; secondement, il parle du devoir de conserver cette règle de conduite morale, de l'entretenir, de l'avoir sans cesse sous les yeux; enfin il dit que les saints hommes, ceux qui approchent le plus de l'intelligence divine, type parfait de notre imparfaite intelligence, l'ont portée par leurs œuvres à son dernier degré de perfection.
Dans les dix chapitres qui suivent, Tseu-sse ne fait, pour ainsi dire, que des citations de paroles de son maître destinées à corroborer et à compléter les sens du premier chapitre. Le grand but de cette partie du livre est de montrer que la prudence éclairée, l'humanité ou la bienveillance universelle pour les hommes, la force d'âme, ces trois vertus universelles et capitales, sont comme la porte par laquelle on doit entrer dans la voie droite que doivent suivre tous les hommes; c'est pourquoi ces vertus ont été traitées dans la première partie de l'ouvrage (qui comprend les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11).
Dans le douzième chapitre, Tseu-sse cherche à expliquer le sens de cette expression du premier chapitre, où il est dit que la voie droite ou la règle de conduite morale de l'homme est tellement obligatoire, que l'on ne peut s'en écarter d'un seul point un seul instant. Dans les huit chapitres qui suivent, Tseu-sse cite sans ordre les paroles de son maître KHOUNG-TSEU pour éclaircir le même sujet.
Toute morale qui n'aurait pas pour but le perfectionnement de la nature humaine serait une morale incomplète et passagère. Aussi le disciple de KHOUNG-TSEU, qui veut enseigner la loi éternelle et immuable d'après laquelle les actions des hommes doivent être dirigées, établit, dans le vingtième chapitre, que la loi suprême, la loi de conduite morale de l'homme qui renferme toutes les autres, est la perfection. «Il y a un principe certain, dit-il, pour reconnaître l'état de perfection. Celui qui ne sait pas distinguer le bien du mal, le vrai du faux, qui ne sait pas reconnaître dans l'homme le mandat du ciel, n'est pas encore arrivé à la perfection.»
Selon le philosophe chinois, le parfait, le vrai, dégagé de tout mélange, est la loi du ciel; la perfection ou le perfectionnement, qui consiste à employer tous ses efforts pour découvrir et suivre la loi céleste, le vrai principe du mandat du ciel, est la loi de l'homme. Par conséquent, il faut que l'homme atteigne la perfection pour accomplir sa propre loi.
Mais, pour que l'homme puisse accomplir sa loi, il faut qu'il la connaisse. «Or, dit Tseu-sse (chap. XXII), il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent connaître à fond leur propre nature, la loi de leur être et les devoirs qui en dérivent; pouvant connaître à fond la loi de leur être et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent, par cela même, connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner tous les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel.» Voilà les hommes parfaits, les saints, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la perfection, constitués les instituteurs des autres hommes, les seuls capables de leur enseigner leurs devoirs et de les diriger dans la droite voie, la voie de la perfection morale. Mais Tseu-sse ne borne point là les facultés de ceux qui sont parvenus à la perfection. Suivant le procédé logique que nous avons signalé précédemment, il montre que les hommes arrivés à la perfection développent leurs facultés jusqu'à leur plus haute puissance, s'assimilent aux pouvoirs supérieurs de la nature, et s'absorbent finalement en eux. «Pouvant connaître à fond, ajoute-t-il, la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent, par cela même, connaître à fond la nature des autres êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature; pouvant connaître à fond la nature des êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature, ils peuvent, par cela même, au moyen de leurs facultés intelligentes supérieures, aider le «ciel et la terre dans la transformation et l'entretien des êtres, pour qu'ils prennent leur complet développement; pouvant aider le ciel et la terre dans la transformation et l'entretien des êtres, ils peuvent, par cela même, constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre.» Voilà la loi du ciel.
Mais, selon Tseu-sse (chap. XXIII-XXIV), il y a différents degrés de perfection. Le plus haut degré est à peine compatible avec la nature humaine, ou plutôt ceux qui l'ont atteint sont devenus supérieurs à la nature humaine. Ils peuvent prévoir l'avenir, la destinée des nations, leur élévation et leur chute, et ils sont assimilés aux intelligences immatérielles, aux êtres supérieurs à l'homme. Cependant ceux qui atteignent un degré de perfection moins élevé, plus accessible à la nature de l'homme (chap. XXIII), opèrent un grand bien dans le monde par la salutaire influence de leurs bons exemples. On doit donc s'efforcer d'atteindre à ce second degré de perfection.
«Le parfait (chap. XXV) est par lui-même parfait, absolu; la loi du devoir est par elle-même loi du devoir.
Le parfait est le commencement et la fin de tous les êtres; sans le parfait, les êtres ne seraient pas.» C'est pourquoi Tseu-sse place le perfectionnement de soi-même et des autres au premier rang des devoirs de l'homme. «Réunir le perfectionnement intérieur et le perfectionnement extérieur constitue la règle du devoir.»
«C'est pour cela, dit-il (chap. XXVI), que l'homme souverainement parfait ne cesse jamais d'opérer le bien et de travailler au perfectionnement des autres hommes.» Ici le philosophe chinois exalte tellement la puissance de l'homme parvenu à la perfection, qu'il l'assimile à celle du ciel et de la terre (chap. XXVI et XXVII). C'est un caractère propre à la philosophie de l'Orient[14], et que l'on ne retrouve point dans la philosophie de l'antiquité classique, d'attribuer à l'homme parvenu à la perfection philosophique des pouvoirs surnaturels qui le placent au rang des puissances surhumaines.
Tseu-sse, dans le vingt-neuvième chapitre de son livre, est amené, par la méthode de déduction, à établir que les lois qui doivent régir un empire ne peuvent pas être proposées par des sages qui ne seraient pas revêtus de la dignité souveraine, parce qu'autrement, quoique excellentes, elles n'obtiendraient pas du peuple le respect nécessaire à leur sanction, et ne seraient point observées. Il en conclut que cette haute mission est réservée au souverain, qui doit établir ses lois selon les lois du ciel et de la terre, et d'après les inspirations des intelligences supérieures. Mais voyez à quelle rare et sublime condition il accorde le droit de donner des institutions aux hommes et de leur commander! «Il n'y a dans l'univers (chap. XXXI) que l'homme souverainement saint qui, par la faculté de connaître à fond et de comprendre parfaitement les lois primitives des êtres vivants, soit digne de posséder l'autorité souveraine et de commander aux hommes; qui, par sa faculté d'avoir une âme grande, magnanime, affable et douce, soit capable de posséder le pouvoir de répandre des bienfaits avec profusion; qui, par sa faculté d'avoir une âme élevée, ferme, imperturbable et constante, soit capable de faire régner la justice et l'équité; qui, par sa faculté d'être toujours honnête, simple, grave, droit et juste, soit capable de s'attirer le respect et la vénération; qui, par sa faculté d'être revêtu des ornements de l'esprit et des talents que donne une étude assidue, et de ces lumières que procure une exacte investigation des choses les plus cachées, des principes les plus subtils, soit capable de discerner avec exactitude le vrai du faux, le bien du mal.»
Il ajoute: «Que cet homme souverainement saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, et les peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur vénération; qu'il parle, et les peuples ne manqueront pas d'avoir foi en ses paroles; qu'il agisse, et les peuples ne manqueront pas d'être dans la joie.... Partout où les vaisseaux et les chars peuvent parvenir, où les forces de l'industrie humaine peuvent faire pénétrer, dans tous les lieux que le ciel couvre de son dais immense, sur tous les points que la terre enserre, que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons, que la rosée et les nuages du matin fertilisent, tous les êtres humains qui vivent et qui respirent ne peuvent manquer de l'aimer et de le révérer.»
Mais ce n'est pas tout d'être souverainement saint, pour donner des lois aux peuples et pour les gouverner, il faut encore être souverainement parfait (chap. XXXII), pour pouvoir distinguer et fixer les devoirs des hommes entre eux. La loi de l'homme souverainement parfait ne peut être connue que par l'homme souverainement saint; la vertu de l'homme souverainement saint ne peut être pratiquée que par l'homme souverainement parfait; il faut donc être l'un et l'autre pour être digne de posséder l'autorité souveraine.
3° Le LUN-YU, ou les ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES. La lecture de ces Entretiens philosophiques de KHOUNG-TSEU et de ses disciples rappelle, sous quelques rapports, les dialogues de Platon, dans lesquels Socrate, son maître, occupe le premier plan, mais avec toute la différence des lieux et des civilisations. Il y a assurément beaucoup moins d'art, si toutefois il y a de l'art, dans les entretiens du philosophe chinois, recueillis par quelques-uns de ses disciples, que dans les dialogues poétiques du philosophe grec. On pourrait plutôt comparer les dits de KHOUNG-TSEU à ceux de Socrate, recueillis par son autre disciple Xénophon. Quoi qu'il en soit, l'impression que l'on éprouve à la lecture des Entretiens du philosophe chinois avec ses disciples n'en est pas moins grande et moins profonde, quoiqu'un peu monotone peut-être. Mais cette monotonie même a quelque chose de la sérénité et de la majesté d'un enseignement moral qui fait passer successivement sous les yeux les divers côtés de la nature humaine en la contemplant d'une région supérieure. Et après cette lecture on peut se dire comme le philosophe chinois: «Celui qui se livre à l'étude du vrai et du bien, qui s'y applique avec persévérance et sans relâche, n'en éprouve-t-il pas une grande satisfaction[15]?»
On peut dire que c'est dans ces Entretiens philosophiques que se révèle à nous toute la belle âme de KHOUNG-TSEU, sa passion pour la vertu, son ardent amour de l'humanité et du bonheur des hommes. Aucun sentiment de vanité ou d'orgueil, de menace ou de crainte, ne ternit la pureté et l'autorité de ses paroles: «Je ne naquis point doué de la science, dit-il; je suis un homme qui a aimé les anciens et qui a fait tous ses efforts pour acquérir leurs connaissances[16].»
«Il était complètement exempt de quatre choses, disent ses disciples: il était sans amour-propre, sans préjugés, sans égoïsme et sans obstination[17].»
L'étude, c'est-à-dire la recherche du bien, du vrai, de la vertu, était pour lui le plus grand moyen de perfectionnement. «J'ai passé, disait-il, des journées entières sans nourriture, et des nuits entières sans sommeil, pour me livrer à la méditation, et cela sans utilité réelle: l'étude est bien préférable.»
Il ajoutait: «L'homme supérieur ne s'occupe que de la droite voie, et non du boire et du manger. Si vous cultivez la terre, la faim se trouve souvent au milieu de vous; si vous étudiez, la félicité se trouve dans le sein même de l'étude. L'homme supérieur ne s'inquiète que de ne pas atteindre la droite voie; il ne s'inquiète pas de la pauvreté[18].»
Avec quelle admiration il parle de l'un de ses disciples, qui, au sein de toutes les privations, ne s'en livrait pas moins avec persévérance à l'étude de la sagesse!
«Oh! qu'il était sage Hoeï! Il avait un vase de bambou pour prendre sa nourriture, une simple coupe pour boire, et il demeurait dans l'humble réduit d'une rue étroite et abandonnée; un autre homme que lui n'aurait pu supporter ses privations et ses souffrances. Cela ne changeait pas cependant la sérénité de Hoeï! Oh! qu'il était sage Hoeï[19]!»
S'il savait honorer la pauvreté, il savait aussi flétrir énergiquement la vie matérielle, oisive et inutile. «Ceux qui ne font que boire et que manger, disait-il, pendant toute la journée, sans employer leur intelligence à quelque objet digne d'elle, font pitié. N'y a-t-il pas le métier de bateleur? Qu'ils le pratiquent; ils seront des sages en comparaison[20]!»
C'est une question résolue souvent par l'affirmative, que les anciens philosophes grecs avaient eu deux doctrines, l'une publique et l'autre secrète; l'une pour le vulgaire (profanum vulgus), et l'autre pour les initiés. La même question ne peut s'élever à l'égard de KHOUNG-TSEU; car il déclare positivement qu'il n'a point de doctrine secrète. «Vous, mes disciples, tous tant que vous êtes, croyez-vous que j'aie pour vous des doctrines cachées? Je n'ai point de doctrines cachées pour vous. Je n'ai rien fait que je ne vous l'aie communiqué, ô mes disciples! C'est la manière d'agir de Khieou (de lui-même[21]).»
Il serait très-difficile de donner une idée sommaire du Lûn-yù, à cause de la nature de l'ouvrage, qui présente, non pas un traité systématique sur un ou plusieurs sujets, mais des réflexions amenées à peu près sans ordre sur toutes sortes de sujets. Voici ce qu'a dit un célèbre commentateur chinois du Lûn-yù et des autres livres classiques, Tching-tseu, qui vivait sur la fin du onzième siècle de notre ère:
«Le Lûn-yù est un livre dans lequel sont déposées les paroles destinées à transmettre la doctrine de la raison; doctrine qui a été l'objet de l'étude persévérante des hommes qui ont atteint le plus haut degré de sainteté.... Si l'on demande quel est le but du Lûn-yù, je répondrai: Le but du Lûn-yù consiste à faire connaître la vertu de l'humanité ou de la bienveillance universelle pour les hommes; c'est le point principal des discours de KHOUNG-TSEU. Il y enseigne les devoirs de tous; seulement, comme ses disciples n'avaient pas les mêmes moyens pour arriver aux mêmes résultats (ou à la pratique des devoirs qu'ils devaient remplir), il répond diversement à leurs questions.» Le Lûn-yù est divisé en deux livres, formant ensemble vingt chapitres. Il y eut, selon les commentateurs chinois, trois copies manuscrites du Lûn-yù; l'une conservée par les hommes instruits de la province de Thsi; l'autre par ceux de Lou, la province natale de KHOUNG-TSEU, et la troisième fut trouvée cachée dans un mur après l'incendie des livres: cette dernière copie fut nommée Kou-lûn, c'est-à-dire l'Ancien Lûn. La copie de Thsi comprenait vingt-deux chapitres; l'ancienne copie (Kou-lûn), vingt et un; et la copie de Lou, celle qui est maintenant suivie, vingt. Les deux chapitres en plus de la copie de Thsi ont été perdus; le chapitre en plus de l'ancienne copie vient seulement d'une division différente de la même matière.
4° MENG-TSEU. Ce quatrième des livres classiques porte le nom de son auteur, qui est placé par les Chinois immédiatement après KHOUNG-TSEU, dont il a exposé et développé les doctrines. Plus vif, plus pétulant que ce dernier, pour lequel il avait la plus haute admiration, et qu'il regardait comme le plus grand instituteur du genre humain que les siècles aient jamais produit, il disait: «Depuis qu'il existe des hommes, il n'y en a jamais eu de comparables à KHOUNG-TSEU[22].» A l'exemple de ce grand maître, il voyagea avec ses disciples (il en avait dix-sept) dans les différents petits États de la Chine, se rendant à la cour des princes, avec lesquels il philosophait et auxquels il donnait souvent des leçons de politique et de sagesse dont ils ne profilaient pas toujours. Comme KHOUNG-TSEU (ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs[23]), il avait pour but le bonheur de ses compatriotes et de l'humanité tout entière. En communiquant la connaissance de ses principes d'abord aux princes et aux hommes qui occupaient un rang élevé dans la société, et ensuite à un grand nombre de disciples que sa renommée attirait autour de lui, il s'efforçait de propager le plus possible ces mêmes doctrines au sein de la multitude, et d'inculquer dans l'esprit des grands, des princes, que la stabilité de leur puissance dépendait uniquement de l'amour et de l'affection qu'ils auraient pour leurs peuples. Sa politique parait avoir eu une expression plus décidée et plus hardie que celle de son maître. En s'efforçant de faire comprendre aux gouvernants et aux gouvernés leurs devoirs réciproques, il tendait à soumettre tout l'empire chinois à la domination de ses principes. D'un côté il enseignait aux peuples le droit divin que les rois avaient à régner, et de l'autre il enseignait aux rois que c'était leur devoir de consulter les désirs du peuple, et de mettre un frein à l'exercice de leur tyrannie; en un mot, de se rendre le père et la mère du peuple. MENG-TSEU était un homme de principes indépendants, et, contrôle vivant et incorruptible du pouvoir, il ne laissait jamais passer un acte d'oppression, dans les États avec lesquels il avait des relations, sans le blâmer sévèrement.
MENG-TSEU possédait une connaissance profonde du cœur humain, et il a déployé dans son ouvrage une grande souplesse de talent, une grande habileté à découvrir les mesures arbitraires des princes régnants et les abus des fonctionnaires publics. Sa manière de philosopher est celle de Socrate et de Platon, mais avec plus de vigueur et de saillies spirituelles. Il prend son adversaire, quel qu'il soit, prince ou autre, corps à corps, et, de déduction en déduction, de conséquence en conséquence, il le mène droit à la sottise ou à l'absurde. Il le serre de si près, qu'il ne peut lui échapper. Aucun écrivain oriental ne pourrait peut-être offrir plus d'attraits à un lecteur européen, surtout à un lecteur français, que MENG-TSEU, parce que (ceci n'est pas un paradoxe) ce qu'il y a de plus saillant en lui, quoique Chinois, c'est la vivacité de son esprit. Il manie parfaitement l'ironie, et cette arme, dans ses mains, est plus dangereuse et plus aiguë que dans celles du sage Socrate.
Voici ce que dit un écrivain chinois du livre de MENG-TSEU: «Les sujets traités dans cet ouvrage sont de diverses natures. Ici, les vertus de la vie individuelle et de parenté sont examinées; là, l'ordre des affaires est discuté. Ici, les devoirs des supérieurs, depuis le souverain jusqu'au magistrat du dernier degré, sont prescrits pour l'exercice d'un bon gouvernement; là, les travaux des étudiants, des laboureurs, des artisans, des négociants, sont exposés aux regards; et, dans le cours de l'ouvrage, les lois du monde physique, du ciel, de la terre et des montagnes, des rivières, des oiseaux, des quadrupèdes, des poissons, des insectes, des plantes, des arbres, sont occasionnellement décrites. Bon nombre des affaires que MENG-TSEU traita dans le cours de sa vie, dans son commerce avec les hommes; ses discours d'occasion avec des personnes de tous rangs; ses instructions à ses élèves; ses vues ainsi que ses explications des livres anciens et modernes, toutes ces choses sont incorporées dans cette publication. Il rappelle aussi les faits historiques, les dits des anciens sages pour l'instruction de l'humanité.»
M. Abel Rémusat a ainsi caractérisé les deux plus célèbres philosophes de la Chine:
«Le style de MENG-TSEU, moins élevé et moins concis que celui du prince des lettres (KOUNG-TSEU), est aussi noble, plus fleuri et plus élégant. La forme du dialogue, qu'il a conservée à ses entretiens philosophiques avec les grands personnages de son temps, comporte plus de variété qu'on ne peut s'attendre à en trouver dans les apophthegmes et les maximes de Confucius. Le caractère de leur philosophie diffère aussi sensiblement. Confucius est toujours grave, même austère; il exalte les gens de bien, dont il fait un portrait idéal, et ne parle des hommes vicieux qu'avec une froide indignation. Meng-tseu, avec le même amour pour la vertu, semble avoir pour le vice plus de mépris que d'horreur; il l'attaque par la force de la raison, et ne dédaigne pas même l'arme du ridicule. Sa manière d'argumenter se rapproche de cette ironie qu'on attribue à Socrate. Il ne conteste rien à ses adversaires; mais, en leur accordant leurs principes, il s'attache à en tirer des conséquences absurdes qui les couvrent de confusion. Il ne ménage même pas les grands et les princes de son temps, qui souvent ne feignaient de le consulter que pour avoir occasion de vanter leur conduite, ou pour obtenir de lui les éloges qu'ils croyaient mériter. Rien de plus piquant que les réponses qu'il leur fait en ces occasions; rien surtout de plus opposé à ce caractère servile et bas qu'un préjugé trop répandu prête aux Orientaux, et aux Chinois en particulier. Meng-tseu ne ressemble en rien à Aristippe: c'est plutôt à Diogène, mais avec plus de dignité et de décence. On est quelquefois tenté de blâmer sa vivacité, qui tient de l'aigreur; mais on l'excuse en le voyant toujours inspiré par le zèle du bien public[24].»
Quel que soit le jugement que l'on porte sur les deux plus célèbres philosophes de la Chine et sur leurs ouvrages, dont nous donnons la traduction dans ce volume, il n'en restera pas moins vrai qu'ils méritent au plus haut degré l'attention du philosophe et de l'historien, et qu'ils doivent occuper un des premiers rangs parmi les plus rares génies qui ont éclairé l'humanité et l'ont guidée dans le chemin de la civilisation. Bien plus, nous pensons que l'on ne trouverait pas dans l'histoire du monde une figure à opposer à celle du grand philosophe chinois, pour l'influence si longue et si puissante que ses doctrines et ses écrits ont exercée sur ce vaste empire qu'il a illustré par sa sagesse et son génie. Et tandis que les autres nations de la terre élevaient de toutes parts des temples à des êtres inintelligents ou à des dieux imaginaires, la nation chinoise en élevait à l'apôtre de la sagesse et de l'humanité, de la morale et de la vertu; au grand missionnaire de l'intelligence humaine, dont les enseignements se soutiennent depuis plus de deux mille ans, et se concilient maintenant l'admiration et l'amour de plus de trois cents millions d'âmes[25].
Avant que de terminer, nous devons dire que ce n'est pas le désir d'une vaine gloire qui nous a fait entreprendre la traduction dont nous donnons aujourd'hui une édition nouvelle[26], mais bien l'espérance de faire partager aux personnes qui la liront une partie des impressions morales que nous avons éprouvées nous-même en la composant. Oh! c'est assurément une des plus douces et des plus nobles impressions de l'âme que la contemplation de cet enseignement si lointain et si pur, dont l'humanité, quel que soit son prétendu progrès dans la civilisation, a droit de s'enorgueillir. On ne peut lire les ouvrages des deux premiers philosophes chinois sans se sentir meilleur, ou du moins sans se sentir raffermi dans les principes du vrai comme dans la pratique du bien, et sans avoir une plus haute idée de la dignité de notre nature. Dans un temps où le sentiment moral semble se corrompre et se perdre, et la société marcher aveuglement dans la voie des seuls instincts matériels, il ne sera peut-être pas inutile de répéter les enseignements de haute et divine raison que le plus grand philosophe de l'antiquité orientale a donnés au monde. Nous serons assez récompensé des peines que notre traduction nous a coûtées, si nous avons atteint le but que nous nous sommes proposé en la composant.
G. PAUTHIER.
[1] Avertissement de la traduction française que nous avons donnée en 1837 du Ta-hio ou de la Grande Étude, avec une version latine et le texte chinois en regard, accompagné du commentaire complet du Tchou-hi et de notes tirées des divers autres commentateurs chinois. Gr. in-8°.
[2] Voyez la note [26] ci-après.
[3] On peut consulter à ce sujet notre Description historique, géographique et littéraire de la Chine, t. I, p. 32 et suiv. F. Didot frères, 1857.
[4] Voyez la traduction de ce livre dans les Livres sacrés de l'Orient que nous avons publiés chez MM. F. Didot, en un fort vol. in-8° à deux colonnes, d'où la traduction que nous donnons ici des Quatre Livres a été tirée.
[5] Voyez la Préface du P. Gaubil, pag. 1 et suiv.
[6] Lun-yu, chap. IV, §5.
[7] Id., §16.
[8] Id., chap. VII, §1, 19.
[9] Lun-yu, chap. II, §1.
[10] Id., chap. XIII, §12.
[11] Lun-yu, chap. XII, §17.
[12] Voyez l'Argument philosophique de l'édition chinoise-latine et française que nous avons donnée de cet ouvrage. Paris, 1837, grand in-8°.
[13] Voyez les Histoires de la philosophie ancienne de Hegel et de H. Ritter.
[14] Voyez aussi notre traduction des Essais de Colebrooke sur la Philosophie des Hindous, un vol. in-8°.
[15] Lun-yu, chap. I, §1.
[16] Lun-yu, chap. V, §19.
[17] Id., chap. IX, §.
[18] Id., chap. XV, §30 et 31.
[19] Lun-yu, chap. VI, §9.
[20] Id., chap. XVII, §22.
[21] Lun-yu, chap. VI, §23.
[22] Meng-tseu, chap. III, pag. 249 de notre traduction. Ce témoignage est corroboré dans Meng-tseu par celui de trois des plus illustres disciples du philosophe, que Meng-tseu rapporte au même endroit.
[23] Description de la Chine, t. I, pag. 187.
[24] Vie de Meng-tseu. Nouv. Mélanges asiatiques, t. II, pag. 119.
[25] Nous renvoyons, pour les détails biographiques que l'on pourrait désirer sur KHOUNG-TSEU et MENG-TSEU, à notre Description de la Chine déjà citée, t. 1, pag. 120 et suiv., où l'on trouvera aussi le portrait de ces deux philosophes.
[26] La traduction que nous publions des Quatre Livres classiques de la Chine est la première traduction française qui ait été faite sur le texte chinois, excepté toutefois les deux premiers livres: le Ta-hio ou la Grande Étude, et le Tchoung-young ou l'Invariabilité dans le milieu, qui avalent déjà été traduits en français par quelques missionnaires (Mémoires sur les Chinois, t. I, p. 436-481) et par M. A. Rémusat (Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, t. X, pag. 269 et suiv.). La traduction des missionnaires n'est qu'une longue paraphrase enthousiaste dans laquelle on reconnaît à peine le texte original. Celle du Tchoung-young de M. Rémusat, qui est accompagnée du texte chinois et d'une version latine, est de beaucoup préférable. La traduction française de l'abbé Pluquet, publiée en 1784, sous le titre de: Les Livres classiques de l'empire de la Chine, a été faite sur la traduction latine du P. Noël, publiée à Prague, en 1711, sous ce titre: Sinensis imperii libri classici sex. Nous avons cru inutile de la consulter pour faire notre propre traduction, attendu que nous nous sommes constamment efforcé de nous appuyer uniquement sur le texte et les commentaires chinois. (Voyez, pour plus de détails, les Livres sacrés de l'Orient, p. XXVIII.)
LES SSE CHOU,
OU
LES QUATRE LIVRES DE PHILOSOPHIE
MORALE ET POLITIQUE
DE LA CHINE.
LE TA HIO,
OU
LA GRANDE ÉTUDE,
OUVRAGE DE
KHOUNG-FOU-TSEU (CONFUCIUS)
ET DE SON DISCIPLE THSÊNG-TSEU.