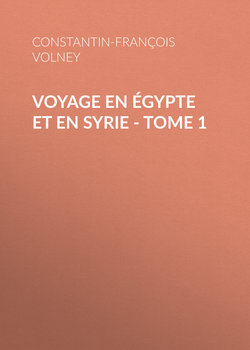Читать книгу Voyage en Égypte et en Syrie - Tome 1 - Constantin-François Volney - Страница 2
ÉTAT PHYSIQUE DE L'ÉGYPTE CHAPITRE II. Du Nil, et de l'extension du Delta
ОглавлениеTOUT l'existence physique et politique de l'Égypte dépend du Nil: lui seul subvient à ce premier besoin des êtres organisés, le besoin de l'eau, si fréquemment senti dans les climats chauds, si vivement irrité par la privation de cet élément. Le Nil seul, sans le secours d'un ciel avare de pluie, porte partout l'aliment de la végétation; par un séjour de trois mois sur la terre, il l'imbibe d'une somme d'eau capable de lui suffire le reste de l'année. Sans son débordement, on ne pourrait cultiver qu'un terrain très-borné, et avec des soins très-dispendieux; et l'on a raison de dire qu'il est la mesure de l'abondance, de la prospérité, de la vie. Si le Portugais Albukerque eût pu exécuter son projet de le dériver de l'Éthiopie dans la mer Rouge, cette contrée si riche ne serait qu'un désert aussi sauvage que les solitudes qui l'environnent. A voir l'usage que l'homme fait de ses forces, doit-on reprocher à la nature de ne lui en avoir pas accordé davantage?
C'est donc à juste titre que les Égyptiens ont eu dans tous les temps, et conservent même de nos jours, un respect religieux pour le Nil10; mais il faut pardonner à un Européen, si, lorsqu'il les entend vanter la beauté de ses eaux, il sourit de leur ignorance. Jamais ces eaux troubles et fangeuses n'auront pour lui le charme des claires fontaines et des ruisseaux limpides; jamais, à moins d'un sentiment exalté par la privation, le corps d'une Égyptienne, hâlé et ruisselant d'une eau jaunâtre, ne lui rappellera les Naïades sortant du bain. Six mois de l'année l'eau du fleuve est si bourbeuse, qu'il faut la faire déposer pour la boire11: pendant les trois mois qui précèdent l'inondation, réduite à une petite profondeur, elle s'échauffe dans son lit, devient verdâtre, fétide et remplie de vers; et il faut recourir à celle que l'on a reçue et conservée dans les citernes. Dans toutes les saisons, les gens délicats ont soin de la parfumer. Au reste, l'on ne fait en aucun pays un aussi grand usage d'eau. Dans les maisons, dans les rues, partout, le premier objet qui se présente est un vase d'eau, et le premier mouvement d'un Égyptien est de le saisir et d'en boire un grand trait, qui n'incommode point, grace à l'extrême transpiration. Ces vases, qui sont de terre cuite non vernissée, laissent filtrer l'eau au point qu'ils se vident en quelques heures. L'objet que l'on se propose par ce mécanisme est d'entretenir l'eau bien fraîche, et l'on y parvient d'autant mieux qu'on l'expose à un courant d'air plus vif. Dans quelques lieux de la Syrie l'on boit l'eau qui a transsudé; mais en Égypte l'on boit celle qui reste dans le vase.
Depuis quelques années, l'action du Nil sur le terrain de l'Égypte est devenue un problème qui partage les savants et les naturalistes. En considérant la quantité de limon que le fleuve dépose, et en rapprochant les témoignages des anciens des observations des modernes, plusieurs pensent que le Delta a pris un accroissement considérable tant en élévation qu'en étendue. Savary vient de donner plus de poids à cette opinion, dans les Lettres qu'il a publiées sur l'Égypte; mais comme les faits et les autorités qu'il allègue me donnent des résultats différents des siens, je crois devoir porter nos contradictions au tribunal du public. La discussion en devient d'autant plus nécessaire que ce voyageur ayant demeuré deux ans sur les lieux, son témoignage ne tarderait pas de passer en loi: établissons les questions, et traitons d'abord de l'agrandissement du Delta.
Un historien grec, qui a dit sur l'Égypte ancienne presque tout ce que nous en savons, et ce que chaque jour constate, Hérodote d'Halicarnasse, écrivait, il y a 22 siècles:
«L'Égypte, où abordent les Grecs (le Delta), est une terre acquise, un don du fleuve, ainsi que tout le pays marécageux qui s'étend en remontant jusqu'à trois jours de navigation»12.
Les raisons qu'il allègue de cette assertion prouvent qu'il ne la fondait pas sur des préjugés. «En effet, ajoute-t-il, le terrain de l'Égypte, qui est un limon noir et gras, diffère absolument, et du sol de l'Afrique, qui est de sable rouge, et de celui de l'Arabie, qui est argileux et rocailleux... Ce limon est apporté de l'Éthiopie par le Nil... et les coquillages que l'on trouve dans le désert prouvent assez que jadis la mer s'étendait plus avant dans les terres.»
En reconnaissant cet empiètement du fleuve si conforme à la nature, Hérodote n'en a pas déterminé les proportions. Savary a cru pouvoir le suppléer: examinons son raisonnement.
En croissant en hauteur, «l'Égypte13 s'est aussi augmentée en longueur; entre plusieurs faits que l'histoire présente, j'en choisirai un seul. Sous le règne de Psammétique, les Milésiens abordèrent avec trente vaisseaux à l'embouchure Bolbitine, aujourd'hui celle de Rosette, et s'y fortifièrent. Ils bâtirent une ville qu'ils nommèrent Metelis (Strabo, lib. XVII): c'est la même que Faoué, qui, dans les vocabulaires coptes, a conservé le nom de Messil. Cette ville, autrefois port de mer, s'en trouve actuellement éloignée de 9 lieues: c'est l'espace dont le Delta s'est prolongé depuis Psammétique jusqu'à nous.»
Rien de si précis au premier aspect que ce raisonnement; mais en recourant à l'original, dont Savary s'autorise, on trouve que le fait principal manque. Voici le texte de Strabon, traduit à la lettre14.
«Après l'embouchure Bolbitine, est un cap sablonneux et bas, appelé Corne de l'Agneau, lequel s'étend assez loin (en mer); puis vient la Guérite de Persée et le Mur des Milésiens: car les Milésiens, au temps de Kyaxares, roi des Mèdes, qui fut aussi le temps de Psammétique, roi d'Égypte, ayant abordé avec trente vaisseaux à l'embouchure Bolbitine, ils descendirent à terre, et construisirent l'ouvrage qui porte leur nom. Quelque temps après, s'étant avancés vers le nome de Saïs, et ayant battu les troupes d'Inarès dans un combat sur le fleuve, ils fondèrent la ville de Naucratis, un peu au-dessous de Schedia. Après le Mur des Milésiens, en allant vers l'embouchure Sebennytique, sont des lacs, tels que celui de Rutos, etc.»
Tel est le passage de Strabon au sujet des Milésiens; on n'y voit pas la moindre mention de Metelis, dont le nom même n'existe pas dans son ouvrage. C'est Ptolomée qui l'a fourni à d'Anville15, sans le rapporter aux Milésiens: et à moins que Savary ne prouve l'identité de Metelis et du mur Milésien par des recherches faites sur les lieux, on ne doit pas admettre ses conclusions.
Il a pensé qu'Homère lui offrait un témoignage analogue dans les passages où il parle de la distance de l'île du Phare à l'Égypte: le lecteur va juger s'il est plus fondé. Je cite la traduction de madame Dacier16, moins brillante, mais plus littérale qu'aucune autre; et ici le littéral nous importe le plus.
«Dans la mer d'Égypte, vis-à-vis du Nil,» raconte Ménélas, «il y a une certaine île qu'on appelle le Phare; elle est éloignée d'une des embouchures de ce fleuve, d'autant de chemin qu'en peut faire en un jour un vaisseau qui a le vent en poupe.» Et plus bas, Protée dit à Ménélas: «Le destin inflexible ne vous permet pas de revoir votre patrie.... que vous ne soyez retourné encore dans le fleuve Égyptus, et que vous n'ayez offert des hécatombes parfaites aux immortels.
«Il dit,» reprend Ménélas, «et mon cœur fut saisi de douleur et de tristesse, parce que ce dieu m'ordonnait de rentrer dans le fleuve Égyptus, dont le chemin est difficile et dangereux.»
De ces passages, et surtout du premier, Savary veut induire que le Phare, aujourd'hui joint au rivage, en était jadis très-éloigné: mais lorsque Homère parle de la distance de cette île, il ne l'applique pas à ce rivage en face, comme l'a traduit le voyageur; il l'applique à la terre d'Égypte, au fleuve du Nil. En second lieu, par journée de navigation, on aurait tort d'entendre l'espace indéfini que pouvaient parcourir les vaisseaux ou, pour mieux dire, les bateaux des anciens. En usitant ce terme, les Grecs lui attribuaient une valeur fixe de 540 stades. Hérodote17, qui nous apprend expressément ce fait, en donne un exemple quand il dit que le Nil a empiété sur la mer le terrain qui va en remontant jusqu'à trois jours de navigation; et les 1,620 stades qui en résultent, reviennent au calcul plus précis de 1,500 stades, qu'il compte ailleurs d'Héliopolis à la mer. Or, en prenant avec d'Anville les 540 stades pour 27,000 toises, ou près d'un demi-degré18, on trouve, par le compas, que cette mesure est la distance du Phare au Nil même; elle s'applique surtout à deux tiers de lieue au-dessus de Rosette, dans un local où l'on a quelque droit de placer la ville qui donnait son nom à l'embouchure Bolbitine; et il est remarquable que c'était celle que fréquentaient les Grecs, et où abordèrent les Milesiens, un siècle et demi après Homère. Rien ne prouve donc l'empiètement du Delta ou du continent aussi rapide qu'on le suppose; et si l'on voulait le soutenir, il resterait à expliquer comment ce rivage, qui n'a pas gagné une demi-lieue depuis Alexandre, en gagna 11 dans le temps infiniment moindre qui s'écoula de Ménélas à ce conquérant19.»
Il existait un moyen plus authentique d'évaluer cet empiètement; c'est la mesure positive de l'Égypte, donnée par Hérodote. Voici son texte: «La largeur de l'Égypte sur la mer, depuis le golfe Plintinite jusqu'au marais Serbonide, près du Casius, est de 3,600 stades; et sa longueur de la mer à Héliopolis est de 1,500 stades.»
Ne parlons que de ce dernier article, le seul qui nous intéresse. Par des comparaisons faites avec cette sagacité qui lui était propre, d'Anville a prouvé que le stade d'Hérodote doit s'évaluer entre 50 et 51 toises de France. En prenant ce dernier terme, les 1,500 stades équivalent à 76,000 toises, qui, à raison de 57,000 au degré sous ce parallèle, donnent un degré et près de 20 minutes et demie. Or, d'après les observations astronomiques de Niebuhr, voyageur du roi de Danemarck en 176120, la différence de latitude entre Héliopolis (aujourd'hui la Matarée) et la mer, étant d'un degré 29 minutes sous Damiât, et d'un degré 24 minutes sous Rosette, il en résulte d'un côté 3 minutes et demie, ou une lieue et demie d'empiètement; et 8 minutes et demie, ou 3 lieues et demie de l'autre: c'est-à-dire que l'ancien rivage répond à 11,800 toises au-dessous de Rosette; ce qui s'éloigne peu du sens que je trouve au passage d'Homère, tandis que, sur la branche de Damiât, l'application tombe 950 toises au-dessous de cette ville. Il est vrai qu'en mesurant immédiatement par le compas, la ligne du rivage remonte environ 3 lieues plus haut du côté de Rosette, et tombe sur Damiât même; ce qui vient du triangle opéré par la différence de longitude. Mais alors Bolbitine, mentionnée par Hérodote, est hors de limite; et il n'est plus vrai que Busiris (Abousir) soit, comme le dit Hérodote21, au milieu du Delta. On ne doit pas le dissimuler; ce que les anciens rapportent, et ce que nous connaissons du local, n'est point assez précis pour déterminer rigoureusement les empiètements successifs. Pour raisonner sûrement, il faudrait des recherches semblables à celles de Choiseul-Gouffier sur le Méandre22, il faudrait des fouilles sur le terrain; et de pareils travaux exigent une réunion de moyens qui n'est donnée qu'à peu de voyageurs. Il y a surtout ici cette difficulté que le terrain sablonneux qui forme le bas Delta, subit d'un jour à l'autre de grands changements. Le Nil et la mer n'en sont pas les seuls agents; le vent lui-même en est un puissant: tantôt il comble des canaux et repousse le fleuve, comme il a fait pour l'ancien bras Canopique; tantôt il entasse le sable et ensevelit les ruines, au point d'en faire perdre le souvenir. Niebuhr en cite un exemple remarquable. Pendant qu'il était à Rosette (en 1762), le hasard fit découvrir dans les collines de sable qui sont au sud de la ville, diverses ruines anciennes, et entre autres vingt belles colonnes de marbre d'un travail grec, sans que la tradition pût dire quel avait été le nom du lieu23. Tout le désert adjacent m'a paru dans le même cas. Cette partie jadis coupée de grands canaux et remplie de villes, n'offre plus que des collines d'un sable jaunâtre, très-fin, que le vent entasse au pied de tout obstacle, et qui souvent submerge les palmiers. Aussi, malgré le travail de d'Anville, ne peut-on se tenir assuré de l'application qu'il a faite de plusieurs lieux anciens au local actuel.
Savary a été beaucoup plus exact dans ce qu'il rapporte d'une de ces révolutions du Nil24, par laquelle il paraît que jadis ce fleuve coula tout entier dans la Libye, au sud de Memphis. Mais le récit d'Hérodote lui-même, dont il tire ce fait, souffre des difficultés. Ainsi, lorsque cet historien dit, d'après les prêtres d'Héliopolis, que Menès, premier roi d'Égypte, barra le coude que faisait le fleuve, deux lieues et quart (cent stades) au-dessus de Memphis25, et qu'il creusa un lit nouveau à l'orient de cette ville, ne s'ensuit-il pas que Memphis avait été jusqu'alors dans un désert aride, loin de toute eau; cette hypothèse peut-elle s'admettre? Peut-on croire littéralement à ces immenses travaux de Menès, qui aurait fondé une ville citée comme existante avant lui; qui aurait creusé des canaux et des lacs, jeté des ponts, construit des palais, des temples, des quais, etc.: et tout cela dans l'origine première d'une nation, et dans l'enfance de tous les arts? Ce Menès lui-même est-il un être historique, et les récits des prêtres sur cette antiquité ne sont-ils pas tous mythologiques? Je suis donc porté à croire que le cours barré par Menès était seulement une dérivation nuisible à l'arrosement du Delta; et cette conjecture paraît d'autant plus probable, que, malgré le témoignage d'Hérodote, cette partie de la vallée, vue des pyramides, n'offre aucun étranglement qui fasse croire à un ancien obstacle. D'ailleurs, il me semble que Savary a trop pris sur lui de faire aboutir à la digue mentionnée au-dessus de Memphis, le grand ravin appelé bahr bela ma, ou fleuve sans eau, comme indiquant l'ancien lit du Nil. Tous les voyageurs cités par d'Anville le font aboutir au Faïoume, dont il paraît une suite plus naturelle26. Pour établir ce fait nouveau, il faudrait avoir vu les lieux; et je n'ai jamais ouï dire au Kaire que Savary se soit avancé plus au sud que les pyramides de Djizé. La formation du Delta, qu'il déduit de ce changement, répugne également à se concevoir; car, dans cette révolution subite, comment imaginer que le poids énorme des eaux, qui vint se jeter à l'entrée du golfe27, fit refluer celles de la mer? Le choc de deux masses liquides ne produit qu'un mélange, dont il résulte bientôt un niveau commun; en faisant abonder plus d'eau, on dut couvrir davantage. Il est vrai que le voyageur ajoute: Les sables et le limon que le Nil entraîne s'y amoncelèrent; l'île du Delta, peu considérable d'abord, sortit des eaux de la mer, dont elle recula les limites. Mais comment une île sort-elle de la mer? Les eaux courantes aplanissent bien plus qu'elles n'amoncellent: ceci nous conduit à la question de l'exhaussement.
10
Ils l'appellent saint, béni, sacré; et lors des nouvelles eaux, c'est-à-dire de l'ouverture des canaux, on voit les mères plonger les enfants dans le courant, avec le préjugé que ces eaux ont une vertu purifiante et divine, telle que la supposèrent les anciens à tous les fleuves.
11
On se sert, pour cet effet, d'amandes amères, dont on frotte le vase, et alors elle est réellement légère et bonne. Mais il n'y a que la soif, ou la prévention, qui puisse la mettre au-dessus de nos fontaines et de nos grandes rivières, telles que la Seine et la Loire.
12
Herod., lib. II, p. 105, édit. Wesseling, in-fol.
13
Lettres sur l'Égypte, tom. 1, p. 16.
14
Geogr. Strabonis, interpret. Casaubon. édit. 1707, lib. XVII. p. 1152.
15
Voyez l'excellent Mémoire de d'Anville sur l'Égypte, in-4º, 1765, p. 77.
16
Odyssée, liv. IV.
17
Herod., lib. II, p. 106 et 107.
18
Il ne s'en faut que de 1,300 toises.
19
On peut reprocher à Homère de n'être pas exact, quand il dit que le Phare était vis-à-vis du Nil; mais pour l'excuser on peut dire que, parlant de l'Égypte comme du bout du monde, il n'a pas dû se piquer d'une précision stricte. En second lieu, la branche Canopique allait jadis par les lacs s'ouvrir près d'Abouqir; et si, comme la vue du terrain me le fait penser, elle passa jadis à l'ouest même d'Abouqir, qui aurait été une île, Homère a pu dire, avec raison, que le Phare était vis-à-vis du Nil.
20
Voyez Voyage en Arabie, par C. Niebuhr, in-4º, qu'il faut distinguer de la Description de l'Arabie, par le même, 2 vol. in-4º.
21
Lib. II, p. 123.
22
Voyez Voyage pittoresque de la Grèce, tom. II.
23
Cette position convient beaucoup à Bolbitine.
24
Lettre 1, p. 12.
25
Herod., lib. II.
26
En effet, on serait plus porté, sur l'inspection de la carte, à croire que ce fut là jadis le cours du fleuve; quant aux pétrifications de mâts et de vaisseaux entiers dont parle Siccard, elles auraient bien besoin, pour être crues, d'être constatées par des voyageurs plus éclairés que ce missionnaire.
27
Pag. 12 et suiv.