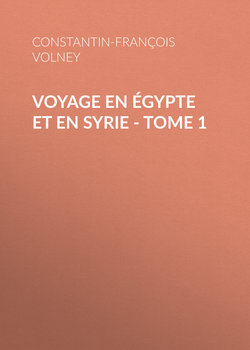Читать книгу Voyage en Égypte et en Syrie - Tome 1 - Constantin-François Volney - Страница 6
ÉTAT POLITIQUE DE L'ÉGYPTE CHAPITRE I. Des diverses races des habitants de l'Égypte
ОглавлениеAU milieu des révolutions qui n'ont cessé d'agiter la fortune des peuples, il est peu de pays qui aient conservé purs et sans mélange leur habitants naturels et primitifs. Partout cette même cupidité qui porte les individus à empiéter sur leurs propriétés respectives, a suscité les nations les unes contre les autres: l'issue de ce choc d'intérêts et de forces a été d'introduire dans les états un étranger vainqueur, qui, tantôt usurpateur insolent, a dépouillé la nation vaincue du domaine que la nature lui avait accordé; et tantôt conquérant plus timide ou plus civilisé, s'est contenté de participer à des avantages que son sol natal lui avait refusés. Par-là se sont établies dans les états des races diverses d'habitants, qui quelquefois, se rapprochant de mœurs et d'intérêts, ont mêlé leur sang; mais qui, le plus souvent, divisés par des préjugés politiques ou religieux, ont vécu rassemblés sur le même sol sans jamais se confondre. Dans le premier cas, les races, perdant par leur mélange les caractères qui les distinguaient, ont formé un peuple homogène où l'on n'a plus aperçu les traces de la révolution. Dans le second, demeurant distinctes, leurs différences perpétuées sont devenues un monument qui a survécu aux siècles, et qui peut, en quelques cas, suppléer au silence de l'histoire.
Tel est le cas de l'Égypte: enlevée depuis 23 siècles à ses propriétaires naturels, elle a vu s'établir successivement dans son sein des Perses, des Macédoniens, des Romains, des Grecs, des Arabes, des Géorgiens, et enfin cette race de Tartares connus sous le nom de Turks ottomans. Parmi tant de peuples, plusieurs y ont laissé des vestiges de leur passage; mais comme dans leur succession ils se sont mêlés, il en est résulté une confusion qui rend moins facile à connaître le caractère de chacun. Cependant on peut encore distinguer dans la population de l'Égypte quatre races principales d'habitants.
La 1re et la plus répandue est celle des Arabes, qu'on doit diviser en 3 classes: 1º La postérité de ceux qui, lors de l'invasion de ce pays par Amrou, l'an 640, accoururent de l'Hedjâz et de toutes les parties de l'Arabie s'établir dans ce pays justement vanté par son abondance. Chacun s'empressa d'y posséder des terres, et bientôt le Delta fut rempli de ces étrangers, au préjudice des Grecs vaincus. Cette première race, qui s'est perpétuée dans la classe actuelle des fellâhs ou laboureurs et des artisans, a conservé sa physionomie originelle; mais elle a pris une taille plus forte et plus élevée: effet naturel d'une nourriture plus abondante que celle des déserts. En général les paysans d'Égypte atteignent 5 pieds 4 pouces; plusieurs vont à 5 pieds 6 et 7; leur corps est musculeux sans être gras, et robuste comme il convient à des hommes endurcis à la fatigue. Leur peau hâlée par le soleil est presque noire; mais leur visage n'a rien de choquant. La plupart ont la tête d'un bel oval, le front large et avancé, et sous un sourcil noir un œil noir, enfoncé et brillant; le nez assez grand, sans être aquilin; la bouche bien taillée et toujours de belles dents. Les habitans des villes, plus mélangés, ont une physionomie moins uniforme, moins prononcée. Ceux des villages, au contraire, ne s'alliant jamais que dans leurs familles, ont des caractères plus généraux, plus constants, et quelque chose de rude dans l'aspect, qui tire sa cause des passions d'une ame sans cesse aigrie par l'état de guerre et de tyrannie qui les environne.
2º Une deuxième classe d'Arabes est celle des Africains ou Occidentaux50, venus à diverses reprises et sous divers chefs se réunir à la première; comme elle, ils descendent des conquérants musulmans qui chassèrent les Grecs de la Mauritanie; comme elle, ils exercent l'agriculture et les métiers; mais ils sont plus spécialement répandus dans le Saïd, où ils ont des villages et même des princes particuliers.
3º. La 3e classe est celle des Bedouins ou hommes des déserts51, connus des anciens sous le nom de Scenites, c'est-à-dire habitant sous des tentes. Parmi ceux-là, les uns, dispersés par familles, habitent les rochers, les cavernes, les ruines et les lieux écartés où il y a de l'eau; les autres, réunis par tribus, campent sous des tentes basses et enfumées, et passent leur vie dans un voyage perpétuel. Tantôt dans le désert, tantôt sur les bords du fleuve, ils ne tiennent à la terre qu'autant que l'intérêt de leur sûreté ou la subsistance de leurs troupeaux les y attachent. Il est des tribus qui, chaque année, après l'inondation, arrivent du sein de l'Afrique pour profiter des herbes nouvelles, et qui au printemps se renfoncent dans le désert; d'autres sont stables en Égypte, et y louent des terrains qu'ils ensemencent et changent annuellement. Toutes observent entre elles des limites convenues qu'elles ne franchissent point, sous peine de guerre. Toutes ont à peu près le même genre de vie, les mêmes usages, les mêmes mœurs. Ignorants et pauvres, les Bédouins conservent un caractère original, distinct des nations qui les environnent. Pacifiques dans leur camp, ils sont partout ailleurs dans un état habituel de guerre. Les laboureurs, qu'ils pillent, les haïssent; les voyageurs, qu'ils dépouillent, en médisent; les Turks, qui les craignent, les divisent et les corrompent. On estime que leurs tribus en Égypte pourraient former trente mille cavaliers; mais ces forces sont tellement dispersées et désunies, qu'on les y traite comme des voleurs et des vagabonds.
Une seconde race d'habitants est celle des Coptes, appelés en arabe el Qoubt. On en trouve plusieurs familles dans le Delta; mais le grand nombre habitent le Saïd, où ils occupent quelquefois des villages entiers. L'histoire et la tradition attestent qu'ils descendent du peuple dépouillé par les Arabes, c'est-à-dire de ce mélange d'Égyptiens, de Perses, et surtout de Grecs qui, sous les Ptolémées et les Constantins, ont si long-temps possédé l'Égyte. Ils diffèrent des Arabes par leur religion, qui est le christianisme; mais ils sont encore distincts des chrétiens par leur secte, qui est celle d'Eutychès. Leur adhésion aux opinions théologiques de cet homme leur a attiré de la part des autres Grecs des persécutions qui les ont rendus irréconciliables. Lorsque les Arabes conquirent le pays, ils en profitèrent pour les affaiblir mutuellement. Les Coptes ont fini par expulser leurs rivaux; et comme ils connaissent de tout temps l'administration intérieure de l'Égypte, ils sont devenus les dépositaires des registres des terres et des tribus. Sous le nom d'écrivains, ils sont au Kaire les intendants, les secrétaires et les traitants du gouvernement et des beks. Ces écrivains, méprisés des Turks qu'ils servent, et haïs des paysans qu'ils vexent, forment une espèce de corps dont est chef l'écrivain du commandant principal. C'est lui qui dispose de tous les emplois de cette partie, qu'il n'accorde, selon l'esprit de ce gouvernement, qu'à prix d'argent.
On prétend que le nom de Coptes leur vient de la ville de Coptos, où ils se retirèrent, dit-on, lors des persécutions des Grecs; mais je lui crois une origine plus naturelle et plus ancienne. Le terme arabe Qoubti, un Copte, me semble une altération évidente du grec Ai-goupti-os, un Égyptien; car on doit remarquer que y était prononcé ou chez les anciens Grecs, et que les Arabes n'ayant, ni g devant a o u, ni la lettre p, remplacent toujours ces lettres par q et b: les Coptes sont donc proprement les représentans des Égyptiens52; et il est un fait singulier qui rend cette acception encore plus probable. En considérant le visage de beaucoup d'individus de cette race, j'y ai trouvé un caractère particulier qui a fixé mon attention: tous ont un ton de peau jaunâtre et fumeux, qui n'est ni grec ni arabe; tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse; en un mot, une vraie figure de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat53, lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée nègre dans tous ses traits, je me rappelai ce passage remarquable d'Hérodote, où il dit54: Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus; c'est-à-dire, que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique55; et dès lors on explique comment leur sang, allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur, en conservant cependant l'empreinte de son moule originel. On peut même donner à cette observation une étendue très-générale, et poser en principe que la physionomie est une sorte de monument propre en bien des cas à constater ou éclaircir les témoignages de l'histoire, sur les origines des peuples. Parmi nous, un laps de neuf cents ans n'a pu effacer la nuance qui distinguait les habitans des Gaules, de ces hommes du Nord, qui, sous Charles-le-Gros, vinrent occuper la plus riche de nos provinces. Les voyageurs qui vont par mer de Normandie en Danemarck, parlent avec surprise de la ressemblance fraternelle des habitans de ces deux contrées, conservée malgré la distance des lieux et des temps. La même observation se présente, quand on passe de Franconie en Bourgogne; et si l'on parcourait avec attention la France, l'Angleterre ou toute autre contrée, on y trouverait la trace des émigrations écrite sur la face des habitans. Les Juifs n'en portent-ils pas d'ineffaçables, en quelque lieu qu'ils soient établis? Dans les états où la noblesse représente un peuple étranger introduit par conquête, si cette noblesse ne s'est point alliée aux indigènes, ses individus ont une empreinte particulière. Le sang kalmouque se distingue encore dans l'Inde; et si quelqu'un avait étudié les diverses nations de l'Europe et du nord de l'Asie, il retrouverait peut-être des analogies qu'on a oubliées.
Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation, de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issues de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs; de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave et l'objet de nos mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole; d'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité, que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages, et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des blancs!
Le langage est un autre monument dont les indications ne sont pas moins justes ni moins instructives. Celui dont usaient ci-devant les Coptes, s'accorde à constater les faits que j'établis. D'un côté, la forme de leurs lettres et la majeure partie de leurs mots démontrent que la nation grecque, dans un séjour de mille ans, a imprimé fortement son empreinte sur l'Égypte56; mais d'autre part, l'alphabet copte a cinq lettres, et le dictionnaire beaucoup de mots qui sont comme les débris et les restes de l'ancien égyptien. Ces mots, examinés avec critique, ont une analogie sensible avec les idiomes des anciens peuples adjacents, tels que les Arabes, les Éthiopiens, les Syriens et même les riverains de l'Euphrate; et l'on peut établir comme un fait certain que toutes ces langues ne furent que des dialectes dérivés d'un fonds commun. Depuis plus de trois siècles, celui des Coptes est tombé en désuétude; les Arabes conquérants, en dédaignant l'idiome des peuples vaincus, leur ont imposé avec leur joug, l'obligation d'apprendre leur langue. Cette obligation même devint une loi, lorsque, sur la fin du premier siècle de l'hedjire, le kalife Ouâled Ier prohiba la langue grecque dans tout son empire: de ce moment l'arabe prit un ascendant universel; et les autres langues, reléguées dans les livres, ne subsistèrent plus que pour les savants qui les négligèrent. Tel a été le sort du copte dans les livres de dévotion et d'église, les seuls connus où il existe: les prêtres et les moines ne l'entendent plus; et en Égypte comme en Syrie, musulman ou chrétien, tout parle arabe et n'entend que cette langue.
Il se présente à ce sujet des observations qui, dans la géographie et l'histoire, ne sont pas sans importance. Les voyageurs, en traitant des pays qu'ils ont vus, sont dans l'usage et souvent dans l'obligation de citer des mots de la langue qu'on y parle. C'est une obligation, par exemple, s'il s'agit de noms propres de peuples, d'hommes, de villes, de rivières et d'autres objets particuliers au pays; mais de là est survenu l'abus, que transportant les mots d'une langue à l'autre, on les a défigurés à les rendre méconnaissables. Ceci est arrivé surtout aux pays dont je traite; et il en est résulté, dans les livres d'histoire et de géographie, un chaos incroyable. Un Arabe qui saurait le français, ne reconnaîtrait pas dans nos cartes dix mots de sa langue, et nous-mêmes lorsque nous l'avons apprise, nous éprouvons le même inconvénient. Il a plusieurs causes.
1º L'ignorance où sont la plupart des voyageurs de la langue arabe, et surtout de sa prononciation; et cette ignorance a été cause que leur oreille, novice à des sons étrangers, en a fait une comparaison vicieuse aux sons de leur propre langue.
2º La nature de plusieurs prononciations qui n'ont point d'analogies dans la langue où on les transporte. Nous l'éprouvons tous les jours dans le th des Anglais et dans le jota des Espagnols: quiconque ne les a pas entendus, ne peut s'en faire une idée; mais c'est bien pis avec les Arabes, dont la langue a trois voyelles et sept à huit consonnes étrangères aux Européens. Comment les peindre pour leur conserver leur nature, et ne les pas confondre avec d'autres qui font des sens différents57?
3º Enfin, une troisième cause de désordre est la conduite des écrivains dans la rédaction des livres de cartes. En empruntant leurs connaissances de tous les Européens qui ont voyagé en Orient, ils ont adopté l'orthographe des noms propres, telle qu'ils l'ont trouvée dans chacun; mais ils n'ont pas fait attention que les diverses nations de l'Europe, en usant également des lettres romaines, leur donnent des valeurs différentes. Par exemple, l'u des Italiens n'est pas notre u, mais ou; leur gh, n'est pas gé, mais gué; leur c, n'est pas cé, mais tché: de là une diversité apparente de mots qui sont cependant les mêmes. C'est ainsi que celui qu'on doit écrire en français, chaik ou chêk, est écrit tour à tour schek58, shekh, schech, sciek, selon qu'on l'a tiré de l'anglais, de l'allemand ou de l'italien, chez qui ces combinaisons de sh, sch, sc, ne sont que notre che. Les Polonais écriraient szech, et les Espagnols, chej; cette différence de finale, j, ch, et kh, vient de ce que la lettre arabe est le jota espagnol, ch allemand59, qui n'existe point chez les Anglais, les Français et les Italiens. C'est encore par des raisons semblables, que les Anglais écrivent Rooda, l'île que les Italiens écrivent Ruda, et que nous devons prononcer comme les Arabes, Rouda; que Pocoke écrit harammé, pour harâmi, un voleur; que Niebuhr écrit dsjebel, pour djebel, une montagne; que d'Anville, qui a beaucoup usé de mémoires anglais, écrit Shâm pour Châm, la Syrie, wadi pour ouâdi, une vallée, et mille autres exemples.
Par là, comme je l'ai dit, s'est introduit un désordre d'orthographe qui confond tout; et si l'on n'y remédie, il en résultera pour le moderne, l'inconvénient dont on se plaint pour l'ancien. C'est avec leur ignorance des langues barbares, et avec leur manie d'en plier les sons à leur gré, que les Grecs et les Romains nous ont fait perdre la trace des noms originaux, et nous ont privés d'un moyen précieux de reconnaître l'état ancien dans celui qui subsiste. Notre langue, comme la leur, a cette délicatesse; elle dénature tout, et notre oreille rejette comme barbare tout ce qui lui est inusité. Sans doute il est inutile d'introduire des sons nouveaux; mais il serait à propos de nous rapprocher de ceux que nous traduisons, et de leur assigner, pour représentants, les plus rapprochés des nôtres, en leur ajoutant des signes convenus. Si chaque peuple en faisait autant, la nomenclature deviendrait une, comme ses modèles60; et ce serait un premier pas vers une opération qui devient de jour en jour plus pressante et plus facile, un alphabet général qui puisse convenir à toutes les langues, ou du moins à celles de l'Europe. Dans le cours de cet ouvrage, je citerai le moins qu'il me sera possible de mots arabes; mais lorsque j'y serai obligé, qu'on ne s'étonne pas si je m'éloigne souvent de l'orthographe de la plupart des voyageurs. A en juger par ce qu'ils ont écrit, il ne paraît pas qu'aucun ait saisi les vrais éléments de l'alphabet arabe, ni connu les principes à suivre dans la translation des mots à notre écriture61. Je reviens à mon sujet.
Une troisième race d'habitants en Égypte est celle des Turks, qui sont les maîtres du pays, ou qui du moins en ont le titre. Dans l'origine, ce nom de Turk n'était point particulier à la nation à qui nous l'appliquons; il désignait en général des peuples répandus à l'orient et même au nord de la mer Caspienne, jusqu'au-delà du lac Aral, dans les vastes contrées qui ont pris d'eux leur dénomination de Tourk-estân62. Ce sont ces mêmes peuples dont les anciens Grecs ont parlé sous le nom de Parthes, de Massagètes, et même de Scythes, auquel nous avons substitué celui de Tartares. Pasteurs et vagabonds comme les Arabes bedouins, ils se montrèrent, dans tous les temps, guerriers farouches et redoutables. Ni Kyrus ni Alexandre ne purent les subjuguer; mais les Arabes furent plus heureux. Environ quatre-vingts ans après Mahomet, ils entrèrent, par ordre du kalife Ouâled I, dans les pays des Turks, et leur firent connaître leur religion et leurs armes. Ils leur imposèrent même des tributs; mais l'anarchie s'étant glissée dans l'empire, les gouverneurs rebelles se servirent d'eux pour résister aux kalifes, et ils furent mêlés dans toutes les affaires. Ils ne tardèrent pas d'y prendre un ascendant qui dérivait de leur genre de vie. En effet, toujours sous des tentes, toujours les armes à la main, ils formaient un peuple guerrier, et une milice rompue à toutes les manœuvres des combats. Ils étaient divisés, comme les Bedouins, en tribus ou camps, appelés dans leur langue ordou, dont nous avons fait horde, pour désigner leurs peuplades. Ces tribus, alliées ou divisées entre elles pour leurs intérêts, avaient sans cesse des guerres plus ou moins générales; et c'est à raison de cet état, que l'on voit dans leur histoire plusieurs peuples également nommés Turks, s'attaquer, se détruire et s'expulser tour à tour. Pour éviter la confusion, je réserverai le nom de Turks propres à ceux de Constantinople, et j'appellerai Turkmans ceux qui les précédèrent.
Quelques hordes de Turkmans ayant donc été introduites dans l'empire arabe, elles parvinrent en peu de temps à faire la loi à ceux qui les avaient appelées comme alliées ou comme stipendiaires. Les kalifes en firent eux-mêmes une expérience remarquable. Motazzam63, frère et successeur d'Almamoun, ayant pris pour sa garde un corps de Turkmans, se vit contraint de quitter Bagdad à cause de leurs désordres. Après lui, leur pouvoir et leur insolence s'accrurent au point qu'ils devinrent les arbitres du trône et de la vie des princes; ils en massacrèrent trois en moins de trois ans. Les kalifes, délivrés de cette première tutelle, ne devinrent pas plus sages. Vers 935, Radi-b'ellah64 ayant encore déposé son autorité dans les mains d'un Turkman, ses successeurs retombèrent dans les premières chaînes; et sous la garde des emirs-el-omara, ils ne furent plus que des fantômes de puissance. Ce fut dans les désordres de cette anarchie qu'une foule de hordes turkmanes pénétrèrent dans l'empire, et qu'elles fondèrent divers états indépendants, plus ou moins passagers, dans le Kerman, le Korasan, à Iconium, à Alep, à Damas et en Égypte.
Jusqu'alors les Turks actuels, distingués par le nom d'Ogouzians, étaient restés à l'orient de la Caspienne et vers le Djihoun; mais dans les premières années du 13e siècle, Djenkiz-Kan ayant amené toutes les tribus de la haute Tartarie contre les princes de Balk et de Samarqand, les Ogouzians ne jugèrent pas à propos d'attendre les Mogols: ils partirent sous les ordres de leur chef Soliman, et poussant devant eux leurs troupeaux, ils vinrent (en 1214) camper dans l'Aderbedjân, au nombre de cinquante mille cavaliers. Les Mogols les y suivirent, et les poussèrent plus à l'ouest dans l'Arménie. Soliman s'étant noyé (en 1220) en voulant passer l'Euphrate à cheval, Ertogrul son fils prit le commandement des hordes, et s'avança dans les plaines de l'Asie mineure, où des pâturages abondants attiraient ses troupeaux. La bonne conduite de ce chef lui procura dans ces contrées une force et une considération qui firent rechercher son alliance par d'autres princes. De ce nombre fut le Turkman Ala-el-din, sultan à Iconium. Cet Ala-el-din se voyant vieux et inquiété par les Tartares de Djenkiz-Kan, accorda des terres aux Turks d'Ertogrul, et le fit même général de toutes ses troupes. Ertogrul répondit à la confiance du sultan, battit les Mogols, acquit de plus en plus du crédit et de la puissance, et les transmit à son fils Osman, qui reçut d'un Ala-el-din, successeur du premier, le Qofetân, le tambour et les queues de cheval, symboles du commandement chez tous les Tartares. Ce fut cet Osman qui, pour distinguer ses Turks des autres, voulut qu'ils portassent désormais son nom, et qu'on les appelât Osmanlès, dont nous avons fait Ottomans65. Ce nouveau nom devint bientôt redoutable aux Grecs de Constantinople, sur qui Osman envahit des terrains assez considérables pour en faire un royaume puissant. Bientôt il lui en donna le titre, en prenant lui-même, en 1300, la qualité de soltân, qui signifie souverain absolu. On sait comment ses successeurs, héritiers de son ambition et de son activité, continuèrent de s'agrandir aux dépens des Grecs; comment de jour en jour, leur enlevant des provinces en Europe et en Asie, ils les resserrèrent jusque dans les murs de Constantinople; et comment enfin Mahomet II, fils d'Amurat, ayant emporté cette ville en 1453, anéantit ce rejeton de l'empire de Rome. Alors les Turks, se trouvant libres des affaires d'Europe, reportèrent leur ambition sur les provinces du midi. Bagdâd, subjuguée par les Tartares, n'avait plus de kalifes depuis deux cents ans66; mais une nouvelle puissance formée en Perse, avait succédé à une partie de leurs domaines. Une autre, formée dans l'Égypte, dès le dixième siècle, et subsistant alors sous le nom de Mamlouks, en avait détaché la Syrie et le Diarbekr. Les Turks se proposèrent de dépouiller ces rivaux. Bayazid, fils de Mahomet, exécuta une partie de ce dessein contre le sofi de Perse, en s'emparant de l'Arménie; et Sélim son fils le compléta contre les Mamlouks. Ce sultan les ayant attirés près d'Alep en 1517, sous prétexte de l'aider dans la guerre de Perse, tourna subitement ses armes contre eux, et leur enleva de suite la Syrie et l'Égypte, où il les poursuivit. De ce moment le sang des Turks fut introduit dans ce pays; mais il s'est peu répandu dans les villages. On ne trouve presque qu'au Kaire des individus de cette nation: ils y exercent les arts, et occupent les emplois de religion et de guerre. Ci-devant ils y joignaient toutes les places du gouvernement; mais depuis environ trente ans, il s'est fait une révolution tacite, qui, sans leur ôter le titre, leur a dérobé la réalité du pouvoir.
Cette révolution a été l'ouvrage d'une quatrième et dernière race, dont il nous reste à parler. Ses individus, nés tous au pied du Caucase, se distinguent des autres habitans par la couleur blonde de leurs cheveux, étrangère aux naturels de l'Égypte. C'est cette espèce d'hommes que nos croisés y trouvèrent dans le treizième siècle, et qu'ils appelèrent Mamelus, ou plus correctement Mamlouks. Après avoir demeuré presque anéantis pendant deux cent trente ans sous la domination des Ottomans, ils ont trouvé moyen de reprendre leur prépondérance. L'histoire de cette milice, les faits qui l'amenèrent pour la première fois en Égypte, la manière dont elle s'y est perpétuée et rétablie, enfin son genre de gouvernement, sont des phénomènes politiques si bizarres, qu'il est nécessaire de donner quelques pages à leur développement.
50
En arabe, magârbe, pluriel de magrebi, homme de garb, ou couchant: ce sont nos Barbaresques.
51
En Arabe, bedâoui, formé de bîd, désert, pays sans habitations.
52
D'autant mieux qu'on les trouve au Saïde dès avant Dioclétien; et qu'il paraît que le Saïde fut moins rempli par les Grecs que le Delta.
53
En effet, j'observe que la figure des nègres représente précisément cet état de contraction que prend notre visage lorsqu'il est frappé par la lumière et par une forte réverbération de chaleur. Alors le sourcil se fronce; la pomme des joues s'élève; la paupière se serre; la bouche fait la moue. Cette contraction des parties mobiles n'a-t-elle pas pu et dû à la longue influer sur les parties solides, et mouler la charpente même des os? Dans les pays froids, le vent, la neige, l'air vif opèrent presque le même effet que l'excès de lumière dans les pays chauds: et nous voyons que presque tous les sauvages ont quelque chose de la tête du nègre; ensuite viennent les coutumes de mouler la tête des enfants, et même le genre de coiffure, qui, par exemple, chez les Tartares étant un bonnet haut, lequel serre les tempes et relève le sourcil, me semble la cause du sourcil de chèvre qu'on remarque chez les Chinois et les Kalmouks: dans les zones tempérées et chez les peuples qui habitent sous des toits, ces diverses circonstances n'ayant pas lieu, les traits se montrent allongés par le repos des muscles, et les yeux à fleur de tête, parce qu'ils sont protégés contre l'action de l'air.
54
Lib. II, p. 150.
55
Cette observation qui, lors de la publication de ce voyage, en 1787, sembla plutôt neuve et piquante que fondée en vérité, se trouve aujourd'hui portée à l'évidence par des faits eux-mêmes aussi piquants que décisifs. Blumenbach, professeur très-distingué d'anatomie à Gottingue, a publié en 1794 un mémoire duquel il résulte:
1º Qu'il a eu l'occasion de disséquer plusieurs momies égyptiennes.
2º Que les crânes de ces momies appartiennent à trois différentes races d'hommes, savoir: l'une, la race éthiopienne caractérisée par les joues élevées, les lèvres épaisses, le nez large et épaté, les prunelles saillantes; ainsi, ajoute-t-il, que Volney nous représente les Coptes d'aujourd'hui.
La seconde race qui porte le caractère des Hindous, et la troisième qui est mixte et participe des deux premières.
Le docteur Blumenbach cite aussi, en preuve de la première race, le sphinx gravé dans Norden, auquel les plus savants antiquaires n'avaient pas fait attention jusque-là. J'y ajoute en cette édition pour nouveau témoin, le même sphinx dessiné par l'un des artistes les plus distingués de nos jours, M. Cassas, auteur du Voyage pittoresque de la Syrie, de l'Egypte, etc. L'on y remarquera, outre des proportions gigantesques, une disposition de traits qui établit de plus en plus ce que j'ai avancé.
56
Voyez le Dict. copte, par Lacroze.
57
Il n'y a pas jusqu'au savant Pocoke qui, expliquant si bien les livres, ne put jamais se passer d'interprète. Récemment, Vonhaven, professeur d'arabe en Danemarck, ne put pas entendre même le salam alai kom (le bonjour), lorsqu'il vint en Égypte; et son compagnon, le jeune Forskal, au bout d'un an, fut plus avancé que lui.
58
Pour faire sentir ces différences à la lecture, il faut appeler les lettres une à une.
59
Pas dans tous les cas, mais après l'o et l'u, comme dans buch, un livre.
60
Lorsque les voyageurs français qui font actuellement le tour du monde seront revenus, on verra la confusion qu'apportera dans leurs récits la variété des orthographes anglaise et française.
61
Le lecteur curieux de ce genre d'étude peut consulter un ouvrage que j'ai publié pour remplir l'objet que j'indique ici. Il est intitulé Simplification des langues orientales, in-8º, et se trouve chez Bossange frères, libraires, rue de Seine, nº 12, à Paris.
62
Estân est un terme persan qui signifie pays, et s'applique en finale aux noms propres; ainsi l'on dit Arab-estân, Frank-estân, etc.
63
En 834.
64
Qui se plaît en Dieu.
65
Cette différence du t à l's, vient de ce que la lettre originale est le th anglais, que les étrangers traduisent tantôt t, tantôt s.
66
En 1239, Holagou-kan, descendant de Djenkiz, abolit le kalifat dans la personne de Mostâzem.