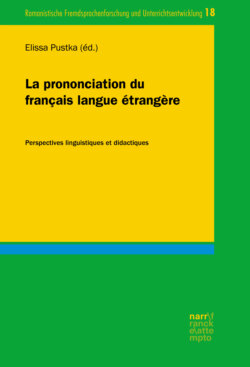Читать книгу La prononciation du français langue étrangère - Группа авторов - Страница 4
Introduction
ОглавлениеElissa Pustka (Vienne)
L’enseignement de la prononciation du français langue étrangère (FLE) se base jusqu’à aujourd’hui essentiellement sur l’intuition : les enseignant.e.s s’appuient sur leur expérience professionnelle (plus ou moins longue), et la formation d’enseignant.e.s (s’il y en a une dans ce domaine) recourt à des manuels qui, eux aussi, découlent de l’expérience personnelle des auteur.e.s. À l’école, la prononciation est souvent négligée, sous couvert du manque de temps, mais probablement surtout en raison du manque de formation des enseignant.e.s (cf. Horvath et al. 2019). La mise en place d’une formation, initiale et continue, s’avère pour sa part difficile car le fondement scientifique nécessaire fait défaut – aussi bien sur le plan de l’interphonologie des apprenant.e.s que sur le plan didactique. On observe donc une insuffisance à deux niveaux : au niveau universitaire, dans la formation des futur.e.s enseignant.e.s de français, ainsi qu’en salle de classe.
Certes, il existe des manuels de prononciation du français, depuis presque aussi longtemps que l’enseignement du FLE. Le premier d’entre eux est à ma connaissance Palsgrave 1530, un manuel dédié aux Anglais.e.s qui évoque entre autres déjà la phrase accentuelle. À la fin du 19ème siècle, alors que l’enseignement des langues vivantes se propage, l’on invente l’alphabet phonétique international à la demande des enseignant.e.s de langues (voir Durand/Lyche dans ce volume). À partir de cette époque, les manuels de prononciation française se multiplient, en partant de ceux de Passy 1887, de Martinon 1913 et de Grammont 1914, jusqu’au grand classique de Fouché 1959. Écrits en français, ils s’adressent à un public international. Parallèlement, les premiers manuels écrits dans la L1 de groupes spécifiques d’apprenant.e.s sont publiés, dont notamment Beyer 1888 et Quiehl 1906 pour les germanophones (pour une analyse des ouvrages plus généraux de Münch 1895 et Wendt 1895 voir Reimann dans ce volume). Les générations actuelles des universitaires et des enseignant.e.s du secondaire ont grandi avec Klein 1963 et Rothe 1972 ou bien, pour les plus jeunes, avec Eggs/Mordellet 1990, Röder 1996, Meisenburg/Selig 1998 et Pustka 2011 ainsi qu’avec le grand classique Phonétisme et prononciations du français [1994] (62011) du franco-canadien Pierre Léon. Ces ouvrages accumulent intuitions et expériences personnelles, les plus récents se basant également de plus en plus sur les résultats d’une phonologie de corpus en forte croissance, qui jusqu’à récemment se restreignait au français L1.
Le premier programme de recherche dédié à la prononciation du FLE, Interphonologie du Français Contemporain IPFC (cblle.tufs.ac.jp/ipfc/, Detey et al. 2010, Racine et al. 2012), n’a vu le jour qu’en 2008. Il fait lui-même partie du programme Phonologie du Français Contemporain PFC mis en place en 1999 (projet-pfc.net, Durand et al. 2002). Aujourd’hui, ce programme de recherche international comprend quatre sous-projets qui portent sur les apprenant.e.s germanophones, localisé.e.s à Munich (Chervinski 2013, Pustka 2015), Osnabrück (Pustka/Meisenburg 2017), Vienne (Pustka/Forster/Kamerhuber 2018) et Zurich (Isely et al. 2018). C’est sur ce fondement qu’a été mis en place le projet de recherche Pronunciation in Progress : French Schwa and Liaison Pro2F à l’université de Vienne (2018–2022 ; https://pro2f.univie.ac.at/, Kamerhuber/Horvath/Pustka 2020, Heiszenberger et al. 2020, Pustka/Heiszenberger/Courdès-Murphy, dans ce volume). Par ailleurs, deux autres programmes de création de corpus phonétiques et phonologiques pour le FLE ont vu le jour : PhoDiFLE (Landron et al. 2010), qui à ma connaissance ne comprend pas de locuteur L1 de l’allemand, et COREIL, qui pour sa part en comprend 8 (Delais-Roussarie/Santiago/Yoo 2015).
Dans les pays germanophones, parallèlement aux projets IPFC-allemand et Pro2F, un vaste projet longitudinal sur le plurilinguisme Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf MEZ (2014–2019 ; https://www.mez.uni-hamburg.de) a été réalisé à l’université de Hambourg. L’on y étudie entre autres la prosodie, le VOT (voice onset time) et le dévoisement final chez les apprenant.e.s bilingues allemand-turc et allemand-russe (Gabriel/Stahnke/Thulke 2015, Gabriel/Kupisch/Seoudy 2016, Gabriel/Krause/Dittmers 2018, Özaslan/Gabriel 2019, Gabriel/Grünke dans ce volume). En phonétique, le projet binational Individualized Feedback for Computer-Assisted Spoken Language Learning IFCASL (2013–2016 ; http://www.ifcasl.org), affilié aux universités de Sarrebruck et de Nancy, étudie notamment la question des pauses et de la fluidité (Trouvain et al. 2013, Fauth et al. 2014, Trouvain et al. 2016, Trouvain/Fauth/Möbius 2016, Trouvain dans ce volume). La question du voisement des obstruantes en français avait déjà été analysée par Schmid 2012 dans une étude-pilote auprès de locuteurs suisse alémaniques.
Un premier objectif de ce volume, intitulé La prononciation du français langue étrangère : perspectives linguistiques et didactiques, sera donc de réunir de nouveaux résultats sur l’interphonologie du français afin de fournir une base scientifique pour l’enseignement de la prononciation du FLE qui permette de sensibiliser les (futur.e.s) enseignant.e.s de français aux problèmes des apprenant.e.s (voir les contributions de Pustka/Heiszenberger/Courdès-Murphy, Gabriel/Grünke et Trouvain dans ce volume). La contribution de Wurzer/Wolf fournit par ailleurs de premiers résultats d’un projet de thèse en cours de Wurzer sur la perception des normes du français par les apprenant.e.s autrichien.ne.s. Étant donné que dans le domaine germanophone le nombre de chercheurs travaillant sur ces questions est encore assez restreint, le volume comprend également des contributions sur l’acquisition du français par des apprenant.e.s d’autres L1 : l’anglais irlandais (Chamot/Racine/Regan/Detey dans ce volume) et l’espagnol mexicain (Santiago/Mairano dans ce volume). Finalement, Trouvain (dans ce volume) expose le potentiel didactique des corpus phonétiques d’apprenant.e.s pour l’enseignement du français.
Les chercheurs impliqués dans les projets de recherche sur la prononciation du FLE ont commencé tout récemment à publier des articles destinés aux enseignant.e.s de français (Pustka 2020, Heiszenberger/Jansen 2020, Gabriel/Grünke/Schlaak 2020, Pustka 2021a/b, Heiszenberger 2021, Heiszenberger/Trouvain 2021, Bäumler/Wagenpfeil 2021). Ils communiquent ainsi non seulement leurs résultats de recherche, mais aussi des conseils et exercices développés sur cette nouvelle base et souvent testés en classe au préalable. Dans les numéros spéciaux de ces revues pratiques, l’on trouve également des articles de practicien.ne.s aux niveaux scolaire et/ou universitaire (Di Luca 2020, Le Bescont 2021). Cependant, une didactique empirique étudiant l’efficacité de ces méthodes n’a pas encore vu le jour, notamment pour le FLE dédié aux apprenant.e.s germanophones (L1). Il n’existe que quelques études pionnières dans ce domaine de recherche en émergence portant sur d’autres premières langues, en l’occurrence l’anglais (Sturm 2013) et l’italien (Schmid/Rajic dans ce volume).
Ce qu’on observe davantage dans le domaine de la didactique sont des études historiques (Galazzi 2010), notamment sur la prononciation dans les manuels de FLE (Reimann 2016). De plus, les sondages effectués auprès d’enseignant.e.s de français quant à la prononciation se sont multipliés durant ces dernières années en Allemagne et en Autriche (Reimann 2017, Gabriel/Thiele 2017, Abel 2018, Horvath et al. 2019). Un deuxième objectif de ce volume a donc été d’inciter des chercheurs à mener de nouvelles études en didactique, notamment sur la prise en compte de la prononciation dans les manuels (voir Fäcke, Chalier et Kondo dans ce volume). On y trouve également un aperçu de différentes méthodes didactiques issues de divers pays. Elles vont de l’alphabet phonétique international API développé en Europe à la fin du 19ème siècle (Durand/Lyche dans ce volume) aux méthodes mises en place dans le cadre des recherches sur l’allemand langue étrangère (Valman dans ce volume) en passant par la méthode verbo-tonale fondée en Croatie et en France (Alazard-Guiu/Massa dans ce volume). Mordellet-Roggenbuck (dans ce volume) présente ensuite non seulement des recommandations didactiques concernant les phénomènes de prononciation du français qui devraient être enseignés en priorité, mais également des méthodes adéquates en fonction de l’âge des apprenant.e.s. Finalement, la contribution d’Abel (dans ce volume) est dédiée à un défi qui suscite actuellement de plus en plus d’intérêt : la question de l’évaluation.
Ainsi, le présent volume fournit une contribution fondamentale à une didactique de la prononciation du FLE naissante, aussi bien pour les recherches à venir que pour la pratique de l’enseignement.
Vienne, le 30 avril 2021, Elissa Pustka