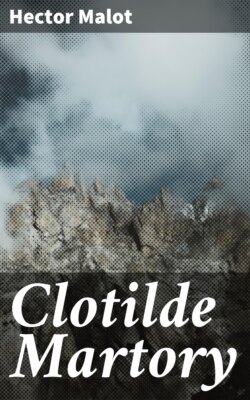Читать книгу Clotilde Martory - Hector Malot - Страница 13
VII
ОглавлениеQuand j'ouvris les yeux le lendemain matin, ma chambre, dont les fenêtres étaient restées ouvertes, me parut teinte en rose. Je me levai vivement et j'allai sur mon balcon; la mer et le ciel, du côté du Levant, étaient roses aussi; partout, en bas, en haut, sur la terre, dans l'air, sur les arbres et sur les maisons, une belle lueur rose.
Je me frottai les yeux, me demandant si je rêvais ou si j'étais éveillé.
Puis je me mis à rire tout seul, me disant que décidément l'amour était un grand magicien, puisqu'il avait la puissance de nous faire voir tout en rose.
Mais ce n'était point l'amour qui avait fait ce miracle, c'était tout simplement l'aurore «aux doigts de rose,» la vieille aurore du bonhomme Homère qui, sur ces côtes de la Provence, dans l'air limpide et transparent du matin, a la même jeunesse et la même fraîcheur que sous le climat de la Grèce.
J'avais de longues heures devant moi avant de pouvoir me présenter chez le général; pour les passer sans trop d'impatience, je résolus de les employer à faire un croquis du fort. Puisque j'avais commencé cette histoire, il fallait maintenant la pousser jusqu'au bout en lui donnant un certain cachet de vraisemblance, au moins pour le général, car, pour Clotilde, il était assez probable qu'elle n'en croyait pas un mot. Ses questions à ce sujet, ses regards interrogateurs, son sourire incrédule m'avaient montré qu'elle avait des doutes sur le motif vrai qui avait déterminé mon voyage à Cassis; si je voulais bien lui laisser ces doutes qui servaient mon amour, je ne voulais point par contre qu'ils pussent se présenter à l'esprit du général. Que Clotilde soupçonnât mon amour, c'était parfait puisqu'elle le tolérait et même l'encourageait d'une façon tacite, mais le général, c'était une autre affaire: les pères ont le plus souvent, à l'égard de l'amour, des idées qui ne sont pas celles des jeunes filles.
Il ne me fallut pas un long examen du fort pour voir que le prétexte de ma visite à Cassis était aussi mal trouvé que possible. Ce n'était pas un fort, en effet, mais une mauvaise bicoque, tout au plus bonne à quelque chose à l'époque de Henri IV ou de Louis XIII, comme me l'avait dit Clotilde. Jamais, bien certainement, l'idée n'avait pu venir à l'esprit d'un membre de la commission de la défense des côtes de se préoccuper de ce fort, et j'aurais sans doute bien du mal à faire accepter mon histoire par le général.
Cependant, comme j'étais engagé dans cette histoire et que je ne pouvais pas maintenant la changer, je me mis au travail et commençai mon dessin. C'était ce dessin qui devait donner l'apparence de la vérité à mon mensonge: quand un homme arrive un morceau de papier à la main, il a des chances pour qu'on l'écoute et le prenne au sérieux: le premier soin des lanceurs de spéculations n'est-il pas de faire imprimer avec tout le luxe de la typographie et de la lithographie le livre à souche de leurs actions? et le bon bourgeois, qui eût gardé son argent pour une affaire qui lui eût été honnêtement expliquée, l'échange avec empressement contre un chiffon de papier rose qu'on lui montre.
A dix heures, j'avais fait deux petits croquis qui étaient assez avancés pour que je pusse les laisser voir. Qui m'eût dit, il y a quinze ans, lorsque je travaillais le dessin avec goût et plaisir, que je tirerais un jour ce parti de ma facilité à manier le crayon? Mais tout sert en ce monde, et l'homme qui sait deux métiers vaut deux hommes. Dans les circonstances présentes, seul avec mon sabre, je serais resté embarrassé; j'ai trouvé un auxiliaire dans un dessinateur qui est mon meilleur ami, et ce sera un fidèle complice qui me rendra peut-être plus d'un service.
Le coeur me battait fort quand je sonnai à la porte du général Martory. La vieille servante qui s'était trouvée la veille à l'arrivée de la voiture vint m'ouvrir, et à la façon dont elle m'accueillit, il me sembla qu'elle m'attendait.
Néanmoins je lui remis ma carte en la priant de la porter au général et de demander à celui-ci s'il voulait bien me recevoir.
—Ce n'est pas la peine, me dit cette domestique aux moeurs primitives, allez au bout du vestibule et entrez, vous trouverez le général qui est en train de sacrer.
Sacrer? Si mes lèvres ne demandèrent point en quoi consistait cette opération, mes yeux surpris parlèrent pour moi.
—C'est la douleur qui le fait jurer, continua la vieille servante; elle a augmenté de force cette nuit. Une visite lui fera du bien; ça le distraira.
Puisque c'était là l'usage de la maison, je devais m'y conformer: je suivis donc le vestibule dallé de larges plaques de pierre grise jusqu'à la porte qui m'avait été indiquée. Il était d'une propreté anglaise, ce vestibule, passé au sable chaque matin comme le pont d'un navire de guerre, frotté, essuyé, et partout sur les murailles brillantes, sur les moulures luisantes de la boiserie on voyait qu'on était dans une maison où les soins du ménage étaient poussés à l'extrême.
Arrivé à la porte qui se trouvait à l'extrémité de ce vestibule, je frappai. J'avais espéré que ce serait Clotilde qui me répondrait, car je me flattais qu'elle serait avec son père; mais, au lieu de la voix douce que j'attendais, ce fut une voix rude et rauque qui me répondit: «Entrez.»
Je poussai la porte, et avant d'avoir franchi le seuil, mon regard chercha Clotilde; elle n'était pas là. La seule personne que j'aperçus fut un vieillard à cheveux blancs qui se tenait assis dans un fauteuil, la jambe étendue sur un tabouret, et lisant sans lunettes le dernier volume de l'Annuaire.
Je m'avançai et me présentai moi-même.
—Parfaitement, parfaitement, dit le général sans se lever et en me rendant mon salut du bout de la main. Je vous attendais, capitaine, et, pour ne rien cacher, j'ajouterai que je vous attendais avec une curiosité impatiente, car il n'y a que vous pour m'expliquer ce que ma fille m'a raconté hier soir.
—C'est bien simple.
—Je n'en doute pas, mais c'est le récit de ma fille qui n'est pas simple, pour moi au moins. Il est vrai que je n'ai jamais rien compris aux histoires de femmes; et vous, capitaine? Mais je suis naïf de vous poser cette question; vous êtes à l'âge où les femmes ont toutes les perfections. Moi, je n'ai jamais eu cet âge heureux, mais j'ai vu des camarades qui l'avaient.
Ce langage, que je rapporte à peu près textuellement, confirma en moi l'impression que j'avais ressentie en apercevant le général. C'est, en effet, un homme qu'on peut juger sans avoir besoin de l'étudier longtemps. Après l'avoir vu pendant deux minutes et l'avoir écouté pendant dix, on le connaît, comme si l'on avait vécu des années avec lui.
Au physique, un homme de taille moyenne, aux épaules larges et à la poitrine puissante; un torse et une encolure de taureau; tous ses cheveux, qu'il porte coupés, ras, et qui lui font comme une calotte d'autant plus blanche que le front, les oreilles et le cou sont plus rouges; toutes ses dents solidement plantées dans de fortes mâchoires qui font saillie de chaque côté de la figure, comme celles d'un carnassier; une voix sonore qui dans une bataille jetant le cri: «En avant!» devait dominer le tapage des tambours battant la charge. Avec cela, une tenue et une attitude régimentaires; un col de crin tenant la tête droite; une redingote bleue boutonnée d'un seul rang de boutons comme une tunique, et cousu, sur le drap même, à la place du coeur, le ruban de la Légion d'honneur.
Au moral, deux mots l'expliqueront:—une culotte de peau, qui a été un sabreur.
—C'est donc au mariage de mademoiselle Bédarrides que vous avez rencontré ma fille?
—Oui, général.
—Bonnes gens, ces Bédarrides. Je les connais beaucoup; ça n'apprécie que la fortune; ça se croit quelque chose parce que ça a des millions; mais, malgré tout, bonnes gens qui rendent à l'officier ce qu'ils lui doivent.
—Pour moi, je leur suis reconnaissant de m'avoir fourni l'occasion de faire la connaissance de mademoiselle votre fille, et par là la vôtre, général.
—Ma fille m'a dit que vous venez à Cassis pour visiter le fort et savoir ce qu'on en peut tirer de bon; est-ce cela?
—Précisément.
—Mais ce n'est pas vraisemblable.
Je fus un moment déconcerté; mais me remettant bientôt, je tâchai de m'expliquer, et lui répétai la fable que j'avais déjà débitée à sa fille.
—C'est bien là ce que Clotilde m'a dit, mais je ne voulais pas le croire; comment, il y a dans la commission de la défense de nos côtes des officiers assez bêtes pour s'occuper de ça; c'est un marin, n'est-ce pas? ce n'est pas un militaire.
J'évitai de répondre directement, car il ne me convenait pas de trop préciser dans une affaire aussi sottement engagée.
—Peut-être veut-on transformer le fort en prison; peut-être veut-on vendre le terrain; je ne sais rien autre chose si ce n'est qu'on m'a demandé comme service, et en dehors de toute mission officielle, de faire quelques dessins de ce fort et de les envoyer à Paris avec les renseignements que je pourrais réunir sur son utilité ou son inutilité.
—Maintenant que vous l'avez vu, je n'ai rien à vous en dire, n'est-ce pas? vous en savez tout autant que moi puisque vous êtes militaire.
—J'en ai cependant fait deux croquis.
Et je présentai mes dessins au général, car gêné par le mensonge dans lequel je m'étais embarqué si légèrement, et que j'avais été obligé de continuer, j'éprouvais le besoin de m'appuyer sur quelque chose qui me soutînt.
—C'est bien ça, tout à fait ça, très-gentil, et c'est vous qui avez fait ces deux petites machines, capitaine?
—Mais oui, mon général.
—Je vous félicite; un officier qui sait faire ces petites choses-là peut rendre des services à un général en campagne; c'est comme un officier qui parle la langue du pays dans lequel on se trouve; cependant pour moi je n'ai jamais su dessiner, et en Allemagne, en Égypte, en Italie, en Espagne, en Russie, en Algérie, je n'ai jamais parlé que ma langue et je m'en suis tout de même tiré.
Pendant que le général Martory m'exposait ainsi de cette façon naïve ses opinions sur les connaissances qui pouvaient être utiles à l'officier en campagne, je me demandais avec une inquiétude qui croissait de minute en minute, si je ne verrais pas Clotilde et si ma visite se passerait sans qu'elle parût.
Elle devait savoir que j'étais là, cependant, et elle ne venait pas; mes belles espérances, dont je m'étais si délicieusement bercé, ne seraient-elles que des chimères?
A mesure que le temps s'écoulait, le sentiment de la tromperie dont je m'étais rendu coupable pour m'introduire dans cette maison m'était de plus en plus pénible; c'était pour la voir que j'avais persisté dans cette fable ridicule, et je ne la voyais pas. Près d'elle je n'aurais probablement pensé qu'à ma joie, mais en son absence je pensais à ma position et j'en étais honteux. Car cela est triste à dire, le fardeau d'une mauvaise action qui ne réussit pas est autrement lourd à porter que le poids de celle qui réussit.