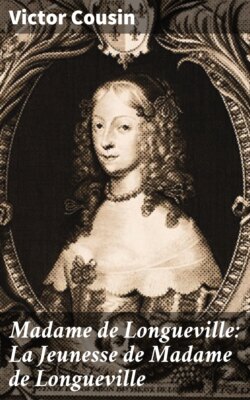Читать книгу Madame de Longueville: La Jeunesse de Madame de Longueville - Victor Cousin - Страница 6
II.
ОглавлениеEn décrivant la personne de Mme de Longueville, il se trouve que nous avons fait connaître son esprit et son âme.
Son esprit a reçu les hommages des connaisseurs les plus délicats. Nous avons vu que La Rochefoucauld, Retz et Mme de Motteville le louent à l'égal de sa beauté. Retz insiste particulièrement sur ce que cet esprit devait tout à la nature et presque rien à l'étude, son indolence accoutumée l'éloignant de tout effort dans les choses ordinaires. «Mme de Longueville, dit-il, a naturellement bien du fonds d'esprit, mais elle en a encore plus le fin et le tour. Sa capacité, qui n'a pas été aidée par sa paresse, n'est pas allée jusqu'aux affaires[36], etc.» Et à propos de la langueur de ses manières: «Elle en avoit une même dans l'esprit qui avoit ses charmes, parce qu'elle avoit, si l'on peut le dire, des réveils lumineux et surprenants.» Mme de Motteville parle comme Retz: «Cette princesse étoit fort paresseuse[37].» Et ailleurs: «L'occupation que donnent les applaudissements du grand monde, qui d'ordinaire regarde avec trop d'admiration les belles qualités des personnes de cette naissance, avoit ôté le loisir à Mme de Longueville de lire, et de donner à son esprit une connaissance assez étendue pour la pouvoir dire savante[38].» Elle ne l'était point et ne se piquait pas de l'être. Tandis que ses deux frères, le prince de Condé et le prince de Conti, avaient fait de fortes études aux Jésuites de Bourges et de Paris, Mlle de Bourbon n'avait reçu, sous les yeux de sa mère, que l'instruction légère qu'on donnait alors aux femmes. Un heureux naturel et le commerce de la société d'élite où elle vivait suppléèrent à tout; elle eut même de bonne heure une grande réputation, et presque enfant on la trouve environnée d'hommages et même de dédicaces. Nous avons là entre les mains une tragi-comédie pastorale intitulée Uranie[39], qu'un nommé Bridard lui dédia en 1631, c'est-à-dire lorsqu'elle avait douze ans. Ce Bridard lui dit: «Les plus parfaits courtisans savent que vous avez un esprit qui prévient votre âge. De moi j'en puis témoigner, vous ayant ouïe réciter des vers avec tant de grâce que l'on doutoit si un ange, empruntant votre beauté, ne venoit point discourir en terre des merveilles du ciel.» Nous tirons cette phrase de ce livre oublié et digne de l'être, parce qu'elle devance toutes celles de Mme de Motteville, de Mlle de Montpensier, de Mlle de Vandy et de Mme de Maintenon. Voilà déjà l'ange à douze ans et pour toujours. Dès sa première jeunesse, on l'avait menée avec son frère, encore duc d'Enghien, à l'hôtel de Rambouillet, et les salons de la rue Saint-Thomas du Louvre n'étaient pas une trop bonne école à un esprit tel que le sien, où se mêlaient presque également la grandeur et la finesse, mais une grandeur tirant un peu au romanesque, et une finesse dégénérant souvent en subtilité, comme au reste dans Corneille lui-même, le parfait représentant de cette époque. Il ne paraît pourtant pas que l'hôtel de Rambouillet lui ait imposé ses préjugés et ses admirations, car un jour qu'on lui lisait la Pucelle de Chapelain, si prônée en ce quartier, et qu'on lui en faisait remarquer les prétendues beautés: «Oui, dit-elle[40], cela est fort beau, mais bien ennuyeux»; à peu près comme son frère, le grand Condé, prenait la défense de Corneille contre les règles, et s'écriait qu'il ne pardonnait pas aux règles de faire faire à l'abbé d'Aubignac d'aussi mauvaises tragédies. On la proclamait de toutes parts le juge souverain de tous les écrits, la reine du bel esprit, l'arbitre du goût et des élégances, comme dit Horace. En 1645, Le Clerc, qui fut depuis de l'Académie Française, mettait sous sa protection la tragédie de Virginie, et lui disait: «Être avoué de vous, c'est l'être de tout le monde... Vous êtes aujourd'hui la divinité tutélaire des Muses.» En 1649, dans la querelle des deux sonnets de Benserade et de Voiture, toute la cour prit parti pour Benserade; mais Mme de Longueville, s'étant déclarée pour Voiture, la ramena à son sentiment. Et il faut bien qu'à ce moment de sa vie elle ait cédé au goût dominant et qu'elle ait été un peu précieuse, car Mme de Motteville, en relevant «la beauté principale de son esprit qui consistoit en la délicatesse des pensées», l'accuse d'affectation, ajoutant bien vite, comme pour s'excuser de trouver des taches à une personne aussi accomplie: «Tous les hommes participent à cette boue dont ils tirent leur origine, et Dieu seul est parfait[41].»
On s'accorde à reconnaître qu'elle causait divinement, avec un mélange exquis de vivacité et de douceur. Le charme de sa conversation doit avoir été quelque chose de bien extraordinaire pour avoir survécu à sa jeunesse et à sa vie mondaine, et subsisté jusque dans la dévotion et la pénitence. L'écrivain janséniste, qui nous a laissé un portrait, ou, comme on disait alors, un caractère de Mme de Longueville[42], n'hésite pas à la comparer et presque à la préférer à l'un des hommes les plus spirituels et des causeurs les plus célèbres du XVIIe siècle, M. de Tréville[43]: «C'étoit une chose à étudier que la manière dont Mme de Longueville conversoit. Elle disoit si bien tout ce qu'elle disoit, qu'il auroit été difficile de le mieux dire, quelque étude que l'on y apportât. Il y avoit plus de choses vives et rares dans ce que disoit M. de Tréville, mais il y avoit plus de délicatesse et plus d'esprit et de bon sens dans la manière dont Mme de Longueville s'exprimoit.»
Mais parler et écrire sont deux choses bien différentes, qui demandent des cultures particulières; et, comme l'étude manquait à Mme de Longueville, il y paraissait dès qu'elle prenait la plume. Ses grandes qualités naturelles avaient peine à se faire jour à travers les fautes de tout genre qui échappaient à son inexpérience. Ce n'est pas en effet une petite affaire que d'exprimer ses sentiments et ses idées dans un ordre naturel, avec leurs nuances vraies, en des termes ni trop recherchés ni trop vulgaires qui ne les exagèrent ni ne les affaiblissent. Il n'est pas très rare de rencontrer dans le monde des hommes pleins d'esprit, de verve et de grâce lorsqu'ils parlent, et qui deviennent méconnaissables la plume à la main. C'est qu'écrire est un art, un art très difficile, et qu'il faut avoir appris. Mme de Longueville l'ignorait, ainsi que les femmes les plus éminentes de son temps. Nous avons parlé ailleurs[44] de la mère Angélique Arnauld et de Jacqueline Pascal, si admirablement douées, et qui n'ont laissé que des œuvres très imparfaites. Les témoignages sont unanimes pour présenter la princesse Palatine comme une personne d'un grand esprit qui traitait d'égal à égal avec les plus grands hommes. Retz[45] et Bossuet[46] le disent, et il les en faut croire, car ils s'y connaissaient mieux que nous. Lisez cependant quelques lettres manuscrites qui nous restent de la Palatine: ce n'est certes pas la solidité, la finesse et les traits ingénieux qui leur manquent; mais on est forcé d'avouer qu'elles sont souvent pleines d'incorrections, que les phrases y sont embarrassées, et les règles les plus vulgaires de l'orthographe quelquefois outrageusement blessées. Nous n'en concluons pas du tout que la Palatine n'était pas un esprit du premier ordre, mais seulement qu'on ne lui avait point enseigné l'art de rendre convenablement par écrit ses sentiments et ses pensées. Mme de Longueville n'était guère plus exercée. Aussi, tout ce que nous publierons d'elle se ressent à la fois de la beauté de son génie et des défauts de son éducation.
A ces femmes qui écrivent si bien et si mal, on se plaît à opposer Mme de Sévigné et Mme de La Fayette, qui écrivent toujours bien. Pour être juste, il faudrait, ce semble, tenir compte ici de deux choses fort considérables.
D'abord ces deux dames avaient reçu une tout autre éducation que Mme de Longueville; elles avaient eu d'habiles maîtres de littérature, et parmi eux l'un des hommes les plus savants du XVIIe siècle, qui en même temps avait les plus grandes prétentions au bel esprit, au bel air, à l'air galant. Ménage avait appris à Mlle de Rabutin et ensuite à Mlle de Lavergne, pendant leur jeunesse et même après leur mariage, non-seulement la langue française telle qu'on la parlait et l'écrivait à l'Académie, mais la langue des beaux esprits du temps, l'italien, et même un peu de latin; il ne leur fit grâce que du grec. Il les exerça à écrire, corrigeant leurs compositions, marquant leurs fautes, cultivant leurs heureux instincts, polissant et réglant leur esprit et leur style. Il les retint assez longtemps sous cette discipline qui avait pour lui ses douceurs. Leur professeur était aussi leur adorateur platonique, plus platonique qu'il n'eût voulu. Il leur adressait des stances, des sonnets, des idylles, des madrigaux, des vers de toute sorte en français, en italien et en latin. Il célébrait tour à tour formosissima Laverna et la bellissima marchesa di Sevigni[47]. Il ne se serait pas donné la peine de composer, à l'honneur de leur esprit et de leurs charmes, des vers latins et italiens qu'elles n'eussent pas compris. Bien loin de là, l'une et l'autre écrivaient fort bien en italien[48]. Dans une correspondance manuscrite de Mme de La Fayette, que nous avons pu parcourir, nous avons rencontré plus d'une allusion au temps où elle faisait pour ainsi dire ses études sous Ménage[49]. La nature avait comblé Mme de Sévigné: elle lui avait donné une justesse et une solidité parfaite, avec un inépuisable enjouement et une vivacité étincelante. Le goût, se joignant en elle au génie, en a fait l'incomparable épistolière qui a laissé bien loin derrière elle Balzac et Voiture, et que Voltaire lui-même n'a point surpassée. Elle a l'air de tout oser, comme une étourdie et une ignorante, et jamais, dans ses traits les plus hardis, elle ne passe la mesure, signe infaillible d'un art achevé. Remarquez encore que si Mme de Sévigné a écrit admirablement, ç'a toujours été par rencontre, sachant bien, il est vrai, que ses lettres seraient montrées; elle n'a jamais mis d'enseigne, elle n'a écrit que des lettres, elle n'a pas fait de livres, nous doutons même qu'elle eût pu en faire, et nous ne l'imaginons pas composant un roman ni un ouvrage quelconque, si ce n'est peut-être des mémoires et des satires, comme son cousin Bussy ou Saint-Simon, ou bien des traités de théologie, comme sa fille, Mme de Grignan[50]. Il n'en est point ainsi de Mme de La Fayette. Ce n'est pas seulement une personne de beaucoup d'esprit et de beaucoup d'instruction, c'est un auteur. Il n'est pas surprenant qu'elle sût écrire, puisqu'elle l'avait appris et en faisait profession. Une politesse exquise est son trait dominant, et il est permis de le rapporter en partie à la discipline littéraire qu'elle garda bien plus longtemps que son amie: d'ailleurs, n'écrivant pas un mot sans le soumettre à ce même Ménage, à Segrais, qui logea quelque temps chez elle et lui prêtait, sinon sa plume, au moins ses conseils et son nom, à Huet, à La Rochefoucauld. Mme de La Fayette est très supérieure assurément à Mlle de Scudéry, à Mme d'Aulnoy, à Mme Lambert, mais elle est de leur famille. Quoiqu'elle ait passé sa vie avec Mme de Sévigné, elle en diffère entièrement, et n'a rien à voir avec une princesse du sang telle que Mme de Longueville.
Mais ce qu'il importe surtout de ne pas oublier, c'est que celle-ci précède d'un certain nombre d'années les deux illustres amies, et que, de bonne heure séparée du monde, et ensevelie dans la retraite pendant les vingt-cinq dernières années de sa vie, elle n'a pu profiter du progrès alors si rapide de la langue et du goût. Il y a en effet deux parties bien différentes dans la littérature du XVIIe siècle, celle de Louis XIII et de la Régence[51], que représentent Corneille et Pascal, et celle qui est particulièrement l'œuvre de Louis XIV, et dont Racine et Fénelon sont l'expression la plus accomplie. Dans l'une est une grandeur un peu négligée; dans l'autre, un art charmant qui quelquefois se fait trop sentir. Les femmes qui appartiennent à la première moitié du XVIIe siècle ont dans leur style, comme elles avaient dans leur conversation, des longueurs, des négligences, des incorrections même, car la langue qu'elles écrivent ou qu'elles parlent n'est pas fixée. Elles ne savent encore ni choisir entre leurs pensées, ni leur donner ce tour heureux, cette précision et cette élégance devenues presque vulgaires à la fin du siècle, grâce au concours de tant de beaux génies. Mais leur esprit, qui avait touché à toutes les grandes choses, politique et religion, ambition mondaine et sainte pénitence, est d'une trempe bien autrement forte que celui des femmes qui sont venues après la Fronde et ont reçu l'impression particulière du goût de Louis XIV, devenu celui de la France entière. Mme de Sévigné, née et formée dans la première époque, se développe et s'épanouit dans la seconde: son cœur est avec la première, son génie en vient; la seconde lui a donné sa politesse sans ôter rien à sa vigueur et à sa verve originale. Mme de Longueville était dans tout son éclat sous la Fronde; depuis elle n'a vécu qu'aux Carmélites et à Port-Royal; son goût était arrêté et achevé vers 1650. Ainsi, ne lui demandons point les qualités qu'elle ne peut avoir; reconnaissons en elle un esprit véritablement du premier rang, mais qui est toujours celui d'une femme, d'une grande dame, d'une princesse fort paresseuse, comme la peignent Retz et Mme de Motteville, qui n'a pas pris le moindre soin des facultés qu'elle a reçues, et laisse paraître indistinctement ses qualités et ses défauts, qui sont aussi les qualités et les défauts du temps où elle est venue, à savoir, une grandeur inculte, une délicatesse souvent raffinée, avec une perpétuelle négligence.