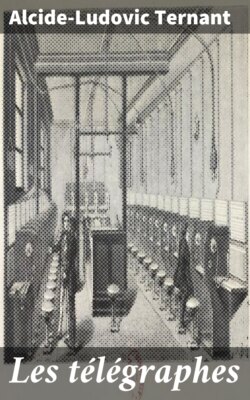Читать книгу Les télégraphes - Alcide-Ludovic Ternant - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TÉLÉGRAPHIE OPTIQUE.
ОглавлениеSystème des anciens. — Diverses méthodes ayant précédé le télégraph de Chappe. — Télégraphe aérien. — Héliographe de Leseurre. — Héliographe de Mance. — Son application au service de l’armée anglaise en Afghanistan. — Système proposé par sir William Thomson pour le signalement des phares.
Que fais-tu, mon vieux télégraphe,
Au sommet de ton vieux clocher,
Sérieux comme une épitaphe,
Immobile comme un rocher?
Hélas! comme d’autres, peut-être,
Devenu sage après la mort,
Tu réfléchis, pour les connaître,
Aux nouveaux caprices du sort.
NADAUD.
Dans son Art des signaux, publié à Hanau en 1795, le major Boucherœder assure que l’art de la Télégraphie remonte à l’époque de la construction de la tour de Babel, en l’an du monde 1756. Cette structure aurait eu surtout pour but d’établir un point central de communications avec les différentes contrées alors habitées par les hommes.
L’Écriture rapporte aussi que l’on se servit de colonnes de feu et de fumée pour conduire les Israélites à travers le désert, lors de leur fuite en Égypte.
L’idée de donner une signification à l’apparition de feux sur des hauteurs est si naturelle, qu’on en trouve la trace chez différentes peuplades sauvages de l’Afrique.
L’histoire et la poésie ont conservé certaines traditions qui prouvent que l’art de la télégraphie était usité aux grandes époques des temps héroïques.
Annibal fit élever des tours d’observation en Afrique et en Espagne pour transmettre des signaux phrasiques. Les Romains suivirent cette méthode et établirent, partout où ils étendirent leur conquête, des communications rapides qui servaient à maintenir leur empire sur les peuples vaincus. On trouve encore en France des vestiges de ces tours. Celles d’Uzès, de Bellegarde, d’Arles, de la vallée de Luchon, étaient sous la garde de vedettes qui faisaient passer avec rapidité des avis de toutes les contrées voisines.
Le télégraphe représenté sur la colonne de Trajan est la seule description d’un poste télégraphique romain qui nous soit parvenue. Ce poste est entouré de palissades; son second étage a un balcon, et le bâtiment est couronné par une petite tour.
Les Arabes et les Asiatiques pratiquaient l’art de parler au moyen de signaux visuels, et les Chinois avaient élevé des machines à feu sur la grande muraille, longue de cent quatre-vingt-huit lieues, pour donner l’alarme à toute la frontière qui les séparait des Tartares, lorsque quelque horde de ce peuple les menaçait. Ils employaient, ainsi que les Indiens, des feux si brillants qu’ils perçaient le brouillard, et que ni la pluie ni le vent ne pouvaient les éteindre. Les Anglais, ayant rapporté de l’Inde, la composition de ces feux, s’en servirent dans les opérations faites en 1787, pour la jonction des observatoires de Paris et de Greenwich.
Ces opérations, conduites par MM. Cassini, Méchain et Legendre d’un côté, le général Roy et M. Blagden de l’autre, permirent non seulement d’établir une triangulation parfaite au moyen de boîtes à feu et même de lampes ordinaires à réflecteur, mais il y eut, en outre, un échange de signaux entre les deux rives du Pas-de-Calais. La possibilité d’une communication télégraphique à travers la Manche était donc démontrée dès 1787.
François Kessler, un chaud partisan des sciences occultes, a été le précurseur du télégraphe optique, maintenant adopté dans l’armée. Il renfermait son télégraphe dans un tonneau contenant une lampe avec son réflecteur. Devant le tonneau se trouvait une trappe mobile, que l’on pouvait lever et abaisser au moyen d’un levier. La trappe soulevée une fois indiquait la première lettre de l’alphabet, deux fois c’était la lettre B, trois fois le C, et ainsi de suite. Nous verrons plus tard comment les signaux de l’alphabet Morse peuvent être reproduits au moyen de systèmes analogues. Le système alphabétique était en honneur à l’époque dont nous parlons, et il a prévalu jusqu’à nos jours. En 1684, le célèbre Robert Hooke décrivit, devant la Société royale de Londres, son système de signaux formés de planches de diverses formes, peintes en noir, qu’on pouvait élever au milieu de châssis. La télégraphie au moyen de corps opaques est restée en usage dans la marine, surtout pour indiquer aux navigateurs les hauteurs et les mouvements des marées dans les ports. A cet effet, on hisse sur un appareil composé d’un mât et d’une vergue, des ballons formés de bandes noires. Ces ballons se détachent parfaitement en noir sur le ciel.
Un ballon placé à l’intersection du mât et de la vergue annonce une profondeur d’eau de 3 mètres dans toute la longueur du chenal. Chaque ballon placé sur le mât, au-dessous du premier, ajoute un mètre à cette hauteur d’eau; placé au-dessus, il en ajoute deux. Hissé à l’extrémité de la vergue, un ballon représente 0m.25, quand il est vu à gauche du mât, et 0m.50, quand il est vu à droite du navigateur. Il suffit donc de six ballons pour indiquer les hauteurs d’eau de 0m.25 en 0m.25 depuis 3 mètres jusqu’à 8m.75.
Ces signaux peuvent se faire la nuit en substituant des fanaux aux ballons et moyennant l’adoption d’un feu coloré, afin de marquer le point essentiel à distinguer, où la vergue s’appuie sur le mât.
Pour indiquer le mouvement de la marée, on emploie un pavillon blanc avec croix noire et une flamme noire en forme de guidon. Ces pavillons se hissent dès qu’il y a 2 mètres d’eau dans le chenal, et sont amenés dès que la mer est redescendue à ce même niveau. Pendant toute la durée du flot, la flamme est au-dessus du pavillon; au moment de la pleine mer et pendant la durée de l’étale, la flamme est amenée; enfin la flamme est au-dessous du pavillon pendant le jusant.
Lorsque l’état de la mer interdit l’entrée du port, tous ces signaux sont remplacés par un pavillon rouge également hissé au sommet du mât.
Cette digression nous a un peu écarté de l’historique des télégraphes visuels; mais nous n’avons pas cru inutile de donner les détails qui précèdent.
Les Curiosités de la littérature de Bertin nous rapportent que le marquis de Worcester prétendit avoir découvert cent machines nouvelles, et qu’il demanda à Charles II d’Angleterre une certaine somme d’argent pour les publier. Elle lui fut refusée. On a dit que le télégraphe et les machines à vapeur faisaient partie de ces inventions, mais il ne nous est rien resté du résultat de ces recherches .
On connaît les expériences d’Amontons et celles de Marcel, vers la fin du dix-septième siècle.
Les machines et les dessins de ces inventeurs ont été perdus, et Marcel n’a même pas laissé de description de son système. Il voulait que sa méthode ne fût publiée qu’après avoir été adoptée par le roi; mais, à cette époque, Louis XIV était vieux et le mémoire de Marcel resta sans réponse. Dupuis, l’auteur de l’Origine de tous les cultes, présenta au ministre, en 1723, un projet de télégraphie alphabétique. Ce ne fut que dix ans plus tard qu’il en fit l’essai à Ménilmontant, pour correspondre de sa maison à celle d’un ami qu’il avait à Bagneux. Quand le télégraphe de Chappe fut présenté à l’Assemblée législative, en 1792, Dupuis, qui en était membre, abandonna son travail.
En 1783, Linguet avait proposé au ministère un moyen de transmettre, aux distances les plus éloignées, des nouvelles de quelque espèce et de quelque longueur qu’elles fussent, avec une rapidité presque égale à l’imagination. Ce projet, qui devait tirer Linguet de la Bastille, fut expérimenté devant des commissaires nommés par le ministre. Il ne fut pas adopté et aucune trace n’en est restée.
Monge paraît aussi avoir proposé, avant Chappe, un télégraphe à signaux qui fut installé sur le pavillon central des Tuileries, mais on ne s’en servit jamais.
Beaucoup de physiciens s’étaient donc occupés de l’art des signaux, avant que Chappe et ses frères introduisissent leur système de télégraphie optique en France. Presque tous ceux qui les avaient précédés s’étaient contentés de faire passer quelques mots entre deux stations, et c’est une des causes qui les avaient empêchés de réussir. Mais pour transmettre en peu de temps, et à de grandes distances, une certaine quantité de signaux, il faut évidemment multiplier les stations. Les frères Chappe, après avoir expérimenté entre eux un appareil rudimentaire de correspondance par signes, consistant en une règle en bois tournant sur un pivot, et portant à ses extrémités deux règles mobiles de moitié plus petites, s’occupèrent pendant un certain temps de faire des essais électriques pour la transmission des signaux. Claude Chappe, le plus ingénieux des cinq frères, avait imaginé de correspondre par le secours du synchronisme de deux pendules harmonisées, marquant électriquement les mêmes valeurs. Il plaça et isola des conducteurs à de certaines distances; mais la difficulté de l’isolement, l’expansion latérale du fluide électrique dans un long conducteur, l’intensité qui eût été nécessaire et qui est subordonnée à l’état de l’atmosphère, lui firent regarder son projet de communication par l’électricité comme chimérique.
Il est curieux de noter que Claude Chappe ait tenu un moment entre ses mains cette électricité qui devait plus tard détrôner son système.
Fig. 1.
Quoi qu’il en soit, après de nombreuses péripéties, Claude Chappe avait fini par compléter un système de télégraphie visuelle, se répétant de stations en stations au moyen d’une machine composée de trois pièces, à sa partie supérieure, et dont chacune d’elles se meut séparément. La plus grande de ces pièces, qui est un parallélogramme très allongé, aux extrémités de laquelle sont ajoutées les deux autres, peut prendre quatre positions: devenir horizontale, verticale, être inclinée à gauche ou à droite, sur un angle de quarante-cinq degrés. Les pièces qui se meuvent sur ses extrémités, et que l’on nomme ailes, sont disposées de manière à prendre chacune sept positions, par rapport à la pièce principale, savoir: en formant soit au-dessus, soit au-dessous d’elle, un angle de 45°, un angle droit, un angle obtus, et enfin en coïncidant avec elle. Les trois pièces forment de la sorte 196 figures différentes, qui doivent être considérées comme autant de signes simples, à chacun desquels on attache une valeur de convention. On conçoit qu’en plaçant ainsi dans une direction quelconque une suite de machines de cette espèce, dont chacune répète les mouvements de celle qui précède, on transmet au bout de cette ligne les figures faites à la première station, et par conséquent les idées qu’on y attache, sans que les agents intermédiaires en prennent connaissance; et, pour qu’on puisse s’assurer que, le signal a été exactement donné au-dessus de la maisonnette, on a placé dans l’intérieur, à la partie inférieure des poteaux qui soutiennent le télégraphe, un répétiteur servant de manivelle, qui donne le mouvement, et prend simultanément, en le donnant, la figure que l’on veut tracer à la partie supérieure.
Tel est le système de Claude Chappe, qu’il fit heureusement prévaloir grâce à l’aide de son frère Ignace, nommé membre de l’Assemblée législative en octobre 1791. Aidé de son parent Delaunay, ancien consul de France à Lisbonne, il composa un vocabulaire secret de 9,999 mots, dans lequel chaque mot était représenté par un nombre. Ce furent ces résultats que Claude Chappe présenta, le 22 mars 1792, à la barre de l’Assemblée législative où il fut admis. Dans le discours qu’il fit à cette occasion, il ne demandait à l’Assemblée, en cas de réussite, qu’à être indemnisé des frais que son expérience pourrait occasionner.
L’examen de sa machine fut confié à un comité ; mais ce ne fut que le 1er avril 1793 que le rapporteur de ce comité, Romme, conclut à l’adoption du système télégraphique de Claude Chappe. Romme terminait son rapport en demandant à l’Assemblée de voter les fonds nécessaires à l’établissement d’une première ligne d’essai. La Convention vota la faible somme de 6 000 francs, prescrivant en même temps au comité de nommer une commission sous les yeux de laquelle le nouvel appareil devrait fonctionner. Les membres de cette commission étaient Arbogast, Daunou et Lakanal, et c’est à ce dernier que Claude Chappe dut de voir son télégraphe finalement adopté par la Convention. Une expérience faite le 12 juillet 1793 avait si admirablement prononcé en faveur de la perfection du système de Chappe, qu’aucune hésitation n’était plus permise. Lakanal, nommé rapporteur de la commission, produisit une impression profonde sur l’assemblée lorsqu’il lut son rapport devant elle, le 26 juillet 1793. Il concluait en proposant d’accorder à Claude Chappe le titre d’ingénieur-télégraphe avec les appointements d’un lieutenant du génie, et d’examiner quelles étaient les lignes de correspondance que le comité de salut public désirait établir dans l’intérêt de la République. La Convention convertit en décret les propositions de Lakanal. Adoptant officiellement le télégraphe de Chappe, elle ordonna au comité de salut public de faire établir une ligne de correspondance composée du nombre de postes nécessaires. Chappe, nommé ngénieur-télégraphe, reçut la paye de 5 livres 10 sous par jour, afin que sa position fût assimilée à celle de lieutenant du génie.
Le comité de salut public, comprenant que le télégraphe de Chappe devait permettre aux chefs d’armée de correspondre rapidement entre eux, décida que les télégraphes seraient surtout établis aux abords des villes assiégées, et que les lignes partiraient de l’extrémité des frontières, c’est-à-dire de Lille et de Landau, pour aboutir à Paris.
Cette ligne fut prête à fonctionner en fructidor an 2 (août 1794), et les circonstances dans lesquelles la première dépêche fut signalée à la Convention méritent d’être rapportées.
La ville de Condé venait d’être reprise sur les Autrichiens. Le jour même, c’est-à-dire le 1er septembre 1794, à midi, une dépêche partie de la tour Sainte-Catherine, à Lille, arrivait de station en station jusqu’au dôme du Louvre, à Paris, juste au moment où la Convention entrait en séance.
Carnot monta à la tribune, et d’une voix vibrante il annonça qu’il venait de recevoir par le télégraphe la nouvelle suivante:
» Condé est restitué à la République; la reddition a eu lieu ce matin à six heures.»
Cette nouvelle fut accueillie par un tonnerre d’applaudissements, et il n’y eut qu’un cri en l’honneur de l’invention nouvelle, si brillamment inaugurée pour l’honneur et le salut de la patrie.
Le télégraphe aérien de Chappe subit diverses vicissitudes sous le Directoire et l’Empire. Cependant, sous ces gouvernements, comme sous celui de la Restauration, de nombreuses lignes furent établies en France; mais Claude Chappe n’avait pas vu ces développements de sa chère invention. Dégoûté du peu de cas que l’empereur paraissait faire de son télégraphe, cruellement éprouvé, d’ailleurs, par une maladie chronique de la vessie, il s’abandonna au désespoir, et se coupa la gorge le 25 janvier 1805. Outre le monument typique qui lui a été élevé au Père-Lachaise, il existe dans la cour intérieure de l’administration des lignes télégraphiques, sise rue de Grenelle-Saint-Germain, et sous la haute tour des signaux d’où sont parties tant de dépêches historiques, il existe, disons-nous, un petit monument qui marque l’endroit où Claude Chappe commit son suicide.
Les frères de Claude, Ignace et René, furent nommés administrateurs, aux appointements de 8 000 francs par an. Ils durent se résigner à donner leur démission en 1830, lorsqu’une ordonnance royale du mois d’octobre eut nommé M. Marchal administrateur provisoire des télégraphes, et à dater de cette époque, jusqu’en 1848, la télégraphie aérienne subit un temps d’arrêt. M. Ferdinand Flocon fut nommé, à cette époque, administrateur des télégraphes, et remplacé en 1849 par M. Alphonse Foy, qui l’avait d’ailleurs précédé sous Louis-Philippe. Ce fut ce dernier qui eut l’honneur d’introduire la télégraphie électrique en France. Il imposa toutefois à M. Bréguet la construction d’un appareil français reproduisant les signaux du télégraphe aérien. Ce problème ardu fut résolu de la façon la plus élégante par M. Bréguet; mais l’appareil à signaux devint bientôt uniquement alphabétique, c’est-à-dire que les signaux du télégraphe aérien furent promptement réduits aux vingt-cinq lettres de l’alphabet, augmentées de chiffres et autres signaux qui se retrouvent dans tous les autres systèmes.
La télégraphie aérienne servit encore à nos troupes pendant la guerre de Crimée, et M. l’inspecteur Carette l’utilisa en cette occasion comme télégraphe de campagne. La télégraphie sous-marine, alors à peine âgée de deux ans, avait d’ailleurs été apportée en Crimée par les Anglais, qui avaient relié Varna à Balaclava par un fil de gutta-percha nu submergé dans la mer Noire, et qui dura environ six mois. La vieille et la nouvelle télégraphie se trouvaient donc en présence dans cette circonstance. La télégraphie aérienne avait fait son temps, et disparut complètement depuis.
Les nations européennes ont eu, elles aussi, des télégraphes aériens ou visuels qui, bien qu’inférieurs au système de Chappe, ont pu rendre des services importants aux communications lointaines. Il n’est pas nécessaire de relater ici ces inventions, qui sont similaires au télégraphe aérien.
Notre époque n’a pas abandonné la télégraphie visuelle. Des systèmes de communications optiques ont été récemment appliqués, surtout pendant les dernières guerres, et les tentatives faites par la télégraphie administrative française en 1870 ont permis des communications entre le Havre et Honfleur, après la rupture du câble sous-marin, et dans certains autres endroits, notamment entre Paris et ses forts détachés. Les Prussiens se servirent aussi de signaux verts et rouges pendant le siège de Belfort. Le comité d’initiative pour la défense nationale de Marseille proposa, en novembre 1870, au gouvernement de Tours, un système de signaux de nuit basé sur l’émission de rayons brefs ou longs permettant l’emploi du code Morse. Cette proposition fut étudiée à Tours par la commission spéciale nommée à cet effet. L’auteur avait en vue de communiquer de Paris au dehors par-dessus la première ligne d’investissement des armées prussiennes. Cette première ligne ne dépassant pas alors un rayon d’environ quarante kilomètres, les communications eussent été possibles si l’on avait su se décider à temps. L’étendue considérable donnée à la seconde ligne d’investissement fit abandonner le projet par son auteur. Dans l’intervalle, M. Lissajous, parti de Paris en ballon avec un projet similaire, apportait à la province une preuve de l’entente qu’il eût été si facile d’établir. Il fit construire par M. Santi, l’habile opticien de Marseille, des appareils de télégraphie optique reposant sur les mêmes principes, mais qui sont restés sans emploi, du moins pendant la guerre. Ces appareils ont été repris depuis par la télégraphie militaire, et servent actuellement à notre armée.
Fig. 2. — Télégraphe aérien.
Fig. 3.
L’administration des télégraphes militaires fait faire des expériences journalières à l’école militaire de Saumur, et chaque année on expérimente plus en grand, au camp de Saint-Maur; pour le présent, on a adopté le modèle présenté par M. le colonel Mangin; en voici la description. Une boîte rectangulaire A est divisée en deux parties égales par le diaphragme B, qui est percé d’un trou rond très petit en C. La partie antérieure de la caisse possède sur la face une lentille convexe. Suivant les cas, ces lentilles ont 0m.14, 0m.24 et 0m.35 de diamètre. Les deux premiers diamètres sont les plus usités. Devant le trou C est placé un obturateur D, pouvant se mouvoir sur un axe de façon à découvrir ou à obstruer l’orifice au moyen d’une manette à balancier aboutissant au dehors au manipulateur M. Il suffit de donner un petit coup à la manette sur la boîte pour que l’obturateur se soulève; il retombe ensuite en place par son propre poids. La seconde chambre de la caisse comprend une lampe et un réflecteur qui renvoie vers elle les rayons de lumière qui se trouveraient autrement perdus. On comprend aisément le jeu de l’appareil de nuit: il suffit, en effet, d’imprimer à la manette des mouvements longs ou brefs pour émettre des éclats longs et brefs reproduisant les traits et les points du code Morse. Une lunette L, placée à l’extérieur de la boîte sert à la recherche de la station correspondante. Il suffit de balayer l’horizon avec l’appareil, en lui imprimant de légers mouvements verticaux, pour trouver sans peine le rayon de lumière permanent qui les désigne. Car, au moment de la recherche, les deux stations soulèvent d’une façon permanente leur obturateur D. Il est nécessaire que la lunette L soit absolument parallèle au rayon de lumière émis par la lampe. Elle est donc fixée à la caisse d’une façon permanente, et possède d’ailleurs des vis de rappel qui permettent, en fixant un point quelconque de l’horizon, d’en obtenir l’image sur un verre dépoli qui s’ajuste au fond de la seconde chambre comme dans un appareil photographique. Lorsque cette image se trouve à la croisée des deux fils perpendiculaire et vertical de cette plaque, et qu’on peut la voir en même temps dans la lunette, le parallélisme des appareils est parfait.
On se sert du même appareil pour le jour, mais alors la lampe est enlevée, et l’on ajuste à sa place une lentille destinée à concentrer les rayons du soleil au foyer même de la lampe. Dans les appareils dont la lentille de face a 0m.14 de diamètre, deux petits miroirs plans, qui s’ajustent à la main, dirigent convenablement à sa place la lumière solaire. Le mouvement solaire diurne nécessite dans ce cas une modification du plan des miroirs; mais ici elle se fait de cinq en cinq minutes, au moyen d’une légère rectification qu’on opère facilement avec la main. Dans les appareils plus grands, un héliostat fixe, situé sur la partie supérieure de la caisse, et muni d’un appareil d’horlogerie qui permet au miroir de suivre le mouvement apparent du soleil, dirige également la lumière solaire à son foyer principal. Dans les temps sombres, on peut très bien communiquer de jour avec l’appareil de nuit, la lampe à pétrole suffisant à donner des signaux perceptibles, même à la distance de 20 kilomètres.
Fig. 4.
On a essayé de nombreux appareils au camp de Saint-Maur. Un, entre autres, à lumière polarisée, dont les signaux sont produits par la polarisation de la lumière chaque fois qu’un prisme est introduit dans le rayon par la station correspondante. Il en résulte que le jet permanent de lumière, restant toujours fixe, ne permet pas aux étrangers qui le perçoivent de saisir les signaux.
Un système italien à feux vert et rouge a aussi été essayé avec succès. Là encore le rayon de lumière fixe n’est pas éclipsé, mais bien coloré par l’introduction dans le faisceau lumineux des lentilles verte ou rouge, que l’opérateur tient à la main et manœuvre comme des baguettes de tambour.
Enfin, M. Mercadier a produit un appareil dans lequel la combustion de la lampe est considérablement activée par un jet d’oxygène. Un appareil de ce genre, inventé par M. Walker, existe depuis longtemps en Angleterre; on le construit à Silvertown, et il comprend même l’appareil nécessaire à la production de l’oxygène en campagne.
Dans tous ces systèmes, la vitesse des transmissions s’élève de 12 à 15 mots par minute et peut être portée à 20 mots par des employés expérimentés.
On avait manifesté la crainte que l’impression des signaux visuels sur la rétine imposât une grande lenteur de transmission: c’est là une appréhension dont la pratique a démontré l’erreur. Le collage qui se produit quelquefois dans les signaux n’est dû qu’à une mauvaise manipulation. De même qu’un employé qui transmet au Morse, sur un câble un peu long, doit être parfaitement pénétré des effets produits sur la ligne par l’émission des courants et régler sa manipulation en conséquence, de même aussi l’opérateur du Morse visuel doit espacer ses signaux de manière à les rendre très nets à la vision. A cet égard, la manette de l’appareil du colonel Mangin nous semble mal construite, et pourrait être aisément modifiée de manière à présenter absolument la forme et les effets de la clef Morse ordinaire.
L’héliographe inventé par M. Leseurre, inspecteur des lignes télégraphiques, a été utilisé pour la première fois en Algérie.
Le maréchal Vaillant a exposé cet appareil devant l’Académie des sciences (Comptes rendus, séance du 16 juin 1856). M. Leseurre a d’ailleurs décrit lui-même son appareil dans le numéro d’octobre 1855 des Annales télégraphiques. M. Leseurre, qui mourut malheureusement en 1864 , à Pau, âgé seulement de trente-six ans, avait surtout en vue l’établissement de télégraphes dans le sud de l’Algérie, où il n’était guère possible alors de construire des lignes électriques ou même des télégraphes aériens.
Le soleil, dont la continuelle présence créait, dans le sud de l’Algérie, un sol exceptionnel, inaccessible aux procédés télégraphiques ordinaires, offrait aussi une source de signaux exceptionnelle, plus puissante que les moyens aériens du système Chappe. Des miroirs, empruntant au soleil sa lumière, peuvent lancer des éclairs qui, convenablement dirigés, forment et peuvent même écrire des signaux.
La puissance de cette source de signaux est sans autre limite que la rotondité de la terre et l’absorption de lumière qui se produit par les couches atmosphériques du sol.
Mais pour que son emploi soit réellement utile, il faut qu’un appareil simple, d’une manœuvre sûre et rapide, permette à des hommes d’une intelligence ordinaire de renvoyer la lumière exactement dans une direction donnée.
Fig. 5.
M. Leseurre avait résolu ce problème d’une façon très élégante. La figure ci-jointe donne une idée de son appareil, que nous allons, d’ailleurs, décrire. Afin de pouvoir correspondre auss bien aux premières et aux dernières heures du jour. qu’en plein midi, M. Leseurre, se rappelant que le soleil, dans son mouvement diurne, décrit un cercle autour de l’axe polaire, avait placé, dans la direction polaire, un axe portant un miroir dont la normale faisait avec cet axe un angle égal à la moitié de la distance du soleil au pôle. En faisant tourner cet axe sur ses coussinets, chaque fois que, dans ce mouvement, la normale du miroir passera dans le méridien actuellement occupé par le soleil, le faisceau réfléchi jaillira vers le pôle.
En plaçant un second miroir, dont le centre se trouve sur le prolongement de l’arbre du premier et dont la direction soit telle qu’il réfléchisse vers la station correspondante les rayons solaires réfléchis une première fois suivant la direction polaire, ce second miroir, de position évidemment fixe, complète l’appareil.
Fig. 5 bis.
Rien de plus simple alors que la manœuvre; il suffit de faire exécuter à l’arbre du miroir mobile autant de rotations qu’on veut produire d’éclairs. M. Leseurre avait aussi imaginé un écran formé de persiennes mobiles. Si les lames de la persienne étaient ouvertes, le faisceau passait, sinon il était arrêté. Une manette a manœuvrait l’ensemble des lames.
Quant à la masse de lumière réfléchie, elle ne change pas pendant la journée, puisque l’inclinaison du miroir tournant sur le rayon réfléchi reste constante et égale. Mais comme la déclinaison solaire varie chaque jour, M. Leseurre avait disposé, en avant du miroir tournant, une lunette dont l’axe optique était bien parallèle à celui du miroir. En observant les rayons réfléchis à l’aide de cette lunette, on s’assure que le centre de l’image solaire vient se placer sur le point de croisée des fils. Le réglage est facilité par l’addition, dans le réticule, de deux fils parallèles à l’essieu du miroir, et distants du point de croisée d’un rayon de l’image solaire. On reconnaît, en effet, très simplement qu’aux environs de la position d’éclair, le soleil réfléchi paraît décrire, lorsque le miroir se meut, une bande parallèle à l’essieu du miroir.
L’appareil de M. Leseurre n’a pas fonctionné en Algérie d’une façon définitive, mais il fut essayé, avec des résultats parfaits, à l’Observatoire de Paris, en présence du directeur de cet établissement, du ministre de la guerre et du directeur général des lignes télégraphiques.
L’appareil pouvait enregistrer les signaux Chappe, au moyen de conventions, aussi bien que les émissions longues et brèves qui constituent l’alphabet Morse.
Reprenant l’idée de Leseurre, M. Henri C. Mance, électricien du télégraphe sous-marin du golfe Persique, est parvenu à faire adopter aux armées anglaises combattant dans l’Afghanistan un système similaire qui paraît avoir rendu d’excellents services.
L’instrument, posé sur un trépied léger mais solide, consiste en un plateau mobile susceptible de mouvements rapides ou lents qui lui sont communiqués par un écrou tangentiel. Un miroir, supporté par une tige aboutissant à un arc de demi – cercle sur lequel il pivote, est percé au centre de façon à viser l’avant de l’appareil par l’arrière. Sur le plateau, une clef Morse ordinaire est reliée à la partie supérieure du miroir concentrique par une tige d’acier qui peut s’allonger ou se raccourcir à volonté et qui est destinée à communiquer ses mouvements au miroir. L’appareil peut d’ailleurs être réglé suivant les mouvements du soleil et l’endroit vers lequel on désire diriger les signaux Le levier de la clef Morse change l’inclinaison du miroir, de façon à lancer les rayons solaires réfléchis sur un point donné. Le miroir peut, d’ailleurs, être mû à la main et ramené ainsi à sa position correcte ou approximativement. La révolution complète du miroir sert, comme dans le système de Leseurre, à balayer l’horizon d’un faisceau de lumière solaire qui attire l’attention de la station correspondante.
Fig. 6,
A environ quatre mètres en avant de l’appareil, se trouve une mire servant de repère entre le centre de l’héliographe et la station correspondante. Sur cette mire se trouvent deux haussières dont l’une est élevée ou abaissée, jusqu’à ce que. le miroir et la station correspondante se trouvent en ligne avec elle. La seconde porte une traverse en bois, d’environ un pied de long, placée à angle droit avec la mire. Quand l’appareil est au repos, c’est sur cette pièce de bois que vient se porter le rayon de soleil réfléchi par le mirroir. Mais aussitôt que la clef Morse est mise en mouvement, ce rayon est transporté sur la haussière supérieure placée dans la ligne de communication. L’employé qui transmet, en voyant la haussière supérieure s’éclairer chaque fois qu’il presse la clef, peut être sûr que ses signaux parviennent exactement à la station correspondante. Les signaux de cet appareil ont pu être perçus à 50 milles de distance, en Angleterre; aux Indes et dans les climats similaires ils se perçoivent à 70 et 100 milles anglais de distance, et la rotondité de la terre paraît être le seul obstacle à leur portée. Les modifications à apporter à la direction du miroir, par suite du mouvement diurne du soleil, peuvent s’opérer pendant la transmission même au moyen d’ajustements spéciaux.
On remarquera que la haussière supérieure oblitère les rayons lumineux à la station correspondante, lorsque la clef Morse est pressée. Le système transmet donc ses signaux par oblitération, c’est-à-dire que les rayons solaires réfléchis par le miroir indiquent constamment à la station correspondante la position du poste opposé, mais que du moment où cette lumière disparaît, c’est parce que l’on transmet. C’est à peu près là toute la nouveauté du système; l’application de la clef Morse à un système de correspondance lumineux date de plus loin, et avait été pratiquée, dès 1863, par la flotte chargée de la pose des câbles sous-marins du golfe Persique. MM. Lissajous et Ternant avaient, d’ailleurs, proposé des systèmes de télégraphie optique à lumière mise en évidence par une clef Morse, en 1870, et l’application que M. Henri C. Mance en a faite à son système date au plus tôt de 1877 .
L’appareil héliographique de M. Mance ne pèse que six livres anglaises et peut être transporté par un soldat. Il a l’avantage de pouvoir servir entre une avant-garde et un corps d’armée, et il a remplacé, dans le Zoulouland et l’Afghanistan, les signaux à drapeau de l’armée anglaise entre les corps détachés. Il a été utilisé partout où le télégraphe électrique n’a pu être employé, et, bien qu’il ait parfois fait défaut par suite de l’absence du soleil, il a pu souvent servir, même sous un ciel nuageux, à de petites distances.
Sir W. Thomson a récemment examiné, dans une conférence faite à la «Ship-Master’s Society», les divers genres de signaux lumineux actuellement en usage pour permettre de distinguer les phares.
Il a émis l’opinion que, ni les feux tournants de durée déterminée, ni les feux à éclats séparés par intervalles de trois à quatre minutes, n’étaient suffisants pour assurer la sécurité des navires, et qu’il en était de même des feux colorés.
Pour vaincre la difficulté, sir W. Thomson propose d’employer un système d’éclipsés lumineuses produites par des écrans tournants ou un appareil mécanique à extinctions intermittentes. Le système serait basé sur l’alphabet Morse, et chaque phare serait représenté par une lettre. L’éminent physicien a d’ailleurs cité, à l’appui de sa thèse, les bons résultats obtenus avec ce système, depuis trois ans, au phare de «Holly Wood Bank», sur le banc de Belfast, où les signaux consistent en deux courtes éclipses suivies d’une longue, et sont produits à l’aide d’un anneau de cuivre tournant qui porte une série d’écrans et qui est mis en mouvement par un engrenage.
En effet, ce système paraît très rationnel: un phare, qui enverrait ainsi des signaux intermittents formant, par exemple, la première ou les deux premières lettres de son nom d’après l’alphabet Morse, serait immédiatement reconnu par tout marin qui sait déjà à l’avance à peu près dans quelle région il se trouve; et l’on pourrait former ainsi aisément un code international de signaux dont l’utilité paraît évidente pour la sécurité de la navigation.
En un mot, c’est là un système qui s’impose et qui ne peut tarder à être adopté, d’autant plus que-son adaptation aux phares existants n’offre aucune difficulté et ne peut causer qu’un supplément de dépenses insignifiant.
Il en sera de même, sans doute, dans la marine. On finira évidemment par établir la lumière électrique sur tous les bâtiments où se trouve une machine à vapeur, et l’emploi de signaux intermittents dans le système Morse, pour caractériser chaque navire et sa nationalité, paraît devoir présenter une grande utilité, soit pour les manœuvres en escadre, soit pour les correspondances à distance dans les ports, soit enfin pour éviter les collisions terribles qui ne sont encore que trop fréquentes.
Ainsi donc, soit en télégraphie, soit dans le service des phares, soit dans la marine, l’emploi de signaux lumineux intermittents paraît indispensable, et la production de ces signaux à l’aide d’écrans mobiles, comme on le fait actuellement dans la télégraphie militaire, peut s’effectuer sans peine et sans inconvénients pratiques.