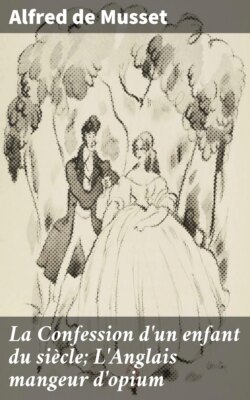Читать книгу La Confession d'un enfant du siècle; L'Anglais mangeur d'opium - Alfred de Musset - Страница 7
CHAPITRE IV
ОглавлениеLe lendemain, au lever du soleil, la première pensée qui me vint fut de me demander: «Que ferai-je à présent?»
Je n’avais point d’état, aucune occupation. J’avais étudié la médecine, le droit, sans pouvoir me décider à prendre l’une ou l’autre de ces deux carrières; j’avais travaillé six mois chez un banquier, avec une telle inexactitude que j’avais été obligé de donner ma démission à temps pour n’être pas renvoyé. J’avais fait de bonnes études, mais superficielles, ayant une mémoire qui veut de l’exercice, et qui oublie aussi facilement qu’elle apprend.
Mon seul trésor, après l’amour, était l’indépendance. Dès ma puberté, je lui avais voué un culte farouche, et je l’avais pour ainsi dire consacrée dans mon cœur. C’était un certain jour que mon père, pensant déjà à mon avenir, m’avait parlé de plusieurs carrières, entre lesquelles il me laissait le choix. J’étais accoudé à ma fenêtre, et je regardais un peuplier maigre et solitaire qui se balançait dans le jardin. Je réfléchissais à tous ces états divers, et délibérais d’en prendre un. Je les remuai tous dans ma tête l’un après l’autre jusqu’au dernier, je laissai flotter mes pensées. Il me sembla tout à coup que je sentais la terre se mouvoir, et que la force sourde et invisible qui l’entraîne dans l’espace se rendait saisissable à mes sens; je la voyais monter dans le ciel; il me semblait que j’étais comme sur un navire; le peuplier que j’avais devant les yeux me paraissait comme un mât de vaisseau; je me levai en étendant les bras, et m’écriai: «C’est bien assez peu de chose d’être un passager d’un jour sur ce navire flottant dans l’éther; c’est bien assez peu d’être un homme, un point noir sur ce navire; je serai un homme, mais non une espèce d’homme particulière.» Je jetai mes vêtements comme par un mouvement involontaire, et ainsi nu je me prosternai, en répétant: «Je serai un homme!»
Tel était le premier vœu qu’à l’âge de quatorze ans j’avais prononcé en face de la nature; et depuis ce temps je n’avais rien essayé que par obéissance pour mon père, mais sans pouvoir jamais vaincre ma répugnance.
J’étais donc libre, non par paresse, mais par volonté ; aimant d’ailleurs tout ce qu’a fait Dieu, et bien peu de ce qu’a fait l’homme. Je n’avais connu de la vie que l’amour, du monde que ma maîtresse, et n’en voulais savoir autre chose. Aussi, étant devenu amoureux en sortant du collège, j’avais cru sincèrement que c’était pour ma vie entière, et toute autre pensée avait disparu.
Mon existence était sédentaire. Je passais la journée chez ma maîtresse; mon grand plaisir était de l’emmener à la campagne durant les beaux jours de l’été, et de me coucher près d’elle dans les bois, sur l’herbe ou sur la mousse, le spectacle de la nature dans sa splendeur ayant toujours été pour moi le plus puissant des aphrodisiaques. En hiver, comme elle aimait le monde, nous courions les bals et les masques, en sorte que cette vie oisive ne cessait jamais; et par la raison que je n’avais pensé qu’à elle tant qu’elle m’avait été fidèle, je me trouvai sans une pensée lorsqu’elle m’eut trahi.
Pour donner une idée de l’état où se trouvait alors mon esprit, je ne puis mieux le comparer qu’à un de ces appartements comme on en voit aujourd’hui, où se trouvent rassemblés et confondus des meubles de tous les temps et de tous les pays. Notre siècle n’a point de formes. Nous n’avons donné le cachet de notre temps ni à nos maisons, ni à nos jardins, ni à quoi que ce soit. On rencontre dans les rues des gens qui ont la barbe coupée comme du temps de Henri III, d’autres qui sont rasés, d’autres qui ont les cheveux arrangés comme ceux du portrait de Raphaël, d’autres comme du temps de Jésus-Christ. Aussi les appartements des riches sont des cabinets de curiosités: l’antique, le gothique, le goût de la Renaissance, celui de Louis XIII, tout est pêle-mêle. Enfin nous avons de tous les siècles, hors du nôtre, chose qui n’a jamais été vue à une autre époque; l’éclectisme est notre goût; nous prenons tout ce que nous trouvons, ceci pour sa beauté, cela pour sa commodité, telle autre chose pour son antiquité, telle autre pour sa laideur même; en sorte que nous ne vivons que de débris, comme si la fin du monde était proche.
Tel était mon esprit; j’avais beaucoup lu; en outre, j’avais appris à peindre. Je savais par cœur une grande quantité de choses, mais rien par ordre, de façon que j’avais la tête à la fois vide et gonflée, comme une éponge. Je devenais amoureux de tous les poètes l’un après l’autre; mais, étant d’une nature très impressionnable, le dernier venu avait toujours le don de me dégoûter du reste. Je m’étais fait un grand magasin de ruines, jusqu’à ce qu’enfin, n’ayant plus soif à force de boire la nouveauté et l’inconnu, je m’étais trouvé une ruine moi-même.
Cependant sur cette ruine il y avait quelque chose de bien jeune encore: c’était l’espérance de mon cœur, qui n’était qu’un enfant.
Cette espérance, que rien n’avait flétrie ni corrompue, et que l’amour avait exaltée jusqu’à l’excès, venait tout à coup de recevoir une blessure mortelle. La perfidie de ma maîtresse l’avait frappée au plus haut de son vol, et, lorsque j’y pensais, je me sentais dans l’âme quelque chose qui défaillait convulsivement, comme un oiseau blessé qui agonise.
La société, qui fait tant de mal, ressemble à ce serpent des Indes dont la demeure est la feuille d’une plante qui guérit sa morsure. Elle présente presque toujours le remède à côté de la souffrance qu’elle a causée. Par exemple, un homme qui a son existence réglée, les affaires au lever, les visites à telle heure, le travail à telle autre, l’amour à telle autre, peut perdre sans danger sa maîtresse. Ses occupations et ses pensées sont comme ces soldats impassibles, rangés en bataille sur une même ligne; un coup de feu en emporte un, les voisins se resserrent, et il n’y paraît pas.
Je n’avais pas cette ressource; la nature, ma mère chérie, depuis que j’étais seul me semblait au contraire plus vaste et plus vide que jamais. Si j’avais pu oublier entièrement ma maîtresse, j’aurais été sauvé. Que de gens à qui il n’en faut pas tant pour les guérir! Ceux-là sont incapables d’aimer une femme infidèle, et leur conduite, en pareil cas, est admirable de fermeté. Mais est-ce ainsi qu’on aime à dix-neuf ans, alors que, ne connaissant rien au monde, désirant tout, le jeune homme sent à la fois le germe de toutes les passions? De quoi doute cet âge? à droite, à gauche, là-bas, à l’horizon, partout quelque voix qui l’appelle. Tout est désir, tout est rêverie. Il n’y a réalité qui tienne lorsque le cœur est jeune; il n’y a chêne si noueux et si dur dont il ne sorte une dryade; et si on avait cent bras on ne craindrait pas de les ouvrir dans le vide; on n’a qu’à y serrer sa maîtresse et le vide est rempli.
Quant à moi, je ne concevais pas qu’on fît autre chose que d’aimer; et lorsqu’on me parlait d’une autre occupation je ne répondais pas. Ma passion pour ma maîtresse avait été comme sauvage, et toute ma vie en ressentait je ne sais quoi de monacal et de farouche. Je n’en veux citer qu’un exemple. Elle m’avait donné son portrait en miniature dans un médaillon; je le portais sur le cœur, chose que font bien des hommes; mais, ayant trouvé un jour chez un marchand de curiosités une discipline de fer, au bout de laquelle était une plaque hérissée de pointes, j’avais fait attacher le médaillon sur la plaque et le portais ainsi. Ces clous, qui m’entraient dans la poitrine à chaque mouvement, me causaient une volupté si étrange que j’y appuyais quelquefois ma main pour les sentir plus profondément. Je sais bien que c’est de la folie; l’amour en fait bien d’autres.
Depuis que cette femme m’avait trahi, j’avais ôté le cruel médaillon. Je ne puis dire avec quelle tristesse j’en détachai la ceinture de fer et quel soupir poussa mon cœur lorsqu’il s’en trouva délivré ! «Ah! pauvres cicatrices, me dis-je, vous allez donc vous effacer? Ah! ma blessure, ma chère blessure, quel baume vais-je poser sur toi?»
J’avais beau haïr cette femme, elle était pour ainsi dire dans le sang de mes veines; je la maudissais, mais j’en rêvais. Que faire à cela? que faire à un rêve? quelle raison donner à des souvenirs de chair et de sang? Macbeth, ayant tué Duncan, dit que l’Océan ne laverait pas ses mains; il n’aurait pas lavé mes cicatrices. Je le disais à Desgenais: «Que voulez-vous! dès que je m’endors, sa tête est là sur l’oreiller.»
Je n’avais vécu que par cette femme; douter d’elle, c’était douter de tout; la maudire, tout renier; la perdre, tout détruire. Je ne sortais plus; le monde m’apparaissait comme peuplé de monstres, de bêtes fauves et de crocodiles. A tout ce qu’on me disait pour me distraire, je répondais: «Oui, c’est bien dit, et soyez certain que je n’en ferai rien.»
Je me mettais à la fenêtre et je me disais: «Elle va venir, j’en suis sûr; elle vient; elle tourne la rue; je la sens qui approche. Elle ne peut vivre sans moi, pas plus que moi sans elle. Que lui dirai-je? quel visage ferai-je?» Là-dessus, ses perfidies me revenaient. «Ah! qu’elle ne vienne pas! m’écriais-je; qu’elle n’approche pas! Je suis capable de la tuer.»
Depuis ma dernière lettre, je n’en entendais plus parler. «Enfin que fait-elle? me disais-je. Elle en aime un autre? Aimons-en donc une autre aussi. Qui aimer?» Et, tout en cherchant, j’entendais comme une voix lointaine qui me criait: «Toi, une autre que moi! Deux êtres qui s’aiment, qui s’embrassent, et qui ne sont pas toi et moi! Est-ce que c’est possible? Est-ce que tu es fou?»
«Lâche! me disait Desgenais, quand oublierez-vous cette femme? Est-ce donc une si grande perte? Le beau plaisir d’être aimé d’elle! Prenez la première venue.
— Non, lui répondais-je; ce n’est pas une si grande perte. N’ai-je pas fait ce que je devais? Ne l’ai-je pas chassée d’ici? Qu’avez-vous donc à dire? Le reste me regarde; les taureaux blessés dans le cirque ont la permission d’aller se coucher dans un coin avec l’épée du matador dans l’épaule, et de finir en paix. Qu’est-ce que j’irai faire, dites-moi, là ou là ? Qu’est-ce que c’est que vos premières venues? Vous me montrerez un ciel pur, des arbres et des maisons, des hommes qui parlent, boivent, chantent, des femmes qui dansent et des chevaux qui galopent. Ce n’est pas la vie, tout cela: c’est le bruit de la vie. Allez, allez; laissez-moi le repos.»