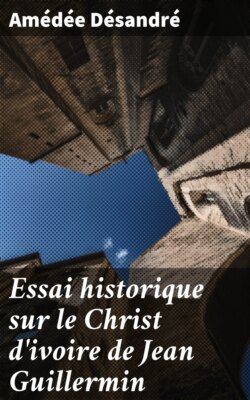Читать книгу Essai historique sur le Christ d'ivoire de Jean Guillermin - Amédée Désandré - Страница 3
I
ОглавлениеEn France on a toujours aimé, beaucoup trop peut-être, la légende historique. — Ce fait, dont la nature est essentiellement abstraite, est né d’une cause qui, pendant de longs siècles, échappa sans doute à l’appréciation de nos aînés, mais que nous pourrions facilement analyser aujourd’hui, si, l’universelle spontanéité avec laquelle il est maintenant accepté partout, ne rendait cette étude pour le moins inutile. Cette cause, du reste, puisant sa force dans les caprices plus ou moins fantaisistes de la grande nation qui est notre mère patrie, a dû toujours marcher de pair avec les progrès, séculairement croissants, de nos aspirations publiques, avec les rêves, longtemps caressés, de nos vieilles gloires nationales. La France, plus noblement positive que ses puissantes sœurs de l’Occident, n’admit jamais la légende historique que comme le poétique reflet, le chevaleresque interprète d’un vaillant passé qui pouvait s’éteindre pour jamais dans les nuits ultérieures des temps écoulés, ou s’engloutir sans retour sous les ruines amoncelées des tempêtes révolutionnaires, sous la cendre sacrilège des haines politiques. Pour la France, la légende fut plutôt un moyen qu’un but, plutôt un levier intelligent qu’un instrument automatique; plus encore, elle fut l’expression, énergiquement conçue, d’un sacerdoce nouveau, dont la mission, bien que terrestre, avait pourtant quelque chose de divin, puisqu’elle rapprochait un peu plus le ciel de notre sphère, en nous transmettant d’âge en âge les providentielles inquiétudes de Dieu sur le passé et l’avenir de nos impérissables annales. Tandis que l’Allemagne, ce colosse si fortement taillé du moyen-âge, prenant par la main la muse légendaire, l’asseyait sur un trône fantastique, et ceignait ses blonds cheveux d’une couronne de fleurs aux parfums funéraires; tandis que les puissances du nord fouillaient stoïquement les secrets de leurs sombres forêts, pour y découvrir, cachée dans un riche manteau d’hermine, la frileuse fée qui devait présider aux veillées des palais et des chaumes, la France, toujours conséquente avec elle-même, plaçait la légende historique sur le trône de Charlemagne, sur lequel l’histoire, son auguste sœur, régnait déjà avec toute la majesté de la force sacrée. Elle traçait à la mystérieuse vagabonde une carrière toute semée de roses épanouies, elle enlevait, avec une sollicitude toute maternelle, les épines cachées qui auraient pu meurtrir ses jolis pieds, et posant sur son front, toujours rajeuni, un de ces baisers qui donnent l’immortalité : «Marche, enfant, lui dit-elle, Dieu et la Patrie sont avec toi.» L’enfant a marché, elle a grandi, et elle domine encore de tout le prestige de sa puissante beauté certaines de nos annales presque contemporaines.
Tel a été, depuis bientôt vingt siècles, le rôle qu’a joué parmi nous la légende historique. Plus ou moins effacée, suivant que les périodes qu’elle traversait étaient plus ou moins intelligentes, elle a cependant toujours eu sa part d’importance sociale. Loin de se réduire sous l’influence civilisatrice, cette part s’est au contraire progressivement étendue, et, nous ne saurions le contester aujourd’hui, elle a compté pour beaucoup dans les premières transformations du pénible édifice que le temps avait à nous construire.
Les historiens et les chroniqueurs des derniers jours de la Gaule romaine n’eurent pas seuls le privilége de transmettre à la postérité les grandes épopées de la légende historique: les peuples voulurent aussi connaître l’aimable muse; ils l’attirèrent, la firent pénétrer sous l’humble chaumière où s’écoulait leur existence, et lui demandèrent de détacher, pour eux, quelques fleurons du frais diadème dont elle ceignait chaque jour le front des rois et des triomphateurs. La fée voyageuse était peu fière; elle leur sourit timidement, et un jour, elle vint s’asseoir, pour ne plus le quitter, au foyer du pauvre, quelquefois même à celui de l’esclave. — Qu’advint-il de cette condescendance de la légende historique? Ce qu’il advient généralement de tous les abus: la confusion dans l’ordre, l’obscurité dans la clarté, la prose là où scintillaient jadis, comme des diamants dans l’ombre, les éclats toujours purs d’une suave poésie. C’est alors que les villes et les monuments qu’elles renferment voulurent avoir leur légende. Qu’on suppute aujourd’hui le nombre de ces ramifications idéalistes par celui des cités qui ont affiché des prétentions au merveilleux, et l’on verra s’il a été plus tard facile de se reconnaître au milieu de ce dédale inextricable de contes plus ou moins acceptables..
La vérité a dû beaucoup souffrir, à coup sûr, de cette influence, longtemps avouée, de la légende historique. Les faits, sinon complètement changés, du moins assez défigurés, de notre histoire secondaire, ne devaient point dès lors se présenter à nous dans toute la force virginale de leur premier accomplissement. Si nos principales gloires, si nos grands héroïsmes, si nos retentissants échecs sont encore purs de toute altération poétique, nous avons à regretter néanmoins qu’une foule d’événements moins importants de notre histoire, par suite de cette fatale tendance de quelques chroniqueurs à grandir leurs œuvres par le merveilleux, échappent encore aujourd’hui au vrai sens d’une sage et impartiale appréciation, à la portée analytique de la déduction philosophique. Aussi cet écueil terrible, contre lequel se sont heurtés les historiens des siècles derniers et bon nombre de celui-ci, est-il sérieusement à redouter pour celui qui veut se donner une idée vraie des révolutions sociales, que chaque jour on lui offre en étude. Il est rare qu’un fait, en dehors du plus ou moins de parti pris politique de l’écrivain qui l’a relaté, ne soit quelque peu entaché du défaut légendaire. Ce défaut, du reste, est si doux à caresser! il plaît tant à l’imagination et au cœur que plus d’un, a, involontairement sans doute, laissé glisser des aspirations nuageuses dans des pages où ne devraient régner que la magique nudité du vrai, que l’imposante immobilité du juste et du vraisemblable. L’histoire profane des hommes et des luttes, souvent fratricides, qu’ils soutiennent pour arriver à la possession d’une plus grande somme de bien commun, n’a jamais rien eu à faire avec la poésie d’une larme d’amour, ou la séduisante beauté d’un sourire. Elle doit être ce que nous sommes, forte de notre forcé, faible de nos faiblesses. — S’il en avait toujours été ainsi, que de crimes, commis à la face du ciel, ne se seraient pas logés, impunis, quelquefois même honorés, dans les plis veloutés d’un manteau d’hermine! que de grandes vertus, encore ignorées, brilleraient aujourd’hui de l’éclat de leur mystérieuse grandeur! En histoire comme en morale, les passions sont toujours mauvaises, leplus souvent mortelles. Or, que sont les légendes, en général, sinon les mélancoliques accords, les harmonieuses intimités d’une passion historiquement expansive? Le poison, quelque doré qu’il soit à sa surface, n’en est pas moins un poison.
Le midi de la France est la patrie, par excellence, de la légende nationale. Sous ce ciel si pur où tout est fleurs et amours, sous ce soleil si beau où la nature, fière de sa fécondité cent fois séculaire, resplendit de toute sa fraîcheur, et déverse partout à profusion les richesses amoncelées qu’elle resserre dans son sein, il n’est pas étonnant que la légende historique, parcourant son royaume, n’ait souri à l’aspect de ces gracieuses promesses et ne se soit dit tout bas: Nous sommes bien ici, restons-y. — Elle y est restée, et chaque pierre, chaque monument nous offre des souvenirs non équivoques de son séjour parmi nous. Il n’est en effet pas de cités, pas d’antiquités monumentales, et souvent pas de familles de notre Provence, qui ne s’énorgueillissent d’avoir arraché quelque riche lambeau du peplum de la fée gauloise pour s’en parer, et les transmettre, plus ou moins frais, aux siècles à venir. Nous ne verrions rien que de très-naturel dans ce fait, s’il n’avait été souvent poussé jusqu’au ridicule le plus accentué de l’exagération méridionale, et parfois jusqu’au mensonge le plus éhonté d’un hideux calcul. Nous aurions beau jeu à prouver ici ce que nous avançons, si le cadre restreint de cet ouvrage nous le permettait, et si la pensée qui nous le fait écrire n’était pas une pensée franchement avouée de réhabilitation historique, un hommage tardivement rendu, c’est vrai, mais enfin rendu une fois pour toutes à la sainte vérité, qui vient de Dieu, une sérieuse et publique protestation contre ce vieil envahissement de la légende dans nos manuscrits et nos archives, alors que les événements ou les faits qu’elle altère sont déjà, par eux-mêmes, très-dignes de l’étude et du respect de tous, parce qu’ils viennent à nous, armés de la toute-puissante vérité.
Avignon, plus que toute autre ville du Comtat et de la Provence, devait fatalement accueillir dans ses murs la légende historique. Les brillantes destinées de ses annales, aussi bien que la merveilleuse beauté de son site, invitaient trop naturellement les nombreux chroniqueurs des pays d’outre-Rhône à venir y continuer le long chapitre des amoureuses rêveries que Pétrarque avait laissé inachevé, pour qu’ils ne répondissent pas au gracieux appel de la cité découronnée. Aussi est-il peu de pays, dans le midi de la France, qui soit aussi riche en légendes de tous genres que l’antique ville papale. Ses gigantesques monuments, fièrement blasonnés de la tiare pontificale, murmurent encore le mâle refrain de ces vieilles ballades si chères à nos ancêtres; dans les profondes fissures de ses tours crénelées, sifflent encore les périodes inachevées d’une plainte déchirante, plainte, hélas! depuis des siècles étouffée! Ses remparts mutilés, semblables à une couronne ébréchée qui reposerait mollement sur un riche coussin de velours effrangé, ses remparts dorment toujours leur sommeil orgueilleux sur le front de l’audacieuse rivale de Rome, tandis que près d’eux glisse encore, vers le soir, mystérieuse et voilée, l’ombre vaporeuse de cette légende aimable, que personnifiaient alors avec tant d’éclat les poètes et les trouvères du moyen-âge.
Dans Avignon, tout est légende au point de vue historique, tout est histoire au point de vue légendaire. La raison de cette curieuse anomalie est bien simple à comprendre: le peuple avignonais, qui a toujours subi, la joie au front et la chanson aux lèvres, les milliers de révolutions intestines qui ont éclaté sur sa tête; ce peuple qui, ébloui par le rayonnement de la tiare trois fois sacrée de son suprême Pontife, semblait défier l’univers entier, ne daignant pas même lui demander compte des sacriléges épouvantes que des rois étrangers, ou des comtes plus ou moins ambitieux lui faisaient capricieusement subir, ce peuple enfin, puissant dans ses murs bastionnés comme le Rhône, son tumultueux voisin, dans son lit de cailloux, ce peuple, disons-nous, n’a jamais eu la pensée de s’instruire sur la nature des faits qu’on lui relatait, de savoir s’ils avaient une certaine raison d’être, ou s’ils étaient tout au moins rappés au coin d’une vraisemblance morale. Que lui importait, à lui, la logique en histoire? Une larme pieusement versée avait plus d’empire sur sa mélancolique organisation que les froids éclats d’un argumentation serrée. Un chaste sourire volé à l’héroïne d’une mystérieuse ballade, fondait, mieux que le feu de la vérité historique, les glaces du temps, et quelques rayons de poésie aidant ces tendances, une croyance obstinée, inébranlable et naïvement expansive, venait dès lors affirmer la véracité de la légende, et la rendre sacrée aux yeux de tous.
Il ne fallut pas davantage que ces diverses combinaisons progressistes de l’esprit et du cœur, chez ce peuple si solidement préparé, pour entraîner des générations entières. Une fois convaincues, elles le furent de bonne foi, si nous en jugeons par ce qui nous reste encore des pieux souvenirs que nous ont transmis nos ancêtres.
Parmi les nombreuses légendes qui, de nos jours encore, enrichissent ce sol, si glorieusement foulé par les successeurs de saint Pierre, il en est une, ou plutôt il en est plusieurs relatives au célèbre Christ d’ivoire, que JEAN GUILLERMIN sculpta dans nos murs en 1659. Bien que deux siècles seulement nous séparent du passage, presqu’ignoré, de l’artiste ivoirier dans la ville pontificale, on dirait presque qu’ils ont vingt fois roulé sur notre tête, tant a été obscure et controuvée, jusqu’à nos jours, l’histoire de ce chef-d’œuvre, tant sont diverses et plus ou moins justes les prétentions de ceux qui croient seuls en connaître l’origine. — Le roman aurait cru manquer à sa mission, s’il ne s’était, lui aussi, emparé de ce fait si essentiellement avignonais, et s’il n’avait tenté d’embrouiller, pour jamais peut-être, le peu de souvenirs historiques qui pouvaient encore nous rester du travail de Jean Guillermin. Romans, légendes, inventions, caprices, tout a été écrit sur lui, tout a été cru, et pourtant, nous l’affirmons en toute connaissance de cause, rien encore de ce qui a été dit et cru à ce sujet n’approche de la vérité.
Pendant que l’imagination des poètes Venaissins brodait à l’envi des chants rhythmés sur les brillants souvenirs du CHRIST de J. Guillermin; pendant que la verve enthousiaste de nos aïeux lui prêtait un passé héroïque, émaillé des plus pittoresques incidents; pendant que l’erreur prenait, à ce sujet, droit de cité parmi nous, la vérité, simple et méconnue, dormait paisiblement dans les archives des délibérations de la Confrérie des Pénitents de la Miséricorde, attendant le grand jour de la réhabilitation. Personne, depuis ce long laps de temps de deux siècles, n’a jamais eu la pensée de se demander s’il n’était pas logique de penser que les Pénitents, fiers de posséder un si étonnant chef-d’œuvre, devaient nécessairement conserver, dans les annales de leur institution, le souvenir seul vrai et seul acceptable de cette origine si étrangement débattue. — On aimait mieux croire à la fantaisie. Elle se prêtait mieux aux rêves et aux caprices de l’imagination. On accepta le rêve et la fantaisie, et l’on se tut. — Sur bien des points, malheureusement plus graves encore, c’est ainsi que souvent, de nos jours, nous avons vu écrire l’histoire.
Heureusement il était réservé à un homme aussi savant que modeste, de dépouiller des erreurs invétérées qui l’entouraient, le berceau historique du Christ d’ivoire de J. Guillermin. Avec cette laborieuse patience, ce loyal amour du vrai et cette savante pratique qui le distingue, M. P. Achard, archiviste de la Préfecture de Vaucluse, après avoir pendant longtemps fouillé, comparé et discuté les nombreux documents dont il a la garde, a trouvé, dans le registre des délibérations de la Confrérie des Pénitents noirs, dits de la Miséricorde, le procès-verbal authentique de la commande, de la raison qui la fit faire et de la remise de ce Christ, ainsi qu’une foule d’autres pièces des plus précieuses, qu’il a bien voulu nous communiquer avec sa bienveillance accoutumée, bienveillance dont nous ne saurions trop lui-être reconnaissant.
L’histoire vraie ne s’invente pas. Aussi nous plaisons-nous à constater que c’est à M. P. Achard et à l’aimable empressement de M. Aug. Deloye, le Conservateur érudit de la bibliothèque et du Muséum-Calvet d’Avignon, que nous devons les documents historiques que nous livrons à l’étude des connaisseurs.
Pour imprimer à la vérité toute la force logique dont elle a besoin dans ces temps de scepticisme, nous avons cru devoir laisser souvent aux pièces qui nous ont été confiées toute la première naïveté de leur allure pittoresque. Nous espérons avoir donné ainsi un attrait de plus à notre travail.
Nous avons apporté aux quelques traductions que nous avons dû faire, la plus scrupuleuse attention; et si cet Essai, tout historique dans son essence, n’offre pas à l’imagination du lecteur les consolantes rêveries, les gracieuses illusions de la légende ou du roman, c’est à l’inexorable puissance de la vérité, au culte que nous avons pour elle, et non à notre volonté, qu’il faut s’en prendre.