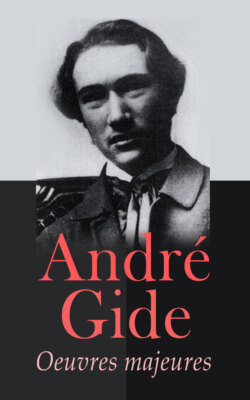Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 103
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Pourquoi parler des premiers jours ? Qu’en reste-t-il ? Leur affreux souvenir est sans voix. Je ne savais plus ni qui, ni où j’étais. Je revois seulement, au-dessus de mon lit d’agonie, Marceline, ma femme, ma vie, se pencher. Je sais que ses soins passionnés, que son amour seul, me sauvèrent. Un jour enfin, comme un marin perdu qui aperçoit la terre, je sentis qu’une lueur de vie se réveillait ; je pus sourire à Marceline. — Pourquoi raconter tout cela ? L’important, c’était que la mort m’eût touché, comme l’on dit, de son aile. L’important, c’est qu’il devînt pour moi très étonnant que je vécusse, c’est que le jour devînt pour moi d’une lumière inespérée. Avant, pensais-je, je ne comprenais pas que je vivais. Je devais faire de la vie la palpitante découverte.
Le jour vint où je pus me lever. Je fus complètement séduit par notre home. Ce n’était presque qu’une terrasse. Quelle terrasse ! Ma chambre et celle de Marceline y donnaient ; elle se prolongeait sur des toits. L’on voyait, lorsqu’on en avait atteint la partie la plus haute, par-dessus les maisons, des palmiers ; par-dessus les palmiers, le désert. L’autre côté de la terrasse touchait aux jardins de la ville ; les branches des dernières cassies l’ombrageaient ; enfin elle longeait la cour, une petite cour régulière, plantée de six palmiers réguliers, et finissait à l’escalier qui la reliait à la cour. Ma chambre était vaste, aérée ; murs blanchis à la chaux, rien aux murs ; une petite porte menait à la chambre de Marceline ; une grande porte vitrée ouvrait sur la terrasse.
Là coulèrent des jours sans heures. Que de fois, dans ma solitude, j’ai revu ces lentes journées !... Marceline est auprès de moi. Elle lit ; elle coud ; elle écrit. Je ne fais rien. Je la regarde. Ô Marceline !... Je regarde. Je vois le soleil ; je vois l’ombre ; je vois la ligne de l’ombre se déplacer ; j’ai si peu à penser, que je l’observe. Je suis encore très faible ; je respire mal ; tout me fatigue, même lire ; d’ailleurs que lire ? Être, m’occupe assez.
Un matin Marceline entre en riant :
— Je t’amène un ami, dit-elle ; et je vois entrer derrière elle un petit Arabe au teint brun. Il s’appelle Bachir, a de grands yeux silencieux qui me regardent. Je suis plutôt un peu gêné, et cette gêne déjà me fatigue ; je ne dis rien, parais fâché. L’enfant, devant la froideur de mon accueil, se déconcerte, se retourne vers Marceline, et, avec un mouvement de grâce animale et câline, se blottit contre elle, lui prend la main, l’embrasse avec un geste qui découvre ses bras nus. Je remarque qu’il est tout nu sous sa mince gandourah blanche et sous son burnous rapiécé.
— Allons ! assieds-toi là, lui dit Marceline qui voit ma gêne. Amuse-toi tranquillement.
Le petit s’assied par terre, sort un couteau du capuchon de son burnous, un morceau de djerid, et commence à le travailler. C’est un sifflet, je crois, qu’il veut faire.
Au bout d’un peu de temps, je ne suis plus gêné par sa présence. Je le regarde ; il semble avoir oublié qu’il est là. Ses pieds sont nus ; ses chevilles sont charmantes, et les attaches de ses poignets. Il manie son mauvais couteau avec une amusante adresse... Vraiment, vais-je m’intéresser à cela ?... Ses cheveux sont rasés à la manière arabe ; il porte une pauvre chéchia qui n’a qu’un trou à la place du gland. La gandourah, un peu tombée, découvre sa mignonne épaule. J’ai le besoin de la toucher. Je me penche ; il se retourne et me sourit. Je fais signe qu’il doit me passer son sifflet, le prends et feins de l’admirer beaucoup. — À présent il veut partir. Marceline lui donne un gâteau, moi deux sous.
Le lendemain, pour la première fois, je m’ennuie ; j’attends ; j’attends quoi ? je me sens désœuvré, inquiet. Enfin je n’y tiens plus :
— Bachir ne vient donc pas, ce matin ?
— Si tu veux, je vais le chercher.
Elle me laisse, descend ; au bout d’un instant, rentre seule. Qu’a fait de moi la maladie ? Je suis triste à pleurer de la voir revenir sans Bachir.
— Il était trop tard, me dit-elle ; les enfants ont quitté l’école et se sont dispersés partout. Il y en a de charmants, sais-tu. Je crois que maintenant tous me connaissent.
— Au moins, tâche qu’il soit là demain.
Le lendemain Bachir revint. Il s’assit comme l’avant-veille, sortit son couteau, voulut tailler un bois trop dur, et fit si bien qu’il s’enfonça la lame dans le pouce. J’eus un frisson d’horreur ; il en rit, montra la coupure brillante et s’amusa de voir couler son sang. Quand il riait, il découvrait des dents très blanches ; il lécha plaisamment sa blessure ; sa langue était rose comme celle d’un chat. Ah ! qu’il se portait bien ! C’était là ce dont je m’éprenais en lui : la santé. La santé de ce petit corps était belle.
Le jour suivant il apporta des billes. Il voulut me faire jouer. Marceline n’était pas là ; elle m’eût retenu. J’hésitai, regardai Bachir ; le petit me saisit le bras, me mit les billes dans la main, me força. Je m’essoufflais beaucoup à me baisser, mais j’essayai de jouer quand même. Enfin je n’en pus plus. J’étais en nage. Je rejetai les billes et me laissai tomber dans un fauteuil. Bachir, un peu troublé, me regardait.
— Malade ? dit-il gentiment ; le timbre de sa voix était exquis. Marceline rentra.
— Emmène-le, lui dis-je ; je suis fatigué, ce matin.
Quelques heures après j’eus un crachement de sang. C’était comme je marchais péniblement sur la terrasse ; Marceline était occupée dans sa chambre ; heureusement elle n’en put rien voir. J’avais fait, par essoufflement, une aspiration plus profonde, et tout à coup c’était venu. Cela m’avait empli la bouche... Mais ce n’était plus du sang clair, comme lors des premiers crachements ; c’était un gros affreux caillot que je crachai par terre avec dégoût.
Je fis quelques pas, chancelant. J’étais horriblement ému. Je tremblais. J’avais peur ; j’étais en colère. — Car jusqu’alors j’avais pensé que, pas à pas, la guérison allait venir et qu’il ne restait qu’à l’attendre. Cet accident brutal venait de me rejeter en arrière. Chose étrange, les premiers crachements ne m’avaient pas fait tant d’effet ; je me souvenais à présent qu’ils m’avaient laissé presque calme. D’où venait donc ma peur, mon horreur, à présent ? C’est que je commençais, hélas ! d’aimer la vie.
Je revins en arrière, me courbai, retrouvai mon crachat, pris une paille et, soulevant le caillot, le déposai sur mon mouchoir. Je regardai. C’était un vilain sang presque noir, quelque chose de gluant, d’épouvantable... Je songeai au beau sang rutilant de Bachir... Et soudain me prit un désir, une envie, quelque chose de plus furieux, de plus impérieux que tout ce que j’avais ressenti jusqu’alors : vivre ! je veux vivre. Je veux vivre. Je serrai les dents, les poings, me concentrai tout entier éperdument, désolément, dans cet effort vers l’existence.
J’avais reçu la veille une lettre de T*** ; en réponse à d’anxieuses questions de Marceline, elle était pleine de conseils médicaux ; T*** avait même joint à sa lettre quelques brochures de vulgarisation médicale et un livre plus spécial, qui pour cela me parut plus sérieux. J’avais lu négligemment la lettre et point du tout les imprimés ; d’abord parce que la ressemblance de ces brochures avec les petits traités moraux dont on avait agacé mon enfance, ne me disposait pas en leur faveur ; parce qu’aussi tous les conseils m’importunaient ; puis je ne pensais pas que ces « Conseils aux tuberculeux », « Cure pratique de la tuberculose » pussent s’appliquer à mon cas. Je ne me croyais pas tuberculeux. Volontiers j’attribuais ma première hémoptysie à une cause différente ; ou plutôt, à vrai dire, je ne l’attribuais à rien, évitais d’y penser, n’y pensais guère, et me jugeais, sinon guéri, du moins près de l’être... Je lus la lettre ; je dévorai le livre, les traités. Brusquement, avec une évidence effarante, il m’apparut que je ne m’étais pas soigné comme il fallait. Jusqu’alors je m’étais laissé vivre, me fiant au plus vague espoir ; — brusquement ma vie m’apparut attaquée, attaquée atrocement à son centre. Un ennemi nombreux, actif, vivait en moi. Je l’écoutai : je l’épiai ; je le sentis. Je ne le vaincrais pas sans lutte... et j’ajoutais à demi-voix, comme pour mieux m’en convaincre moi-même : c’est une affaire de volonté.
Je me mis en état d’hostilité.
Le soir tombait : j’organisai ma stratégie. Pour un temps, seule ma guérison devait devenir mon étude ; mon devoir c’était ma santé ; il fallait juger bon, nommer Bien, tout ce qui m’était salutaire, oublier, repousser tout ce qui ne guérissait pas. — Avant le repas du soir, pour la respiration, l’exercice, la nourriture, j’avais pris des résolutions.
Nous prenions nos repas dans une sorte de petit kiosque que la terrasse enveloppait de toutes parts. Seuls, tranquilles, loin de tout, l’intimité de nos repas était charmante. D’un hôtel voisin, un vieux nègre nous apportait une passable nourriture. Marceline surveillait les menus, commandait un plat, en repoussait tel autre... N’ayant pas très grand’faim d’ordinaire, je ne souffrais pas trop des plats manqués, ni des menus insuffisants. Marceline, habituée elle-même à ne pas beaucoup se nourrir, ne savait pas, ne se rendait pas compte que je ne mangeais pas suffisamment. Manger beaucoup était, de toutes mes résolutions, la première. Je prétendais la mettre à exécution dès ce soir. — Je ne pus. Nous avions je ne sais quel salmis immangeable, puis un rôti ridiculement trop cuit.
Mon irritation fut si vive, que, la reportant sur Marceline, je me répandis devant elle en paroles immodérées. Je l’accusai ; il semblait, à m’entendre, qu’elle eût dû se sentir responsable de la mauvaise qualité de ces mets. Ce petit retard au régime que j’avais résolu d’adopter devenait de la plus grave importance ; j’oubliais les jours précédents ; ce repas manqué gâtait tout. Je m’entêtai. Marceline dut descendre en ville chercher une conserve, un pâté de n’importe quoi.
Elle revint bientôt avec une petite terrine que je dévorai presque entière, comme pour nous prouver à tous deux combien j’avais besoin de manger davantage.
Ce même soir nous arrêtâmes ceci : Les repas seraient beaucoup meilleurs : plus nombreux aussi, un toutes les trois heures ; le premier dès 6½. Une abondante provision de conserves de toutes sortes suppléerait les médiocres plats de l’hôtel...
Je ne pus dormir cette nuit, tant le pressentiment de mes nouvelles vertus me grisait. J’avais, je pense, un peu de fièvre ; une bouteille d’eau minérale était là ; j’en bus un verre, deux verres ; à la troisième fois, buvant à même, j’achevai toute la bouteille d’un coup. Je repassais ma volonté comme une leçon ; j’apprenais mon hostilité, la dirigeais sur toutes choses ; je devais lutter contre tout : mon salut dépendait de moi seul.
Enfin, je vis la nuit pâlir ; le jour parut.
Ç’avait été ma veillée d’armes.
Le lendemain, c’était dimanche. Je ne m’étais jusqu’alors pas inquiété, l’avouerai-je, des croyances de Marceline ; par indifférence ou pudeur, il me semblait que cela ne me regardait pas ; puis je n’y attachais pas d’importance. Ce jour-là Marceline se rendit à la messe. J’appris au retour qu’elle avait prié pour moi. Je la regardai fixement, puis, avec le plus de douceur que je pus :
— Il ne faut pas prier pour moi, Marceline.
— Pourquoi ? dit-elle, un peu troublée.
— Je n’aime pas les protections.
— Tu repousses l’aide de Dieu ?
— Après, il aurait droit à ma reconnaissance. Cela crée des obligations ; je n’en veux pas.
Nous avions l’air de plaisanter, mais ne nous méprenions nullement sur l’importance de nos paroles.
— Tu ne guériras pas tout seul, pauvre ami, soupira-t-elle.
— Alors, tant pis... Puis, voyant sa tristesse, j’ajoutai moins brutalement : — Tu m’aideras.