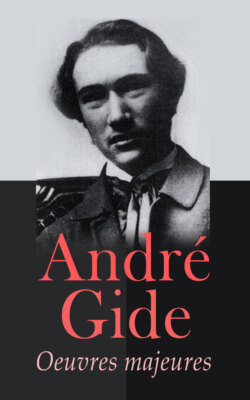Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 106
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
Notre séjour à Biskra ne devait pas se prolonger longtemps encore. Les pluies de février passées, la chaleur éclata trop forte. Après plusieurs pénibles jours, que nous avions vécus sous l’averse, un matin, brusquement, je me réveillai dans l’azur. Sitôt levé je courus à la terrasse la plus haute. Le ciel, d’un horizon à l’autre, était pur. Sous le soleil, ardent déjà, des buées s’élevaient ; l’oasis fumait tout entière ; on entendait gronder au loin l’Oued débordé. L’air était si pur et si beau qu’aussitôt je me sentis aller mieux. Marceline vint ; nous voulûmes sortir, mais la boue ce jour-là nous retînt.
Quelques jours après nous rentrions au verger de Lassif ; les tiges semblaient lourdes, molles et gonflées d’eau. Cette terre africaine, dont je ne connaissais pas l’attente, submergée durant de longs jours, à présent s’éveillait de l’hiver, ivre d’eau, éclatant de sèves nouvelles ; elle riait d’un printemps forcené dont je sentais le retentissement et comme le double en moi-même. Ashour et Moktir nous accompagnèrent d’abord ; je savourais encore leur légère amitié qui ne coûtait qu’un demi-franc par jour ; mais bientôt, lassé d’eux, n’étant plus moi-même si faible que j’eusse encore besoin de l’exemple de leur santé et ne trouvant plus dans leurs jeux l’aliment qu’il fallait pour ma joie, je retournai vers Marceline l’exaltation de mon esprit et de mes sens. À la joie qu’elle en eut, je m’aperçus qu’avant elle était restée triste. Je m’excusai comme un enfant de l’avoir souvent délaissée, mis sur le compte de ma faiblesse mon humeur fuyante et bizarre, affirmai que jusqu’à présent j’avais été trop las pour aimer, mais que je sentirais désormais croître avec ma santé mon amour. Je disais vrai ; mais sans doute j’étais bien faible encore, car ce ne fut que plus d’un mois après que je désirai Marceline.
Chaque jour cependant augmentait la chaleur. Rien ne nous retenait à Biskra — que ce charme qui devait m’y rappeler ensuite. Notre résolution de partir fut subite. En trois heures nos paquets furent prêts. Le train partait le lendemain à l’aube...
Je me souviens de la dernière nuit. La lune était à peu près pleine ; par ma fenêtre grande ouverte elle entrait en plein dans ma chambre. Marceline dormait, je pense. J’étais couché, mais ne pouvais dormir. Je me sentais brûler d’une sorte de fièvre heureuse, qui n’était autre que la vie... Je me levai, trempai dans l’eau mes mains et mon visage, puis, poussant la porte vitrée, je sortis.
Il était tard déjà ; pas un bruit ; pas un souffle ; l’air même paraissait endormi. À peine, au loin, entendait-on les chiens arabes, qui, comme des chacals, glapissent tout le long de la nuit. Devant moi, la petite cour ; la muraille, en face de moi, y portait un pan d’ombre oblique ; les palmiers réguliers, sans plus de couleur ni de vie, semblaient immobilisés pour toujours... Mais on retrouve dans le sommeil encore une palpitation de vie, — ici rien ne semblait dormir ; tout semblait mort. Je m’épouvantai de ce calme ; et brusquement m’envahit de nouveau, comme pour protester, s’affirmer, se désoler dans le silence, le sentiment tragique de ma vie, si violent, douloureux presque, et si impétueux que j’en aurais crié, si j’avais pu crier comme les bêtes. Je pris ma main, je me souviens, ma main gauche dans ma main droite ; je voulus la porter à ma tête et le fis. Pourquoi ? pour m’affirmer que je vivais et trouver cela admirable. Je touchai mon front, mes paupières. Un frisson me saisit. Un jour viendra — pensai-je, — un jour viendra où même pour porter à mes lèvres même l’eau dont j’aurai le plus soif, je n’aurai plus assez de forces... Je rentrai, mais ne me recouchai pas encore ; je voulais fixer cette nuit, en imposer le souvenir à ma pensée, la retenir ; indécis de ce que je ferais, je pris un livre sur ma table, — la Bible, — la laissai s’ouvrir au hasard ; penché dans la clarté de la lune je pouvais lire ; je lus ces mots du Christ à Pierre, ces mots, hélas ! que je ne devais plus oublier : « Maintenant tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux aller ; mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains... » Tu étendras les mains...
Le lendemain, à l’aube, nous partîmes.