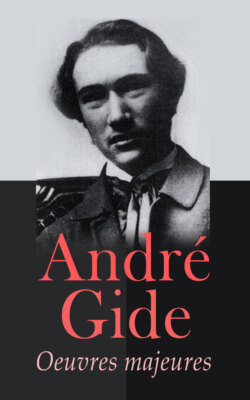Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 108
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеTable des matières
Ainsi me contentais-je pour toute action, tout travail, d’exercices physiques qui, certes, impliquaient ma morale changée, mais qui ne m’apparaissaient déjà plus que comme un entraînement, un moyen, et ne me satisfaisaient plus pour eux-mêmes.
Un autre acte pourtant, à vos yeux ridicule peut-être, mais que je redirai, car il précise en sa puérilité le besoin qui me tourmentait de manifester au dehors l’intime changement de mon être : À Amalfi, je m’étais fait raser.
Jusqu’à ce jour j’avais porté toute ma barbe, avec les cheveux presque ras. Il ne me venait pas à l’idée qu’aussi bien j’aurais pu porter une coiffure différente. Et, brusquement, le jour où je me mis pour la première fois nu sur la roche, cette barbe me gêna ; c’était comme un dernier vêtement que je n’aurais pu dépouiller ; je la sentais comme postiche ; elle était soigneusement taillée, non pas en pointe, mais en une forme carrée, qui me parut aussitôt très déplaisante et ridicule. Rentré dans la chambre d’hôtel, je me regardai dans la glace et me déplus ; j’avais l’air de ce que j’avais été jusqu’alors : un chartiste. Sitôt après le déjeuner, je descendis à Amalfi, ma résolution prise. La ville est très petite : je dus me contenter d’une vulgaire échoppe sur la place. C’était jour de marché ; la boutique était pleine ; je dus attendre interminablement ; mais rien, ni les rasoirs douteux, le blaireau jaune, l’odeur, les propos du barbier, ne put me faire reculer. Sentant sous les ciseaux tomber ma barbe, c’était comme si j’enlevais un masque. N’importe ! quand, après, je m’apparus, l’émotion qui m’emplit et que je réprimai de mon mieux, ne fut pas la joie, mais la peur. Je ne discute pas ce sentiment ; je le constate. Je trouvais mes traits assez beaux... non, la peur venait de ce qu’il me semblait qu’on voyait à nu ma pensée et de ce que, soudain, elle me paraissait redoutable.
Par contre, je laissai pousser mes cheveux.
Voilà tout ce que mon être neuf, encore désœuvré, trouvait à faire. Je pensais qu’il naîtrait de lui des actes étonnants pour moi-même ; mais plus tard ; plus tard, me disais-je, — quand l’être serait plus formé. Forcé de vivre en attendant, je conservais, comme Descartes, une façon provisoire d’agir. Marceline ainsi put s’y tromper. Le changement de mon regard, il est vrai, et, surtout le jour où j’apparus sans barbe, l’expression nouvelle de mes traits, l’auraient inquiétée peut-être, mais elle m’aimait trop déjà pour me bien voir ; puis je la rassurais de mon mieux. Il importait qu’elle ne troublât pas ma renaissance ; pour la soustraire à ses regards, je devais donc dissimuler.
Aussi bien celui que Marceline aimait, celui qu’elle avait épousé, ce n’était pas mon « nouvel être ». Et je me redisais cela, pour m’exciter à le cacher. Ainsi ne lui livrai-je de moi qu’une image qui, pour être constante et fidèle au passé, devenait de jour en jour plus fausse.
Mes rapports avec Marceline demeurèrent donc, en attendant, les mêmes — quoique plus exaltés de jour en jour, par un toujours plus grand amour. Ma dissimulation même (si l’on peut appeler ainsi le besoin de préserver de son jugement ma pensée), ma dissimulation l’augmentait. Je veux dire que ce jeu m’occupait de Marceline sans cesse. Peut-être cette contrainte au mensonge me coûta-t-elle un peu d’abord ; mais j’arrivai vite à comprendre que les choses réputées les pires (le mensonge, pour ne citer que celle-là) ne sont difficiles à faire que tant qu’on ne les a jamais faites ; mais qu’elles deviennent chacune, et très vite, aisées, plaisantes, douces à refaire, et bientôt comme naturelles. Ainsi donc, comme à chaque chose pour laquelle un premier dégoût est vaincu, je finis par trouver plaisir à cette dissimulation même, à m’y attarder, comme au jeu de mes facultés inconnues. Et j’avançais chaque jour, dans une vie plus riche et plus pleine, vers un plus savoureux bonheur.