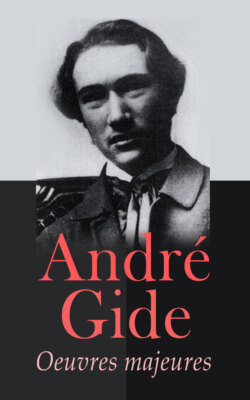Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 133
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JOURNAL D’ALISSA
ОглавлениеTable des matières
Aigues-Vives.
Avant-hier, départ du Havre ; hier, arrivée à Nîmes ; mon premier voyage ! N’ayant aucun souci du ménage ni de la cuisine, dans le léger désœuvrement qui s’ensuit, ce 23 mai 188., jour anniversaire de mes vingt-cinq ans, je commence un journal – sans grand amusement, un peu pour me tenir compagnie ; car, pour la première fois de ma vie peut-être, je me sens seule – sur une terre différente, étrangère presque, et avec qui je n’ai pas encore lié connaissance. Ce qu’elle a à me dire est sans doute pareil à ce que me racontait la Normandie, et que j’écoute infatigablement à Fongueusemare – car Dieu n’est différent de soi nulle part – mais elle parle, cette terre méridionale, une langue que je n’ai pas encore apprise et que j’écoute avec étonnement.
24 mai.
Juliette sommeille sur une chaise longue près de moi – dans la galerie ouverte qui fait le charme de cette maison à l’italienne, de plain-pied avec la cour sablée qui continue le jardin… Juliette, sans quitter sa chaise longue, peut voir la pelouse se vallonner jusqu’à la pièce d’eau où s’ébat un peuple de canards bariolés et où naviguent deux cygnes. Un ruisseau que ne tarit, dit-on, aucun été l’alimente, puis fuit à travers le jardin qui devient bosquet toujours plus sauvage, resserré de plus en plus entre la garrigue sèche et les vignobles, et bientôt complètement étranglé.
… Édouard Teissières a fait visiter hier, à mon père, le jardin, la ferme, les celliers, les vignobles, pendant que je restais auprès de Juliette, – de sorte que ce matin, de très bonne heure, j’ai pu faire, seule, ma première promenade de découverte dans le parc. Beaucoup de plantes et d’arbres inconnus dont pourtant j’aurais voulu savoir le nom. De chacun d’eux je cueille une ramille pour me les faire nommer, au déjeuner. Je reconnais en ceux-ci les chênes verts qu’admirait Jérôme à la villa Borghèse ou Doria-Pamphili… si lointains parents de nos arbres du nord – d’expression si différente ; ils abritent, presque à l’extrémité du parc, une clairière étroite, mystérieuse et se penchent au-dessus d’un gazon doux aux pieds, invitant le chœur des nymphes. Je m’étonne, m’effarouche presque de ce qu’ici mon sentiment de la nature, si profondément chrétien à Fongueusemare, malgré moi devienne un peu mythologique. Pourtant elle était encore religieuse la sorte de crainte qui de plus en plus m’oppressait. Je murmurais ces mots : hic nemus. L’air était cristallin : il faisait un silence étrange. Je songeais à Orphée, à Armide, lorsque tout à coup un chant d’oiseau, unique, s’est élevé, si près de moi, si pathétique, si pur qu’il me sembla soudain que toute la nature l’attendait. Mon cœur battait très fort ; je suis restée un instant appuyée contre un arbre, puis suis rentrée avant que personne encore ne fût levé.
26 mai.
Toujours sans nouvelles de Jérôme. Quand il m’aurait écrit au Havre, sa lettre m’aurait été renvoyée… Je ne puis confier qu’à ce cahier mon inquiétude ; ni la course d’hier aux Baux, ni la prière, depuis trois jours, n’ont pu m’en distraire un instant. Aujourd’hui, je ne peux écrire rien d’autre : l’étrange mélancolie dont je souffre depuis mon arrivée à Aigues-Vives n’a peut-être pas d’autre cause ; – pourtant je la sens à une telle profondeur en moi-même qu’il me semble maintenant qu’elle était là depuis longtemps et que la joie dont je me disais fière ne faisait que la recouvrir.
27 mai.
Pourquoi me mentirais-je à moi-même ? C’est par un raisonnement que je me réjouis du bonheur de Juliette. Ce bonheur que j’ai tant souhaité, jusqu’à offrir de lui sacrifier mon bonheur, je souffre de le voir obtenu sans peine, et différent de ce qu’elle et moi nous imaginions qu’il dût être. Que cela est compliqué ! Si… je discerne bien qu’un affreux retour d’égoïsme s’offense de ce qu’elle ait trouvé son bonheur ailleurs que dans mon sacrifice – qu’elle n’ait pas eu besoin de mon sacrifice pour être heureuse.
Et je me demande à présent, à sentir quelle inquiétude me cause le silence de Jérôme : ce sacrifice était-il réellement consommé dans mon cœur ? Je suis comme humiliée que Dieu ne l’exige plus de moi. N’en étais-je donc point capable ?
28 mai.
Combien cette analyse de ma tristesse est dangereuse ! Déjà je m’attache à ce cahier. La coquetterie, que je croyais vaincue, reprendrait-elle ici ses droits ? Non ; que ce journal ne soit pas le complaisant miroir devant lequel mon âme s’apprête ! Ce n’est pas par désœuvrement, comme je le croyais d’abord, que j’écris, mais par tristesse. La tristesse est un état de péché, que je ne connaissais plus, que je hais, dont je veux décompliquer mon âme. Ce cahier doit m’aider à réobtenir en moi le bonheur.
La tristesse est une complication. Jamais je ne cherchais à analyser mon bonheur.
À Fongueusemare j’étais bien seule aussi, plus seule encore… pourquoi donc ne le sentais-je pas ? Et quand Jérôme m’écrivait d’Italie, j’acceptais qu’il vît sans moi, qu’il vécût sans moi, je le suivais par la pensée et faisais de sa joie la mienne. Je l’appelle à présent malgré moi ; sans lui tout ce que je vois de neuf m’importune…
10 juin.
Longue interruption de ce journal à peine commencé ; naissance de la petite Lise ; longues veillées auprès de Juliette ; tout ce que je peux écrire à Jérôme, je n’ai nul plaisir à l’écrire ici. Je voudrais me garder de cet insupportable défaut commun à tant de femmes : le trop écrire. Considérer ce cahier comme un instrument de perfectionnement.
Suivaient plusieurs pages de notes prises au cours de lectures, passages copiés, etc. Puis, datée de Fongueusemare de nouveau :
16 juillet.
Juliette est heureuse ; elle le dit, le paraît ; je n’ai pas le droit, pas de raison d’en douter… D’où me vient à présent, auprès d’elle, ce sentiment d’insatisfaction, de malaise ? – Peut-être à sentir cette félicité si pratique, si facilement obtenue, si parfaitement sur mesure qu’il semble qu’elle enserre l’âme et l’étouffe…
Et je me demande à présent si c’est bien le bonheur que je souhaite ou plutôt l’acheminement vers le bonheur. Ô Seigneur ! Gardez-moi d’un bonheur que je pourrais trop vite atteindre ! Enseignez-moi à différer, à reculer jusqu’à Vous mon bonheur.
De nombreuses feuilles ensuite avaient été arrachées ; sans doute relataient-elles notre pénible revoir du Havre. Le journal ne reprenait que l’an suivant ; feuillets non datés, mais certainement écrits au moment de mon séjour à Fongueusemare.
Parfois, en l’écoutant parler je crois me regarder penser. Il m’explique et me découvre à moi-même. Existerais-je sans lui ? Je ne suis qu’avec lui…
Parfois j’hésite si ce que j’éprouve pour lui c’est bien ce que l’on appelle de l’amour – tant la peinture que d’ordinaire on fait de l’amour diffère de celle que je pourrais en faire. Je voudrais que rien n’en fût dit et l’aimer sans savoir que je l’aime. Surtout je voudrais l’aimer sans qu’il le sût.
De tout ce qu’il me faut vivre sans lui, rien ne m’est plus d’aucune joie. Toute ma vertu n’est que pour lui plaire et pourtant, près de lui, je sens ma vertu défaillante.
J’aimais l’étude du piano parce qu’il me semblait que je pouvais y progresser un peu chaque jour. C’est peut-être aussi le secret du plaisir que je prends à lire un livre en langue étrangère : non certes que je préfère quelque langue que ce soit à la nôtre ou que ceux de nos écrivains que j’admire me paraissent le céder en rien aux étrangers – mais la légère difficulté dans la poursuite du sens et de l’émotion, l’inconsciente fierté peut-être de la vaincre et de la vaincre toujours mieux, ajoute au plaisir de l’esprit je ne sais quel contentement de l’âme, dont il me semble que je ne puis me passer.
Si bienheureux qu’il soit, je ne puis souhaiter un état sans progrès. Je me figure la joie céleste non comme une confusion en Dieu, mais comme un rapprochement infini, continu… et si je ne craignais de jouer sur un mot, je dirais que je ferais fi d’une joie qui ne serait pas progressive.
Ce matin nous étions assis tous deux sur le banc de l’avenue ; nous ne disions rien et n’éprouvions le besoin de rien dire… Tout à coup, il m’a demandé si je croyais à la vie future.
– Mais, Jérôme, me suis-je écriée aussitôt, c’est mieux pour moi qu’une espérance : c’est une certitude…
Et brusquement il m’a semblé que toute ma foi s’était comme vidée dans ce cri.
– Je voudrais savoir ! a-t-il ajouté… il s’est arrêté quelques instants, puis : – Agirais-tu différemment, sans ta foi ?
– Comment puis-je le savoir, ai-je répondu ; et j’ajoutai : – Mais toi-même, et malgré toi, mon ami, tu ne peux plus agir autrement que tu ne ferais, animé par la foi la plus vive. Et je ne t’aimerais pas, différent.
Non, Jérôme, non, ce n’est pas la récompense future vers quoi s’efforce notre vertu : ce n’est pas la récompense que cherche notre amour. L’idée d’une rémunération de sa peine est blessante à l’âme bien née. La vertu n’est pas non plus pour elle une parure : non, c’est la forme de sa beauté.
Papa va de nouveau moins bien ; rien de grave j’espère, mais il a dû se remettre au lait depuis trois jours.
Hier au soir, Jérôme venait de monter dans sa chambre ; papa, qui prolongeait avec moi la veillée, m’a laissée seule quelques instants. J’étais assise sur le canapé, ou plutôt – ce qui ne m’arrive presque jamais – je m’étais étendue, je ne sais pourquoi. L’abat-jour abritait de la lumière mes yeux et le haut de mon corps ; je regardais machinalement la pointe de mes pieds, qui dépassait un peu ma robe et qu’un reflet de lampe accrochait. Quand papa est rentré, il est resté quelques instants debout devant la porte à me dévisager d’une manière étrange, à la fois souriante et triste. Vaguement confuse, je me suis levée ; alors il m’a fait signe.
– Viens t’asseoir près de moi, m’a-t-il dit et, bien qu’il fût déjà tard, il a commencé à me parler de ma mère, ce qu’il n’avait jamais fait depuis leur séparation. Il m’a raconté comment il l’avait épousée, combien il l’aimait et ce que d’abord elle avait été pour lui.
– Papa, lui ai-je dit enfin, je te supplie de me dire pourquoi tu me racontes cela ce soir, ce qui te fait me raconter cela précisément ce soir…
– Parce que, tout à l’heure, quand je suis rentré dans le salon, et que je t’ai vue, comme tu étais étendue sur le canapé, un instant j’ai cru revoir ta mère.
Si j’insistais ainsi, c’est que, ce même soir… Jérôme lisait par-dessus mon épaule, debout, appuyé contre mon fauteuil, penché sur moi. Je ne pouvais le voir mais sentais son haleine et comme la chaleur et le frémissement de son corps. Je feignais de continuer ma lecture, mais je ne comprenais plus ; je ne distinguais même plus les lignes ; un trouble si étrange s’était emparé de moi que j’ai dû me lever de ma chaise, en hâte, tandis que je le pouvais encore. J’ai pu quitter quelques instants la pièce sans qu’heureusement il se soit rendu compte de rien… Mais quand, un peu plus tard, seule dans le salon, je m’étais étendue sur ce canapé où papa trouvait que je ressemblais à ma mère, précisément alors c’est à elle que je pensais.
J’ai très mal dormi cette nuit, inquiète, oppressée, misérable, obsédée par le souvenir du passé qui remontait en moi comme un remords. Seigneur, enseignez-moi l’horreur de tout ce qui a quelque apparence du mal.
Pauvre Jérôme ! Si pourtant il savait que parfois il n’aurait qu’un geste à faire, et que ce geste parfois je l’attends…
Lorsque j’étais enfant, c’est à cause de lui déjà que je souhaitais d’être belle. Il me semble à présent que je n’ai jamais « tendu à la perfection » que pour lui. Et que cette perfection ne puisse être atteinte que sans lui, c’est, ô mon Dieu ! celui d’entre vos enseignements qui déconcerte le plus mon âme.
Combien heureuse doit être l’âme pour qui vertu se confondrait avec amour ! Parfois je doute s’il est d’autre vertu que d’aimer, d’aimer le plus possible et toujours plus… Mais certains jours, hélas ! la vertu ne m’apparaît plus que comme une résistance à l’amour. Eh quoi ! oserais-je appeler vertu le plus naturel penchant de mon cœur ! Ô sophisme attrayant ! invitation spécieuse ! mirage insidieux du bonheur !
Je lis ce matin dans La Bruyère :
« Il y a quelquefois, dans le cours de la vie, de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis : de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu. »
Pourquoi donc inventai-je ici la défense ? Serait-ce que m’attire en secret un charme plus puissant encore, plus suave que celui de l’amour ? Oh ! pouvoir entraîner à la fois nos deux âmes, à force d’amour, au delà de l’amour !…
Hélas ! Je ne le comprends que trop bien à présent : entre Dieu et lui, il n’est pas d’autre obstacle que moi-même. Si, peut-être, comme il me le dit, son amour pour moi l’inclina vers Dieu tout d’abord, à présent cet amour l’empêche ; il s’attarde à moi, me préfère, et je deviens l’idole qui le retient de s’avancer plus loin dans la vertu. Il faut que l’un de nous deux y parvienne ; et désespérant de surmonter dans mon lâche cœur mon amour, permettez-moi, mon Dieu, accordez-moi la force de lui apprendre à ne m’aimer plus ; de manière qu’au prix des miens, je vous apporte ses mérites infiniment préférables… et si mon âme aujourd’hui sanglote de le perdre, n’est-ce pas pour que, plus tard, je le retrouve en Vous…
Dites, ô mon Dieu ! quelle âme vous mérita jamais davantage ? N’est-il pas né pour mieux que pour m’aimer ? Et l’aimerais-je autant, s’il devait s’arrêter à moi-même ? Combien se rétrécit dans le bonheur tout ce qui pourrait être héroïque !…
Dimanche.
« Dieu nous ayant gardés pour quelque chose de meilleur. »
Lundi 3 mai.
Que le bonheur soit là, tout près, qu’il se propose… n’avoir qu’à allonger la main pour s’en saisir…
Ce matin, causant avec lui, j’ai consommé le sacrifice.
Lundi soir.
Il part demain…
Cher Jérôme, je t’aime toujours de tendresse infinie ; mais jamais plus je ne pourrai te le dire. La contrainte que j’impose à mes yeux, à mes lèvres, à mon âme, est si dure que te quitter m’est délivrance et amère satisfaction.
Je m’efforce d’agir avec raison, mais au moment de l’action, les raisons qui me faisaient agir m’échappent, ou me paraissent folles ; je n’y crois plus…
Les raisons qui me font le fuir ? Je n’y crois plus… Et je le fuis pourtant, avec tristesse, et sans comprendre pourquoi je le fuis.
Seigneur ! nous avancer vers vous, Jérôme et moi, l’un avec l’autre, l’un par l’autre ; marcher tout le long de la vie comme deux pèlerins dont l’un parfois dise à l’autre : « Appuie-toi sur moi, frère, si tu es las », et dont l’autre réponde : « Il me suffit de te sentir près de moi… » Mais non ! la route que vous nous enseignez, Seigneur, est une route étroite – étroite à n’y pouvoir marcher deux de front.
4 juillet.
Voilà plus de six semaines que je n’ai pas rouvert ce cahier. Le mois dernier, en en relisant quelques pages, j’y avais surpris un absurde, un coupable souci de bien écrire… que je lui dois…
Comme si, dans ce cahier que je n’ai commencé que pour m’aider à me passer de lui, je continuais à lui écrire.
J’ai déchiré toutes les pages qui m’ont paru bien écrites. (Je sais ce que j’entends par là.) J’aurais dû déchirer toutes celles où il est question de lui. J’aurais dû tout déchirer… Je n’ai pas pu.
Et déjà d’avoir arraché ces quelques pages, j’ai ressenti un peu d’orgueil… un orgueil dont je rirais, si mon cœur n’était si malade.
Vraiment il semblait que j’eusse là du mérite et que ce que je supprimais fût grand-chose !
6 juillet.
J’ai dû bannir de ma bibliothèque…
De livre en livre je le fuis et le retrouve. Même la page que sans lui je découvre, j’entends sa voix encore me la lire. Je n’ai goût qu’à ce qui l’intéresse, et ma pensée a pris la forme de la sienne au point que je ne sais les distinguer pas plus qu’au temps où je pouvais me plaire à les confondre.
Parfois je m’efforce d’écrire mal, pour échapper au rythme de ses phrases ; mais lutter contre lui, c’est encore m’occuper de lui. Je prends la résolution de ne plus lire pour un temps que la Bible (l’Imitation aussi, peut-être) et de ne plus écrire dans ce carnet que, chaque jour, le verset marquant de ma lecture.
Suivait une sorte de « pain quotidien », où la date de chaque jour, à partir du premier juillet, était accompagnée d’un verset. Je ne transcris ici que ceux qu’accompagnait aussi quelque commentaire.
20 juillet.
« Vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres. » Je comprends qu’il faudrait donner aux pauvres ce cœur dont je ne dispose que pour Jérôme. Et du même coup n’est-ce pas lui enseigner à faire de même ?… Seigneur, donnez-moi ce courage.
24 juillet.
J’ai cessé de lire l’Internelle Consolacion. Cette ancienne langue m’amusait fort, mais me distrayait et la joie quasi païenne que j’y goûte n’a rien à voir avec l’édification que je me proposais d’y chercher.
Repris l’Imitation ; et non point même dans le texte latin, que je suis trop vaine de comprendre. J’aime que ne soit pas même signée la traduction où je la lis – protestante il est vrai, mais « appropriée à toutes les communions chrétiennes », dit le titre.
« Oh ! si tu savais quelle paix tu acquerrais, et quelle joie tu donnerais aux autres en t’avançant dans la vertu, je m’assure que tu y travaillerais avec plus de soin. »
10 août.
Quand je crierais vers Vous, mon Dieu, avec l’élan de la foi d’un enfant et la voix surhumaine des anges…
Tout cela, je le sais, me vient non de Jérôme, mais de Vous.
Mais pourquoi entre Vous et moi, posez-Vous partout son image ?
14 août.
Plus que deux mois pour parachever cet ouvrage… Ô Seigneur aidez-moi !
20 août.
Je le sens bien, je le sens à ma tristesse, que le sacrifice n’est pas consommé dans mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi de ne devoir qu’à Vous cette joie que lui seul me faisait connaître.
28 août.
À quelle médiocre, triste vertu je parviens ! Exigé-je donc trop de moi ? – N’en plus souffrir.
Par quelle lâcheté toujours implorer de Dieu sa force ! À présent toute ma prière est plaintive.
29 août.
« Regardez les lis des champs… »
Cette parole si simple m’a plongée ce matin dans une tristesse dont rien ne pouvait me distraire. Je suis sortie dans la campagne et ces mots que malgré moi je répétais sans cesse emplissaient de larmes mon cœur et mes yeux. Je contemplais la vaste plaine vide où le laboureur penché sur la charrue peinait… « Les lis des champs… » Mais, Seigneur, où sont-ils ?…
16 septembre, 10 heures du soir.
Je l’ai revu. Il est là, sous ce toit. Je vois sur le gazon la clarté qu’y porte sa fenêtre. Pendant que j’écris ces lignes, il veille ; et peut-être qu’il pense à moi. Il n’a pas changé ; il le dit ; je le sens. Saurai-je me montrer à lui telle que j’ai résolu d’être, afin que son amour me désavoue ?…
24 septembre.
Oh ! conversation atroce où j’ai su feindre l’indifférence, la froideur, lorsque mon cœur au dedans de moi se pâmait… Jusqu’à présent, je m’étais contentée de le fuir. Ce matin j’ai pu croire que Dieu me donnerait la force de vaincre, et que me dérober sans cesse à la lutte n’allait pas sans lâcheté. Ai-je triomphé ? Jérôme m’aime-t-il un peu moins ?… Hélas ! c’est ce que j’espère, et que je crains tout à la fois… Je ne l’ai jamais aimé davantage.
Et s’il vous faut, Seigneur, pour le sauver de moi, que je me perde, faites !…
« Entrez dans mon cœur et dans mon âme pour y porter mes souffrances et pour continuer d’endurer en moi ce qui vous reste à souffrir de votre Passion. »
Nous avons parlé de Pascal… Qu’ai-je pu lui dire ? Quels honteux, absurdes propos ! Si je souffrais en les disant déjà, ce soir je m’en repens comme d’un blasphème. J’ai repris le livre pesant des Pensées, qui de lui-même s’est ouvert à ce passage des lettres à Mlle de Roannez :
« On ne sent pas son lien quand on suit volontairement celui qui entraîne ; mais quand on commence à résister et à marcher en s’éloignant on souffre bien. »
Ces paroles me touchaient si directement que je n’ai pas eu la force de continuer ma lecture ; mais ouvrant le livre à un autre endroit, ce fut pour trouver un passage admirable que je ne connaissais pas et que je viens de copier.
Ici s’achevait le premier cahier de ce journal. Sans doute un cahier suivant fut détruit ; car, dans les papiers laissés par Alissa, le journal ne reprenait que trois ans plus tard, à Fongueusemare encore – en septembre – c’est-à-dire peu de temps avant notre dernier revoir.
Les phrases qui suivent ouvrent ce dernier cahier.
17 septembre.
Mon Dieu, vous savez bien que j’ai besoin de lui pour Vous aimer.
20 septembre.
Mon Dieu, donnez-le-moi, afin que je Vous donne mon cœur.
Mon Dieu, faites-le-moi revoir seulement.
Mon Dieu, je m’engage à vous donner mon cœur ; accordez-moi ce que mon amour vous demande. Je ne donnerai plus qu’à Vous ce qui me restera de vie…
Mon Dieu, pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne puis écarter son nom de mes lèvres, ni oublier la peine de mon cœur.
Mon Dieu, je crie à Vous ; ne m’abandonnez pas dans ma détresse.
21 septembre.
« Tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom… »
Seigneur ! en votre nom je n’ose…
Mais si je ne formule plus ma prière, en connaîtrez-vous moins pour cela le délirant souhait de mon cœur ?
27 septembre.
Depuis ce matin un grand calme. Passé presque toute la nuit en méditation, en prière. Soudain il m’a semblé que m’entourait, que descendait en moi une sorte de paix lumineuse, pareille à l’imagination qu’enfant je me faisais du Saint-Esprit. Je me suis aussitôt couchée, craignant de ne devoir ma joie qu’à une exaltation nerveuse ; je me suis endormie assez vite, sans que cette félicité m’eût quittée. Elle est là ce matin tout entière. J’ai maintenant la certitude qu’il viendra.
30 septembre.
Jérôme ! mon ami, toi que j’appelle encore mon frère, mais que j’aime infiniment plus qu’un frère… Combien de fois ai-je crié ton nom dans la hêtraie !… Sortant chaque soir, vers la tombée du jour, par la petite porte du potager, je descends l’avenue déjà sombre… Tu me répondrais soudain, tu m’apparaîtrais là, derrière le talus pierreux qu’avait hâte de contourner mon regard, ou bien je te verrais de loin, assis sur le banc, à m’attendre, mon cœur n’aurait pas un sursaut… au contraire, je m’étonne de ne pas te voir.
1er octobre.
Rien encore. Le soleil s’est couché dans un ciel incomparablement pur. J’attends. Je sais que bientôt, sur ce même banc, je serai assise avec lui… J’écoute déjà sa parole. J’aime tant à l’entendre prononcer mon nom… Il sera là ! Je mettrai ma main dans sa main. Je laisserai mon front s’appuyer contre son épaule. Je respirerai près de lui. Hier déjà, j’avais emporté quelques-unes de ses lettres pour les relire ; mais je ne les ai pas regardées, trop occupée par sa pensée. J’avais également pris sur moi la croix d’améthyste qu’il aimait et que je portais chaque soir, un des étés passés, aussi longtemps que je ne voulais pas qu’il partît.
Je voudrais lui remettre cette croix. Il y a longtemps déjà je faisais ce rêve : lui marié ; moi, marraine de sa première fille, une petite Alissa, à qui je donnais ce bijou… Pourquoi n’ai-je jamais osé le lui dire ?
2 octobre.
Mon âme est légère et joyeuse aujourd’hui comme un oiseau qui aurait fait son nid dans le ciel. C’est aujourd’hui qu’il doit venir ; je le sens, je le sais ; je voudrais le crier à tous ; j’ai besoin de l’écrire ici. Je ne veux plus cacher ma joie. Même Robert, si distrait d’ordinaire et si indifférent à moi, l’a remarquée. Ses questions m’ont troublée et je n’ai su quoi lui répondre. Comment vais-je attendre à ce soir ?…
Je ne sais quel transparent bandeau me présente partout agrandie son image et concentre tous les rayons de l’amour sur un seul point brûlant de mon cœur.
Oh ! que l’attente me fatigue !…
Seigneur ! entr’ouvrez un instant devant moi les larges vantaux du bonheur.
3 octobre.
Tout s’est éteint. Hélas ! il s’est échappé d’entre mes bras, comme une ombre. Il était là ! Il était là ! Je le sens encore. Je l’appelle. Mes mains, mes lèvres le cherchent en vain dans la nuit…
Je ne puis ni prier, ni dormir. Je suis ressortie dans le jardin sombre. Dans ma chambre, dans toute la maison, j’avais peur ; ma détresse m’a ramenée jusqu’à la porte derrière laquelle je l’avais laissé ; j’ai rouvert cette porte avec une folle espérance ; s’il était revenu ! J’ai appelé. J’ai tâtonné dans les ténèbres. Je suis rentrée pour lui écrire. Je ne peux accepter mon deuil.
Que s’est-il donc passé ? Que lui ai-je dit ? Qu’ai-je fait ? Quel besoin devant lui d’exagérer toujours ma vertu ? De quel prix peut être une vertu que mon cœur tout entier renie ? Je mentais en secret aux paroles que Dieu proposait à mes lèvres… De tout ce qui gonflait mon cœur, rien n’est sorti. Jérôme ! Jérôme, mon ami douloureux près de qui mon cœur se déchire, et loin de qui je meurs, de tout ce que je te disais tantôt, n’écoute rien que ce qui te racontait mon amour.
Déchiré ma lettre ; puis récrit… Voici l’aube ; grise, mouillée de pleurs, aussi triste que ma pensée… J’entends les premiers bruits de la ferme et tout ce qui dormait reprend vie… « À présent levez-vous. Voici l’heure… »
Ma lettre ne partira pas.
5 octobre.
Dieu jaloux, qui m’avez dépossédée, emparez-vous donc de mon cœur. Toute chaleur désormais l’abandonne et rien ne l’intéressera plus. Aidez-moi donc à triompher de ce triste restant de moi-même. Cette maison, ce jardin encouragent intolérablement mon amour. Je veux fuir en un lieu où je ne verrai plus que Vous.
Vous m’aiderez à disposer pour vos pauvres de ce que je possédais de fortune ; laissez-moi disposer en faveur de Robert, de Fongueusemare que je ne puis vendre aisément. J’ai bien écrit un testament, mais j’ignore la plupart des formalités nécessaires, et hier je n’ai pu causer suffisamment avec le notaire, craignant qu’il ne soupçonnât la décision que j’ai prise et n’avertît Juliette ou Robert… Je compléterai cela à Paris.
10 octobre.
Suis arrivée ici si fatiguée que j’ai dû rester couchée les deux premiers jours. Le médecin qu’on a fait venir contre mon gré parle d’une opération qu’il juge nécessaire. À quoi bon protester ? mais je lui ai fait aisément croire que cette opération m’effrayait et que je préférais attendre d’avoir repris quelques forces.
J’ai pu cacher mon nom, mon adresse. J’ai déposé au bureau de la maison suffisamment d’argent pour qu’on ne fît point difficulté de me recevoir et de me garder autant de temps que Dieu va le juger encore nécessaire.
Cette chambre me plaît. La parfaite propreté suffit à l’ornement des murs. J’étais tout étonnée de me sentir presque joyeuse. C’est que je n’espère plus rien de la vie. C’est qu’il faut à présent que je me contente de Dieu, et que son amour n’est exquis que s’il occupe en nous toute la place…
Je n’ai pris avec moi d’autre livre que la Bible ; mais aujourd’hui, plus haut que les paroles que j’y lis, résonne en moi ce sanglot éperdu de Pascal :
« Tout ce qui n’est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. »
Ô trop humaine joie que mon cœur imprudent souhaitait… Est-ce pour obtenir ce cri, Seigneur ! que vous m’avez désespérée ?
12 octobre.
Que votre règne vienne ! Qu’il vienne en moi ; de sorte que vous seul régniez sur moi ; et régniez sur moi tout entière. Je ne veux plus vous marchander mon cœur.
Fatiguée comme si j’étais très vieille, mon âme garde une étrange puérilité. Je suis encore la petite fille que j’étais, qui ne pouvait pas s’endormir que tout ne fût en ordre dans sa chambre, et bien pliés au chevet du lit les vêtements quittés…
C’est ainsi que je voudrais me préparer à mourir.
13 octobre.
Relu mon journal avant de le détruire. Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu’ils ressentent. Elle est de Clotilde de Vaux, je crois, cette belle parole.
À l’instant de jeter au feu ce journal, une sorte d’avertissement m’a retenue ; il m’a paru qu’il ne m’appartenait déjà plus à moi-même ; que je n’avais pas le droit de l’enlever à Jérôme ; que je ne l’avais jamais écrit que pour lui. Mes inquiétudes, mes doutes me paraissent si dérisoires aujourd’hui que je ne puis plus y attacher d’importance ni croire que Jérôme puisse en être troublé. Mon Dieu, laissez qu’il y surprenne parfois l’accent malhabile d’un cœur désireux jusqu’à la folie de le pousser jusqu’à ce sommet de vertu que je désespérais d’atteindre.
« Mon Dieu, conduisez-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. »
15 octobre.
« Joie, joie, joie, pleurs de joie… »
Au-dessus de la joie humaine et par delà toute douleur, oui, je pressens cette joie radieuse. Ce rocher où je ne puis atteindre, je sais bien qu’il a nom : bonheur… Je comprends que toute ma vie est vaine sinon pour aboutir au bonheur… Ah ! pourtant vous le promettiez, Seigneur, à l’âme renonçante et pure. « Heureux dès à présent, disait votre sainte parole, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. » Dois-je attendre jusqu’à la mort ? C’est ici que ma foi chancelle. Seigneur ! Je crie à vous de toutes mes forces. Je suis dans la nuit ; j’attends l’aube. Je crie à Vous jusqu’à mourir. Venez désaltérer mon cœur. De ce bonheur j’ai soif aussitôt… Ou dois-je me persuader de l’avoir ? Et comme l’impatient oiseau qui crie par devant l’aurore, appelant plus qu’annonçant le jour, dois-je n’attendre pas le pâlissement de la nuit pour chanter ?
16 octobre.
Jérôme, je voudrais t’enseigner la joie parfaite.
Ce matin une crise de vomissements m’a brisée. Je me suis sentie, sitôt après, si faible qu’un instant j’ai pu espérer de mourir. Mais non ; il s’est d’abord fait dans tout mon être un grand calme ; puis une angoisse s’est emparée de moi, un frisson de la chair et de l’âme ; c’était comme l’éclaircissement brusque et désenchanté de ma vie. Il me semblait que je voyais pour la première fois les murs atrocement nus de ma chambre. J’ai pris peur. À présent encore j’écris pour me rassurer, me calmer. Ô Seigneur ! puissé-je atteindre jusqu’au bout sans blasphème.
J’ai pu me lever encore. Je me suis mise à genoux comme un enfant…
Je voudrais mourir à présent, vite, avant d’avoir compris de nouveau que je suis seule.
J’ai revu Juliette l’an passé. Plus de dix ans s’étaient écoulés depuis sa dernière lettre, celle qui m’annonçait la mort d’Alissa. Un voyage en Provence me fut une occasion de m’arrêter à Nîmes. Avenue de Feuchères, au centre bruyant de la ville, les Teissières habitent une maison d’assez belle apparence. Bien que j’eusse écrit pour annoncer ma venue, j’étais passablement ému en franchissant le seuil.
Une bonne me fit monter dans le salon où, quelques instants après, Juliette vint me rejoindre. Je crus voir la tante Plantier : même démarche, même carrure, même cordialité essoufflée. Elle me pressa tout aussitôt de questions dont elle n’attendait pas les réponses, sur ma carrière, mon installation à Paris, mes occupations, mes relations ; qu’est-ce que je venais faire dans le Midi ? Pourquoi n’irais-je pas jusqu’à Aigues-Vives où Édouard serait si heureux de me voir ?… Puis elle me donnait des nouvelles de tous, parlait de son mari, de ses enfants, de son frère, de la dernière récolte, de la mévente… J’apprenais que Robert avait vendu Fongueusemare, pour venir habiter Aigues-Vives ; qu’il était maintenant l’associé d’Édouard, ce qui permettait à celui-ci de voyager et de s’occuper plus spécialement de la partie commerciale de l’affaire, tandis que Robert restait sur les terres, améliorant et étendant les plants.
Cependant je cherchais des yeux, inquiètement, ce qui pouvait rappeler le passé. Je reconnaissais bien, parmi le mobilier neuf du salon, quelques meubles de Fongueusemare ; mais ce passé qui frémissait en moi, il semblait que Juliette à présent l’ignorât ou prît à tâche de nous en distraire.
Deux garçons de douze et treize ans jouaient dans l’escalier ; elle les appela pour me les présenter. Lise, l’aînée de ses enfants, avait accompagné son père à Aigues-Vives. Un autre garçon de dix ans allait rentrer de promenade ; c’est celui dont Juliette m’avait annoncé la naissance prochaine en m’annonçant aussi notre deuil. Cette dernière grossesse ne s’était pas terminée sans peine ; Juliette en était restée longtemps éprouvée ; puis, l’an passé, comme se ravisant, elle avait donné le jour à une petite fille qu’il semblait, à l’entendre parler, qu’elle préférât à ses autres enfants.
– Ma chambre, où elle dort, est à côté, dit-elle ; viens la voir. Et comme je la suivais : – Jérôme, je n’ai pas osé te l’écrire… consentirais-tu à être parrain de cette petite ?
– Mais j’accepte volontiers, si cela doit t’être agréable, dis-je, un peu surpris, en me penchant vers le berceau. Quel est le nom de ma filleule ?
– Alissa… répondit Juliette à voix basse. Elle lui ressemble un peu, ne trouves-tu pas ?
Je serrai la main de Juliette sans répondre. La petite Alissa, que sa mère soulevait, ouvrit les yeux ; je la pris dans mes bras.
– Quel bon père de famille tu ferais ! dit Juliette en essayant de rire. Qu’attends-tu pour te marier ?
– D’avoir oublié bien des choses ; – et je la regardai rougir.
– Que tu espères oublier bientôt ?
– Que je n’espère pas oublier jamais.
– Viens par ici, dit-elle brusquement, en me précédant dans une pièce plus petite et déjà sombre, dont une porte ouvrait sur sa chambre et l’autre sur le salon. C’est là que je me réfugie quand j’ai un instant ; c’est la pièce la plus tranquille de la maison ; je m’y sens presque à l’abri de la vie.
La fenêtre de ce petit salon n’ouvrait pas, comme celle des autres pièces, sur les bruits de la ville, mais sur une sorte de préau planté d’arbres.
– Asseyons-nous, dit-elle en se laissant tomber dans un fauteuil. – Si je te comprends bien, c’est au souvenir d’Alissa que tu prétends rester fidèle.
Je fus un instant sans répondre.
– Peut-être plutôt à l’idée qu’elle se faisait de moi… Non, ne m’en fais pas un mérite. Je crois que je ne puis faire autrement. Si j’épousais une autre femme, je ne pourrais faire que semblant de l’aimer.
– Ah ! fit-elle, comme indifférente, puis détournant de moi son visage qu’elle penchait à terre comme pour chercher je ne sais quoi de perdu : – Alors tu crois qu’on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ?
– Oui, Juliette.
– Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l’éteindre ?…
Le soir montait comme une marée grise, atteignant, noyant chaque objet qui, dans cette ombre, semblait revivre et raconter à mi-voix son passé. Je revoyais la chambre d’Alissa, dont Juliette avait réuni là tous les meubles. À présent elle ramenait vers moi son visage, dont je ne distinguais plus les traits, de sorte que je ne savais pas si ses yeux n’étaient pas fermés. Elle me paraissait très belle. Et tous deux nous restions à présent sans rien dire.
– Allons ! fit-elle enfin ; il faut se réveiller…
Je la vis se lever, faire un pas en avant, retomber comme sans force sur une chaise voisine ; elle passa ses mains sur son visage et il me parut qu’elle pleurait…
Une servante entra, qui apportait la lampe.