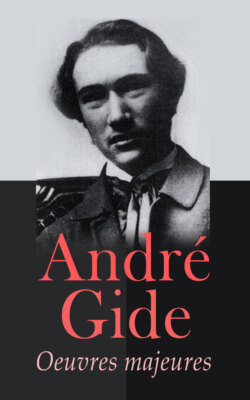Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 131
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеTable des matières
– Alissa t’attend dans le jardin, me dit mon oncle, après m’avoir embrassé paternellement lorsque, à la fin d’avril, j’arrivai à Fongueusemare. Si d’abord je fus déçu de ne pas la trouver prompte à m’accueillir, tout aussitôt après je lui sus gré de nous épargner à tous deux l’effusion banale des premiers instants du revoir.
Elle était au fond du jardin. Je m’acheminai vers ce rond-point, étroitement entouré de buissons, à cette époque de l’année tout en fleurs, lilas, sorbiers, cytises, weigelias ; pour ne point l’apercevoir de trop loin, ou pour qu’elle ne me vît pas venir, je suivis, de l’autre côté du jardin, l’allée sombre où l’air était frais sous les branches. J’avançais lentement ; le ciel était comme ma joie, chaud, brillant, délicatement pur. Sans doute elle m’attendait venir par l’autre allée ; je fus près d’elle, derrière elle, sans qu’elle m’eût entendu approcher ; je m’arrêtai… Et comme si le temps eût pu s’arrêter avec moi : voici l’instant, pensai-je, l’instant le plus délicieux peut-être, quand il précéderait le bonheur même, et que le bonheur même ne vaudra pas…
Je voulais tomber à genoux devant elle ; je fis un pas, qu’elle entendit. Elle se dressa soudain, laissant rouler à terre la broderie qui l’occupait, tendit les bras vers moi, posa ses mains sur mes épaules. Quelques instants nous demeurâmes ainsi, elle, les bras tendus, la tête souriante et penchée, me regardant tendrement sans rien dire. Elle était vêtue toute en blanc. Sur son visage presque trop grave, je retrouvais son sourire d’enfant…
– Écoute, Alissa, m’écriai-je tout d’un coup : j’ai douze jours libres devant moi. Je n’en resterai pas un de plus qu’il ne te plaira. Convenons d’un signe qui voudra dire : c’est demain qu’il faut quitter Fongueusemare. Le lendemain, sans récriminations, sans plaintes, je partirai. Consens-tu ?
N’ayant point préparé mes phrases, je parlais plus aisément. Elle réfléchit un moment, puis :
– Le soir où, descendant pour dîner, je ne porterai pas à mon cou la croix d’améthyste que tu aimes… comprendras-tu ?
– Que ce sera mon dernier soir.
– Mais sauras-tu partir, reprit-elle, sans larmes, sans soupirs…
– Sans adieux. Je te quitterai ce dernier soir comme je l’aurais fait la veille, si simplement que tu te demanderas d’abord : n’aurait-il pas compris ? mais quand tu me chercheras, le lendemain matin, simplement je ne serai plus là.
– Le lendemain je ne te chercherai plus.
Elle me tendit la main ; comme je la portais à mes lèvres :
– D’ici le soir fatal, dis-je encore, pas une allusion qui me fasse rien pressentir.
– Toi, pas une allusion à la séparation qui suivra.
Il fallait à présent rompre la gêne que la solennité de ce revoir risquait d’élever entre nous.
– Je voudrais tant, repris-je, que ces quelques jours près de toi nous paraissent pareils à d’autres jours… Je veux dire : ne pas sentir, tous deux, qu’ils sont exceptionnels. Et puis… si nous pouvions ne pas trop chercher à causer d’abord…
Elle se mit à rire. J’ajoutai :
– N’y a-t-il rien à quoi nous puissions nous occuper ensemble ?
De tout temps nous avions pris plaisir au jardinage. Un jardinier sans expérience remplaçait l’ancien depuis peu, et le jardin, abandonné durant deux mois, offrait beaucoup à faire. Des rosiers étaient mal taillés ; certains, à végétation puissante, restaient encombrés de bois mort ; d’autres, grimpants, croulaient, mal soutenus ; des gourmands en épuisaient d’autres. La plupart avaient été greffés par nous ; nous reconnaissions nos élèves ; les soins qu’ils réclamaient nous occupèrent longuement et nous permirent, les trois premiers jours, de beaucoup parler sans rien dire de grave, et, lorsque nous nous taisions, de ne point sentir peser le silence.
C’est ainsi que nous reprîmes l’habitude l’un de l’autre. Je comptais sur cette accoutumance plus que sur n’importe quelle explication. Le souvenir même de notre séparation déjà s’effaçait entre nous, et déjà diminuaient cette crainte que souvent je sentais en elle, cette contraction de l’âme qu’elle craignait en moi. Alissa, plus jeune qu’à ma triste visite d’automne, ne m’avait jamais paru plus jolie. Je ne l’avais pas encore embrassée. Chaque soir je revoyais sur son corsage, retenue par une chaînette d’or, la petite croix d’améthyste briller. En confiance, l’espoir renaissait dans mon cœur ; que dis-je : espoir ? c’était déjà de l’assurance, et que j’imaginais sentir également chez Alissa ; car je doutais si peu de moi que je ne pouvais plus douter d’elle. Peu à peu nos propos s’enhardirent.
– Alissa, lui dis-je un matin que l’air charmant riait et que notre cœur s’ouvrait comme les fleurs, – à présent que Juliette est heureuse, ne nous laisseras-tu pas, nous aussi…
Je parlais lentement, les yeux sur elle ; elle devint soudain pâle si extraordinairement que je ne pus achever ma phrase.
– Mon ami ! commença-t-elle, et sans tourner vers moi son regard – je me sens plus heureuse auprès de toi que je n’aurais cru qu’on pût l’être… mais crois-moi : nous ne sommes pas nés pour le bonheur.
– Que peut préférer l’âme au bonheur ? m’écriai-je impétueusement. Elle murmura :
– La sainteté… si bas que, ce mot, je le devinai plutôt que je ne pus l’entendre.
Tout mon bonheur ouvrait les ailes, s’échappait de moi vers les cieux.
– Je n’y parviendrai pas sans toi, dis-je, et le front dans ses genoux, pleurant comme un enfant, mais d’amour et non point de tristesse, je repris : pas sans toi ; pas sans toi !
Puis ce jour s’écoula comme les autres jours. Mais au soir, Alissa parut sans le petit bijou d’améthyste. Fidèle à ma promesse, le lendemain, dès l’aube, je partis.
Je reçus le surlendemain l’étrange lettre que voici, portant en guise d’épigraphe ces quelques vers de Shakespeare :
That strain again, – it had a dying fall : O, it came o’er my ear like the sweet south, That breathes upon a bank of violets, Stealing and giving odour. – Enough ; no more, ‘Tis not so sweet now as it was before…
Oui ! malgré moi je t’ai cherché tout le matin, mon frère. Je ne pouvais te croire parti. Je t’en voulais d’avoir tenu notre promesse. Je pensais : c’est un jeu. Derrière chaque buisson, j’allais te voir apparaître. – Mais non ! ton départ est réel. Merci.
J’ai passé le reste du jour obsédée par la constante présence de certaines pensées, que je voudrais te communiquer – et la crainte bizarre, précise, que, si je ne les communiquais pas, j’aurais plus tard le sentiment d’avoir manqué envers toi, mérité ton reproche…
Je m’étonnai, aux premières heures de ton séjour à Fongueusemare, je m’inquiétai vite ensuite de cet étrange contentement de tout mon être que j’éprouvais près de toi ; « un contentement tel, me disais-tu, que je ne souhaite rien au-delà ! » Hélas ! c’est cela même qui m’inquiète…
Je crains, mon ami, de me faire mal comprendre. Je crains surtout que tu ne voies un raisonnement subtil (oh ! combien il serait maladroit) dans ce qui n’est que l’expression du plus violent sentiment de mon âme.
« S’il ne suffisait pas, ce ne serait pas le bonheur » – m’avais-tu dit, t’en souviens-tu ? Et je n’avais su que répondre. – Non, Jérôme, il ne nous suffit pas. Jérôme, il ne doit pas nous suffire. Ce contentement plein de délices, je ne puis le tenir pour véritable. N’avons-nous pas compris cet automne quelle détresse il recouvrait ?…
Véritable ! ah ! Dieu nous garde qu’il le soit ! nous sommes nés pour un autre bonheur…
Ainsi que notre correspondance naguère gâta notre revoir de l’automne, le souvenir de ta présence d’hier désenchante ma lettre aujourd’hui. Qu’est devenu ce ravissement que j’éprouvais à t’écrire ? Par les lettres, par la présence, nous avons épuisé tout le pur de la joie à laquelle notre amour peut prétendre. Et maintenant, malgré moi, je m’écrie comme Orsino du Soir des Rois : « Assez ! pas davantage ! Ce n’est plus aussi suave que tout à l’heure. »
Adieu, mon ami. Hic incipit amor Dei. Ah ! sauras-tu jamais combien je t’aime ?… Jusqu’à la fin je serai ton
ALISSA.
Contre le piège de la vertu, je restais sans défense. Tout héroïsme, en m’éblouissant, m’attirait – car je ne le séparais pas de l’amour… La lettre d’Alissa m’enivra du plus téméraire enthousiasme. Dieu sait que je ne m’efforçais vers plus de vertu, que pour elle. Tout sentier, pourvu qu’il montât, me mènerait où la rejoindre. Ah ! le terrain ne se rétrécirait jamais trop vite, pour ne supporter plus que nous deux ! Hélas ! je ne soupçonnais pas la subtilité de sa feinte, et j’imaginais mal que ce fût par une cime qu’elle pourrait de nouveau m’échapper.
Je lui répondis longuement. Je me souviens du seul passage à peu près clairvoyant de ma lettre.
« Il me paraît souvent, lui disais-je, que mon amour est ce que je garde en moi de meilleur ; que toutes mes vertus s’y suspendent ; qu’il m’élève au-dessus de moi, et que sans toi je retomberais à cette médiocre hauteur d’un naturel très ordinaire. C’est par l’espoir de te rejoindre que le sentier le plus ardu m’apparaîtra toujours le meilleur. »
Qu’ajoutai-je qui pût la pousser à me répondre ceci :
Mais, mon ami, la sainteté n’est pas un choix : c’est une obligation (le mot était souligné trois fois dans sa lettre). Si tu es celui que j’ai cru, toi non plus tu ne pourras pas t’y soustraire.
C’était tout. Je compris, pressentis plutôt, que là s’arrêterait notre correspondance, et que le conseil le plus retors, non plus que la volonté la plus tenace, n’y pourrait rien.
Je récrivis pourtant, longuement, tendrement. Après ma troisième lettre, je reçus ce billet :
Mon ami,
Ne crois point que j’aie pris quelque résolution de ne plus t’écrire ; simplement je n’y ai plus de goût. Tes lettres cependant m’amusent encore, mais je me reproche de plus en plus d’occuper à ce point ta pensée.
L’été n’est plus loin. Renonçons pour un temps à correspondre et viens passer à Fongueusemare les quinze derniers jours de septembre près de moi. Acceptes-tu ? Si oui, je n’ai pas besoin de réponse. Je prendrai ton silence pour un assentiment et souhaite donc que tu ne me répondes pas.
Je ne répondis pas. Sans doute ce silence n’était qu’une épreuve dernière à laquelle elle me soumettait. Quand, après quelques mois de travail, puis quelques semaines de voyage, je revins à Fongueusemare, ce fut avec la plus tranquille assurance.
Comment, par un simple récit, amènerais-je à comprendre aussitôt ce que je m’expliquai d’abord si mal ? Que puis-je peindre ici que l’occasion de la détresse à laquelle je cédai dès lors tout entier ? Car si je ne trouve aujourd’hui nul pardon en moi pour moi-même de n’avoir su sentir, sous le revêtement de la plus factice apparence, palpiter encore l’amour, je ne pus voir que cette apparence d’abord et, ne retrouvant plus mon amie, l’accusai… Non, même alors je ne vous accusai pas, Alissa ! mais pleurai désespérément de ne plus vous reconnaître. À présent que je mesure la force de votre amour à la ruse de son silence et à sa cruelle industrie, dois-je vous aimer d’autant plus que vous m’aurez plus atrocement désolé ?…
Dédain ? Froideur ? Non ; rien qui se pût vaincre ; rien contre quoi je pusse même lutter ; et parfois j’hésitais, doutais si je n’inventais pas ma misère, tant la cause en restait subtile et tant Alissa se montrait habile à feindre de ne la comprendre pas. De quoi donc me fussé-je plaint ? Son accueil fut plus souriant que jamais ; jamais elle ne s’était montrée plus empressée, plus prévenante ; le premier jour je m’y laissai presque tromper… Qu’importait, après tout, qu’une nouvelle façon de coiffure, plate et tirée, durcît les traits de son visage comme pour en fausser l’expression ; qu’un malséant corsage, de couleur morne, d’étoffe laide au toucher, gauchît le rythme délicat de son corps… ce n’était rien à quoi elle ne pût porter remède, et dès le lendemain, pensai-je aveuglément, d’elle-même ou sur ma requête… Je m’affectai davantage de ces prévenances, de cet empressement, si peu coutumiers entre nous, et où je craignais de voir plus de résolution que d’élan, et j’ose à peine dire : plus de politesse que d’amour.
Le soir, entrant dans le salon, je m’étonnai de ne plus retrouver le piano à sa place accoutumée ; à mon exclamation désappointée :
– Le piano est à regarnir, mon ami, répondit Alissa, et de sa voix la plus tranquille.
– Je te l’ai pourtant répété, mon enfant, dit mon oncle sur un ton de reproche presque sévère : puisqu’il t’avait suffi jusqu’à présent, tu aurais pu attendre le départ de Jérôme pour l’expédier ; ta hâte nous prive d’un grand plaisir…
– Mais, père, dit-elle en se détournant pour rougir, je t’assure que, ces derniers temps, il était devenu si creux que Jérôme lui-même n’aurait pu rien en tirer.
– Quand tu en jouais, reprit mon oncle, il ne paraissait pas si mauvais.
Elle resta quelques instants, penchée vers l’ombre, comme occupée à relever les mesures d’une housse de fauteuil, puis quitta brusquement la pièce et ne reparut que plus tard, apportant sur un plateau la tisane que mon oncle avait accoutumé de prendre chaque soir.
Le lendemain elle ne changea ni de coiffure, ni de corsage ; assise près de son père sur un banc devant la maison, elle reprit l’ouvrage de couture, de rapiéçage plutôt qui l’avait occupée déjà dans la soirée. À côté d’elle, sur le banc ou sur la table, elle puisait dans un grand panier plein de bas et de chaussettes usés. Quelques jours après, ce furent des serviettes et des draps… Ce travail l’absorbait complètement, semblait-il, au point que ses lèvres en perdissent toute expression et ses yeux toute lueur.
– Alissa ! m’écriai-je le premier soir, presque épouvanté par la dépoétisation de ce visage qu’à peine pouvais-je reconnaître et que je fixais depuis quelques instants sans qu’elle parût sentir mon regard.
– Quoi donc ? fit-elle en levant la tête.
– Je voulais voir si tu m’entendrais. Ta pensée semblait si loin de moi.
– Non, je suis là ; mais ces reprises demandent beaucoup d’attention.
– Pendant que tu couds, ne veux-tu pas que je te fasse la lecture ?
– Je crains de ne pas pouvoir très bien écouter.
– Pourquoi choisis-tu un travail si absorbant ?
– Il faut bien que quelqu’un le fasse.
– Il y a tant de pauvres femmes pour qui ce serait un gagne-pain. Ce n’est pourtant pas par économie que tu t’astreins à ce travail ingrat ?
Elle m’affirma tout aussitôt qu’aucun ouvrage ne l’amusait davantage, que depuis longtemps elle n’en avait plus fait d’autres, pour quoi sans doute elle avait perdu toute habileté… Elle souriait en parlant. Jamais sa voix n’avait été plus douce que pour ainsi me désoler. « Je ne dis là rien que de naturel, semblait exprimer son visage, pourquoi t’attristerais-tu de cela ? » – Et toute la protestation de mon cœur ne montait même plus à mes lèvres, m’étouffait.
Le surlendemain, comme nous avions cueilli des roses, elle m’invita à les lui porter dans sa chambre où je n’étais pas encore entré cette année. De quel espoir aussitôt me flattai-je ! Car j’en étais encore à me reprocher ma tristesse ; un mot d’elle eût guéri mon cœur.
Je n’entrais jamais sans émotion dans cette chambre ; je ne sais de quoi s’y formait une sorte de paix mélodieuse où je reconnaissais Alissa. L’ombre bleue des rideaux aux fenêtres et autour du lit, les meubles de luisant acajou, l’ordre, la netteté, le silence, tout racontait à mon cœur sa pureté et sa pensive grâce.
Je m’étonnai, ce matin-là, de ne plus voir au mur, près de son lit, deux grandes photographies de Masaccio que j’avais rapportées d’Italie ; j’allais lui demander ce qu’elles étaient devenues, quand mon regard tomba tout auprès sur l’étagère où elle rangeait ses livres de chevet. Cette petite bibliothèque s’était lentement formée moitié par les livres que je lui avais donnés, moitié par d’autres que nous avions lus ensemble. Je venais de m’apercevoir que ces livres étaient tous enlevés, remplacés uniquement par d’insignifiants petits ouvrages de piété vulgaire pour lesquels j’espérais qu’elle n’avait que du mépris. Levant les yeux soudain, je vis Alissa qui riait – oui, qui riait en m’observant.
– Je te demande pardon, dit-elle aussitôt ; c’est ton visage qui m’a fait rire ; il s’est si brusquement décomposé en apercevant ma bibliothèque…
J’étais bien peu d’humeur à plaisanter.
– Non, vraiment, Alissa, est-ce là ce que tu lis à présent ?
– Mais oui. De quoi t’étonnes-tu ?
– Je pensais qu’une intelligence habituée à de substantielles nourritures ne pouvait plus goûter à de semblables fadeurs sans nausée.
– Je ne te comprends pas, dit-elle. Ce sont là d’humbles âmes qui causent avec moi simplement, s’exprimant de leur mieux, et dans la société desquelles je me plais. Je sais d’avance que nous ne céderons, ni elles à aucun piège du beau langage, ni moi, en les lisant, à aucune profane admiration.
– Ne lis-tu donc plus que cela ?
– À peu près. Oui, depuis quelques mois. Du reste je ne trouve plus beaucoup de temps pour lire. Et je t’avoue que, tout récemment, ayant voulu reprendre quelqu’un de ces grands auteurs que tu m’avais appris à admirer, je me suis fait l’effet de celui dont parle l’Écriture, qui s’efforce d’ajouter une coudée à sa taille.
– Quel est ce « grand auteur » qui t’a donné si bizarre opinion de toi ?
– Ce n’est pas lui qui me l’a donnée ; mais c’est en le lisant que je l’ai prise… C’était Pascal. J’étais peut-être tombée sur quelque moins bon passage…
Je fis un geste d’impatience. Elle parlait d’une voix claire et monotone, comme elle eût récité une leçon, ne levant plus les yeux de dessus ses fleurs, qu’elle n’en finissait pas d’arranger. Un instant elle s’interrompit devant mon geste, puis continua du même ton :
– Tant de grandiloquence étonne, et tant d’effort ; et pour prouver si peu. Je me demande parfois si son intonation pathétique n’est pas l’effet plutôt du doute que de la foi. La foi parfaite n’a pas tant de larmes ni de tremblement dans la voix.
– C’est ce tremblement, ce sont ces larmes qui font la beauté de cette voix – essayai-je de repartir, mais sans courage, car je ne reconnaissais dans ces paroles rien de ce que je chérissais dans Alissa. Je les transcris telles que je m’en souviens et sans y apporter après coup art ni logique.
– S’il n’avait pas d’abord vidé la vie présente de sa joie, reprit-elle, elle pèserait plus lourd dans la balance que…
– Que quoi ? fis-je, interdit par ses étranges propos.
– Que l’incertaine félicité qu’il propose.
– N’y crois-tu donc pas ? m’écriai-je.
– Qu’importe ! reprit-elle ; je veux qu’elle demeure incertaine afin que tout soupçon de marché soit écarté. C’est par noblesse naturelle, non par espoir de récompense, que l’âme éprise de Dieu va s’enfoncer dans la vertu.
– De là ce secret scepticisme où se réfugie la noblesse d’un Pascal.
– Non scepticisme : jansénisme, dit-elle en souriant. Qu’avais-je affaire de cela ? Les pauvres âmes que voici – et elle se retournait vers ses livres – seraient bien embarrassées de dire si elles sont jansénistes, quiétistes ou je ne sais quoi de différent. Elles s’inclinent devant Dieu comme des herbes qu’un vent presse, sans malice, sans trouble, sans beauté. Elles se tiennent pour peu remarquables et savent qu’elles ne doivent quelque valeur qu’à leur effacement devant Dieu.
– Alissa ! m’écriai-je, pourquoi t’arraches-tu les ailes ?
Sa voix restait si calme et naturelle que mon exclamation m’en parut d’autant plus ridiculement emphatique.
Elle sourit de nouveau, en secouant la tête.
– Tout ce que j’ai retenu de cette dernière visite à Pascal…
– Quoi donc ? demandai-je, car elle s’arrêtait.
– C’est ce mot du Christ : « Qui veut sauver sa vie la perdra. » Pour le reste, reprit-elle en souriant plus fort et en me regardant bien en face, en vérité je ne l’ai presque plus compris. Quand on a vécu quelque temps dans la société de ces petits, c’est extraordinaire combien vite la sublimité des grands vous essouffle.
Dans mon désarroi n’allais-je trouver rien à répondre ?…
– S’il me fallait aujourd’hui lire avec toi tous ces sermons, ces méditations…
– Mais, interrompit-elle, je serais désolée de te les voir lire ! Je crois en effet que tu es né pour beaucoup mieux que cela.
Elle parlait tout simplement et sans paraître se douter que ces mots qui séparaient ainsi nos deux vies pussent me déchirer le cœur. J’avais la tête en feu ; j’aurais voulu parler encore et pleurer ; peut-être eût-elle été vaincue par mes larmes ; mais je restais sans plus rien dire, les coudes appuyés sur la cheminée et le front dans les mains. Elle continuait tranquillement d’arranger ses fleurs, ne voyant rien de ma douleur, ou faisant semblant de n’en rien voir…
À ce moment retentit la première cloche du repas.
– Jamais je ne serai prête pour le déjeuner, dit-elle.
Laisse-moi vite. – Et comme s’il ne s’était agi que d’un jeu :
– Nous reprendrons cette conversation plus tard.
Cette conversation ne fut pas reprise. Alissa m’échappait sans cesse ; non qu’elle parût jamais se dérober ; mais toute occupation de rencontre s’imposait aussitôt en devoir de beaucoup plus pressante importance. Je prenais rang ; je ne venais qu’après les soins toujours renaissants du ménage, qu’après la surveillance des travaux qu’on avait dû faire à la grange, qu’après les visites aux fermiers, les visites aux pauvres dont elle s’occupait de plus en plus. J’avais ce qui restait de temps, bien peu ; je ne la voyais jamais qu’affairée, – mais c’est peut-être encore à travers ces menus soins et renonçant à la poursuivre que je sentais le moins combien j’étais dépossédé. La moindre conversation m’en avertissait davantage. Quand Alissa m’accordait quelques instants, c’était en effet pour une conversation des plus gauches, à laquelle elle se prêtait comme on fait au jeu d’un enfant. Elle passait rapidement près de moi, distraite et souriante, et je la sentais devenue plus lointaine que si je ne l’eusse jamais connue. Même je croyais voir parfois dans son sourire quelque défi, du moins quelque ironie, et qu’elle prît amusement à éluder ainsi mon désir… Puis aussitôt je retournais contre moi tout grief, ne voulant pas me laisser aller au reproche et ne sachant plus bien ce que j’aurais attendu d’elle, ni ce que je pouvais lui reprocher.
Ainsi s’écoulèrent les jours dont je m’étais promis tant de félicité. J’en contemplais avec stupeur la fuite, mais n’en eusse voulu ni augmenter le nombre ni ralentir le cours, tant chacun aggravait ma peine. L’avant-veille de mon départ pourtant, Alissa m’ayant accompagné au banc de la marnière abandonnée – c’était par un clair soir d’automne où jusqu’à l’horizon sans brume on distinguait bleui chaque détail, dans le passé jusqu’au plus flottant souvenir – je ne pus retenir ma plainte, montrant du deuil de quel bonheur mon malheur d’aujourd’hui se formait.
– Mais que puis-je à ceci, mon ami ? dit-elle aussitôt : tu tombes amoureux d’un fantôme.
– Non, point d’un fantôme, Alissa.
– D’une figure imaginaire.
– Hélas ! je ne l’invente pas. Elle était mon amie. Je la rappelle. Alissa ! Alissa ! vous étiez celle que j’aimais. Qu’avez-vous fait de vous ? Que vous êtes-vous fait devenir ?
Elle demeura quelques instants sans répondre, effeuillant lentement une fleur et gardant la tête baissée.
Puis enfin :
– Jérôme, pourquoi ne pas avouer tout simplement que tu m’aimes moins ?
– Parce que ce n’est pas vrai ! Parce que ce n’est pas vrai ! m’écriai-je avec indignation ; parce que je ne t’ai jamais plus aimée.
– Tu m’aimes… et pourtant tu me regrettes ! dit-elle en tâchant de sourire et en haussant un peu les épaules !
– Je ne peux mettre au passé mon amour.
Le sol cédait sous moi ; et je me raccrochais à tout…
– Il faudra bien qu’il passe avec le reste.
– Un tel amour ne passera qu’avec moi.
– Il s’affaiblira lentement. L’Alissa que tu prétends aimer encore n’est déjà plus que dans ton souvenir ; un jour viendra où tu te souviendras seulement de l’avoir aimée.
– Tu parles comme si rien la pouvait remplacer dans mon cœur, ou comme si mon cœur devait cesser d’aimer. Ne te souviens-tu plus de m’avoir aimé toi-même, que tu puisses ainsi te plaire à me torturer ?
Je vis ses lèvres pâles trembler ; d’une voix presque indistincte elle murmura :
– Non ; non ; ceci n’a pas changé dans Alissa.
– Mais alors rien n’aurait changé, dis-je en lui saisissant le bras…
Elle reprit plus assurée :
– Un mot expliquerait tout ; pourquoi n’oses-tu pas le dire ?
– Lequel ?
– J’ai vieilli.
– Tais-toi…
Je protestai tout aussitôt que j’avais vieilli moi-même autant qu’elle, que la différence d’âge entre nous restait la même… mais elle s’était ressaisie ; l’instant unique était passé et, me laissant aller à discuter, j’abandonnai tout avantage ; je perdis pied.
Je quittai Fongueusemare deux jours après, mécontent d’elle et de moi-même, plein d’une haine vague contre ce que j’appelais encore « vertu » et de ressentiment contre l’ordinaire occupation de mon cœur. Il semblait qu’en ce dernier revoir, et par l’exagération même de mon amour, j’eusse usé toute ma ferveur ; chacune des phrases d’Alissa, contre lesquelles je m’insurgeais d’abord, restait en moi vivante et triomphante après que mes protestations s’étaient tues. Eh ! sans doute elle avait raison ! je ne chérissais plus qu’un fantôme ; l’Alissa que j’avais aimée, que j’aimais encore n’était plus… Eh ! sans doute nous avions vieilli ! cette dépoétisation affreuse, devant quoi tout mon cœur se glaçait, n’était rien, après tout, que le retour au naturel ; lentement si je l’avais surélevée, si je m’étais formé d’elle une idole, l’ornant de tout ce dont j’étais épris, que restait-il de mon travail, que ma fatigue ?… Sitôt abandonnée à elle-même, Alissa était revenue à son niveau, médiocre niveau, où je me retrouvais moi-même, mais où je ne la désirais plus. Ah ! combien cet effort épuisant de vertu m’apparaissait absurde et chimérique, pour la rejoindre à ces hauteurs où mon unique effort l’avait placée. Un peu moins orgueilleux, notre amour eût été facile… mais que signifiait désormais l’obstination dans un amour sans objet ; c’était être entêté, ce n’était plus être fidèle. Fidèle à quoi ? – à une erreur. Le plus sage n’était-il pas de m’avouer que je m’étais trompé ?…
Proposé cependant pour l’École d’Athènes, j’acceptai d’y entrer aussitôt, sans ambition, sans goût, mais souriant à l’idée de départ comme à celle d’une évasion.