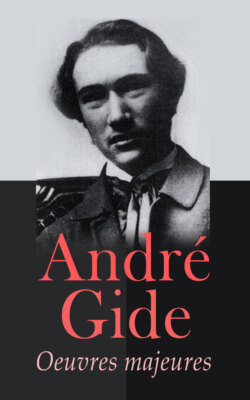Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 125
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
D’autres en auraient pu faire un livre ; mais l’histoire que je raconte ici, j’ai mis toute ma force à la vivre et ma vertu s’y est usée. J’écrirai donc très simplement mes souvenirs, et s’ils sont en lambeaux par endroits, je n’aurai recours à aucune invention pour les rapiécer ou les joindre ; l’effort que j’apporterais à leur apprêt gênerait le dernier plaisir que j’espère trouver à les dire.
Je n’avais pas douze ans lorsque je perdis mon père. Ma mère, que plus rien ne retenait au Havre, où mon père avait été médecin, décida de venir habiter Paris, estimant que j’y finirais mieux mes études. Elle loua, près du Luxembourg, un petit appartement, que Miss Ashburton vint occuper avec nous. Miss Flora Ashburton, qui n’avait plus de famille, avait été d’abord l’institutrice de ma mère, puis sa compagne et bientôt son amie. Je vivais auprès de ces deux femmes à l’air également doux et triste, et que je ne puis revoir qu’en deuil. Un jour, et, je pense, assez longtemps après la mort de mon père, ma mère avait remplacé par un ruban mauve le ruban noir de son bonnet du matin :
« Ô maman ! m’étais-je écrié, comme cette couleur te va mal ! »
Le lendemain elle avait remis un ruban noir.
J’étais de santé délicate. La sollicitude de ma mère et de Miss Ashburton, tout occupée à prévenir ma fatigue, si elle n’a pas fait de moi un paresseux, c’est que j’ai vraiment goût au travail. Dès les premiers beaux jours, toutes deux se persuadent qu’il est temps pour moi de quitter la ville, que j’y pâlis ; vers la mi-juin, nous partons pour Fongueusemare, aux environs du Havre, où mon oncle Bucolin nous reçoit chaque été.
Dans un jardin pas très grand, pas très beau, que rien de bien particulier ne distingue de quantité d’autres jardins normands, la maison des Bucolin, blanche, à deux étages, ressemble à beaucoup de maisons de campagne du siècle avant-dernier. Elle ouvre une vingtaine de grandes fenêtres sur le devant du jardin, au levant ; autant par derrière ; elle n’en a pas sur les côtés. Les fenêtres sont à petits carreaux : quelques-uns, récemment remplacés, paraissent trop clairs parmi les vieux qui, auprès, paraissent verts et ternis. Certains ont des défauts que nos parents appellent des « bouillons » ; l’arbre qu’on regarde au travers se dégingande ; le facteur, en passant devant, prend une bosse brusquement.
Le jardin, rectangulaire, est entouré de murs. Il forme devant la maison une pelouse assez large, ombragée, dont une allée de sable et de gravier fait le tour. De ce côté, le mur s’abaisse pour laisser voir la cour de ferme qui enveloppe le jardin et qu’une avenue de hêtres limite à la manière du pays.
Derrière la maison, au couchant, le jardin se développe plus à l’aise. Une allée, riante de fleurs, devant les espaliers au midi, est abritée contre les vents de mer par un épais rideau de lauriers du Portugal et par quelques arbres. Une autre allée, le long du mur du nord, disparaît sous les branches. Mes cousines l’appelaient « l’allée noire », et, passé le crépuscule du soir, ne s’y aventuraient pas volontiers. Ces deux allées mènent au potager, qui continue en contrebas le jardin, après qu’on a descendu quelques marches. Puis, de l’autre côté du mur que troue, au fond du potager, une petite porte à secret, on trouve un bois taillis où l’avenue de hêtres, de droite et de gauche, aboutit. Du perron du couchant le regard, par-dessus ce bosquet retrouvant le plateau, admire la moisson qui le couvre. À l’horizon, pas très distant, l’église d’un petit village et, le soir, quand l’air est tranquille, les fumées de quelques maisons.
Chaque beau soir d’été, après dîner, nous descendions dans « le bas jardin ». Nous sortions par la petite porte secrète et gagnions un banc de l’avenue d’où l’on domine un peu la contrée ; là, près du toit de chaume d’une marnière abandonnée, mon oncle, ma mère et Miss Ashburton s’asseyaient ; devant nous, la petite vallée s’emplissait de brume et le ciel se dorait au-dessus du bois plus lointain. Puis nous nous attardions au fond du jardin déjà sombre. Nous rentrions ; nous retrouvions au salon ma tante qui ne sortait presque jamais avec nous… Pour nous, enfants, là se terminait la soirée ; mais bien souvent nous étions encore à lire dans nos chambres quand, plus tard, nous entendions monter nos parents.
Presque toutes les heures du jour que nous ne passions pas au jardin, nous les passions dans « la salle d’étude », le bureau de mon oncle où l’on avait disposé des pupitres d’écoliers. Mon cousin Robert et moi, nous travaillions côte à côte ; derrière nous, Juliette et Alissa. Alissa a deux ans de plus, Juliette un an de moins que moi ; Robert est, de nous quatre, le plus jeune.
Ce ne sont pas mes premiers souvenirs que je prétends écrire ici, mais ceux-là seuls qui se rapportent à cette histoire. C’est vraiment l’année de la mort de mon père que je puis dire qu’elle commence. Peut-être ma sensibilité, surexcitée par notre deuil et, sinon par mon propre chagrin, du moins par la vue du chagrin de ma mère, me prédisposait-elle à de nouvelles émotions : j’étais précocement mûri ; lorsque, cette année, nous revînmes à Fongueusemare, Juliette et Robert m’en parurent d’autant plus jeunes, mais, en revoyant Alissa, je compris brusquement que tous deux nous avions cessé d’être enfants.
Oui, c’est bien l’année de la mort de mon père ; ce qui confirme ma mémoire, c’est une conversation de ma mère avec Miss Ashburton, sitôt après notre arrivée. J’étais inopinément entré dans la chambre où ma mère causait avec son amie ; il s’agissait de ma tante ; ma mère s’indignait qu’elle n’eût pas pris le deuil ou qu’elle l’eût déjà quitté. (Il m’est, à vrai dire, aussi impossible d’imaginer ma tante Bucolin en noir que ma mère en robe claire.) Ce jour de notre arrivée, autant qu’il m’en souvient, Lucile Bucolin portait une robe de mousseline. Miss Ashburton, conciliante comme toujours, s’efforçait de calmer ma mère ; elle arguait craintivement :
– Après tout, le blanc aussi est de deuil.
– Et vous appelez aussi « de deuil » ce châle rouge qu’elle a mis sur ses épaules ? Flora, vous me révoltez ! s’écriait ma mère.
Je ne voyais ma tante que durant les mois de vacances et sans doute la chaleur de l’été motivait ces corsages légers et largement ouverts que je lui ai toujours connus ; mais, plus encore que l’ardente couleur des écharpes que ma tante jetait sur ses épaules nues, ce décolletage scandalisait ma mère.
Lucile Bucolin était très belle. Un petit portrait d’elle que j’ai gardé me la montre telle qu’elle était alors, l’air si jeune qu’on l’eût prise pour la sœur aînée de ses filles, assise de côté, dans cette pose qui lui était coutumière : la tête inclinée sur la main gauche au petit doigt mièvrement replié vers la lèvre. Une résille à grosses mailles retient la masse de ses cheveux crêpelés à demi croulés sur la nuque ; dans l’échancrure du corsage pend, à un lâche collier de velours noir, un médaillon de mosaïque italienne. La ceinture de velours noir au large nœud flottant, le chapeau de paille souple à grands bords qu’au dossier de la chaise elle a suspendu par la bride, tout ajoute à son air enfantin. La main droite, tombante, tient un livre fermé.
Lucile Bucolin était créole ; elle n’avait pas connu ou avait perdu très tôt ses parents. Ma mère me raconta, plus tard, qu’abandonnée ou orpheline elle fut recueillie par le ménage du pasteur Vautier qui n’avait pas encore d’enfants et qui, bientôt après quittant la Martinique, amena celle-ci au Havre où la famille Bucolin était fixée. Les Vautier et les Bucolin se fréquentèrent ; mon oncle était alors employé dans une banque à l’étranger, et ce ne fut que trois ans plus tard, lorsqu’il revint auprès des siens, qu’il vit la petite Lucile ; il s’éprit d’elle et aussitôt demanda sa main, au grand chagrin de ses parents et de ma mère. Lucile avait alors seize ans. Entre temps, Mme Vautier avait eu deux enfants ; elle commençait à redouter pour eux l’influence de cette sœur adoptive dont le caractère s’affirmait plus bizarrement de mois en mois ; puis les ressources du ménage étaient maigres… tout ceci, c’est ce que me dit ma mère pour m’expliquer que les Vautier aient accepté la demande de son frère avec joie. Ce que je suppose, au surplus, c’est que la jeune Lucile commençait à les embarrasser terriblement. Je connais assez la société du Havre pour imaginer aisément le genre d’accueil qu’on fit à cette enfant si séduisante. Le pasteur Vautier, que j’ai connu plus tard doux, circonspect et naïf à la fois, sans ressources contre l’intrigue et complètement désarmé devant le mal – l’excellent homme devait être aux abois. Quant à Mme Vautier, je n’en puis rien dire ; elle mourut en couches à la naissance d’un quatrième enfant, celui qui, de mon âge à peu près, devait devenir plus tard mon ami…
Lucile Bucolin ne prenait que peu de part à notre vie ; elle ne descendait de sa chambre que passé le repas de midi ; elle s’allongeait aussitôt sur un sofa ou dans un hamac, demeurait étendue jusqu’au soir et ne se relevait que languissante. Elle portait parfois à son front, pourtant parfaitement mat, un mouchoir comme pour essuyer une moiteur ; c’était un mouchoir dont m’émerveillaient la finesse et l’odeur qui semblait moins un parfum de fleur que de fruit ; parfois elle tirait de sa ceinture un minuscule miroir à glissant couvercle d’argent, qui pendait à sa chaîne de montre avec divers objets ; elle se regardait, d’un doigt touchait sa lèvre, cueillait un peu de salive et s’en mouillait le coin des yeux. Souvent elle tenait un livre, mais un livre presque toujours fermé ; dans le livre, une liseuse d’écaille restait prise entre les feuillets. Lorsqu’on approchait d’elle, son regard ne se détournait pas de sa rêverie pour vous voir. Souvent, de sa main ou négligente ou fatiguée, de l’appui du sofa, d’un repli de sa jupe, le mouchoir tombait à terre, ou le livre, ou quelque fleur, ou le signet. Un jour, ramassant le livre – c’est un souvenir d’enfant que je vous dis – en voyant que c’étaient des vers, je rougis.
Le soir, après dîner, Lucile Bucolin ne s’approchait pas à notre table de famille, mais, assise au piano, jouait avec complaisance de lentes mazurkas de Chopin ; parfois rompant la mesure, elle s’immobilisait sur un accord…
J’éprouvais un singulier malaise auprès de ma tante, un sentiment fait de trouble, d’une sorte d’admiration et d’effroi. Peut-être un obscur instinct me prévenait-il contre elle ; puis je sentais qu’elle méprisait Flora Ashburton et ma mère, que Miss Ashburton la craignait et que ma mère ne l’aimait pas.
Lucile Bucolin, je voudrais ne plus vous en vouloir, oublier un instant que vous avez fait tant de mal… du moins j’essaierai de parler de vous sans colère.
Un jour de cet été – ou de l’été suivant, car dans ce décor toujours pareil, parfois mes souvenirs superposés se confondent – j’entre au salon chercher un livre ; elle y était. J’allais me retirer aussitôt ; elle qui, d’ordinaire, semble à peine me voir, m’appelle :
– Pourquoi t’en vas-tu si vite ? Jérôme ! est-ce que je te fais peur ?
Le cœur battant, je m’approche d’elle ; je prends sur moi de lui sourire et de lui tendre la main. Elle garde ma main dans l’une des siennes et de l’autre caresse ma joue.
– Comme ta mère t’habille mal, mon pauvre petit !…
Je portais alors une sorte de vareuse à grand col, que ma tante commence de chiffonner.
– Les cols marins se portent beaucoup plus ouverts ! dit-elle en faisant sauter un bouton de chemise. – Tiens ! regarde si tu n’es pas mieux ainsi ! – et, sortant son petit miroir, elle attire contre le sien mon visage, passe autour de mon cou son bras nu, descend sa main dans ma chemise entr’ouverte, demande en riant si je suis chatouilleux, pousse plus avant… J’eus un sursaut si brusque que ma vareuse se déchira ; le visage en feu, et tandis qu’elle s’écriait :
– Fi ! le grand sot ! – je m’enfuis ; je courus jusqu’au fond du jardin ; là, dans un petit citerneau du potager, je trempai mon mouchoir, l’appliquai sur mon front, lavai, frottai mes joues, mon cou, tout ce que cette femme avait touché.
Certains jours, Lucile Bucolin avait « sa crise ». Cela la prenait tout à coup et révolutionnait la maison. Miss Ashburton se hâtait d’emmener et d’occuper les enfants ; mais on ne pouvait pas, pour eux, étouffer les cris affreux qui partaient de la chambre à coucher ou du salon. Mon oncle s’affolait, on l’entendait courir dans les couloirs, cherchant des serviettes, de l’eau de Cologne, de l’éther ; le soir, à table, où ma tante ne paraissait pas encore, il gardait une mine anxieuse et vieillie.
Quand la crise était à peu près passée, Lucile Bucolin appelait ses enfants auprès d’elle ; du moins Robert et Juliette ; jamais Alissa. Ces tristes jours, Alissa s’enfermait dans sa chambre, où parfois son père venait la retrouver ; car il causait souvent avec elle.
Les crises de ma tante impressionnaient beaucoup les domestiques. Un soir que la crise avait été particulièrement forte et que j’étais resté avec ma mère, consigné dans sa chambre d’où l’on percevait moins ce qui se passait au salon, nous entendîmes la cuisinière courir dans les couloirs en criant :
– Que Monsieur descende vite, la pauvre Madame est en train de mourir !
Mon oncle était monté dans la chambre d’Alissa ; ma mère sortit à sa rencontre. Un quart d’heure après, comme tous deux passaient sans y faire attention devant les fenêtres ouvertes de la chambre où j’étais resté, me parvint la voix de ma mère :
– Veux-tu que je te dise, mon ami : tout cela, c’est de la comédie. – Et plusieurs fois, séparant les syllabes : de la co-mé-die.
Ceci se passait vers la fin des vacances, et deux ans après notre deuil. Je ne devais plus revoir longtemps ma tante. Mais avant de parler du triste événement qui bouleversa notre famille, et d’une petite circonstance qui, précédant de peu le dénouement, réduisit en pure haine le sentiment complexe et indécis encore que j’éprouvais pour Lucile Bucolin, il est temps que je vous parle de ma cousine.
Qu’Alissa Bucolin fût jolie, c’est ce dont je ne savais m’apercevoir encore ; j’étais requis et retenu près d’elle par un charme autre que celui de la simple beauté. Sans doute, elle ressemblait beaucoup à sa mère ; mais son regard était d’expression si différente que je ne m’avisai de cette ressemblance que plus tard. Je ne puis décrire un visage ; les traits m’échappent, et jusqu’à la couleur des yeux ; je ne revois que l’expression presque triste déjà de son sourire et que la ligne de ses sourcils, si extraordinairement relevés au-dessus des yeux, écartés de l’œil en grand cercle. Je n’ai vu les pareils nulle part… si pourtant : dans une statuette florentine de l’époque de Dante ; et je me figure volontiers que Béatrix enfant avait des sourcils très largement arqués comme ceux-là. Ils donnaient au regard, à tout l’être, une expression d’interrogation à la fois anxieuse et confiante, – oui, d’interrogation passionnée. Tout, en elle, n’était que question et qu’attente… Je vous dirai comment cette interrogation s’empara de moi, fit ma vie.
Juliette cependant pouvait paraître plus belle ; la joie et la santé posaient sur elle leur éclat ; mais sa beauté, près de la grâce de sa sœur, semblait extérieure et se livrer à tous d’un seul coup. Quant à mon cousin Robert, rien de particulier ne le caractérisait. C’était simplement un garçon à peu près de mon âge ; je jouais avec Juliette et avec lui ; avec Alissa je causais ; elle ne se mêlait guère à nos jeux ; si loin que je replonge dans le passé, je la vois sérieuse, doucement souriante et recueillie. – De quoi causions-nous ? De quoi peuvent causer deux enfants ? Je vais bientôt tâcher de vous le dire, mais je veux d’abord et pour ne plus ensuite reparler d’elle, achever de vous raconter ce qui a trait à ma tante.
Deux ans après la mort de mon père, nous vînmes, ma mère et moi, passer les vacances de Pâques au Havre. Nous n’habitions pas chez les Bucolin qui, en ville, étaient assez étroitement logés, mais chez une sœur aînée de ma mère, dont la maison était plus vaste. Ma tante Plantier, que je n’avais que rarement l’occasion de voir, était veuve depuis longtemps ; à peine connaissais-je ses enfants, beaucoup plus âgés que moi et de nature très différente. La « maison Plantier », comme on disait au Havre, n’était pas dans la ville même, mais à mi-hauteur de cette colline qui domine la ville et qu’on appelle « la Côte ». Les Bucolin habitaient près du quartier des affaires ; un raidillon menait assez rapidement de l’une à l’autre maison ; je le dégringolais et le regravissait plusieurs fois par jour.
Ce jour-là je déjeunai chez mon oncle. Peu de temps après le repas, il sortit ; je l’accompagnai jusqu’à son bureau, puis remontai à la maison Plantier chercher ma mère. Là j’appris qu’elle était sortie avec ma tante et ne rentrerait que pour dîner. Aussitôt je redescendis en ville, où il était rare que je pusse librement me promener. Je gagnai le port, qu’un brouillard de mer rendait morne ; j’errai une heure ou deux sur les quais. Brusquement le désir me saisit d’aller surprendre Alissa que pourtant je venais de quitter… Je traverse la ville en courant, sonne à la porte des Bucolin ; déjà je m’élançais dans l’escalier. La bonne qui m’a ouvert m’arrête :
– Ne montez pas, monsieur Jérôme ! ne montez pas : Madame a une crise.
Mais je passe outre : – Ce n’est pas ma tante que je viens voir… La chambre d’Alissa est au troisième étage. Au premier, le salon et la salle à manger ; au second, la chambre de ma tante d’où jaillissent des voix. La porte est ouverte, devant laquelle il faut passer ; un rai de lumière sort de la chambre et coupe le palier de l’escalier ; par crainte d’être vu, j’hésite un instant, me dissimule, et plein de stupeur, je vois ceci : au milieu de la chambre aux rideaux clos, mais où les bougies de deux candélabres répandent une clarté joyeuse, ma tante est couchée sur une chaise longue ; à ses pieds, Robert et Juliette ; derrière elle, un inconnu jeune homme en uniforme de lieutenant. – La présence de ces deux enfants m’apparaît aujourd’hui monstrueuse ; dans mon innocence d’alors, elle me rassura plutôt.
Ils regardent en riant l’inconnu qui répète d’une voix flûtée :
– Bucolin ! Bucolin !… Si j’avais un mouton, sûrement je l’appellerais Bucolin.
Ma tante elle-même rit aux éclats. Je la vois tendre au jeune homme une cigarette qu’il allume et dont elle tire quelques bouffées. La cigarette tombe à terre. Lui s’élance pour la ramasser, feint de se prendre les pieds dans une écharpe, tombe à genoux devant ma tante… À la faveur de ce ridicule jeu de scène, je me glisse sans être vu.
Me voici devant la porte d’Alissa. J’attends un instant. Les rires et les éclats de voix montent de l’étage inférieur ; et peut-être ont-ils couvert le bruit que j’ai fait en frappant, car je n’entends pas de réponse. Je pousse la porte, qui cède silencieusement. La chambre est déjà si sombre que je ne distingue pas aussitôt Alissa ; elle est au chevet de son lit, à genoux, tournant le dos à la croisée d’où tombe un jour mourant. Elle se retourne, sans se relever pourtant, quand j’approche ; elle murmure :
– Oh ! Jérôme, pourquoi reviens-tu ?
Je me baisse pour l’embrasser ; son visage est noyé de larmes…
Cet instant décida de ma vie ; je ne puis encore aujourd’hui le remémorer sans angoisse. Sans doute je ne comprenais que bien imparfaitement la cause de la détresse d’Alissa, mais je sentais intensément que cette détresse était beaucoup trop forte pour cette petite âme palpitante, pour ce frêle corps tout secoué de sanglots.
Je restais debout près d’elle, qui restait agenouillée ; je ne savais rien exprimer du transport nouveau de mon cœur ; mais je pressais sa tête contre mon cœur et sur son front mes lèvres par où mon âme s’écoulait. Ivre d’amour, de pitié, d’un indistinct mélange d’enthousiasme, d’abnégation, de vertu, j’en appelais à Dieu de toutes mes forces et m’offrais, ne concevant plus d’autre but à ma vie que d’abriter cette enfant contre la peur, contre le mal, contre la vie. Je m’agenouille enfin plein de prière ; je la réfugie contre moi ; confusément je l’entends dire :
– Jérôme ! ils ne t’ont pas vu, n’est-ce pas ? Oh ! va-t’en vite ! Il ne faut pas qu’ils te voient.
Puis plus bas encore :
– Jérôme, ne raconte à personne… mon pauvre papa ne sait rien…
Je ne racontai donc rien à ma mère ; mais les interminables chuchoteries que ma tante Plantier tenait avec elle, l’air mystérieux, affairé et peiné de ces deux femmes, le : « Mon enfant, va jouer plus loin ! » avec lequel elles me repoussaient chaque fois que je m’approchais de leurs conciliabules, tout me montrait qu’elles n’ignoraient pas complètement le secret de la maison Bucolin.
Nous n’étions pas plus tôt rentrés à Paris qu’une dépêche rappelait ma mère au Havre : ma tante venait de s’enfuir.
– Avec quelqu’un ? demandai-je à Miss Ashburton, auprès de qui ma mère me laissait.
– Mon enfant, tu demanderas cela à ta mère ; moi je ne peux rien te répondre, disait cette chère vieille amie, que cet événement consternait.
Deux jours après, nous partions, elle et moi, rejoindre ma mère. C’était un samedi. Je devais retrouver mes cousines le lendemain, au temple, et cela seul occupait ma pensée ; car mon esprit d’enfant attachait une grande importance à cette sanctification de notre revoir. Après tout, je me souciais peu de ma tante, et mis un point d’honneur à ne pas questionner ma mère.
Dans la petite chapelle, il n’y avait, ce matin-là, pas grand monde. Le pasteur Vautier, sans doute intentionnellement, avait pris pour texte de sa méditation ces paroles du Christ : Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite.
Alissa se tenait à quelques places devant moi. Je voyais de profil son visage ; je la regardai fixement, avec un tel oubli de moi qu’il me semblait que j’entendais à travers elle ces mots que j’écoutais éperdument. – Mon oncle était assis à côté de ma mère et pleurait.
Le pasteur avait d’abord lu tout le verset : Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. Puis, précisant les divisions du sujet, il parlait d’abord du chemin spacieux… L’esprit perdu, et comme en rêve, je revoyais la chambre de ma tante ; je revoyais ma tante étendue, riante ; je voyais le brillant officier rire aussi… et l’idée même du rire, de la joie, se faisait blessante, outrageuse, devenait comme l’odieuse exagération du péché !…
Et nombreux sont ceux qui y passent, reprenait le pasteur Vautier ; puis il peignait et je voyais une multitude parée, riant et s’avançant folâtrement, formant cortège où je sentais que je ne pouvais, que je ne voulais pas trouver place, parce que chaque pas que j’eusse fait avec eux m’aurait écarté d’Alissa. – Et le pasteur ramenait le début du texte, et je voyais cette porte étroite par laquelle il fallait s’efforcer d’entrer. Je me la représentais, dans le rêve où je plongeais, comme une sorte de laminoir, où je m’introduisais avec effort, avec une douleur extraordinaire où se mêlait pourtant un avant-goût de la félicité du ciel. Et cette porte devenait encore la porte même de la chambre d’Alissa ; pour entrer je me réduisais, me vidais de tout ce qui subsistait en moi d’égoïsme… Car étroite est la voie qui conduit à la Vie, continuait le pasteur Vautier – et par-delà toute macération, toute tristesse, j’imaginais, je pressentais une autre joie, pure, mystique, séraphique et dont mon âme déjà s’assoiffait. Je l’imaginais, cette joie, comme un chant de violon à la fois strident et tendre, comme une flamme aiguë où le cœur d’Alissa et le mien s’épuisaient. Tous deux nous avancions, vêtus de ces vêtements blancs dont nous parlait l’Apocalypse, nous tenant par la main et regardant un même but… Que m’importe si ces rêves d’enfant font sourire ! je les redis sans y changer. La confusion qui peut-être y paraît n’est que dans les mots et dans les imparfaites images pour rendre un sentiment très précis.
– Il en est peu qui la trouvent, achevait le pasteur Vautier. Il expliquait comment trouver la porte étroite… Il en est peu. – Je serais de ceux-là…
J’étais parvenu vers la fin du sermon à un tel état de tension morale que, sitôt le culte fini, je m’enfuis sans chercher à voir ma cousine – par fierté, voulant déjà mettre mes résolutions (car j’en avais pris) à l’épreuve, et pensant la mieux mériter en m’éloignant d’elle aussitôt.