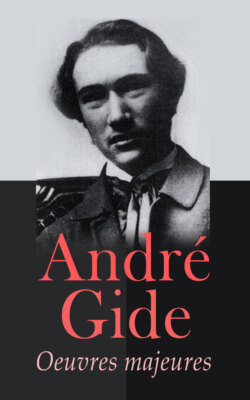Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 114
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
La saison devenait clémente. Dès que mon cours fut terminé, je transportai Marceline à la Morinière, le docteur affirmant que tout danger pressant était passé et que, pour achever de la remettre, il ne fallait rien tant qu’un air meilleur. J’avais moi-même grand besoin de repos. Ces veilles que j’avais tenu à supporter presque toutes moi-même, cette angoisse prolongée, et surtout cette sorte de sympathie physique qui, lors de l’embolie de Marceline, m’avait fait ressentir en moi les affreux sursauts de son cœur, tout cela m’avait fatigué comme si j’avais moi-même été malade.
J’eusse préféré emmener Marceline dans la montagne ; mais elle me montra le désir le plus vif de retourner en Normandie, prétendit que nul climat ne lui serait meilleur, et me rappela que j’avais à revoir ces deux fermes, dont je m’étais un peu témérairement chargé. Elle me persuada que je m’en étais fait responsable, et que je me devais d’y réussir. Nous ne fûmes pas plus tôt arrivés qu’elle me poussa donc de courir sur les terres... Je ne sais si, dans son amicale insistance, beaucoup d’abnégation n’entrait pas ; la crainte que, sinon, me croyant retenu près d’elle par les soins qu’il fallait encore lui donner, je ne sentisse pas assez grande ma liberté... Marceline pourtant allait mieux ; du sang recolorait ses joues ; et rien ne me reposait plus que de sentir moins triste son sourire ; je pouvais la laisser sans crainte.
Je retournai donc sur les fermes. On y faisait les premiers foins. L’air chargé de pollens, de senteurs, m’étourdit tout d’abord comme une boisson capiteuse. Il me sembla que, depuis l’an passé, je n’avais plus respiré, ou respiré que des poussières, tant pénétrait mielleusement en moi l’atmosphère. Du talus où je m’étais assis, comme grisé, je dominais la Morinière ; je voyais ses toits bleus, les eaux dormantes de ses douves ; autour, des champs fauchés, d’autres pleins d’herbes ; plus loin, la courbe du ruisseau ; plus loin, les bois ou l’automne dernier je me promenais à cheval avec Charles. Des chants que j’entendais depuis quelques instants se rapprochèrent ; c’étaient des faneurs qui rentraient, la fourche ou le râteau sur l’épaule. Ces travailleurs, que je reconnus presque tous, me firent fâcheusement souvenir que je n’étais point là en voyageur charmé, mais en maître. Je m’approchai, leur souris, leur parlai, m’enquis de chacun longuement. Déjà Bocage le matin m’avait pu renseigner sur l’état des cultures ; par une correspondance régulière, il n’avait d’ailleurs pas cessé de me tenir au courant des moindres incidents des fermes. L’exploitation n’allait pas mal, beaucoup mieux que Bocage ne me le laissait d’abord espérer. Pourtant on m’attendait pour quelques décisions importantes, et, durant quelques jours, je dirigeai tout de mon mieux, sans plaisir, mais raccrochant à ce semblant de travail ma vie défaite.
Dès que Marceline fut assez bien pour recevoir, quelques amis vinrent habiter avec nous. Leur société affectueuse et point bruyante sut plaire à Marceline, mais fit que je quittai d’autant plus volontiers la maison. Je préférais la société des gens de la ferme ; il me semblait qu’avec eux je trouvais mieux à apprendre — non point que je les interrogeasse beaucoup — non, et je sais à peine exprimer cette sorte de joie que je ressentais auprès d’eux : il me semblait sentir à travers eux — et tandis que la conversation de nos amis, avant qu’ils commençassent de parler, m’était déjà toute connue, la seule vue de ces gueux me causait un émerveillement continuel.
Si d’abord l’on eût dit qu’ils missent à me répondre toute la condescendance que j’évitais de mettre à les interroger, bientôt ils supportèrent mieux ma présence. J’entrais toujours plus en contact avec eux. Non content de les suivre au travail, je voulais les voir à leurs jeux ; leurs obtuses pensées ne m’intéressaient guère, mais j’assistais à leurs repas, j’écoutais leurs plaisanteries, surveillais amoureusement leurs plaisirs. C’était, dans une sorte de sympathie, pareille à celle qui faisait sursauter mon cœur aux sursauts de celui de Marceline, c’était un immédiat écho de chaque sensation étrangère — non point vague, mais précis, aigu. Je sentais en mes bras la courbature du faucheur ; j’étais las de sa lassitude ; la gorgée de cidre qu’il buvait me désaltérait ; je la sentais glisser dans sa gorge ; un jour, en aiguisant sa faux, l’un s’entailla profondément le pouce : je ressentis sa douleur, jusqu’à l’os.
Il me semblait, ainsi, que ma vue ne fût plus seule à m’enseigner le paysage, mais que je le sentisse encore par une sorte d’attouchement qu’illimitait cette bizarre sympathie.
La présence de Bocage me gênait ; il me fallait, quand il venait, jouer au maître, et je n’y trouvais plus aucun goût. Je commandais encore, il le fallait, et dirigeais à ma façon les travailleurs ; mais je ne montais plus à cheval, par crainte de les dominer trop. Mais, malgré les précautions que je prenais pour qu’ils ne souffrissent plus de ma présence et ne se contraignissent plus devant moi, je restais devant eux, comme avant, plein de curiosité mauvaise. L’existence de chacun d’eux me demeurait mystérieuse. Il me semblait toujours qu’une partie de leur vie se cachait. Que faisaient-ils, quand je n’étais plus là ? Je ne consentais pas qu’ils ne s’amusassent pas plus. Et je prêtais à chacun d’eux un secret que je m’entêtais à désirer connaître. Je rôdais, je suivais, j’épiais. Je m’attachais aux plus frustes natures, comme si, de leur obscurité, j’attendais, pour m’éclairer, quelque lumière.
Un surtout m’attirait : il était assez beau, grand, point stupide, mais uniquement mené par l’instinct ; il ne faisait jamais rien que de subit, et cédait à toute impulsion de passage. Il n’était pas de ce pays ; on l’avait embauché par hasard. Excellent travailleur deux jours, il se soûlait à mort le troisième. Une nuit j’allai furtivement le voir dans la grange ; il était vautré dans le foin ; il dormait d’un épais sommeil ivre. Que de temps je le regardai !... Un beau jour il partit comme il était venu. J’eusse voulu savoir sur quelles routes... J’appris le soir même que Bocage l’avait renvoyé.
Je fus furieux contre Bocage ; le fis venir.
— Il paraît que vous avez renvoyé Pierre, commençai-je. Voulez-vous me dire pourquoi ?
Un peu interloqué par ma colère, que pourtant je tempérais de mon mieux :
— Monsieur ne voulait pas garder chez lui un sale ivrogne, qui débauchait les meilleurs ouvriers...
— Je sais mieux que vous ceux que je désire garder.
— Un galvaudeur ! On ne sait même pas d’où qu’il vient. Dans le pays, ça ne faisait pas bon effet... Quand, une nuit, il aurait mis le feu à la grange, Monsieur aurait peut-être été content.
— Mais enfin cela me regarde, et la ferme est à moi, je suppose ; j’entends la diriger comme il me plaît. À l’avenir, vous voudrez bien me faire part de vos motifs, avant d’exécuter personne.
Bocage, je l’ai dit, m’avait connu tout enfant ; quelque blessant que fût le ton de mes paroles, il m’aimait trop pour beaucoup s’en fâcher. Et même il ne me prit pas suffisamment au sérieux. Le paysan normand demeure trop souvent sans créance pour ce dont il ne pénètre pas le mobile, c’est-à-dire pour ce que ne conduit pas l’intérêt. Bocage considérait simplement comme une lubie cette querelle.
Pourtant je ne voulus pas rompre l’entretien sur un blâme, et, sentant que j’avais été trop vif, je cherchais ce que je pourrais ajouter.
— Votre fils Charles ne doit-il pas bientôt revenir ? me décidai-je à demander après un instant de silence.
— Je pensais que Monsieur l’avait oublié, à voir comme il s’inquiétait peu après lui, dit Bocage encore blessé.
— Moi, l’oublier ! Bocage, et comment le pourrais-je, après tout ce que nous avons fait ensemble l’an passé ? Je compte même beaucoup sur lui pour les fermes...
— Monsieur est bien bon. Charles doit revenir dans huit jours.
— Allons, j’en suis heureux, Bocage, — et je le congédiai.
Bocage avait presque raison : je n’avais certes pas oublié Charles, mais je ne me souciais plus de lui que fort peu. Comment expliquer qu’après une camaraderie si fougueuse, je ne sentisse plus à son égard qu’une chagrine incuriosité ? C’est que mes occupations et mes goûts n’étaient plus ceux de l’an passé. Mes deux fermes, il me fallait me l’avouer, ne m’intéressaient plus autant que les gens que j’y employais ; et pour les fréquenter, la présence de Charles allait être gênante. Il était bien trop raisonnable et se faisait trop respecter. Donc, malgré la vive émotion qu’éveillait en moi son souvenir, je voyais approcher son retour avec crainte.
Il revint. — Ah ! que j’avais raison de craindre et que Ménalque faisait bien de renier tout souvenir ! — Je vis entrer, à la place de Charles, un absurde Monsieur, coiffé d’un ridicule chapeau melon. Dieu ! qu’il était changé ! Gêné, contraint, je tâchai pourtant de ne pas répondre avec trop de froideur à la joie qu’il montrait de me revoir ; mais même cette joie me déplut ; elle était gauche et ne me parut pas sincère. Je l’avais reçu dans le salon, et, comme il était tard, je ne distinguais pas bien son visage ; mais quand on apporta la lampe, je vis avec dégoût qu’il avait laissé pousser ses favoris.
L’entretien, ce soir-là, fut plutôt morne ; puis, comme je savais qu’il serait sans cesse sur les fermes, j’évitai, durant près de huit jours, d’y aller, et je me rabattis sur mes études et sur la société de mes hôtes. Puis, sitôt que je recommençai de sortir, je fus requis par une occupation très nouvelle :
Des bûcherons avaient envahi les bois. Chaque année on en vendait une partie ; partagés en douze coupes égales, les bois fournissaient chaque année, avec quelques baliveaux dont on n’espérait plus de croissance, un taillis de douze ans qu’on mettait en fagots.
Ce travail se faisait à l’hiver, puis, avant le printemps, selon les clauses de la vente, les bûcherons devaient avoir vidé la coupe. Mais l’incurie du père Heurtevent, le marchand de bois qui dirigeait l’opération, était telle, que parfois le printemps entrait dans la coupe encore encombrée ; on voyait alors de nouvelles pousses fragiles s’allonger au travers des ramures mortes, et lorsque enfin les bûcherons faisaient vidange, ce n’était point sans abîmer bien des bourgeons.
Cette année la négligence du père Heurtevent, l’acheteur, passa nos craintes. En l’absence de toute surenchère, j’avais dû lui laisser la coupe à très bas prix ; aussi, sûr d’y trouver toujours son compte, se pressait-il fort peu de débiter un bois qu’il avait payé si peu cher. Et de semaine en semaine il différait le travail, prétextant une fois l’absence d’ouvriers, une autre fois le mauvais temps, puis un cheval malade, des prestations, d’autres travaux... que sais-je ? Si bien qu’au milieu de l’été rien n’était encore enlevé.
Ce qui, l’an précédent, m’eût irrité au plus haut point, cette année me laissait assez calme ; je ne me dissimulais pas le tort que Heurtevent me faisait ; mais ces bois ainsi dévastés étaient beaux, et je m’y promenais avec plaisir, épiant, surveillant le gibier, surprenant les vipères, et parfois, m’asseyant longuement sur un des troncs couchés qui semblait vivre encore et par ses plaies jetait quelques vertes brindilles.
Puis, tout à coup, vers le milieu de la première quinzaine d’août, Heurtevent se décida à envoyer ses hommes. Ils vinrent six à la fois, prétendant achever tout l’ouvrage en dix jours. La partie des bois exploitée touchait presque à la Valterie ; j’acceptai, pour faciliter l’ouvrage des bûcherons, qu’on apportât leur repas de la ferme. Celui qui fut chargé de ce soin était un loustic nommé Bute, que le régiment venait de nous renvoyer tout pourri — j’entends quant à l’esprit, car son corps allait à merveille ; c’était un de ceux de mes gens avec qui je causais volontiers. Je pus donc ainsi le revoir sans aller pour cela sur la ferme. Car c’est précisément alors que je recommençai de sortir. Et durant quelques jours, je ne quittai guère les bois, ne rentrant à la Morinière que pour les heures des repas, et souvent me faisant attendre. Je feignais de surveiller le travail, mais en vérité ne voyais que les travailleurs.
Il se joignait parfois, à cette bande de six hommes, deux des fils Heurtevent ; l’un âgé de vingt ans, l’autre de quinze, élancés, cambrés, les traits durs. Ils semblaient de type étranger, et j’appris plus tard, en effet, que leur mère était Espagnole. Je m’étonnai d’abord qu’elle eût pu venir jusqu’ici, mais Heurtevent, un vagabond fieffé dans sa jeunesse, l’avait, paraît-il, épousée en Espagne. Il était pour cette raison assez mal vu dans le pays. La première fois que j’avais rencontré le plus jeune des fils, c’était, il m’en souvient, sous la pluie ; il était seul, assis sur une très haute charrette au plus haut d’un entassement de fagots ; et là, tout renversé parmi les branches, il chantait ou plutôt gueulait une espèce de chant bizarre et tel que je n’en avais jamais ouï dans le pays. Les chevaux qui traînaient la charrette, connaissant le chemin, avançaient sans être conduits. Je ne puis dire l’effet que ce chant produisit sur moi ; car je n’en avais entendu de pareil qu’en Afrique... Le petit, exalté, paraissait ivre ; quand je passai, il ne me regarda même pas. Le lendemain j’appris que c’était un fils de Heurtevent. C’était pour le revoir, ou du moins pour l’attendre que je m’attardais ainsi dans la coupe. On acheva bientôt de la vider. Les garçons Heurtevent n’y vinrent que trois fois. Ils semblaient fiers, et je ne pus obtenir d’eux une parole.
Bute, par contre, aimait à raconter ; je fis en sorte que bientôt il comprît ce qu’avec moi l’on pouvait dire ; dès lors il ne se gêna guère et déshabilla le pays. Avidement je me penchai sur son mystère. Tout à la fois il dépassait mon espérance, et ne me satisfaisait pas. Était-ce là ce qui grondait sous l’apparence ? ou peut-être n’était-ce encore qu’une nouvelle hypocrisie ? N’importe ! Et j’interrogeais Bute, comme j’avais fait les informes chroniques des Goths. De ses récits sortait une trouble vapeur d’abîme qui déjà me montait à la tête et qu’inquiètement je humais. Par lui j’appris d’abord que Heurtevent couchait avec sa fille. Je craignais, si je manifestais le moindre blâme, d’arrêter toute confidence ; je souris donc ; la curiosité me poussait.
— Et la mère ? Elle ne dit rien ?
— La mère ! voilà douze ans pleins qu’elle est morte... Il la battait.
— Combien sont-ils dans la famille ?
— Cinq enfants. Vous avez vu l’aîné des fils et le plus jeune. Il y en a encore un de seize ans, qui n’est pas fort, et qui veut se faire curé. Et puis la fille aînée a déjà deux enfants du père...
Et j’appris peu à peu bien d’autres choses, qui faisaient de la maison Heurtevent un lieu brûlant, à l’odeur forte, autour duquel, quoi que j’en eusse, mon imagination, comme une mouche à viande, tournoyait : — Un soir, le fils aîné tenta de violer une jeune servante ; et comme elle se débattait, le père intervenant aida son fils, et de ses mains énormes la contint ; ce pendant que le second fils, à l’étage au-dessus, continuait tendrement ses prières, et que le cadet, témoin du drame, s’amusait. Pour ce qui est du viol, je me figure qu’il n’avait pas été bien difficile, car Bute racontait encore que, peu de temps après, la servante, y ayant pris goût, avait tenté de débaucher le petit prêtre.
— Et l’essai n’a pas réussi ? demandai-je ?
— Il tient encore, mais plus bien dru, répondit Bute.
— N’as-tu pas dit qu’il y avait une autre fille ?
— Qui en prend bien tant qu’elle en trouve ; et encore sans demander rien. Quand ça la tient, c’est elle qui paierait plutôt. Par exemple, faudrait pas coucher chez le père ; il cognerait. Il dit comme ça qu’en famille on a le droit de faire ce qui vous plaît, mais que ça ne regarde pas les autres. Pierre, le gars de la ferme que vous avez fait renvoyer, ne s’en est pas vanté, mais, une nuit, il n’en est pas sorti sans un trou dans la tête. Depuis ce temps-là, c’est dans le bois du château qu’on s’amuse.
Alors, et l’encourageant du regard :
— Tu en as essayé ? demandai-je.
Il baissa les yeux pour la forme et dit en rigolant :
— Quelquefois. Puis, relevant vite les yeux : — Le petit au père Bocage aussi.
— Quel petit au père Bocage ?
— Alcide, celui qui couche sur la ferme. Monsieur ne le connaît donc pas ?
J’étais absolument stupéfait d’apprendre que Bocage avait un autre fils.
— C’est vrai, continua Bute, que, l’an passé, il était encore chez son oncle. Mais c’est bien étonnant que Monsieur ne l’ait pas déjà rencontré dans les bois ; presque tous les soirs il braconne.
Bute avait dit ces derniers mots plus bas. Il me regarda bien et je compris qu’il était urgent de sourire. Alors Bute, satisfait, continua :
— Monsieur sait parbleu bien qu’on le braconne. Bah ! les bois sont si grands que ça n’y fait pas bien du tort...
Je m’en montrai si peu mécontent que, bien vite, Bute enhardi et, je pense aujourd’hui, heureux de desservir un peu Bocage, me montra dans tel creux des collets tendus par Alcide, puis m’enseigna tel endroit de la haie où je pouvais être à peu près sûr de le surprendre. C’était, sur le haut d’un talus, un étroit pertuis dans la haie qui formait lisière, et par lequel Alcide avait accoutumé de passer vers six heures. Là, Bute et moi, fort amusés, nous tendîmes un fil de cuivre, très joliment dissimulé. Puis, m’ayant fait jurer que je ne le dénoncerais pas, Bute partit, ne voulant pas se compromettre. Je me couchai contre le revers du talus ; j’attendis.
Et trois soirs j’attendis en vain. Je commençais à croire que Bute m’avait joué... Le quatrième soir, enfin, j’entends un très léger pas approcher. Mon cœur bat et j’apprends soudain l’affreuse volupté de celui qui braconne... Le collet est si bien posé qu’Alcide y vient donner tout droit. Je le vois brusquement s’étaler, la cheville prise. Il veut se sauver, retombe, et se débat comme un gibier. Mais déjà je le tiens. C’est un méchant galopin, à l’œil vert, aux cheveux filasse, à l’expression chafouine. Il me lance des coups de pied ; puis, immobilisé, tâche de mordre, et comme il n’y peut parvenir commence à me jeter au nez les plus extraordinaires injures que j’aie jusqu’alors entendues. À la fin je n’y puis plus tenir ; j’éclate de rire. Alors lui s’arrête soudain, me regarde et, d’un ton plus bas :
— Espèce de brutal, vous m’avez estropié.
— Fais voir.
Il fait glisser son bas sur ses galoches et montre sa cheville où l’on distingue à peine une légère trace un peu rose. — Ce n’est rien. — Il sourit un peu, puis, sournoisement :
— J’m’en vas le dire à mon père que c’est vous qui tendez les collets.
— Parbleu ! c’est un des tiens.
— Ben sûr que c’est pas vous qui l’avez posé, c’ti là.
— Pourquoi donc pas ?
— Vous n’sauriez pas si bien. Montrez-moi comment que vous faites.
— Apprends-moi...
Ce soir je ne rentrai que bien tard pour le dîner, et, comme on ne savait où j’étais, Marceline était inquiète. Je ne lui racontai pourtant pas que j’avais posé six collets et que, loin de gronder Alcide, je lui avais donné dix sous.
Le lendemain, allant relever ces collets avec lui, j’eus l’amusement de trouver deux lapins pris aux pièges ; naturellement je les lui laissai. La chasse n’était pas encore ouverte. Que devenait donc ce gibier, qu’on ne pouvait montrer sans se commettre ? C’est ce qu’Alcide se refusait à m’avouer. Enfin j’appris, par Bute encore, que Heurtevent était un maître recéleur, et qu’entre Alcide et lui le plus jeune des fils commissionnait. Allais-je donc ainsi pénétrer plus avant dans cette famille farouche ? Avec quelle passion je braconnai !
Je retrouvais Alcide chaque soir ; nous prîmes des lapins en grand nombre, et même une fois un chevreuil ; il vivait faiblement encore. Je ne me souviens pas sans horreur de la joie qu’eut Alcide à le tuer. Nous mîmes le chevreuil en lieu sûr, où le fils Heurtevent pût venir le chercher dans la nuit.
Dès lors je ne sortis plus si volontiers le jour, où les bois vidés m’offraient moins d’attraits. Je tâchai même de travailler ; triste travail sans but — car j’avais dès la fin de mon cours refusé de continuer ma suppléance — travail ingrat, et dont me distrayait soudain le moindre chant, le moindre bruit dans la campagne ; tout cri me devenait appel. Que de fois ai-je ainsi bondi de ma lecture à ma fenêtre, pour ne voir rien du tout passer ! Que de fois, sortant brusquement... La seule attention dont je fusse capable, c’était celle de tous mes sens.
Mais quand la nuit tombait, — et la nuit à présent déjà, tombait vite — c’était notre heure, dont je ne soupçonnais pas jusqu’alors la beauté ; et je sortais comme entrent les voleurs. Je m’étais fait des yeux d’oiseau de nuit. J’admirais l’herbe plus mouvante et plus haute, les arbres épaissis. La nuit creusait tout, éloignait, faisait le sol distant et toute surface profonde. Le plus uni sentier paraissait dangereux. On sentait s’éveiller partout ce qui vivait d’une existence ténébreuse.
— Où ton père te croit-il à présent ?
— À garder les bêtes, à l’étable.
Alcide couchait là, je le savais, tout près des pigeons et des poules ; comme on l’y enfermait le soir, il sortait par un trou du toit ; il gardait dans ses vêtements une chaude odeur de poulaille...
Puis brusquement, et sitôt le gibier récolté, il fonçait dans la nuit comme dans une trappe, sans un geste d’adieu, sans même me dire : à demain. Je savais qu’avant de rentrer dans la ferme où les chiens, pour lui, se taisaient, il retrouvait le petit Heurtevent et lui remettait sa provende. Mais où ? C’est ce que mon désir ne pouvait arriver à surprendre ; menaces, ruses échouèrent ; les Heurtevent ne se laissaient pas approcher. Et je ne sais où triomphait le plus ma folie : poursuivre un médiocre mystère qui reculait toujours devant moi ? peut-être même inventer le mystère, à force de curiosité ? — Mais que faisait Alcide en me quittant ? Couchait-il vraiment à la ferme ? ou seulement le faisait-il croire au fermier ? Ah ! j’avais beau me compromettre, je n’arrivais à rien qu’à diminuer encore son respect sans augmenter sa confiance ; et cela m’enrageait et me désolait à la fois...
Lui disparu, soudain, je restais affreusement seul ; et je rentrais à travers champs, dans l’herbe lourde de rosée, ivre de nuit, de vie sauvage et d’anarchie, trempé, boueux, couvert de feuilles. De loin, dans la Morinière endormie, semblait me guider, comme un paisible phare, la lampe de la chambre de Marceline à qui j’avais persuadé que, sans sortir ainsi la nuit, je n’aurais pas pu m’endormir. C’était vrai : je prenais en horreur mon lit, et j’eusse préféré la grange.
Le gibier abondait cette année. Lapins, lièvres, faisans, se succédèrent. Voyant tout marcher à souhait, Bute, au bout de trois soirs, prit le goût de se joindre à nous.
Le sixième soir de braconnage, nous ne retrouvâmes plus que deux collets sur douze ; une rafle avait été faite pendant le jour. Bute me demanda cent sous pour racheter du fil de cuivre, le fil de fer ne valant rien.
Le lendemain j’eus le plaisir de voir mes dix collets chez Bocage, et je dus approuver son zèle. Le plus fort c’est que, l’an passé, j’avais inconsidérément promis dix sous pour chaque collet saisi ; j’en dus donc donner cent à Bocage. Cependant, avec ses cent sous, Bute rachète du fil de cuivre. Quatre jours après, même histoire ; dix nouveaux collets sont saisis. C’est de nouveau cent sous à Bute ; de nouveau cent sous à Bocage. Et comme je le félicite :
— Ce n’est pas moi, dit-il, qu’il faut féliciter. C’est Alcide.
— Bah !
Trop d’étonnement peut nous perdre ; je me contiens.
— Oui, continue Bocage ; que voulez-vous, Monsieur, je me fais vieux, et suis trop requis par la ferme. Le petit court les bois pour moi ; il les connaît ; il est malin, et il sait mieux que moi où chercher et trouver les pièges.
— Je le crois sans effort, Bocage.
— Alors, sur les dix sous que Monsieur donne, je lui laisse cinq sous par piège.
— Certainement il les mérite. Parbleu ! Vingt collets en cinq jours ! Il a bien travaillé. Les braconniers n’ont qu’à bien se tenir. Ils vont se reposer, je parie.
— Oh ! Monsieur, tant plus qu’on en prend, tant plus qu’on en trouve. Le gibier se vend cher cette année, et pour quelques sous que ça leur coûte...
Je suis si bien joué que pour un peu je croirais Bocage de mèche. Et ce qui me dépite en cette affaire, ce n’est pas le triple commerce d’Alcide, c’est de le voir ainsi me tromper. Et puis que font-ils de l’argent, Bute et lui ? Je ne sais rien ; je ne saurai rien de tels êtres. Ils mentiront toujours ; me tromperont pour me tromper. Ce soir ce n’est pas cent sous, c’est dix francs que je donne à Bute ; je l’avertis que c’est pour la dernière fois et que, si les collets sont repris, c’est tant pis.
Le lendemain je vois venir Bocage ; il semble très gêné ; je le deviens aussitôt plus que lui. Que s’est-il donc passé ? Et Bocage m’apprend que Bute n’est rentré qu’au petit matin sur la ferme ; Bute est soûl comme un Polonais ; aux premiers mots que lui a dits Bocage, Bute l’a salement insulté, puis s’est jeté sur lui, l’a frappé...
— Enfin, me dit Bocage, je venais savoir si Monsieur m’autorise (il reste un instant sur le mot), m’autorise à le renvoyer.
— Je vais y réfléchir, Bocage. Je suis très désolé qu’il vous ait manqué de respect. Je vois... Laissez-moi seul y réfléchir ; et revenez ici dans deux heures.
Bocage sort.
Garder Bute, c’est manquer péniblement à Bocage ; chasser Bute, c’est le pousser à se venger. Tant pis ; advienne que pourra ; aussi bien suis-je le seul coupable... Et dès que Bocage revient :
— Vous pouvez dire à Bute qu’on ne veut plus le voir ici.
Puis j’attends. Que fait Bocage ? Que dit Bute ? Et le soir seulement j’ai quelques échos du scandale. Bute a parlé. Je le comprends d’abord par les cris que j’entends chez Bocage ; c’est le petit Alcide qu’on bat. — Bocage va venir ; il vient ; j’entends son vieux pas approcher, et mon cœur bat plus fort encore qu’il ne battait pour le gibier. L’insupportable instant ! Tous les grands sentiments seront de mise ; je vais être forcé de le prendre au sérieux. Quelles explications inventer ? Comme je vais jouer mal ! Ah ! je voudrais rendre mon rôle... Bocage entre. Je ne comprends strictement rien à ce qu’il dit. C’est absurde : je dois le faire recommencer. À la fin je distingue ceci : Il croit que Bute est seul coupable ; l’incroyable vérité lui échappe ; que j’aie donné dix francs à Bute, et pour quoi faire ? il est trop Normand pour l’admettre. Les dix francs, Bute les a volés, c’est sûr ; en prétendant que je les ai donnés, il ajoute au vol le mensonge ; histoire d’abriter son vol ; ce n’est pas à Bocage qu’on en fait accroire... Du braconnage il n’en est plus question. Si Bocage battait Alcide, c’est parce que le petit découchait.
Allons ! je suis sauvé ; devant Bocage au moins tout va bien. Quel imbécile que ce Bute ! Certes, ce soir je n’ai pas grand désir de braconner.
Je croyais déjà tout fini, mais une heure après voici Charles. Il n’a pas l’air de plaisanter ; de loin déjà il paraît plus rasant encore que son père. Dire que l’an passé...
— Eh bien ! Charles, voilà longtemps qu’on ne t’a vu.
— Si Monsieur tenait à me voir, il n’avait qu’à venir sur la ferme. Ce n’est parbleu ni des bois ni de la nuit que j’ai affaire.
— Ah ! ton père t’a raconté...
— Mon père ne m’a rien raconté parce que mon père ne sait rien. Qu’a-t-il besoin d’apprendre, à son âge, que son maître se fiche de lui ?
— Attention, Charles ! tu vas trop loin...
— Oh ! parbleu, vous êtes le maître ! et vous faites ce qui vous plaît.
— Charles, tu sais parfaitement que je ne me suis moqué de personne, et si je fais ce qui me plaît c’est que cela ne nuit qu’à moi.
Il eut un léger haussement d’épaules.
— Comment voulez-vous qu’on défende vos intérêts, quand vous les attaquez vous-même ? Vous ne pouvez protéger à la fois le garde et le braconnier.
— Pourquoi ?
— Parce qu’alors... ah ! tenez, Monsieur, tout cela c’est trop malin pour moi, et simplement cela ne me plaît pas de voir mon maître faire bande avec ceux qu’on arrête, et défaire avec eux le travail qu’on a fait pour lui.
Et Charles dit cela d’une voix de plus en plus assurée. Il se tient presque noblement. Je remarque qu’il a fait couper ses favoris. Ce qu’il dit est d’ailleurs assez juste. Et comme je me tais (que lui dirais-je ?), il continue :
— Qu’on ait des devoirs envers ce qu’on possède, Monsieur me l’enseignait l’an dernier, mais semble l’avoir oublié. Il faut prendre ces devoirs au sérieux et renoncer à jouer avec... ou alors c’est qu’on ne méritait pas de posséder.
Un silence.
— C’est tout ce que tu avais à dire ?
— Pour ce soir, oui Monsieur ; mais un autre soir, si Monsieur m’y pousse, peut-être viendrai-je dire à Monsieur que mon père et moi quittons la Morinière.
Et il sort en me saluant très bas. À peine si je prends le temps de réfléchir :
— Charles ! — Il a parbleu raison... Mais si c’est là ce qu’on appelle posséder !... Charles ! Je cours après lui ; je le rattrape dans la nuit, et, très vite, comme pour assurer ma décision subite :
— Tu peux annoncer à ton père que je mets la Morinière en vente.
Charles salue gravement et s’éloigne sans dire un mot.
Tout cela est absurde.
Marceline, ce soir, ne peut descendre pour dîner et me fait dire qu’elle est souffrante. Je monte en hâte et plein d’anxiété dans sa chambre. Elle me rassure aussitôt. « Ce n’est qu’un rhume », espère-t-elle. Elle a pris froid.
— Tu ne pouvais donc pas te couvrir ?
— Pourtant, dès le premier frisson, j’ai mis mon châle.
— Ce n’est pas après le frisson qu’il fallait le mettre ; c’est avant.
Elle me regarde, essaye de sourire... Ah ! peut-être une journée si mal commencée me dispose-t-elle à l’angoisse — elle m’aurait dit à haute voix : « Tiens-tu donc tant à ce que je vive ? » je ne l’aurais pas mieux entendue. Décidément tout se défait autour de moi ; de tout ce que ma main saisit, ma main ne sait rien retenir... Je m’élance vers Marceline et couvre de baisers ses tempes pâles. Alors, elle ne se retient plus et sanglote sur mon épaule.
— Oh ! Marceline ! Marceline ! partons d’ici. Ailleurs je t’aimerai comme je t’aimais à Sorrente. Tu m’as cru changé, n’est-ce pas ? Mais ailleurs, tu sentiras bien que rien n’a changé notre amour...
Et je ne guéris pas encore sa tristesse, mais déjà, comme elle se raccroche à l’espoir !
La saison n’était pas avancée, mais il faisait humide et froid, et déjà les derniers boutons des rosiers pourrissaient sans pouvoir éclore. Nos invités nous avaient quittés depuis longtemps. Marceline n’était pas si souffrante qu’elle ne pût s’occuper de fermer la maison, et cinq jours après nous partîmes.