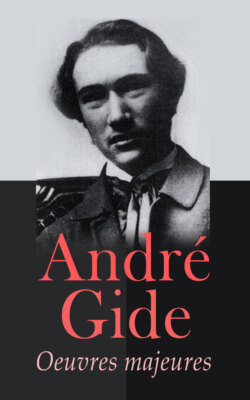Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 122
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIALOGUE AVEC LE FRÈRE PUÎNÉ
ОглавлениеTable des matières
C’est, à côté de celle du prodigue, une chambre point étroite aux murs nus. Le prodigue, une lampe à la main, s’avance près du lit où son frère puîné repose, le visage tourné vers le mur. Il commence à voix basse, afin, si l’enfant dort, de ne pas le troubler dans son sommeil.
– Je voudrais te parler, mon frère.
– Qu’est-ce qui t’en empêche ?
– Je croyais que tu dormais.
– On n’a pas besoin de dormir pour rêver.
– Tu rêvais ; à quoi donc ?
– Que t’importe ! Si déjà moi je ne comprends pas mes rêves, ce n’est pas toi, je pense, qui me les expliqueras.
– Ils sont donc bien subtils ? Si tu me les racontais, j’essaierais.
– Tes rêves, est-ce que tu les choisis ? Les miens sont ce qu’ils veulent, et plus libres que moi… Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Pourquoi tue déranger dans mon sommeil ?
– Tu ne dors pas, et je viens te parler doucement.
– Qu’as-tu à me dire ?
– Rien, si tu le prends sur ce ton.
– Alors adieu.
Le prodigue va vers la porte, mais pose à terre la lampe qui n’éclaire plus que faiblement la pièce, puis, revenant, s’assied au bord du lit et, dans l’ombre, caresse longuement le front détourné de l’enfant.
– Tu me réponds plus durement que je ne fis jamais à ton frère. Pourtant je protestais aussi contre lui.
L’enfant rétif s’est redressé brusquement.
– Dis : c’est le frère qui t’envoie ?
– Non, petit ; pas lui, mais notre mère.
– Ah ! Tu ne serais pas venu de toi-même.
– Mais je viens pourtant en ami. À demi soulevé sur son lit, l’enfant regarde fixement le prodigue.
– Comment quelqu’un des miens saurait-il être mon ami ?
– Tu te méprends sur notre frère…
– Ne me parle pas de lui ! Je le hais… mon cœur, contre lui, s’impatiente. Il est cause que je t’ai répondu durement.
– Comment cela ?
– Tu ne comprendrais pas.
– Dis cependant…
Le prodigue berce son frère contre lui, et déjà l’enfant adolescent s’abandonne :
– Le soir de ton retour, je n’ai pas pu dormir. Toute la nuit je songeais : J’avais un autre frère, et je ne le savais pas… C’est pour cela que mon cœur a battu si fort, quand, dans la cour de la maison, je t’ai vu t’avancer couvert de gloire.
– Hélas ! j’étais couvert alors de haillons.
– Oui, je t’ai vu ; mais déjà glorieux. Et j’ai vu ce qu’a fait notre père : il a mis à ton doigt un anneau, un anneau tel que n’en a pas notre frère. Je ne voulais interroger à ton sujet personne ; je savais seulement que tu revenais de très loin, et ton regard, à table…
– Étais-tu du festin ?
– Oh ! je sais bien que tu ne m’as pas vu ; durant tout le repas tu regardais au loin sans rien voir. Et, que le second soir tu aies été parler au père, c’était bien, mais le troisième…
– Achève.
– Ah ! ne fût-ce qu’un mot d’amour tu aurais pourtant bien pu me le dire !
– Tu m’attendais donc ?
– Tellement ! Penses-tu que je haïrais à ce point notre frère si tu n’avais pas été causer et si longuement avec lui ce soir-là ? Qu’est-ce que vous avez pu vous dire ? Tu sais bien, si tu me ressembles, que tu ne peux rien avoir de commun avec lui.
– J’avais eu de graves torts envers lui.
– Se peut-il ?
– Du moins envers notre père et notre mère. Tu sais que j’avais fui de la maison.
– Oui, je sais. Il y a longtemps n’est-ce pas ?
– À peu près quand j’avais ton âge.
– Ah !… Et c’est là ce que tu appelles tes torts ?
– Oui, ce fut là mon tort, mon péché.
– Quand tu partis, sentais-tu que tu faisais mal ?
– Non ; je sentais en moi comme une obligation de partir.
– Que s’est-il donc passé depuis ? pour changer ta vérité d’alors en erreur.
– J’ai souffert.
– Et c’est cela qui te fait dire : j’avais tort ?
– Non, pas précisément : c’est cela qui m’a fait réfléchir.
– Auparavant tu n’avais donc pas réfléchi ?
– Si, mais ma débile raison s’en laissait imposer par mes désirs.
– Comme plus tard par la souffrance. De sorte qu’aujourd’hui, tu reviens… vaincu.
– Non, pas précisément ; résigné.
– Enfin, tu as renoncé à être celui que tu voulais être.
– Que mon orgueil me persuadait d’être.
L’enfant reste un instant silencieux, puis brusquement sanglote et crie :
– Mon frère ! je suis celui que tu étais en partant. Oh ! dis : n’as-tu donc rencontré rien que de décevant sur la route ? Tout ce que je pressens au dehors, de différent d’ici, n’est-ce donc que mirage ? tout ce que je sens en moi de neuf, que folie ? Dis : qu’as-tu rencontré de désespérant sur ta route ? Oh ! qu’est-ce qui t’a fait revenir ?
– La liberté que je cherchais, je l’ai perdue ; captif, j’ai dû servir.
– Je suis captif ici.
– Oui, mais servir de mauvais maîtres ; ici, ceux que tu sers sont tes parents.
– Ah ! servir pour servir, n’a-t-on pas cette liberté de choisir du moins son servage ?
– Je l’espérais. Aussi loin que mes pieds m’ont porté, j’ai marché, comme Saül à la poursuite de ses ânesses, à la poursuite de mon désir ; mais, où l’attendait un royaume, c’est la misère que j’ai trouvée. Et pourtant…
– Ne t’es-tu pas trompé de route ?
– J’ai marché devant moi.
– En es-tu sûr ? Et pourtant il y a d’autres royaumes, encore, et des terres sans roi, à découvrir.
– Qui te l’a dit ?
– Je le sais. Je le sens. Il me semble déjà que j’y domine.
– Orgueilleux !
– Ah ! ah ! ça c’est ce que t’a dit notre frère. Pourquoi, toi, me le redis-tu maintenant ? Que n’as-tu gardé cet orgueil ! Tu ne serais pas revenu.
– Je n’aurais donc pas pu te connaître.
– Si, si, là-bas, où je t’aurais rejoint, tu m’aurais reconnu pour ton frère ; même il me semble encore que c’est pour te retrouver que je pars.
– C’est le porcher qui me la rapporta l’autre soir, après n’être pas rentré de trois jours.
– Oui, c’est une grenade sauvage.
– Je le sais ; elle est d’une âcreté presque affreuse ; je sens pourtant que, si j’avais suffisamment soif, j’y mordrais.
– Ah ! je peux donc te le dire à présent : c’est cette soif que dans le désert je cherchais.
– Une soif dont seul ce fruit non sucré désaltère…
– Non ; mais il fait aimer cette soif.
– Tu sais où le cueillir ?
– C’est un petit verger abandonné, où l’on arrive avant le soir. Aucun mur ne le sépare plus du désert. Là coulait un ruisseau ; quelques fruits demi-mûrs pendaient aux branches.
– Quels fruits ?
– Les mêmes que ceux de notre jardin ; mais sauvages. Il avait fait très chaud tout le jour.
– Écoute ; sais-tu pourquoi je t’attendais ce soir ? C’est avant la fin de la nuit que je pars. Cette nuit ; cette nuit, dès qu’elle pâlira… J’ai ceint, mes reins, j’ai gardé cette nuit mes sandales.
– Quoi ! ce que je n’ai pas pu faire, tu le feras ?…
– Tu m’as ouvert la route, et de penser à toi me soutiendra.
– À moi de t’admirer ; à toi de m’oublier, au contraire. Qu’emportes-tu ?
– Tu sais bien que, puîné, je n’ai point part à l’héritage. Je pars sans rien.
– Que tu pars ?
– Ne l’as-tu pas compris ? Ne m’encourages-tu pas toi-même à partir ?
– Je voudrais t’épargner le retour ; mais en t’épargnant le départ.
– Non, non, ne me dis pas cela ; non ce n’est pas cela que tu veux dire. Toi aussi, n’est-ce pas, c’est comme un conquérant que tu partis.
– Et c’est ce qui me fit paraître plus dur le servage.
– Alors, pourquoi t’es-tu soumis ? Étais-tu si fatigué déjà ?
– Non, pas encore ; mais j’ai douté.
– Que veux-tu dire ?
– Douté de tout, de moi ; j’ai voulu m’arrêter, m’attacher enfin quelque part ; le confort que me promettait ce maître m’a tenté… oui, je le sens bien à présent ; j’ai failli.
Le prodigue incline la tête et cache son dans ses mains.
– Mais d’abord ?
– J’avais marché longtemps à travers la grande terre indomptée.
– Le désert ?
– Ce n’était pas toujours le désert.
– Qu’y cherchais-tu ?
– Je ne le comprends plus moi-même.
– Lève-toi de mon lit. Regarde, sur la table, à mon chevet, là, près de ce livre déchiré.
– Je vois une grenade ouverte.
– C’est mieux.
– Que regardes-tu donc à la croisée ?
– Le jardin où sont couchés nos parents morts.
– Mon frère… (et l’enfant, qui s’est levé du lit, pose, autour du cou du prodigue, son bras qui se fait aussi doux que sa voix) – Pars avec moi.
– Laisse-moi ! laisse-moi ! je reste à consoler notre mère. Sans moi tu seras plus vaillant. Il est temps à présent. Le ciel pâlit. Pars sans bruit. Allons ! embrasse-moi, mon jeune frère : tu emportes tous mes espoirs. Sois fort ; oublie-nous ; oublie-moi. Puisses-tu ne pas revenir… Descends doucement. Je tiens la lampe…
– Ah ! donne-moi la main jusqu’à la porte.
– Prends garde aux marches du perron…