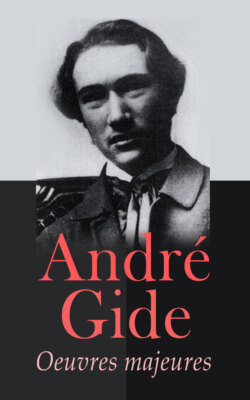Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 115
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TROISIÈME PARTIE
ОглавлениеTable des matières
Je tâchai donc, et encore une fois, de refermer ma main sur mon amour. Mais qu’avais-je besoin de tranquille bonheur ? Celui que me donnait et que représentait pour moi Marceline, était comme un repos pour qui ne se sent pas fatigué. — Mais comme je sentais qu’elle était lasse et qu’elle avait besoin de mon amour, je l’en enveloppai et feignis que ce fût par le besoin que j’en avais moi-même. Je sentais intolérablement sa souffrance ; c’était pour l’en guérir que je l’aimais.
Ah ! soins passionnés, tendres veilles ! Comme d’autres ravivent leur foi en en exagérant les pratiques, ainsi développai-je mon amour. Et Marceline se reprenait, vous dis-je, aussitôt à l’espoir. En elle il y avait encore tant de jeunesse ; en moi tant de promesses, croyait-elle. — Nous nous enfuîmes de Paris comme pour de nouvelles noces. Mais, dès le premier jour du voyage, elle commença d’aller beaucoup plus mal ; dès Neuchâtel il nous fallut nous arrêter.
Combien j’aimai ce lac aux rives glauques ! sans rien d’alpestre, et dont les eaux, comme celles d’un marécage, longtemps se mêlent à la terre et filtrent entre les roseaux. Je pus trouver pour Marceline, dans un hôtel très confortable, une chambre ayant vue sur le lac ; je ne la quittai pas de tout le jour.
Elle allait si peu bien que, dès le lendemain, je fis venir un docteur de Lausanne. Il s’inquiéta, bien inutilement, de savoir si déjà, dans la famille de ma femme, je connaissais d’autres cas de tuberculose. Je répondis que oui ; pourtant je n’en connaissais pas ; mais il me déplaisait de dire que moi-même j’avais été presque condamné pour cela et qu’avant de m’avoir soigné Marceline n’avait jamais été malade. Et je rejetai tout sur l’embolie, bien que le médecin n’y voulût voir rien qu’une cause occasionnelle et m’affirmât que le mal datait de plus loin. Il nous conseilla vivement le grand air des hautes Alpes, où Marceline, affirmait-il, guérirait ; et, comme précisément mon désir était de passer tout l’hiver en Engadine, sitôt que Marceline fut assez bien pour pouvoir supporter le voyage, nous repartîmes.
Je me souviens comme d’événements de chaque sensation de la route. Le temps était limpide et froid ; nous avions emporté les plus chaudes fourrures... À Coire, le vacarme incessant de l’hôtel nous empêcha presque complètement de dormir. J’aurais pris gaîment mon parti d’une nuit blanche dont je ne me serais pas senti fatigué ; mais Marceline... Et je ne m’irritai point tant contre ce bruit que de ce qu’elle n’eût su trouver, et malgré ce bruit, le sommeil. Elle en eût eu si grand besoin ! — Le lendemain nous partîmes dès avant l’aube ; nous avions retenu les places du coupé dans la diligence de Coire ; les relais bien organisés permettent de gagner Saint-Moritz en un jour.
Tiefenkasten, le Julier, Samaden... je me souviens de tout, heure par heure ; de la qualité très nouvelle et de l’inclémence de l’air ; du son des grelots des chevaux ; de ma faim ; de la halte à midi devant l’auberge ; de l’œuf cru que je crevai dans la soupe, du pain bis et de la froideur du vin aigre. — Ces mets grossiers convenaient mal à Marceline ; elle ne put manger à peu près rien que quelques biscuits secs qu’heureusement j’avais eu soin de prendre pour la route. — Je revois la tombée du jour, la rapide ascension de l’ombre contre les pentes des forêts ; puis une halte encore. L’air devient toujours plus vif et plus cru. Quand la diligence s’arrête, on plonge jusqu’au cœur dans la nuit et dans le silence limpide ; limpide... il n’y a pas d’autre mot. Le moindre bruit prend sur cette transparence étrange sa qualité parfaite et sa pleine sonorité. On repart dans la nuit. Marceline tousse... Oh ! n’arrêtera-t-elle pas de tousser ? Je resonge à la diligence de Sousse. Il me semble que je toussais mieux que cela : Elle fait trop d’efforts... Comme elle paraît faible et changée ; dans l’ombre, ainsi, je la reconnaîtrais à peine. Que ses traits sont tirés ! Est-ce que l’on voyait ainsi les deux trous noirs de ses narines ? — Oh ! elle tousse affreusement. C’est le plus clair résultat de ses soins. J’ai horreur de la sympathie ; toutes les contagions s’y cachent ; on ne devrait sympathiser qu’avec les forts. — Oh ! vraiment elle n’en peut plus ! N’arriverons-nous pas bientôt ?... Que fait-elle ?... Elle prend son mouchoir ; le porte à ses lèvres ; se détourne... Horreur ! est-ce qu’elle aussi va cracher le sang ? — Brutalement j’arrache le mouchoir de ses mains. Dans la demi-clarté de la lanterne, je regarde... Rien. Mais j’ai trop montré mon angoisse ; Marceline tristement s’efforce de sourire et murmure :
— Non ; pas encore.
Enfin nous arrivons. Il n’est que temps ; elle se tient à peine. Les chambres qu’on nous a préparées ne me satisfont pas ; nous y passons la nuit, puis demain nous changerons. Rien ne me paraît assez beau ni trop cher. Et comme la saison d’hiver n’est pas encore commencée, l’immense hôtel se trouve à peu près vide ; je peux choisir. Je prends deux chambres spacieuses, claires et simplement meublées ; un grand salon y attenant, se terminant en large bow-window d’où l’on peut voir et le hideux lac bleu, et je ne sais quel mont brutal, aux pentes trop boisées ou trop nues. C’est là qu’on nous servira nos repas. L’appartement est hors de prix, mais que m’importe ! Je n’ai plus mon cours, il est vrai, mais fais vendre la Morinière. Et puis nous verrons bien... D’ailleurs, qu’ai-je besoin d’argent ? Qu’ai-je besoin de tout cela ?... Je suis devenu fort, à présent... Je pense qu’un complet changement de fortune doit éduquer autant qu’un complet changement de santé... Marceline, elle, a besoin de luxe ; elle est faible... ah ! pour elle je veux dépenser tant et tant que... Et je prenais tout à la fois l’horreur et le goût de ce luxe. J’y lavais, j’y baignais ma sensualité, puis la souhaitais vagabonde.
Cependant Marceline allait mieux, et mes soins constants triomphaient. Comme elle avait peine à manger, je commandais, pour stimuler son appétit, des mets délicats, séduisants ; nous buvions les vins les meilleurs. Je me persuadais qu’elle y prenait grand goût, tant m’amusaient ces crus étrangers que nous expérimentions chaque jour. Ce furent d’âpres vins du Rhin ; des Tokay presque sirupeux qui m’emplirent de leur vertu capiteuse. Je me souviens d’un bizarre Barbagrisca, dont il ne restait plus qu’une bouteille, de sorte que je ne pus savoir si le goût saugrenu qu’il avait se serait retrouvé dans les autres.
Chaque jour nous sortions en voiture ; puis en traîneau, lorsque la neige fut tombée, enveloppés jusqu’au cou de fourrures. Je rentrais le visage en feu, plein d’appétit, puis de sommeil. — Cependant je ne renonçais pas à tout travail et trouvais chaque jour plus d’une heure où méditer sur ce que je sentais devoir dire. D’histoire il n’était plus question ; depuis longtemps déjà mes études historiques ne m’intéressaient plus que comme un moyen d’investigation psychologique. J’ai dit comment j’avais pu m’éprendre à nouveau du passé, quand j’y avais cru voir de troubles ressemblances ; j’avais osé prétendre, à force de presser les morts, obtenir d’eux quelque secrète indication sur la vie... À présent le jeune Athalaric lui-même pouvait pour me parler, se lever de sa tombe ; je n’écoutais plus le passé. — Et comment une antique réponse eût-elle satisfait à ma nouvelle question : — Qu’est-ce que l’homme peut encore ? Voilà ce qu’il m’importait de savoir. Ce que l’homme a dit jusqu’ici, est-ce tout ce qu’il pouvait dire ? N’a-t-il rien ignoré de lui ? Ne lui reste-t-il qu’à redire ?... Et chaque jour croissait en moi le confus sentiment de richesses intactes, que couvraient, cachaient, étouffaient les cultures, les décences, les morales.
Il me semblait alors que j’étais né pour une sorte inconnue de trouvailles ; et je me passionnais étrangement dans ma recherche ténébreuse, pour laquelle je sais que le chercheur devait abjurer et repousser de lui culture, décence et morale.
J’en venais à ne goûter plus en autrui que les manifestations les plus sauvages, à déplorer qu’une contrainte quelconque les réprimât. Pour un peu je n’eusse vu dans l’honnêteté que restrictions, conventions ou peur. Il m’aurait plu de la chérir comme une difficulté rare ; nos mœurs en avaient fait la forme mutuelle et banale d’un contrat. En Suisse, elle fait partie du confort. Je comprenais que Marceline en eût besoin ; mais ne lui cachais pourtant pas le cours nouveau de mes pensées. À Neuchâtel déjà, comme elle louangeait cette honnêteté qui transpire là-bas des murs et des visages :
— La mienne me suffit amplement, répartis-je ; j’ai les honnêtes gens en horreur. Si je n’ai rien à craindre d’eux, je n’ai non plus rien à apprendre. Et eux n’ont d’ailleurs rien à dire... Honnête peuple suisse ! Se porter bien ne lui vaut rien... sans crimes, sans histoire, sans littérature, sans arts... un robuste rosier, sans épines ni fleurs...
Et que ce pays honnête m’ennuyât, c’est ce que je savais d’avance, mais, au bout de deux mois, cet ennui devenant une sorte de rage, je ne songeai plus qu’à partir.
Nous étions à la mi-janvier. Marceline allait mieux, beaucoup mieux : la petite fièvre continue qui lentement la minait s’était éteinte ; un sang plus frais recolorait ses joues ; elle marchait de nouveau volontiers, quoique peu ; n’était plus comme avant constamment lasse. Je n’eus pas trop grand’peine à la persuader que tout le bénéfice de cet air tonique était acquis, que rien ne lui serait meilleur à présent que de descendre en Italie où la tiède faveur du printemps achèverait de la guérir — et surtout je n’eus pas grand’peine à m’en persuader moi-même, tant j’étais las de ces hauteurs.
Et pourtant, à présent que, dans mon désœuvrement, le passé détesté reprend sa force, entre tous, ces souvenirs m’obsèdent. Courses rapides en traîneau ; cinglement joyeux de l’air sec, éclaboussement de la neige, appétit ; — marche incertaine dans le brouillard, sonorités bizarres des voix, brusque apparition des objets ; — lectures dans le salon bien calfeutré, paysage à travers la vitre, paysage glacé ; — tragique attente de la neige ; — disparition du monde extérieur, voluptueux blottissement des pensées... Oh ! patiner encore avec elle, là-bas, seuls, sur ce petit lac pur, entouré de mélèzes, perdu ; puis rentrer avec elle, le soir...
Cette descente en Italie eut pour moi tous les vertiges d’une chute. Il faisait beau. À mesure que nous enfoncions dans l’air plus tiède et plus dense, les arbres rigides des sommets, mélèzes et sapins réguliers, faisaient place à une végétation riche de molle grâce et d’aisance. Il me semblait quitter l’abstraction pour la vie, et bien que nous fussions en hiver, j’imaginais partout des parfums. Depuis trop longtemps nous n’avions plus ri qu’à des ombres. Ma privation me grisait, et c’est de soif que j’étais ivre, comme d’autres sont ivres de vin. L’épargne de ma vie était admirable ; au seuil de cette terre tolérante et prometteuse, tous mes appétits éclataient. Une énorme réserve d’amour me gonflait ; parfois elle affluait du fond de ma chair vers ma tête et dévergondait mes pensées.
Cette illusion de printemps dura peu. Le brusque changement d’altitude m’avait pu tromper un instant, mais, dès que nous eûmes quitté les rives abritées des lacs, Bellagio, Côme où nous nous attardâmes quelques jours, nous retrouvâmes l’hiver et la pluie. Le froid que nous supportions bien en Engadine, non plus sec et léger comme sur les hauteurs, mais humide à présent et maussade, commença de nous faire souffrir. Marceline se remit à tousser. Alors, pour fuir le froid, nous descendîmes plus au Sud : nous quittâmes Milan pour Florence, Florence pour Rome, Rome pour Naples qui, sous la pluie d’hiver, est bien la plus lugubre ville que je connaisse. Je traînais un ennui sans nom. Nous revînmes à Rome, chercher, à défaut de chaleur, un semblant de confort. Sur le Monte Pincio nous louâmes un appartement trop vaste, mais admirablement situé. À Florence déjà, mécontents des hôtels, nous avions loué pour trois mois une exquise villa sur le Viale dei Colli. Un autre y aurait souhaité toujours vivre... Nous n’y restâmes pas vingt jours. À chaque nouvelle étape pourtant, j’avais soin d’aménager tout comme si nous ne devions plus repartir. Un démon plus fort me poussait... Ajoutez à cela que nous n’emportions pas moins de huit malles. Il y en avait une, uniquement pleine de livres, et que, durant tout le voyage, je n’ouvris pas même une fois.
Je n’admettais pas que Marceline s’occupât de nos dépenses, ni tentât de les modérer. Qu’elles fussent excessives, certes, je le savais, et qu’elles ne pourraient durer. Je cessai de compter sur l’argent de la Morinière ; elle ne rapportait plus rien et Bocage écrivait qu’il ne trouvait pas d’acquéreur. Mais toute considération d’avenir n’aboutissait qu’à me faire dépenser davantage. Ah ! qu’aurais-je besoin de tant, une fois seul !... pensais-je et j’observais, plein d’angoisse et d’attente, diminuer, plus vite encore que ma fortune, la frêle vie de Marceline.
Bien qu’elle se reposât sur moi de tous les soins, ces déplacements précipités la fatiguaient ; mais ce qui la fatiguait plus, j’ose bien à présent me l’avouer, c’était la peur de ma pensée.
— Je vois bien, me dit-elle un jour, je comprends bien votre doctrine — car c’est une doctrine à présent. Elle est belle, peut-être, — puis elle ajouta plus bas, tristement : mais elle supprime les faibles.
— C’est ce qu’il faut, répondis-je aussitôt malgré moi.
Alors il me parut sentir, sous l’effroi de ma brutale parole, cet être délicat se replier et frissonner... Ah ! peut-être allez-vous penser que je n’aimais pas Marceline. Je jure que je l’aimais passionnément. Jamais elle n’avait été et ne m’avait paru si belle. La maladie avait subtilisé et comme extasié ses traits. Je ne la quittais presque plus, l’entourais de soins continus, protégeais, veillais chaque instant et de ses jours et de ses nuits. Si léger que fût son sommeil, j’exerçai mon sommeil à rester plus léger encore ; je la surveillais s’endormir et je m’éveillais le premier. Quand, parfois, la quittant une heure, je voulais marcher seul dans la campagne ou dans les rues, je ne sais quel souci d’amour et la crainte de son ennui me rappelaient vite auprès d’elle ; et parfois j’appelais à moi ma volonté, protestais contre cette emprise, me disais : n’est-ce que cela que tu vaux, faux grand homme ! et me contraignais à faire durer mon absence ; mais je rentrais alors les bras chargés de fleurs, fleurs de jardin précoce ou fleurs de serre... Oui, vous dis-je ; je la chérissais tendrement. Mais comment exprimer ceci... à mesure que je me respectais moins, je la vénérais davantage ; — et qui dira combien de passions et combien de pensées ennemies peuvent cohabiter en l’homme ?...
Depuis longtemps déjà le mauvais temps avait cessé ; la saison s’avançait ; et brusquement les amandiers fleurirent. — C’était le premier mars. Je descends au matin sur la place d’Espagne. Les paysans ont dépouillé de ses rameaux blancs la campagne, et les fleurs d’amandiers chargent les paniers des vendeurs. Mon ravissement est tel que j’en achète tout un bosquet. Trois hommes me l’apportent. Je rentre avec tout ce printemps. Les branches s’accrochent aux portes, des pétales neigent sur le tapis. J’en mets partout, dans tous les vases ; j’en blanchis le salon, dont Marceline pour l’instant, est absente. Déjà je me réjouis de sa joie... Je l’entends venir. La voici. Elle ouvre la porte. Elle chancelle... Elle éclate en sanglots.
— Qu’as-tu ? ma pauvre Marceline.
Je m’empresse auprès d’elle ; la couvre de tendres caresses. Alors, comme pour s’excuser de ses larmes :
— L’odeur de ces fleurs me fait mal, dit-elle...
Et c’était une fine, fine, une discrète odeur de miel... Sans rien dire, je saisis ces innocentes branches fragiles, les brise, les emporte, les jette, exaspéré, le sang aux yeux. — Ah ! si déjà ce peu de printemps elle ne le peut plus supporter !...
Je repense souvent à ces larmes et je crois maintenant que, déjà se sentant condamnée, c’est du regret d’autres printemps qu’elle pleurait. — Je pense aussi qu’il est de fortes joies pour les forts, et de faibles joies pour les faibles que les fortes joies blesseraient. Elle, un rien de plaisir la soûlait ; un peu d’éclat de plus, et elle ne le pouvait plus supporter. Ce qu’elle appelait le bonheur, c’est ce que j’appelais le repos, et moi je ne voulais ni ne pouvais me reposer.
Quatre jours après nous repartîmes pour Sorrente. Je fus déçu de n’y trouver pas plus de chaleur. Tout semblait grelotter. Le vent qui n’arrêtait pas de souffler fatiguait beaucoup Marceline. Nous avions voulu descendre au même hôtel qu’à notre précédent voyage ; nous retrouvions la même chambre... Nous regardions avec étonnement, sous le ciel terne, tout le décor désenchanté, et le morne jardin de l’hôtel qui nous paraissait si charmant quand s’y promenait notre amour.
Nous résolûmes de gagner par mer Palerme dont on nous vantait le climat ; nous rentrâmes à Naples où nous devions nous embarquer et où nous nous attardâmes encore. Mais à Naples du moins je ne m’ennuyais pas. Naples est une ville vivante où ne s’impose pas le passé.
Presque tous les instants du jour je restais près de Marceline. La nuit, elle se couchait tôt, étant lasse ; je la surveillais s’endormir, et parfois me couchais moi-même, puis, quand son souffle plus égal m’avertissait qu’elle dormait, je me relevais sans bruit, je me rhabillais sans lumière ; je me glissais dehors comme un voleur.
Dehors ! oh ! j’aurais crié d’allégresse. Qu’allais-je faire ? Je ne sais pas. Le ciel, obscur le jour, s’était délivré des nuages ; la lune presque pleine luisait. Je marchais au hasard, sans but, sans désir, sans contrainte. Je regardais tout d’un œil neuf ; j’épiais chaque bruit, d’une oreille plus attentive ; je humais l’humidité de la nuit ; je posais ma main sur des choses ; je rôdais.
Le dernier soir que nous restions à Naples je prolongeai jusqu’au matin cette débauche vagabonde. En rentrant je trouvai Marceline en larmes. Elle avait eu peur, me dit-elle, s’étant brusquement réveillée et ne m’ayant plus senti là. Je la tranquillisai, expliquai de mon mieux mon absence et promis de ne plus la quitter. — Mais, dès la première nuit de Palerme, je n’y pus tenir ; je sortis... Les premiers orangers fleurissaient ; le moindre souffle en apportait l’odeur...
Nous ne restâmes à Palerme que cinq jours ; puis, par un grand détour, regagnâmes Taormine que tous deux désirions revoir. Ai-je dit que le village est assez haut perché dans la montagne ; la gare est au bord de la mer. La voiture qui nous conduisit à l’hôtel dut me ramener aussitôt vers la gare où j’allais réclamer nos malles. Je m’étais mis debout dans la voiture pour causer avec le cocher. C’était un petit Sicilien de Catane, beau comme un vers de Théocrite, éclatant, odorant, savoureux comme un fruit.
— Com’è bella la Signora ! dit-il d’une voix charmante en regardant s’éloigner Marceline.
— Anche tu sei bello, ragazzo, répondis-je ; et, comme j’étais penché vers lui, je n’y pus tenir et, bientôt, l’attirant contre moi, l’embrassai. Il se laissa faire en riant.
— I Francesi sono tutti amanti, dit-il.
— Ma non tutti gli Italiani amati, répartis-je en riant aussi... Je le cherchai les jours suivants, mais je ne pus parvenir à le revoir.
Nous quittâmes Taormine pour Syracuse. Nous redéfaisions pas à pas notre premier voyage, remontions vers le début de notre amour. Et de même que, de semaine en semaine lors de notre premier voyage, je marchais vers la guérison, de semaine en semaine à mesure que nous avancions vers le Sud, l’état de Marceline empirait.
Par quelle aberration, quel aveuglement obstiné, quelle volontaire folie, me persuadai-je, et surtout tâchai-je de lui persuader qu’il lui fallait plus de lumière encore et de chaleur, invoquai-je le souvenir de ma convalescence à Biskra... L’air s’était attiédi pourtant ; la baie de Palerme est clémente et Marceline s’y plaisait. Là, peut-être, elle aurait... Mais étais-je maître de choisir mon vouloir ? de décider de mon désir ?
À Syracuse l’état de la mer et le service irrégulier des bateaux nous força d’attendre huit jours. Tous les instants que je ne passai pas près de Marceline, je les passai dans le vieux port. Ô petit port de Syracuse ! odeurs de vin suri, ruelles boueuses, puante échoppe où roulaient débardeurs, vagabonds, mariniers avinés. La société des pires gens m’était compagnie délectable. Et qu’avais-je besoin de comprendre bien leur langage, quand toute ma chair le goûtait. La brutalité de la passion y prenait encore à mes yeux un hypocrite aspect de santé, de vigueur. Et j’avais beau me dire que leur vie misérable ne pouvait avoir pour eux le goût qu’elle prenait pour moi... Ah ! j’eusse voulu rouler avec eux sous la table et ne me réveiller qu’au frisson triste du matin. Et j’exaspérais auprès d’eux ma grandissante horreur du luxe, du confort, de ce dont je m’étais entouré, de cette protection que ma neuve santé avait su me rendre inutile, de toutes ces précautions que l’on prend pour préserver son corps du contact hasardeux de la vie. J’imaginais plus loin leur existence. J’eusse voulu plus loin les suivre, et pénétrer dans leur ivresse... Puis soudain je revoyais Marceline. Que faisait-elle en cet instant ? Elle souffrait, pleurait peut-être... Je me levais en hâte ; je courais ; je rentrais à l’hôtel, où semblait écrit sur la porte : Ici les pauvres n’entrent pas.
Marceline m’accueillait toujours de même ; sans un mot de reproche ou de doute, et s’efforçant malgré tout de sourire. — Nous prenions nos repas à part ; je lui faisais servir tout ce que le médiocre hôtel pouvait réserver de meilleur. Et pendant le repas je pensais : un morceau de pain, de fromage, un pied de fenouil leur suffit et me suffirait comme à eux. Et peut-être que là, là tout près, il en est qui ont faim et qui n’ont même pas cette maigre pitance... Et voici sur ma table de quoi les soûler pour trois jours ! J’eusse voulu crever les murs, laisser affluer les convives... Car sentir souffrir de la faim me devenait angoisse affreuse. Et je regagnais le vieux port où je répandais au hasard les menues pièces dont j’avais les poches remplies.
La pauvreté de l’homme est esclave ; pour manger elle accepte un travail sans plaisir ; tout travail qui n’est pas joyeux est lamentable, pensais-je, et je payais le repos de plusieurs. Je disais : — Ne travaille donc pas : ça t’ennuie. Je rêvais pour chacun ce loisir sans lequel ne peut s’épanouir aucune nouveauté, aucun vice, aucun art.
Marceline ne se méprenait pas sur ma pensée ; quand je revenais du vieux port, je ne lui cachais pas quels tristes gens m’y entouraient. — Tout est dans l’homme. Marceline entrevoyait bien ce que je m’acharnais à découvrir ; et comme je lui reprochais de croire trop souvent à des vertus qu’elle inventait à mesure en chaque être :
— Vous, vous n’êtes content, me dit-elle, que quand vous leur avez fait montrer quelque vice. Ne comprenez-vous pas que notre regard développe, exagère en chacun le point sur lequel il s’attache ? et que nous le faisons devenir ce que nous prétendons qu’il est.
J’eusse voulu qu’elle n’eût pas raison, mais devais bien m’avouer qu’en chaque être, le pire instinct me paraissait le plus sincère. — Puis, qu’appelais-je sincérité ?
Nous quittâmes enfin Syracuse. Le souvenir et le désir du Sud m’obsédait. Sur mer, Marceline alla mieux... Je revois le ton de la mer. Elle est si calme que le sillage du navire semble y durer. J’entends les bruits d’égouttement, les bruits liquides ; le lavage du pont, et sur les planches le claquement des pieds nus des laveurs. Je revois Malte toute blanche ; l’approche de Tunis... Comme je suis changé !
Il fait chaud. Il fait beau. Tout est splendide. Ah ! je voudrais qu’en chaque phrase, ici, toute une moisson de volupté se distille... En vain chercherais-je à présent à imposer à mon récit plus d’ordre qu’il n’y en eut dans ma vie. Assez longtemps j’ai cherché de vous dire comment je devins qui je suis. Ah ! désembarrasser mon esprit de cette insupportable logique !... Je ne sens rien que de noble en moi.
Tunis. Lumière plus abondante que forte. L’ombre en est encore emplie. L’air lui-même semble un fluide lumineux où tout baigne, où l’on plonge, où l’on nage. Cette terre de volupté satisfait mais n’apaise pas le désir, et toute satisfaction l’exalte.
Terre en vacance d’œuvres d’art. Je méprise ceux qui ne savent reconnaître la beauté que transcrite déjà et toute interprétée. Le peuple arabe a ceci d’admirable que, son art, il le vit, il le chante et le dissipe au jour le jour ; il ne le fixe point et ne l’embaume en aucune œuvre. C’est la cause et l’effet de l’absence de grands artistes... J’ai toujours cru les grands artistes ceux qui osent donner droit de beauté à des choses si naturelles qu’elles font dire après, à qui les voit : « Comment n’avais-je pas compris jusqu’alors que cela aussi était beau... »
À Kairouan, que je ne connaissais pas encore, et où j’allai sans Marceline, la nuit était très belle. Au moment de rentrer dormir à l’hôtel, je me souvins d’un groupe d’Arabes couchés en plein air sur les nattes d’un petit café. Je m’en fus dormir tout contre eux. Je revins couvert de vermine.
La chaleur moite de la côte affaiblissant beaucoup Marceline, je lui persuadai que ce qu’il nous fallait, c’était gagner Biskra au plus vite. Nous étions au début d’avril.
Ce voyage est très long. Le premier jour nous gagnons d’une traite Constantine ; le second jour, Marceline est très lasse et nous n’allons que jusqu’à El Kantara. — Là nous avons cherché et nous avons trouvé vers le soir une ombre plus délicieuse et plus fraîche que la clarté de la lune, la nuit. Elle était comme un breuvage intarissable ; elle ruisselait jusqu’à nous. Et du talus où nous étions assis, on voyait la plaine embrasée. Cette nuit Marceline ne peut dormir ; l’étrangeté du silence et des moindres bruits l’inquiète. Je crains qu’elle n’ait un peu de fièvre. Je l’entends se remuer sur son lit. Le lendemain je la trouve plus pâle. Nous repartons.
Biskra. C’est donc là que je veux en venir... Oui ; voici le jardin public ; le banc... je reconnais le banc où je m’assis aux premiers jours de ma convalescence. Qu’y lisais-je donc ?... Homère ; depuis je ne l’ai pas rouvert. — Voici l’arbre dont j’allai palper l’écorce. Que j’étais faible, alors !... Tiens ! voici des enfants... Non ; je n’en reconnais aucun. Que Marceline est grave ! Elle est aussi changée que moi. Pourquoi tousse-t-elle, par ce beau temps ? — Voici l’hôtel. Voici nos chambres ; nos terrasses. Que pense Marceline ? Elle ne m’a pas dit un mot. Sitôt arrivée dans sa chambre, elle s’étend sur le lit ; elle est lasse et dit vouloir dormir un peu. Je sors.
Je ne reconnais pas les enfants, mais les enfants me reconnaissent. Prévenus de mon arrivée, tous accourent. Est-il possible que ce soient eux ? Quelle déconvenue ! Que s’est-il donc passé ? Ils ont affreusement grandi. En à peine un peu plus de deux ans, — cela n’est pas possible... quelles fatigues, quels vices, quelles paresses, ont déjà mis tant de laideur sur ces visages, où tant de jeunesse éclatait ? Quels travaux vils ont déjeté si tôt ces beaux corps ? Il y a là comme une banqueroute... Je questionne. Bachir est garçon plongeur d’un café ; Ashour gagne à grand’peine quelques sous à casser les cailloux des routes ; Hammatar a perdu un œil. Qui l’eût cru ? Sadeck s’est rangé ; il aide un frère aîné à vendre des pains au marché ; il semble devenu stupide. Agib s’est établi boucher près de son père ; il engraisse ; il est laid ; il est riche ; il ne veut plus parler à ses compagnons déclassés... Que les carrières honorables abêtisent ! Vais-je donc retrouver chez eux ce que je haïssais parmi nous ? — Boubaker ? — Il s’est marié. Il n’a pas quinze ans. C’est grotesque. — Non, pourtant ; je l’ai revu le soir. Il s’explique : son mariage n’est qu’une frime. C’est, je crois, un sacré débauché. Mais il boit, se déforme... Et voilà donc tout ce qui reste ? Voilà donc ce qu’en fait la vie ! — Je sens à mon intolérable tristesse que c’était beaucoup eux que je venais revoir. — Ménalque avait raison : le souvenir est une invention de malheur.
Et Moktir ? — Ah ! celui-là sort de prison. Il se cache. Les autres ne fraient plus avec lui. Je voudrais le revoir. Il était le plus beau d’eux tous ; va-t-il me décevoir aussi ?... On le retrouve. On me l’amène. Non ! celui-là n’a pas failli. Même mon souvenir ne me le représentait pas si superbe. Sa force et sa beauté sont parfaites... En me reconnaissant il sourit.
— Et que faisais-tu donc avant d’être en prison ?
— Rien.
— Tu volais ?
Il proteste.
— Que fais-tu maintenant ?
Il sourit.
— Eh ! Moktir ! si tu n’as rien à faire, tu nous accompagneras à Touggourt. — Et je suis pris soudain du désir d’aller à Touggourt.
Marceline ne va pas bien ; je ne sais pas ce qui se passe en elle. Quand je rentre à l’hôtel ce soir-là, elle se presse contre moi sans rien dire, les yeux fermés. Sa manche large, qui se relève, laisse voir son bras amaigri. Je la caresse et la berce longtemps, comme un enfant que l’on veut endormir. Est-ce l’amour, ou l’angoisse, ou la fièvre qui la fait trembler ainsi ?... Ah ! peut-être il serait temps encore... Est-ce que je ne m’arrêterai pas ? — J’ai cherché, j’ai trouvé ce qui fait ma valeur : une espèce d’entêtement dans le pire. — Mais comment arrivé-je à dire à Marceline que demain nous partons pour Touggourt ?...
À présent elle dort dans la chambre voisine. La lune, depuis longtemps levée, inonde à présent la terrasse. C’est une clarté presque effrayante. On ne peut pas s’en cacher. Ma chambre a des dalles blanches, et là surtout elle paraît. Son flot entre par la fenêtre grande ouverte. Je reconnais sa clarté dans la chambre, et l’ombre qu’y dessine la porte. Il y a deux ans elle entrait plus avant encore... oui, là précisément où elle avance maintenant — quand je me suis levé renonçant à dormir. J’appuyais mon épaule contre le montant de cette porte-là. Je reconnais l’immobilité des palmiers... Quelle parole avais-je donc lue ce soir-là ?... Ah ! oui ; les mots du Christ à Pierre : « Maintenant tu te ceins toi-même, et tu vas où tu veux aller... » Où vais-je ? Où veux-je aller ?... Je ne vous ai pas dit que, de Naples, cette dernière fois, j’avais gagné Pœstum, un jour, seul... ah ! j’aurais sangloté devant ces pierres ! L’ancienne beauté paraissait, simple, parfaite, souriante — abandonnée. L’art s’en va de moi, je le sens. C’est pour faire place à quoi d’autre ? Ce n’est plus, comme avant, une souriante harmonie... Je ne sais plus le dieu ténébreux que je sers. Ô Dieu neuf ! donnez-moi de connaître encore des races nouvelles, des types imprévus de beauté.
Le lendemain, dès l’aube, la diligence nous emmène, Moktir est avec nous. Moktir est heureux comme un roi.
Chegga ; Kefeldorh’ ; M’reyer... mornes étapes sur la route plus morne encore, interminable. J’aurais cru pourtant, je l’avoue, plus riantes ces oasis. Mais plus rien que la pierre et le sable ; puis quelques buissons nains bizarrement fleuris ; parfois quelque essai de palmiers qu’alimente une source cachée... À l’oasis je préfère à présent le désert... ce pays de mortelle gloire et d’intolérable splendeur. L’effort de l’homme y paraît laid et misérable. Maintenant toute autre terre m’ennuie.
— Vous aimez l’inhumain, dit Marceline. Mais comme elle regarde elle-même ! et avec quelle avidité !
Le temps se gâte un peu, le second jour ; c’est-à-dire que le vent s’élève et que l’horizon se ternit. Marceline souffre ; le sable qu’on respire, brûle, irrite sa gorge ; la surabondante lumière fatigue son regard ; ce paysage hostile la meurtrit. — Mais à présent il est trop tard pour revenir. Dans quelques heures nous serons à Touggourt.
C’est de cette dernière partie du voyage, pourtant si proche encore, que je me souviens le moins bien. Impossible, à présent, de revoir les paysages du second jour et ce que je fis d’abord à Touggourt. Mais ce que je me rappelle encore, c’est quelles étaient mon impatience et ma précipitation.
Il avait fait très froid le matin. Vers le soir, un simoun ardent s’élève. — Marceline, exténuée par le voyage, s’est couchée sitôt arrivée. J’espérais trouver un hôtel un peu plus confortable ; notre chambre est affreuse ; le sable, le soleil et les mouches ont tout terni, tout sali, défraîchi. N’ayant presque rien mangé depuis l’aurore, je fais servir aussitôt le repas ; mais tout paraît mauvais à Marceline et je ne peux la décider à rien prendre. Nous avons emporté de quoi faire du thé. Je m’occupe à ces soins dérisoires. Nous nous contentons, pour dîner, de quelques gâteaux secs et de ce thé, auquel l’eau salée du pays a donné son goût détestable.
Par un dernier semblant de vertu, je reste jusqu’au soir près d’elle. Et soudain je me sens comme à bout de forces moi-même. Ô goût de cendres ! Ô lassitude ! Tristesse du surhumain effort ! J’ose à peine la regarder ; je sais trop que mes yeux, au lieu de chercher son regard, iront affreusement se fixer sur les trous noirs de ses narines ; l’expression de son visage souffrant est atroce. Elle non plus ne me regarde pas. Je sens, comme si je la touchais, son angoisse. Elle tousse beaucoup ; puis s’endort. Par moments un frisson brusque la secoue.
La nuit pourrait être mauvaise et, avant qu’il ne soit trop tard, je veux savoir à qui je pourrais m’adresser. Je sors. Devant la porte de l’hôtel, la place de Touggourt, les rues, l’atmosphère même sont étranges au point de me faire croire que ce n’est pas moi qui les vois. — Après quelques instants, je rentre. Marceline dort tranquillement. Je m’effrayais à tort ; sur cette terre bizarre, on suppose un péril partout ; c’est absurde. Et, suffisamment rassuré, je ressors.
Étrange animation nocturne sur la place ; circulation silencieuse ; glissement clandestin des burnous blancs. Le vent déchire par instant des lambeaux de musique étrange et les apporte je ne sais d’où. Quelqu’un vient à moi... C’est Moktir. Il m’attendait, dit-il, et pensait bien que je ressortirais. Il rit. Il connaît bien Touggourt, y vient souvent et sait où il m’emmène. Je me laisse entraîner par lui.
Nous marchons dans la nuit ; nous entrons dans un café maure ; c’est de là que venait la musique. Des femmes arabes y dansent — si l’on peut appeler une danse ce monotone glissement. — Une d’elles me prend par la main ; je la suis ; c’est la maîtresse de Moktir ; il accompagne... Nous entrons tous les trois dans l’étroite et profonde chambre où l’unique meuble est un lit... Un lit très bas, sur lequel on s’assied. Un lapin blanc, enfermé dans la chambre, s’effarouche d’abord puis s’apprivoise et vient manger dans la main de Moktir. On nous apporte du café. Puis, tandis que Moktir joue avec le lapin, cette femme m’attire à elle, et je me laisse aller à elle comme on se laisse aller au sommeil...
Ah ! je pourrais ici feindre ou me taire — mais que m’importe à moi ce récit, s’il cesse d’être véritable ?...
Je retourne seul à l’hôtel, Moktir restant là-bas pour la nuit. Il est tard. Il souffle un siroco aride ; c’est un vent tout chargé de sable, et torride malgré la nuit. Au bout de quatre pas, je suis en nage ; mais j’ai soudain trop hâte de rentrer, et c’est presque en courant que je reviens. — Elle s’est réveillée peut-être... peut-être elle a besoin de moi ?... Non ; la croisée de la chambre est sombre. J’attends un court répit du vent pour ouvrir ; j’entre très doucement dans le noir. — Quel est ce bruit ?... Je ne reconnais pas sa toux... J’allume.
Marceline est assise à demi sur son lit ; un de ses maigres bras se cramponne aux barreaux du lit, la tient dressée ; ses draps, ses mains, sa chemise, sont inondés d’un flot de sang ; son visage en est tout sali ; ses yeux sont hideusement agrandis ; et n’importe quel cri d’agonie m’épouvanterait moins que son silence. — Je cherche sur son visage transpirant une petite place où poser un affreux baiser ; le goût de sa sueur me reste aux lèvres. Je lave et rafraîchis son front, ses joues... Contre le lit, quelque chose de dur sous mon pied : je me baisse, et ramasse le petit chapelet qu’elle réclamait naguère à Paris, et qu’elle a laissé tomber ; je le passe à sa main ouverte, mais sa main aussitôt s’abaisse et le laisse tomber de nouveau. — Je ne sais que faire ; je voudrais demander du secours... Sa main s’accroche à moi désespérément, me retient ; ah ! croit-elle donc que je veux la quitter ? Elle me dit :
— Oh ! tu peux bien attendre encore. Elle voit que je veux parler : — Ne me dis rien, ajouta-t-elle ; tout va bien. — De nouveau je ramasse le chapelet ; je le lui remets dans la main, mais de nouveau elle le laisse — que dis-je ? elle le fait tomber. Je m’agenouille auprès d’elle et presse sa main contre moi.
Elle se laisse aller, moitié contre le traversin et moitié contre mon épaule, semble dormir un peu, mais ses yeux restent grands ouverts.
Une heure après elle se redresse ; sa main se dégage des miennes, se crispe à sa chemise et en déchire la dentelle. Elle étouffe. — Vers le petit matin, un nouveau vomissement de sang...
J’ai fini de vous raconter mon histoire. Qu’ajouterais-je de plus ? — Le cimetière français de Touggourt est hideux, à moitié dévoré par les sables... Le peu de volonté qui me restait, je l’ai tout employé à l’arracher de ces lieux de détresse. C’est à El Kantara qu’elle repose, dans l’ombre d’un jardin privé qu’elle aimait. Il y a de tout cela trois mois à peine. Ces trois mois ont éloigné cela de dix ans.
Michel resta longtemps silencieux. Nous nous taisions aussi, pris chacun d’un étrange malaise. Il nous semblait hélas ! qu’à nous la raconter, Michel avait rendu son action plus légitime. De ne savoir où la désapprouver, dans la lente explication qu’il en donna, nous en faisait presque complices. Nous y étions comme engagés. Il avait achevé ce récit sans un tremblement dans la voix, sans qu’une inflexion ni qu’un geste témoignât qu’une émotion quelconque le troublât, soit qu’il mît un cynique orgueil à ne pas nous paraître ému, soit qu’il craignît, par une sorte de pudeur, de provoquer notre émotion par ses larmes, soit enfin qu’il ne fût pas ému. Je ne distingue pas en lui, même à présent, la part d’orgueil, de force, de sécheresse ou de pudeur. — Au bout d’un instant, il reprit :
Ce qui m’effraie c’est, je l’avoue, que je suis encore très jeune. Il me semble parfois que ma vraie vie n’a pas encore commencé. Arrachez-moi d’ici à présent, et donnez-moi des raisons d’être. Moi je ne sais plus en trouver. Je me suis délivré, c’est possible ; mais qu’importe ? je souffre de cette liberté sans emploi. Ce n’est pas, croyez-moi, que je sois fatigué de mon crime, s’il vous plaît de l’appeler ainsi, — mais je dois me prouver à moi-même que je n’ai pas outre-passé mon droit.
J’avais, quand vous m’avez connu d’abord, une grande fixité de pensée, et je sais que c’est là ce qui fait les vrais hommes ; — je ne l’ai plus. Mais ce climat, je crois, en est cause. Rien ne décourage autant la pensée que cette persistance de l’azur. Ici toute recherche est impossible, tant la volupté suit de près le désir. Entouré de splendeur et de mort, je sens le bonheur trop présent et l’abandon à lui trop uniforme. Je me couche au milieu du jour pour tromper la longueur morne des journées et leur insupportable loisir.
J’ai là, voyez, des cailloux blancs que je laisse tremper à l’ombre, puis que je tiens longtemps dans le creux de ma main, jusqu’à ce qu’en soit épuisée la calmante fraîcheur acquise. Alors je recommence, alternant les cailloux, remettant à tremper ceux dont la froideur est tarie. Du temps s’y passe, et vient le soir... Arrachez-moi d’ici ; je ne puis le faire moi-même. Quelque chose en ma volonté s’est brisé ; je ne sais même où j’ai trouvé la force de m’éloigner d’El Kantara. Parfois j’ai peur que ce que j’ai supprimé ne se venge. Je voudrais recommencer à neuf. Je voudrais me débarrasser de ce qui reste de ma fortune ; voyez, ces murs en sont encore couverts... Ici je vis de presque rien. Un aubergiste mi-français m’apprête un peu de nourriture. L’enfant, que vous avez fait fuir en entrant, me l’apporte soir et matin, en échange de quelques sous et de caresses. Cet enfant qui, devant les étrangers, se fait sauvage, est avec moi tendre et fidèle comme un chien. Sa sœur est une Ouled-Naïl qui, chaque hiver, regagne Constantine où elle vend son corps aux passants. Elle est très belle et je souffrais, les premières semaines, que parfois elle passât la nuit près de moi. Mais, un matin, son frère, le petit Ali, nous a surpris couchés ensemble. Il s’est montré fort irrité et n’a pas voulu revenir de cinq jours. Pourtant il n’ignore pas comment ni de quoi vit sa sœur ; il en parlait auparavant d’un ton qui n’indiquait aucune gêne... Est-ce donc qu’il était jaloux ? — Du reste, ce farceur en est arrivé à ses fins ; car moitié par ennui, moitié par peur de perdre Ali, depuis cette aventure je n’ai plus retenu cette fille. Elle ne s’en est pas fâchée ; mais chaque fois que je la rencontre, elle rit et plaisante de ce que je lui préfère l’enfant. Elle prétend que c’est lui qui surtout me retient ici. Peut-être a-t-elle un peu raison...