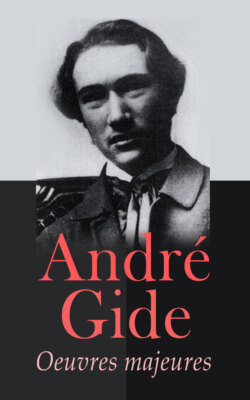Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 119
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA RÉPRIMANDE DU PÈRE
ОглавлениеTable des matières
Mon Dieu, comme un enfant je m’agenouille devant vous aujourd’hui, le visage trempé de larmes. Si je me remémore et transcris ici votre pressante parabole, c’est que je sais quel était votre enfant prodigue ; c’est qu’en lui je me vois ; que j’entends en moi, parfois et répète en secret ces paroles que, du fond de sa grande détresse, vous lui faites crier :
– Combien de mercenaires de mon père ont chez lui le pain en abondance ; et moi je meurs de faim !
J’imagine l’étreinte du Père ; à la chaleur d’un tel amour mon cœur fond. J’imagine une précédente détresse, même ; ah ! j’imagine tout ce qu’on veut. Je crois cela ; je suis celui-là même dont le cœur bat quand, au défaut de la colline, il revoit les toits bleus de la maison qu’il a quittée. Qu’est-ce donc que j’attends pour m’élancer vers la demeure ; pour entrer ? – On m’attend. Je vois déjà le veau gras qu’on apprête… Arrêtez ! ne dressez pas trop vite le festin ! – Fils prodigue, je songe à toi ; dis-moi d’abord ce que t’a dit le Père, le lendemain, après le festin du revoir. Ah ! malgré que le fils aîné vous souffle, Père, puissé-je entendre votre voix, parfois, à travers ses paroles !
– Mon fils, pourquoi m’as-tu quitté ?
– Vous ai-je vraiment quitté ? Père ! n’êtes vous pas partout ? jamais je n’ai cessé de vous aimer.
– N’ergotons pas. J’avais une maison qui t’enfermait. Elle était élevée pour toi. Pour que ton âme y puisse trouver un abri, un luxe digne d’elle, du confort, un emploi, des générations travaillèrent. Toi, l’héritier, le fils, pourquoi t’être évadé de la Maison ?
– Parce que la Maison m’enfermait. La Maison, ce n’est pas Vous, mon Père.
– C’est moi qui l’ai construite, et pour toi.
– Ah ! Vous n’avez pas dit cela, mais mon frère. Vous, vous avez construit toute la terre, et la Maison et ce qui n’est pas la Maison. La Maison, d’autres que vous l’ont construite ; en votre nom, je sais, mais d’autres que vous.
– L’homme a besoin d’un toit sous lequel reposer sa tête. Orgueilleux ! Penses-tu pouvoir dormir en plein vent ?
– Y faut-il tant d’orgueil ? de plus pauvres que moi l’ont bien fait.
– Ce sont les pauvres. Pauvre, tu ne l’es pas. Nul ne peut abdiquer sa richesse. Je t’avais fait riche entre tous.
– Mon père, vous savez bien qu’en partant j’avais emporté tout ce que j’avais pu de mes richesses. Que m’importent les biens qu’on ne peut emporter avec soi ?
– Toute cette fortune emportée, tu l’as dépensée follement.
– J’ai changé votre or en plaisirs, vos préceptes en fantaisie, ma chasteté en poésie, et mon austérité en désirs.
– Était-ce pour cela que tes parents économes s’employèrent à distiller en toi tant de vertu ?
– Pour que je brûle d’une flamme plus belle, peut-être, une nouvelle ferveur m’allumant.
– Songe à cette pure flamme que vit Moïse, sur le buisson sacré : elle brillait mais sans consumer.
– J’ai connu l’amour qui consume.
– L’amour que je veux t’enseigner rafraîchit. Au bout de peu de temps, que t’est-il resté, fils prodigue ?
– Le souvenir de ces plaisirs.
– Et le dénûment qui les suit.
– Dans ce dénûment, je me suis senti près de vous, Père.
– Fallait-il la misère pour te pousser à revenir à moi ?
– Je ne sais ; je ne sais. C’est dans l’aridité du désert que j’ai le mieux aimé ma soif.
– Ta misère te fit mieux sentir le prix des richesses.
– Non, pas cela ! Ne m’entendez-vous pas, mon père ? Mon cœur, vidé de tout, s’emplit d’amour. Au prix de tous mes biens, j’avais acheté la ferveur.
– Étais-tu donc heureux loin de moi ?
– Je ne me sentais pas loin de vous.
– Alors qu’est-ce qui t’a fait revenir ? Parle.
– Je ne sais. Peut-être la paresse.
– La paresse, mon fils ! Eh quoi ! Ce ne fut pas l’amour ?
– Père, je vous l’ai dit, je ne vous aimai jamais plus qu’au désert. Mais j’étais las, chaque matin, de poursuivre ma subsistance. Dans la maison, du moins, on mange bien.
– Oui, des serviteurs y pourvoient. Ainsi, ce qui t’a ramené, c’est la faim.
– Peut-être aussi la lâcheté, la maladie… À la longue cette hasardeuse nourriture m’affaiblit ; car je me nourrissais de fruits sauvages, de sauterelles et de miel. Je supportais de plus en plus mal l’inconfort qui d’abord attisait ma ferveur. La nuit, quand j’avais froid, je songeais que mon lit était bien bordé chez mon père ; quand je jeûnais, je songeais que, chez mon père, l’abondance des mets servis outrepassait toujours ma faim. J’ai fléchi ; pour lutter plus longtemps je ne me sentais plus assez courageux, assez fort, et cependant…
– Donc le veau gras d’hier t’a paru bon ? Le fils prodigue se jette en sanglotant le visage contre terre :
– Mon père ! mon père ! Le goût sauvage des glands doux demeure malgré tout dans ma bouche. Rien n’en saurait couvrir la saveur.
– Pauvre enfant ! – reprend le père qui le relève, – je t’ai parlé peut-être durement. Ton frère l’a voulu ; ici c’est lui qui fait la loi. C’est lui qui m’a sommé de te dire : « Hors la Maison, point de salut pour toi. » Mais écoute : C’est moi qui t’ai formé ; ce qui est en toi, je le sais. Je sais ce qui te poussait sur les routes ; je t’attendais au bout. Tu m’aurais appelé… j’étais là.
– Mon père ! j’aurais donc pu vous retrouver sans revenir ?…
– Si tu t’es senti faible, tu as bien fait de revenir. Va maintenant ; rentre dans la chambre que j’ai fait préparer pour toi. Assez pour aujourd’hui ; repose-toi ; demain tu pourras parler à ton frère.