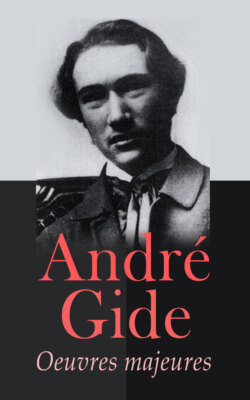Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 121
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA MÈRE
ОглавлениеTable des matières
Prodigue enfant, dont l’esprit, aux propos de ton frère, regimbe encore, laisse à présent ton cœur parler. Qu’il t’est doux, à demi couché aux pieds de ta mère assise, le front caché dans ses genoux, de sentir sa caressante main incliner ta nuque rebelle !
– Pourquoi m’as-tu laissée si longtemps ?
Et comme tu ne réponds que par des larmes :
– Pourquoi pleurer à présent, mon fils ? Tu m’es rendu. Dans l’attente de toi j’ai versé toutes mes larmes.
– M’attendiez-vous encore ?
– Jamais je n’ai cessé de t’espérer. Avant de m’endormir, chaque soir, je pensais : s’il revient cette nuit, saura-t-il bien ouvrir la porte ? et j’étais longue à m’endormir. Chaque matin, avant de m’éveiller tout à fait, je pensais : Est-ce pas aujourd’hui qu’il revient ? Puis je priais. J’ai tant prié, qu’il te fallait bien revenir.
– Vos prières ont forcé mon retour.
– Ne souris pas de moi, mon enfant.
– Ô mère ! je reviens à vous très humble. Voyez comme je mets mon front plus bas que votre cœur ! Il n’est plus une de mes pensées d’hier qui ne devienne vaine aujourd’hui. À peine si je comprends, près de vous, pourquoi j’étais parti de la maison.
– Tu ne partiras plus ?
– Je ne puis plus partir.
– Qu’est-ce qui t’attirait donc au dehors ?
– Je ne veux plus y songer : Rien… Moi-même.
– Pensais-tu donc être heureux loin de nous ?
– Je ne cherchais pas le bonheur.
– Que cherchais-tu ?
– Je cherchais… qui j’étais.
– Oh ! fils de tes parents, et frère entre tes frères.
– Je ne ressemblais pas à mes frères. N’en parlons plus ; me voici de retour.
– Si ; parlons-en encore : Ne crois pas si différents de toi, tes frères.
– Mon seul soin désormais c’est de ressembler à vous tous.
– Tu dis cela comme avec résignation.
– Rien n’est plus fatigant que de réaliser sa dissemblance. Ce voyage à la fin m’a lassé.
– Te voici tout vieilli, c’est vrai.
– J’ai souffert.
– Mon pauvre enfant ! Sans doute ton lit n’était pas fait tous les soirs, ni pour tous tes repas la table mise ?
– Je mangeais ce que je trouvais et souvent ce n’était que fruits verts ou gâtés dont ma faim faisait nourriture.
– N’as-tu souffert du moins que de la faim ?
– Le soleil du milieu du jour, le vent froid du cœur de la nuit, le sable chancelant du désert, les broussailles où mes pieds s’ensanglantaient, rien de tout cela ne m’arrêta, mais – je ne l’ai pas dit à mon frère – j’ai dû servir…
– Pourquoi l’avoir caché ?
– De mauvais maîtres qui malmenaient mon corps, exaspéraient mon orgueil, et me donnaient à peine de quoi manger. C’est alors que j’ai pensé : Ah ! servir pour servir !… En rêve j’ai revu la maison ; je suis rentré.
Le fils prodigue baisse à nouveau le front que tendrement sa mère caresse.
– Qu’est-ce que tu vas faire à présent ?
– Je vous l’ai dit : m’occuper de ressembler à mon grand frère ; régir nos biens ; comme lui prendre femme…
– Sans doute tu penses à quelqu’un, en disant cela.
– Oh ! n’importe laquelle sera la préférée, du moment que vous l’aurez choisie. Faites comme vous avez fait pour mon frère.
– J’eusse voulu la choisir selon ton cœur.
– Qu’importe ! mon cœur avait choisi. Je résigne un orgueil qui m’avait emporté loin de vous. Guidez mon choix. Je me soumets, vous dis-je. Je soumettrai de même mes enfants ; et ma tentative ainsi ne me paraîtra plus si vaine.
– Écoute ; il est à présent un enfant dont tu pourrais déjà t’occuper.
– Que voulez-vous dire, et de qui parlez-vous ?
– De ton frère cadet, qui n’avait pas dix ans quand tu partis, que tu n’as reconnu qu’à peine, et qui pourtant…
– Achevez, mère ; de quoi vous inquiéter, à présent ?
– En qui pourtant tu aurais pu te reconnaître, car il est tout pareil à ce que tu étais en partant.
– Pareil à moi ?
– À celui que tu étais, te dis-je, non encore hélas ! à celui que tu es devenu.
– Qu’il deviendra.
– Qu’il faut le faire aussitôt devenir. Parle-lui ; sans doute il t’écoutera, toi, prodigue. Dis-lui bien quel déboire était sur la route ; épargne-lui…
– Mais qu’est-ce qui vous fait vous alarmer ainsi sur mon frère ? Peut-être simplement un rapport de traits…
– Non, non ; la ressemblance entre vous deux est plus profonde. Je m’inquiète à présent pour lui de ce qui ne m’inquiétait d’abord pas assez pour toi-même. Il lit trop, et ne préfère pas toujours les bons livres.
– N’est-ce donc que cela ?
– Il est souvent juché sur le plus haut point du jardin, d’où l’on peut voir le pays, tu sais, par-dessus les murs.
– Je m’en souviens. Est-ce là tout ?
– Il est bien moins souvent auprès de nous que dans la ferme.
– Ah ! qu’y fait-il ?
– Rien de mal. Mais ce n’est pas les fermiers, c’est les goujats les plus distants de nous qu’il fréquente, et ceux qui ne sont pas du pays. Il en est un surtout, qui vient de loin, qui lui raconte des histoires.
– Ah ! le porcher.
– Oui. Tu le connaissais ?… Pour l’écouter, ton frère chaque soir le suit dans l’étable des porcs ; et il ne revient que pour dîner, sans appétit, et les vêtements pleins d’odeur. Les remontrances n’y font rien ; il se raidit sous la contrainte. Certains matins, à l’aube, avant qu’aucun de nous ne soit levé, il court accompagner jusqu’à la porte ce porcher quand il sort paître son troupeau.
– Lui, sait qu’il ne doit pas sortir.
– Tu le savais aussi ! Un jour il m’échappera, j’en suis sûre. Un jour il partira…
– Non, je lui parlerai, mère. Ne vous alarmez pas.
– De toi, je sais qu’il écoutera bien des choses. As-tu vu comme il te regardait le premier soir ?
De quel prestige tes haillons étaient couverts ! puis la robe de pourpre dont le père t’a revêtu. J’ai craint qu’en son esprit il ne mêle un peu l’un à l’autre, et que ce qui l’attire ici, ce ne soit d’abord le haillon. Mais cette pensée à présent me paraît folle ; car enfin, si toi, mon enfant, tu avais pu prévoir tant de misère, tu ne nous aurais pas quittés, n’est-ce pas ?
– Je ne sais plus comment j’ai pu vous quitter, vous, ma mère.
– Eh bien ! tout cela, dis-le-lui.
– Tout cela je le lui dirai demain soir. Embrassez-moi maintenant sur le front comme lorsque j’étais petit enfant et que vous me regardiez m’endormir. J’ai sommeil.
– Va dormir. Je m’en vais prier pour vous tous.