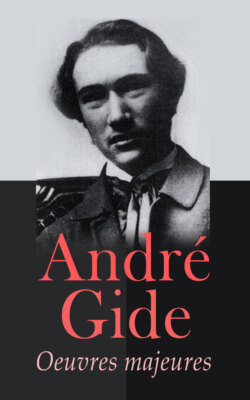Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 154
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеMalgré certaine curiosité professionnelle et la flatteuse illusion que rien d'humain ne lui devait demeurer étranger, Julius était peu descendu jusqu'à présent hors des coutumes de sa classe et n'avait guère eu de rapports qu'avec des gens de son milieu. L'occasion, plutôt que le goût, lui manquait. Sur le point de sortir pour cette visite, Julius se rendit compte qu'il n'avait point non plus tout à fait le costume qu'il y fallait. Son pardessus, son plastron, son chapeau cronstadt même, présentaient je ne sais quoi de décent, de restreint et de distingué... Mais peut-être, après tout, valait-il mieux que sa mise n'invitât pas à trop brusque familiarité le jeune homme. C'est par les propos, pensait-il, qu'il sied de s'amener à confiance. Et, tout en se dirigeant vers l'impasse Claude-Bernard, Julius imaginait avec quelles précautions, sous quel prétexte, s'introduire et pousser son inquisition.
Que pouvait bien avoir affaire avec ce Lafcadio le comte Juste-Agénor de Baraglioul? La question bourdonnait autour de Julius, importune. Ce n'est pas maintenant qu'il venait d'achever d'écrire la vie de son père, qu'il allait se permettre des questions à son sujet. Il n'en voulait savoir que ce que son père voudrait lui dire. Ces dernières années le comte était devenu taciturne, mais il n'avait jamais été cachottier. Une averse surprit Julius tandis qu'il traversait le Luxembourg.
Impasse Claude-Bernard, devant la porte du douze, un fiacre stationnait où Julius, en passant, put distinguer, sous un trop grand chapeau, une dame à toilette un peu tapageuse.
Son coeur battit tandis qu'il jetait le nom de Lafcadio Wluiki au portier de la maison meublée; il semblait au romancier qu'il s'enfonçât dans l'aventure; mais, tandis qu'il montait l'escalier, la médiocrité du lieu, l'insignifiance du décor le rebutèrent; sa curiosité qui ne trouvait où s'alimenter fléchissait et cédait à la répugnance.
Au quatrième étage le couloir sans tapis, qui ne recevait de jour que par la cage de l'escalier, à quelques pas du palier faisait coude; de droite et de gauche, des portes closes y donnaient; celle du fond, entrouverte, laissait passer un mince rai de jour. Julius frappa; en vain; timidement poussa la porte un peu plus; personne dans la chambre. Julius redescendit.
— S'il n'est pas là, il ne tardera pas à entrer, avait dit le portier.
La pluie tombait à flots. Dans le vestibule, en face de l'escalier, ouvrait un salon d'attente où Julius allait pénétrer; l'odeur poisseuse, l'aspect désespéré du lieu le reculèrent jusqu'à penser qu'il eût aussi bien pu pousser la porte, là-haut, et de pied ferme attendre le jeune homme dans la chambre. Julius remonta.
Comme il tournait à nouveau le corridor, une femme sortit de la chambre voisine de celle du fond. Julius donna contre elle et s'excusa.
— Vous désirez?
— Monsieur Wluiki, c'est bien ici?
— Il est sorti.
— Ah! fit Julius, sur un ton de contrariété si vive que la femme lui demanda:
— C'est pressé, ce que vous aviez à lui dire?
Julius, uniquement armé pour affronter l'inconnu Lafcadio, restait décontenancé; pourtant l'occasion était belle; cette femme, peut-être, en savait long sur le jeune homme; s'il savait la faire parler...
— C'est un renseignement que je voulais lui demander.
— De la part de qui?
"Me croirait-elle de la police?" pensa Julius.
— Je suis le comte Julius de Baraglioul, dit-il d'une voix un peu solennelle, en soulevant légèrement son chapeau.
— Oh! Monsieur le comte... Je vous demande bien pardon de ne pas vous avoir... Dans ce couloir il fait si sombre! Donnez-vous la peine d'entrer. (Elle poussa la porte du fond). Lafcadio ne doit pas tarder à... Il a seulement été jusque chez le... Oh! permettez!...
Et, comme Julius allait entrer, elle s'élança d'abord dans la pièce, vers un pantalon de femme, indiscrètement étalé sur une chaise, que ne parvenant pas à dissimuler, elle s'efforça du moins de réduire.
— C'est dans un tel désordre, ici...
— Laissez! laissez! Je suis habitué, disait complaisamment Julius.
Carola Venitequa était une jeune femme assez forte, ou mieux: un peu grasse, mais bien faite et saine d'aspect, de traits communs mais non vulgaires et passablement engageants, au regard animal et doux, à la voix bêlante. Comme elle était prête à sortir, un petit feutre mou la coiffait; sur son corsage en forme de blouse, qu'un noeud marin coupait par le milieu, elle portait un col d'homme et des poignets blancs.
— Il y a longtemps que vous connaissez M. Wluiki?
— Je pourrais peut-être lui faire votre commission? reprenait-elle sans répondre.
— Voilà... J'aurais voulu savoir s'il est très occupé pour le moment!
— ça dépend des jours.
— Parce que, s'il avait eu un peu de temps de libre, je pensais lui demander de... s'occuper pour moi d'un petit travail.
— Dans quel genre?
— Eh bien! précisément, voilà... J'aurais voulu d'abord connaître un peu le genre de ses occupations.
La question était sans astuce, mais l'apparence de Carola n'invitait guère aux subtilités. Cependant le comte de Baraglioul avait recouvré son assurance; il était assis à présent sur la chaise qu'avait débarrassée Carola, et celle-ci, près de lui, accotée contre la table, déjà commençait de parler, lorsqu'un grand bruit se fit dans le corridor: la porte s'ouvrit avec fracas et cette femme parut, que Julius avait aperçue dans la voiture.
— J'en était sûre, dit-elle; quand je l'ai vu monter...
Et Carola, tout aussitôt, s'écartant un peu de Julius:
— Mais pas du tout, ma chère... nous causions. Mon amie Bertha Grand-Marnier; Monsieur le comte... pardon! voilà que j'ai oublié votre nom!
— Peu importe, fit Julius, un peu contraint, en serrant la main gantée que Bertha lui tendait.
— Présente-moi aussi, dit Carola...
— écoute, ma petite: voilà une heure qu'on nous attend, reprit l'autre, après avoir présenté son amie. Si tu veux causer avec Monsieur, emmène-le: j'ai une voiture.
— Mais ce n'est pas moi qu'il venait voir.
— Alors viens! Vous dînerez ce soir avec nous?...
— Je regrette beaucoup.
— Excusez-moi, Monsieur, dit Carola rougissante, et pressée à présent d'emmener son amie. Lafcadio va rentrer d'un moment à l'autre.
Les deux femmes en sortant avaient laissé la porte ouverte; sans tapis, le couloir était sonore; le coude qu'il faisait empêchait qu'on ne vît venir; mais on entendait approcher.
— Après tout, mieux que la femme encore, la chambre me renseignera, j'espère, se dit Julius. Tranquillement il commença d'examiner.
Presque rien dans cette banale chambre meublée ne se prêtait hélas! à sa curiosité mal experte:
Pas de bibliothèque, pas de cadres aux murs. Sur la cheminée, la Moll Flanders de Daniel Defoe, en anglais, dans une vile édition coupée seulement aux deux tiers, et les Novelle d'Anton-Francesco Grazzini, dit le Lasca, en italien. Ces deux livres intriguèrent Julius. A côté d'eux, derrière un flacon d'alcool de menthe, une photographie ne l'inquiéta pas moins: sur une plage de sable, une femme, non plus très jeune, mais étrangement belle, penchée au bras d'un homme de type anglais très accusé, élégant et svelte, en costume de sport; à leurs pieds, assis sur une périssoire renversée, un robuste enfant d'une quinzaine d'années, aux épais cheveux clairs en désordre, l'air effronté, rieur, et complètement nu.
Julius prit la photographie et l'approcha du jour pour lire, au coin de droite, quelques mots pâlis: Duino; juillet 1886, — qui ne lui apprirent pas grand-chose, bien qu'il se souvînt que Duino est une petite bourgade sur le littoral autrichien de l'Adriatique. Hochant la tête de haut en bas et les lèvres pincées, il reposa la photographie. Dans l'âtre froid de la cheminée se réfugiaient une boîte de farine d'avoine, un sac de lentilles et un sac de riz; dressé contre le mur, un peu plus loin, un échiquier. Rien ne laissait entrevoir à Julius le genre d'études ou d'occupation auxquelles ce jeune homme employait ses journées.
Lafcadio venait apparemment de déjeuner; sur une table, dans une petite casserole, au-dessus d'un réchaud à essence, trempait encore ce petit oeuf creux, en métal perforé, dont se servent pour préparer leur thé les touristes soucieux du moindre bagage; et des miettes autour d'une tasse salie. Julius s'approcha de la table; la table avait un tiroir et le tiroir avait sa clef...
Je ne voudrais pas qu'on se méprît sur le caractère de Julius, à ce qui va suivre: Julius n'était rien moins qu'indiscret; il respectait, de la vie de chacun, ce revêtement qu'il plaît à chacun de lui donner; il tenait en grand respect les décences. Mais, devant l'ordre de son père, il devait plier son humeur. Il attendit encore un instant, prêtant l'oreille, puis, n'entendant rien venir — contre son gré, contre ses principes, mais avec le sentiment délicat du devoir, — il amena le tiroir de la table dont la clef n'était pas tournée.
Un carnet relié en cuir de Russie se trouvait là; que prit Julius et qu'il ouvrit. Il lut sur la première page ces mots, de la même écriture que ceux de la photographie:
A Cadio, pour qu'il inscrive ses comptes, A mon loyal compagnon, son vieux oncle.
Faby
et presque sans intervalle, au-dessous, d'une écriture un peu enfantine, sage, droite et régulière:
Duino. Ce matin, 10 juillet 86, lord Fabian est venu nous rejoindre ici. Il m'apporte une périssoire, une carabine et ce beau carnet.
Rien d'autre sur cette première page.
Sur la troisième page, à la date du 29 août, on lisait:
Rendu 4 brasses à Faby. — Et le lendemain: Rendu 12 brasses...
Julius comprit qu'il n'y avait là qu'un carnet d'entraînement. La liste des jours, toutefois, s'interrompait bientôt, et, après une page blanche, on lisait:
20 septembre: Départ d'Alger pour l'Aurès.
Puis quelques indications de lieux et de dates: et, enfin, cette dernière indication:
5 octobre: Retour à El Kantara. 50 kilom. on horseback, sans arrêt.
Julius tourna quelques feuillets blancs; mais un peu plus loin le carnet semblait reprendre à neuf. En manière de nouveau titre, au chef d'une page était écrit en caractères plus grands et appliqués:
QUI INCOMINCIA IL LIBRO
DELLA NOVA ESIGENZA
E
DELLA SUPREMA VIRTU.
Puis au-dessous, en guise d'épigraphe:
"Tanto quanto se ne taglia" BOCCACIO.
Devant l'expression d'idées morales l'intérêt de Julius s'éveillait brusquement; c'était gibier pour lui. Mais dès la page suivante il fut déçu: on retombait dans la comptabilité. Pourtant, c'était une comptabilité d'un autre ordre. On lisait, sans plus d'indication de dates ni de lieux:
Pour avoir gagné Protos aux échecs = 1 punta. Pour avoir laissé voir que je parlais italien = 3 punte. Pour avoir répondu avant Protos = 1 p. Pour avoir eu le dernier mot = 1 p. Pour avoir pleuré en apprenant la mort de Faby = 4 p.
Julius, qui lisait hâtivement, prit "punta" pour une pièce de monnaie étrangère et ne vit dans ces comptes qu'un puéril et mesquin marchandage de mérites et de rétribution. Puis, de nouveau, les comptes cessent. Julius tournait encore la page, lisait:
Ce 4 avril, conversation avec Protos: "Comprends-tu ce qu'il y a dans ces mots: PASSER OUTRE"?
Là s'arrêtait l'écriture.
Julius haussa les épaules, serra les lèvres, hocha la tête et remit en place le cahier. Il tira sa montre, se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda dehors; la pluie avait cessé. Il se dirigea vers le coin de la chambre où, en entrant, il avait posé son parapluie; c'est à ce moment qu'il vit, appuyé un peu en retrait dans l'embrasure de la porte, un beau jeune homme blond qui l'observait en souriant.