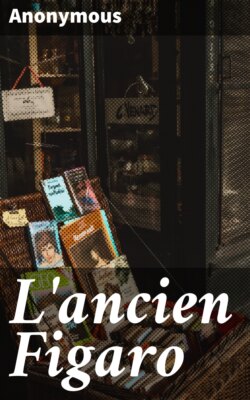Читать книгу L'ancien Figaro - Anonymous - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE FIGARO ET VICTOR BOHAIN
ОглавлениеTable des matières
C’est au plus fort de la lutte des partis, lorsque de toutes parts se soulevait l’opinion contre le gouvernement des Bourbons, que fut fondé le Figaro, par Lepoitevin-Saint-Alme, que toute la génération littéraire a connu rédacteur en chef du Corsaire-Satan en 1846 et de la Liberté en 1848.
Saint-Alme avait créé ce nouveau journal avec le concours de MM. Nestor Roqueplan et Maurice Alhoy, et d’un jeune homme qui débutait alors sous le nom de Horace de Saint-Aubin, et qui devait être notre illustre Balzac.
A ce journal, M. Michel Masson remplissait les importantes fonctions de cuisinier et de caissier. Ce dernier poste n’était pas une sinécure.
L’instant était admirablement choisi pour fonder une feuille satirique, aussi un très-grand succès accueillit-il tout d’abord le Figaro.
Saint-Alme cependant ne garda pas longtemps son journal; moins de six mois après l’avoir fondé, il le céda, par l’intermédiaire de M. Nestor Roqueplan, à Victor Bohain, qui devait lui imprimer une impulsion nouvelle.
De ce moment le Figaro prit hardiment place à l’avant-garde de l’opposition, et il resta fidèle au poste, toujours sur la brèche, jusqu’au jour où ses deux rédacteurs en chef, Victor Bohain et M. Nestor Roqueplan, signèrent la fameuse protestation contre les ordonnances. Le lendemain, la révolution était faite.
De 1826 à 1830, le Figaro fut rédigé par l’élite de tous les jeunes esprits de la fin de la Restauration. Mais aucun nom n’était connu. L’incognito était, on le comprenait alors, une des conditions indispensables du succès, de la liberté d’esprit, de la puissance d’un journal satirique. Aussi Bohain était-il, à cet égard, d’une discrétion à toute épreuve. Quelles séductions, quels subterfuges M. Dupin et tant d’autres n’ont-ils pas employés pour connaître l’auteur de la série d’articles mordants et révélateurs qui se publiaient sous le titre d’Esquisses de la Chambre des députés! Tout fut inutile. Bohain répondait invariablement que ces articles se trouvaient dans la boîte du journal. Néanmoins, lorsque M. Laffitte, loué dans un de ces articles, après avoir tenté vainement de savoir qui il en devait remercier, fit remettre à Bohain un magnifique service de thé, celui-ci s’empressa d’envoyer le cadeau à l’auteur.
Il serait facile aujourd’hui de violer cet incognito si scrupuleusement gardé, mais ce secret est devenu celui de la comédie littéraire, si bien qu’il n’offre plus guère d’intérêt. Il est, je crois, plus utile et plus juste d’esquisser la vie de celui qui personnifia le Figaro aux jours de ses plus grands succès.
Ces quelques détails, je les emprunte à M. Julien Lemer, un des hommes les mieux informés des choses littéraires de ce temps-ci; ils furent publiés dans la Gazette de Paris à la mort de Victor Bohain, en 1856, et ce fut même un des rares, très-rares articles consacrés à cet homme qui avait rendu tant de services, je ne dirai pas à la littérature, mais aux gens de lettres.
Donc, je copie:
«Quels beaux commencements que ceux de Victor Bohain! Je ne parle pas du temps de son enfance; ceci n’est point une notice biographique, c’est une simple esquisse composée principalement de souvenirs personnels.
«J’ai vu Bohain pour la première fois en 1828. Si j’en crois ses amis, il devait avoir alors vingt-cinq ans. Il était rédacteur en chef du Figaro, qui, en ce temps-là, était une des feuilles politiques quotidiennes les plus importantes de Paris, une de celles qui devaient jouer un des rôles les plus considérables sous la Restauration, et laisser dans l’histoire de cette époque une trace des plus brillantes. Adolphe Blanqui, le plus spirituel de nos économistes, chez qui j’étais en pension pour faire mes études, me chargeait quelquefois, en allant au collége Bourbon, de remettre sa copie[2] à Bohain, qui habitait une charmante maison à l’italienne dans la cité Bergère, au nº 12, je crois. Ces jours-là étaient pour moi des jours de fête, car Bohain ne me laissait jamais partir sans me donner quelque billet de spectacle; aussi m’apparaissait-il comme le grand dispensateur des plaisirs parisiens. J’eus occasion de voir alors dans son cabinet ou dans ses bureaux presque tous les hommes devenus célèbres depuis.
«A la fin de 1829, Bohain, âgé tout au plus de vingt-six ans, possédait une fortune magnifique pour le temps. On l’évaluait à plus de quatre millions. Outre la propriété du Figaro, il avait le théâtre des Nouveautés, situé place de la Bourse, là où est aujourd’hui le Vaudeville, une part considérable dans le Vaudeville de la rue de Chartres et dans les Variétés, où il fit jouer une des pièces les plus audacieuses, sous le rapport de la verve satirique et de la licence aristophanesque, qu’on ait jamais représentées sur aucun théâtre. Cette pièce, intitulée les Immortels, Bohain n’en était pas l’auteur, mais je crois bien qu’il en avait conçu l’idée et qu’il avait appelé à concourir à la collaboration, non-seulement les rédacteurs de son journal, mais encore les vaudevillistes les plus spirituels de ce temps-là, où florissaient les Dumersan, les Théaulon, les Duvert, les Varin, les Rochefort, les Rougemont et tant d’autres, alors animés du feu de la jeunesse et de la passion politique. Cette témérité en couplets, qui montrait au public le roi Charles X personnifié par Brunet, et divers ministres incarnés dans la peau de Vernet, d’Odry, de Cazot et de quelques autres comiques, fut interdite après un certain nombre de représentations.
«Peu de temps après la révolution de 1830, Bohain se mariait et était nommé préfet de la Charente. Les dames de la halle vinrent en corps le féliciter et lui apporter des bouquets. Ce fait donne la mesure de l’importance du personnage.
«Mais au bout de quelques mois, les entreprises dramatiques étant «tombées dans le marasme, comme dit Bilboquet,» la fortune de Bohain déclina rapidement. En même temps, l’ancien directeur du Figaro crut devoir, pour représenter dignement l’Etat dans la Charente, mener une vie de prince, et appliquer toute son expérience de savoir bien et largement vivre. Nul ne possédait mieux que lui l’art de donner à dîner, d’organiser des bals et des fêtes; il en donna tant de preuves, qu’il vit bientôt la fin de ce qui lui restait de sa fortune, de la vente du Figaro et de ses parts dans les divers théâtres. Un beau jour il se trouva complétement ruiné; il est même probable que son passif dépassa de beaucoup son actif.
«C’est vers 1832 que Bohain fit jouer à l’Odéon son fameux Mirabeau, en douze ou quatorze tableaux, où Frédérick Lemaître fut magnifique. Le tableau des Jacobins fit un tel effet, qu’on fut obligé de le supprimer à la seconde représentation. Tous les jours, l’auteur envoyait aux acteurs un panier de vin de Champagne, afin de les mettre à même de jouer dignement l’acte du banquet.
«Depuis 1834, Bohain se dépensa lui-même en commencements d’entreprises pour la plupart fort ingénieuses, organisées soit à Paris, soit à Londres, où il a fondé un journal français: le Courrier de l’Europe, qui, je crois, existe encore.
«La première tentative qu’il fit à Paris pour relever sa fortune, rappelle une des publications littéraires les plus importantes et les mieux conçues dont on ait doté les lettres françaises: c’était l’Europe littéraire, un grand, un immense journal quotidien, auquel collaboraient toutes les sommités littéraires du moment. Les frais de rédaction, qui étaient énormes, absorbèrent bientôt le prix des abonnements et le capital de fondation. La rédaction y fut payée jusqu’au prix de UN franc la ligne.—A combien de lignes dînons-nous aujourd’hui? disait Henri Heine.—A vingt lignes par tête, répondait Bohain.
«Ce fut Bohain qui organisa la mise en actions de l’imprimerie Everat, dont il voulait faire une imprimerie modèle. Une partie du montant des actions devait être consacrée à former des lots très-importants pour une loterie à laquelle prenaient part tous les actionnaires. Cette combinaison, qui avait facilité le placement immédiat de toutes les actions, ne fut pas goûtée du gouvernement, qui s’opposa au tirage. Mais la Ville de Paris et, depuis, le Crédit foncier, lui empruntèrent le système du tirage des primes d’obligations.
«Bohain inventa encore Napoléon Landais, à qui il fit une célébrité qui ne l’a pas préservé de la pauvreté, et la Société des Dictionnaires: Dictionnaire de médecine usuelle, Dictionnaire de législation usuelle, etc.
«C’est lui qui, le premier, a imaginé les trains de plaisir sur les chemins de fer.
«Pendant quelques mois de convalescence qu’il passait chez le docteur Ley, aux Champs-Élysées, il eut l’idée du journal la Semaine et de la presse colossale, qui reste encore aujourd’hui la plus grande presse connue, entreprise très-bien conçue, qui certes aurait eu un grand succès, si Bohain n’avait pas été forcé, comme toujours, par un besoin d’argent, de vendre sa part et de se retirer.
«Je vois encore dans le jardin de la maison de santé ce petit homme, au buste rond, à la figure pleine, à l’œil gris, vif et intelligent, ombragé de cils longs et épais, donnant audience à tout ce que Paris comptait d’écrivains connus, d’hommes politiques importants. Son infirmité (une jambe trop courte), qui l’obligeait à s’appuyer sur une canne, lui donnait une sorte de physionomie de diable boiteux. Et, en effet, on peut bien dire qu’il fut l’Asmodée du monde littéraire, du monde des affaires, et peut-être aussi du monde politique de ce temps-ci.
«Oh! qu’il connaissait bien les hommes, et qu’il savait bien les prendre par leur vanité, leur ambition, leurs passions et leurs faiblesses!
«Un autre jour, il concevait et exécutait à lui seul une chose inouïe. Il soufflait à un homme politique, qui n’y songeait pas, la pensée de devenir journaliste; il suggérait au directeur d’un grand journal, à qui cette idée ne serait jamais venue, le dessein de céder sa position; il servait d’intermédiaire à ces deux hommes.—Puis, quand, ainsi qu’il l’avait prévu, le premier était bien convaincu de son inaptitude à ses nouvelles fonctions, quand le second était dans la nécessité de rompre le marché, par suite de l’opposition de ses co-intéressés, Bohain se trouvait encore là pour faciliter à l’un la rétrocession, à l’autre la réacquisition de la position et de la part primitivement vendues.
«Pour en finir avec les journaux, c’est Bohain encore qui a fondé l’Époque et inventé tous les moyens de publicité qui avaient fait à ce journal un si rapide mais si éphémère succès.
«C’est lui de même qui, en 1850 et 1851, créa le Moniteur du dimanche. Dieu sait ce qu’il dépensa de ressources ingénieuses, ce qu’il imagina de combinaisons pour faire vivre ce journal impossible!
«A la passion du papier imprimé, Bohain joignait le fanatisme des fleurs. Dans les dernières années, il avait entrepris à Palaiseau une culture de rosiers et de dahlias, et il obtenait, disent les connaisseurs, des variétés très-curieuses.
«Aussi, ne faut-il pas être surpris de lui voir inventer le Jardin d’hiver. Le Château des fleurs est encore une de ses idées; c’est à lui qu’on doit la première conception et le premier dessin de ce jardin, dont les frères Mabille ont su tirer meilleur parti que lui.»
Il y aurait encore bien des choses à dire; mais si Bohain a eu une part plus ou moins active dans d’autres conceptions et dans d’autres créations contemporaines, c’est dans l’histoire, c’est dans les mémoires du temps que plus tard on le lira. Quels mémoires il aurait pu laisser lui-même!
Victor Bohain est mort aux Batignolles, le samedi 19 juillet 1856, à l’âge de cinquante-trois ans, après avoir conçu et remué plus d’idées, fondé plus d’entreprises, mis en mouvement plus de choses et plus d’hommes qu’aucun spéculateur millionnaire, qu’aucun homme d’État de ce temps-ci.