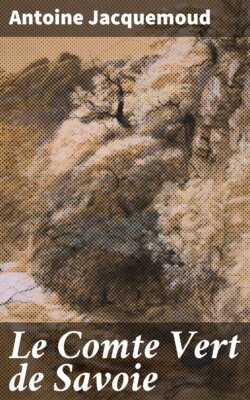Читать книгу Le Comte Vert de Savoie - Antoine Jacquemoud - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE.
ОглавлениеTable des matières
DANS cette suite de vaillants comtes sous laquelle, au moyen âge, fleurissait bien brillamment, comme le dit M. de Sainte-Beuve, la tige de l’antique Maison souveraine de Savoie; dans cette série dynastique, si glorieusement continuée, d’hommes de haute et intacte renommée, que M. de Châteaubriand compte parmi les princes les plus chevaleresques de l’Europe, et que M. Victor Hugo appelle très-grands seigneurs, forts et puissants dans leur montagne, il en est plusieurs qui ont marqué mémorablement dans l’histoire; plusieurs dont les noms se trouvent mêlés sous un rôle avantageux à ce qui se fit de grand et de retentissant sur la scène du monde passé ; plusieurs dont l’importance et, pour ainsi dire, l’extension personnelle ne sauraient être mesurées sur l’étendue géographique de leur modeste héritage, tant elles l’ont dépassée en merveilleuse disproportion, dans cette période si favorable au développement des grandes individualités! noms privilégiés que, par suite de la nature complexe des événements d’alors, les annales des peuples étrangers ont mentionnés avec un éloge plus ou moins impartial; noms chers et révérés que notre Savoie a recueillis, elle d’abord, elle avant tous, avec un soin jaloux, une religieuse sollicitude, comme on fait d’un patrimoine sacré, d’un précieux dépôt de famille; et cela, pour les montrer en exemple à ses enfants d’à présent et à ceux des temps futurs, comme une vivante et physionomique tradition de son honneur originel, comme la personnification héroïquement caractérisée de sa nationalité primitive et indéfectible. Or, parmi ces plusieurs dont on vient de parler, anneaux splendides et saillants sur le reste dans la longue chaîne dynastique, il s’en rencontre un, à première vue, qui s’est mis incontestablement hors de ligne; un dont la figure ressort entre tous par la place élevée et singulièrement lumineuse qu’il lui fut donné de se faire dans le cadre général des physionomies historiques du moyen âge. Les familiers de notre histoire m’auront déjà prévenu et auront nommé le Comte Vert (Amé ou Amédée VI).
«Vi ha di certi nomi il solo cui suono fa correre più rapidamente il
» sangue ne’petti atti a sentire entusiasmo. Tale è il nome del Conte
» Verde. Questo principe è nella storia di Savoia ciò che Tancredi è nel
» poema del Tasso.» (Bertoletti.)
Les chroniqueurs de Savoie, les biographes de Piémont nos co-nationaux, et les historiens italiens, sont unanimes à préconiser dans ce prince toutes les parties qui constituent le grand homme, le héros, dans la sévère acception du mot. Ils ont, les premiers notamment, rapporté avec assez d’accord entre eux, bien que dans une narration par trop parcimonieuse de détails et dépouillée d’attraits littéraires, les principaux faits dont se compose son existence extérieure. Quant à la partie intérieure, à ce côté de sa vie qu’on appellerait aujourd’hui populaire, individuel et tout humain, ils ont fait pour lui indistinctement comme pour les divers autres princes de la Maison de Savoie. Partout, dans leur récit, une aride économie de circonstances privées aux endroits qui intéresseraient le plus. On dirait parfois, chez eux, un scrupule de modestie ingénue, un dessein presque avoué de se conformer, dans leurs pages, au vœu sobre comme aux habitudes simples et austères de ceux dont ils racontent les actions. Mais si, d’une part, au point de vue multiple sous lequel on étudie l’histoire à notre époque, on a regret de cette absence de développements, il est juste de convenir, par compensation, que cette sobriété outre mesure, qui peut à bon droit leur être reprochée, devient, pour la postérité, une abondante garantie de leur probité historique, une tacite recommandation de créance absolue à leur récit, pour le peu qu’ils nous ont transmis.
Les étrangers, eux aussi, comme nous l’indiquions tout à l’heure, ont rendu bonne justice à cette noble mémoire. A preuve de cette assertion, et comme témoignage désintéressé, il suffit de produire ici, puisées ailleurs que chez nos écrivains nationaux, deux citations seulement, lesquelles tiendront lieu, en quelque façon, d’exposé sommaire et authentique:
«Amé VI, dit le Comte Verd pour s’être trouvé à un tournoy avec des
» armes vertes, et monté sur un cheval caparaçonné de verd, fut un
» des plus grands princes de son tems. Après s’être affermi en ses sei-
» gneuries, auxquelles il avait succédé, en 1343, à son père Aimon, à
» l’âge de dix ans, et avoir heureusement achevé plusieurs guerres
» qu’il avait avec ses voisins (en Piémont et en Dauphiné), il reçut l‘in-
» vestiture de ses Etats de l’empereur Charles IV. Il mena du secours
» au roy de France contre Edouard, roy d’Angleterre; fit une ligue avec
» Jeanne, reine de Naples et de Sicile; combattit le prince d’Achaïe,
» qui avait fait mourir ses officiers, et prit la ville de Turin. Depuis,
» l’an 1366, il alla en Grèce, contre les Ottomans, pour la défense
» de l’empereur Jean Paléologue, qu’il délivra des mains du roy de Bul-
» garie; et, à son retour d’Orient, il passa à Viterbe, où il présenta à
» Urbin V le patriarche de Constantinople, que l’Empereur lui envoyait
» pour la soumission de l’Eglise grecque. Le Comte Verd unit plusieurs
» principautés à la couronne de Savoie, et institua l’Ordre de l’Annon-
» ciade. Enfin, ce prince, heureux en ses nombreuses entreprises, après
» avoir régné quarante ans et s’être vu le juge médiateur de l’Italie et
» le défenseur des papes, mourut de peste dans la Pouille, où il avait
» porté du secours à Louis d’Anjou, roy de Naples, pour la conquête
» de son royaume, l’an 1383. Par ses rares qualités, il fut comme l’ar-
» bitre des grandes affaires de son siècle. Il avait épousé Bonne de Bour-
» bon, fille de Pierre, duc de Bourbon, et sœur de Jeanne, reine de
» France.» (Grand dictionnaire historique français de Moréry et des Continuateurs.)
Tristan le Voyageur, cet Anacharsis du moyen âge, dit, à propos de son passage en Bresse, pays qui, en ce temps, appartenait à la Maison de Savoie: «Alors régnait le fameux Comte Amé VI, surnommé le Vert » parce qu’il préférait la couleur verte à toute autre couleur, et qu’il
» la portait sur ses vêtements, dans ses armes et ses bannières. Ce fut
» à Bourg que je vis ce prince vénéré et puissant..... Il conquit plu-
» sieurs pays voisins..... Il fit des merveilles à la grande journée de
» Crécy..... Il délivra l’empereur de Constantinople des prisons du roi
» des Bulgares, et chassa les Turcs de la Grèce..... Le Pape lui déféra
» le titre de protecteur du Saint-Siège, et l’empereur d’Allemagne le
» nomma Vicaire général de l’Empire, en Italie.» (France au XIVe siècle, par de Marchangy.)
Tel est le sujet traité dans ces pages que je laisse, non sans quelque appréhension, aller au vent chanceux de la publicité.
Sur le simple exposé qu’il vient de lire, le lecteur aura, je le présume, entrevu déjà, d’un coup d’oeil préliminaire, le caractère à peu près général de l’œuvre (je n’ose dire poétique) que je soumets à son appréciation. Il ne s’agit ici de rien qui ressemble à une épopée taillée sur le patron antique. D’abord, un monde épique à remuer, c’est là un fardeau écrasant. Il faut un dieu pour créer un Olympe, et un Atlas pour le supporter. Les ressorts de la fiction homérique ne jouent bien que sous la main puissante du divin vieillard. D’autre part, les merveilles de la machine épique demeurent désormais en dehors de nos habitudes littéraires. Les formes, même de simple encadrement, de canevas superficiel, calquées sur le système de la fable primitive, ne sont plus de mise depuis voici bien des années. Employées dans un sujet moderne et chrétien, en si discrète mesure et avec tel ingénieux déguisement qu’on le veuille supposer, les données classiques du thème païen seraient une infaillible condition d’irréussite pour l’imitateur malavisé et trop tard venu. L’intonation d’une formule qui consonnerait le moindrement avec l’Arma virumque cano du chantre d’Enée, ferait, dès l’ouverture du poëme, crier à l’anachronisme, au renouvelé des Grecs. — Le lecteur intelligent aura senti encore qu’il ne peut non plus être question ici de rien qui ait parenté avec le genre épique mixte, composé de moyens empruntés à la fable ancienne et d’éléments puisés dans le roman de chevalerie (La Jérusalem délivrée, par exemple). Cette espèce-là, traitée une fois pour toutes par le chantre de Renaud, avec une admirable entente et une parfaite contexture de l’ensemble, est également tombée en désuétude. Avec leurs nouvelles préoccupations littéraires, les hommes d’aujourd’hui ne seraient guère d’humeur à se prêter complaisamment à l’illusion des enchantements magiques. Continuer, à l’heure qu’il est, une pareille nuance épique, ce serait se perdre, même pour un poëte souverain; la toute-puissance de ses accents ne le sauverait pas, et le chant de sa lyre inopportune mourrait dans le désert. Mais, y eût il actualité, le passereau qui chante dans un creux sibérien des Alpes sait très-bien d’ailleurs que l’ambition ne lui appartient pas de se faire entendre sur le mode du cygne de Sorrente. — L’œuvre présente n’a également aucun rapport de filiation avec un certain genre moderne, triplement bâtard, fabriqué avec de l’histoire récente, de la fiction païenne et du merveilleux chrétien (la Henriade). J’omets dans cet amalgame hétérogène un quatrième ordre d’idées disparate: l’allégorie morale. On l’a dit: une telle création manque de principe de vie. Poëme sans poésie, série de vers presque sans versification, les quelques tableaux et portraits tracés de main de maître qu’on y rencontre çà et là ne suffisent pas pour donner à cette conception une physionomie épique. Oui, il y a de belles figures poétiques dans la Henriade. C’est grand dommage que la seule figure à caractère qu’on y désirerait avant toutes les autres, n’y paraisse pas: celle de Henri IV. Le sujet est national et, de plus, merveilleusement domestique et familier pour la Franco; comment le poète français n’a-t-il tiré de là qu’un poëme impopulaire? Quoi qu’il en soit, celui qui ose aujourd’hui articuler le nom du Comte Vert n’aurait pas même, aveu qu’il se hâte de faire, la prétention de s’aventurer sur les traces du barde qui a suivi le Béarnais allant à la conquête de sa royauté.
La production annoncée sous le titre de Comte Vert de Savoie, n’est et ne devait être qu’un poëme historique. Un tel cachet littéraire lui était de rigueur imposé par la nature foncière du sujet choisi.
Considérer donc le tableau résultant de l’ensemble de la composition, autrement qu’en se plaçant au point de vue de l’histoire, ce serait y chercher des effets de lumière artificiels, des faces et perspectives idéales qu’on n’a pas voulu y mettre, et fermer en même temps les yeux au jour vrai, mais peu étendu, à l’aspect naturel, bien que très-tempéré de saillie et d’éclat, sous lequel on a eu dessein de représenter une individualité héroïque.
Les grands profils poétiques d’une beauté achevée peuvent se rencontrer dans d’autres figures créées par l’art moderne. La réalité des traits, avec sa noblesse simple et rude, est partout ici; c’est du moins ce qu’on a essayé de relever dans cette ébauche.
N’était l’infériorité, sincèrement confessée, d’une pareille œuvre, j’aurais volontiers écrit en tête du livre: Odyssée chevaleresque. L’appellation pouvait convenir à plus d’un égard. Le type de physionomie bien prononcé sous lequel l’homme se présente, certains traits homériques mêlés aux traits chrétiens dans son caractère réel, le genre spécial de plusieurs de ses pérégrinations guerrières, une teinte enfin d’héroïsme aventureux qui domine, fortement accusée en maint endroit, dans le tableau général et varié de sa vie, tous ces accidents, consignés dans l’histoire et reproduits en esquisse dans ce poëme, semblaient donner motif au choix d’une telle dénomination. Dans l’embarras, toutefois, de savoir au juste en quelle catégorie littéraire convenue doit être classée, hasardeusement née comme elle l’est, une conception qui n’a pas, que je sache, d’antécédents générateurs ni régulateurs; dans la difficulté, par conséquent, de lui appliquer d’office, pour la légitimer, une étiquette connue, je l’intitulerai tout uniment: Biographie d’un héros écrite en vers; dénomination assez juste et pas trop ambitieuse, qui ne saurait lui être contestée, ce me paraît.
C’est bien une biographie en effet. L’homme réel est pris à son berceau et conduit jusqu’à sa tombe par les phases diverses de son existence positive. L’intérêt d’action et de situation, si intérêt de cette sorte il y a, se trouve ici presque exclusivement restreint et concentré autour d’une personnalité unique. Pour la faire revivre, cette grande vie, dans les notables détails de sa vérité historique, il fallait remettre en scène, en les dramatisant modérément, les entours avec lesquels elle a été en contact, le milieu humain où elle a joué un rôle principal. Mais, on le répète, hommes et événements contemporains, tout cela figure ici accessoirement; ce qu’il y avait à recomposer dans ce cadre biographique, ce n’était point le passé d’un monde, mais celui d’un homme.
Ainsi, nulle invention dans le sujet; pas de force créatrice dans le plan de l’œuvre; et pas non plus peut-être, je le crains bien, de mouvement animateur dans la composition.
Ensuite de ce qui précède, à peine est-il besoin d’ajouter que la légende n’a rien fourni à ces pages. J’ai compulsé consciencieusement les documents authentiques; et il m’est passé sous les yeux un nombre suffisant de chroniques et de biographies, rédigées, les unes par des écrivains savoisiens, et les autres par des auteurs italiens. Muni de ces matériaux, je n’ai eu, à vrai dire, qu’à rassembler les faits et à les disposer selon l’ordre naturel. Dans ce travail de pur arrangement, je me suis interdit toute mutilation et déplacement historique. Aux endroits où les récits des divers historiographes et annalistes consultés se sont trouvés en désaccord entre eux, la vraisemblance restant néanmoins suffisamment gardée de part et d’autre à travers ces différences de narration, j’ai toujours opté, comme cela m’était permis, pour la version qui se prêtait le mieux aux exigences du thème poétique. Là où quelque lacune était à combler, j’ai fait la moindre part possible à la fantaisie des suppositions. En ce qui a trait aux habitudes du héros, à son humanité proprement dite, enfin à ce qu’on pourrait appeler la face morale de l’œuvre, j’ai rassemblé avec soin ce qui s’est offert de saillant et de personnellement caractérisé dans les lignes biographiques des écrivains nationaux et étrangers. Ce côté moral, aussi vrai en son genre que le côté strictement historique, devait, à moins que l’ouvrage ne mentît à la pensée fondamentale qui l’a engendré, embrasser surtout le triple ordre des idées religieuses, chevaleresques et monarchiques; car, ce n’est qu’à travers l’éclairement de ces idées, comme à travers son jour naturel, que la figure de l’homme pouvait se présenter. Isolée et vue ailleurs que dans ce milieu lumineux, l’image donnée n’eût pas été la sienne; on n’aurait eu qu’une apparition fausse, qu’une demi-silhouette. De là la nécessité de faire marcher constamment, le long de l’œuvre, sur une double ligne parallèle, l’homme et le principe qui a fait son humanité ce qu’elle est, le héros et la grande pensée où il a puisé son héroïsme, la chose et sa raison morale, le fait positif et la vérité sociale qui l’a produit, qui le domine et le vivifie.
De tout cela j’ai tâché de former un ensemble aussi homogène que la nature multiple et diverse du sujet le comportait, peiné seulement que ce travail n’ait trouvé pour son exécution qu’un ouvrier aussi insuffisant. Au défaut de la triple unité d’action, de temps et de lieu, qui était, on le comprend, forcément exclue de l’ordonnance d’une œuvre de ce genre, j’ai tenté d’imprimer au total de la composition un autre principe essentiel d’unité générale, loi intrinsèque, plus difficile peut-être à garder que la règle des unités communes, dont les créations dramatiques de nos jours tendent de plus en plus à s’affranchir: règle, du reste, dépourvue de principe foncier, et qui n’avait pour base qu’une vérité de convention routinière.
La création, à supposer qu’il existe ici quelque chose d’approchant, porterait donc, non point sur le fonds mais sur la forme extérieure, sur le procédé d’exécution. L’idéal, toujours dans la même supposition, toucherait au bord des choses seulement, aux contours flottants, aux accidents de remplissage, à tout ce qui est en dehors du fait réel et de la personne historique: simple affaire de détail de style; question de diction, de ton, de couleur, de mise en relief, etc. L’Art et la Poésie, en un mot (mais j’appréhende très-fort que l’un et l’autre ne soient absents d’ici ), entreraient enfin par exception dans la partie morale de l’ouvrage, dans les morceaux sous façon lyrique tenant lieu d’épisodes, et servant d’accompagnement aux divisions principales et de complément au total.
Il existe, chacun le sait, d’excellentes rhétoriques, traités complets et approuvés, sur la vraie manière de confectionner des poëmes épiques, des tragédies, des comédies, tout ce qu’on veut, enfin. Bien certainement, s’il en eût existé une aussi pour le genre particulier dont il s’agit, une sur la belle tournure à donner à une biographie héroïque écrite en vers, je n’aurais pas manqué d’en étudier l’esthétique d’un bout à l’autre; j’aurais puisé le plus possible d’inspiration à cette source des saines doctrines et des justes élégances. Si, de plus, comme il y en a pour tout expliquer, il y eût eu aussi des rhéteurs commentant et élucidant en conscience de profession les règles dudit traité, je me serais fait un devoir de prendre avis de ces messieurs; et, leurs leçons aidant, je serais parvenu, aussi bien qu’un autre, à produire quelque chose de conforme aux vrais principes et d’avoué par le bon goût. A défaut de rhétorique et de rhéteurs, en cette fâcheuse absence d’une direction quelconque, je me suis vu réduit à prendre conseil de moi-même. Qu’avec un tel guide, ma faible vue ait dû souvent s’égarer dans l’horizon inexploré, et mon pied faillir sur la route non encore battue, c’est chose qui se dit de soi-même.
Sans doute, d’après les principes admis par l’école des imitateurs, et autorisé en cela par de nombreux exemples, j’aurais pu, faute d’imaginative, puiser à pleine urne, avec plus ou moins de bonheur, dans les œuvres épiques des grands maîtres, ces sources originales, abondantes et limpides du beau classique; il m’était facultatif de faire de larges emprunts à ces riches mines d’où chacun a droit d’extraire le pur or natif. J’ai pensé néanmoins qu’il valait mieux recueillir, dans mon humble coupe de rude écorce, quelques gouttes, s’il était possible, de simple poésie suintant, bien qu’un peu trouble, de la veine avare de mon rocher solitaire, en exprimant toutefois mon ennui de n’avoir rien de mieux à offrir à la soif poétique de mon lecteur désappointé ; j’ai pensé qu’il valait mieux creuser dans mon ténébreux souterrain et y poursuivre courageusement quelque filon oublié, au risque d’en tirer seulement deux ou trois parcelles de matière demi-lucide et équivoque, ne fût-ce même que des paillettes de chrysochalque. Au lieu de prendre la large route ouverte par les génies-modèles, ces grands voyageurs et éclaireurs du monde poétique; route que le dernier venu peut fréquenter à plaisir, et qui mène aux belles régions de la pensée, aux horizons étendus de la fantaisie; j’ai préféré (y aurait-il eu présomption et égarement de ma part?) suivre dans l’isolement mon sentier étroit, rocailleux, brusquement tournant, et brisé sans cesse, mais conduisant peut-être à la découverte de quelque coin de verdure non encore foulée et de quelques aunes d’horizon restées jusqu’ici inaperçues aux explorateurs. Voilà pour la conception, les idées générales et la conduite de l’œuvre.
Relativement aux idées secondaires et au matériel des formes et des moyens de composition, je ne me suis pas fait faute, quand cela était à ma convenance, de ce qu’il y a de déjà connu et définitivement acquis à la littérature moderne: fonds de données qui n’est l’exclusive propriété d’aucun écrivain, mais qui constitue le domaine commun et appartient de droit à tous. Aujourd’hui, comme à chaque âge de l’esprit humain, il règne un nouveau courant d’air intellectuel; on dirait une sorte d’atmosphère poétique rafraîchie, où les âmes respirent plus amplement, où chacune d’elles puise avec un surcroît d’activité, pour se les approprier et assimiler ensuite selon sa nature individuelle, les molécules du nouveau fluide vital universellement flottantes. Chacun prend dans ce milieu ambiant; j’ai fait comme tout le monde. Mais tirer absolument tout du trésor ouvert, reproduire telle quelle la substance prise dans ce fonds commun, sans chercher si l’on n’aurait point par devers soi des ressources spéciales, ne créer en un mot que par réminiscence, ce serait, on le conçoit, une tâche par trop commode, triviale, et partant inutile. Pour caractériser une poésie, il faut autre chose que la répétition monotone des rimes qui déjà circulent partout. Deux ou trois idées sortant du propre fonds de l’écrivain donneront seules à ses pages une empreinte originale qui les recommande un moment à l’attention du public, de ce public de jour en jour plus difficile, plus exigeant, et qui a bien, il en faut convenir, un peu raison de se montrer tel. Mû par cette considération, qui doit, du reste, demeurer présente à l’esprit de tout homme prenant mission de parler au public, j’ai fait une tentative. A travers l’emploi des moyens laissés à la disposition de quiconque veut écrire dans la langue des vers, je me suis attaché à mettre en œuvre certains éléments poétiques auxquels, sauf démonstration contraire, je ne connais pas de précédents en littérature. Il me serait aisé de signaler ici les endroits; mais ce n’est pas nécessaire; puis, franchement, cela en vaut-il la peine? Le lecteur qui se tient au courant du mouvement littéraire, notera lui-même de prime abord les passages; il remarquera peut-être çà et là, au milieu des nombreuses vulgarités et défaillances de mon chant, quelques accents, trop clair-semés à mon grand regret, accents peu mélodieux et discordants sans doute, mais où je n’ai été l’écho d’aucune voix poétique étrangère. J’ai dit quelques accents, et c’est beaucoup dire; car l’innovation un peu étendue appartient au talent, et la création complète, au génie. Je ne suis dans aucune de ces conditions.
Reste à savoir maintenant si, construite comme elle l’est, cette œuvre possède en partie un mérite qui, pour extrinsèque qu’il soit, n’en est pas moins indispensable à tous les ouvrages de l’esprit, mérite d’où ils tirent leur principale chance de viabilité présente: celui de répondre à un besoin intellectuel ou moral du moment. La question de l’actualité littéraire est trop importante de nos jours pour qu’il n’en soit pas dit ici quelques mots.
Nous l’avons déjà remarqué en commençant: on ne peut plus jeter aucune œuvre dans le moule de l’ancienne épopée mythologique; cette forme est brisée à jamais. La reconstruction d’un tel type épique est dorénavant laissée à l’innocente manie de certains hommes de lettres qui, demeurés fidèles au culte des Muses scolastiques d’il y a trente ans, s’obstinent à ne pas savoir l’âge où il vivent à présent. A cet égard donc, pas de contestation.
Mais de ce que la raison humaine a accompli sa phase juvénile, de ce que nous sommes loin, bien loin déjà, assure-t-on, de l’ère où la vérité se fondait avec la fable, où la première histoire des nations était une épopée, et leurs premiers annalistes, des poëtes et des rapsodes, on a tiré une induction trop générale, on a passé à une conclusion fausse, parce qu’elle est absolue. Quelques écrivains modernes sont allés jusqu’à prétendre que toute poésie tenant plus ou moins du genre héroïque, est devenue impossible; et ceux qui ont mis en avant cette assertion exclusive ont cherché à l’étayer des considérations suivantes, à savoir que les grands hommes et les héros ont essentiellement contribué à former le noyeau rudimentaire des sociétés naissantes, à policer, à émanciper graduellement les peuples enfants; que, par une conséquence nécessaire, les jeunes générations ont dû s’habituer à personnaliser leur nationalité et leur civilisation dans ces puissants individus, restés longtemps les bienfaisants tuteurs des patries adolescentes; que la gratitude nationale s’est dès le principe attachée avec un souverain intérêt à ces glorieuses mémoires, en les perpétuant par la tradition orale pieusement maintenue; que les littératures, après avoir consacré les premiers accents de leur berceau à bégayer la Divinité sous ses diverses appellations lyriques, ont dû, en grandissant, célébrer les grands noms héroïques et les inscrire dans l’immortalité par des chants populaires. Jusque-là, rien qui ne soit conforme aux enseignements de l’histoire. La critique a mis en pleine lumière ce fait primordial. Mais, de ce que le genre épique, qui est individuel de sa nature, a été la première forme affectée par la poésie, les détracteurs de l’épopée héroïque induisent mal à propos qu’elle n’est plus praticable aujourd’hui. Précisons leurs motifs. Ils nous représentent, car tous ne se sont pas encore mis d’accord sur l’âge assignable à l’esprit humain, ils nous représentent le monde arrivé, les uns, à sa maturité seulement, les autres, à sa vieillesse déjà, et quelques-uns, à sa décrépitude enfin; cela posé, ils déclarent que ce qui a intéressé son enfance ne va plus aux goûts de sa virilité, et reste également sans charme pour son humeur sénile; qu’à la suite des successives et profondes transformations subies par l’humanité, l’œuvre sociale s’accomplit à notre époque bien autrement qu’aux ères initiales; que le travail de la civilisation n’est plus uniquement dévolu aux puissants individus, aux grands hommes, aux héros, mais qu’il se fait par l’apport de la capacité personnelle de chaque homme et par le concours, sans distinction aucune, de toutes les intelligences et aptitudes en masse; que le niveau commun de la raison humaine, demeuré si inférieur durant tant de siècles, se trouve aujourd’hui avoir atteint un tel degré d’élévation, que les grandes personnalités exceptionnelles ne peuvent plus surgir au-dessus; que dès lors, les figures phénoménales du monde passé ont cessé d’appeler à elles et d’occuper l’attention admirative des générations présentes; qu’ainsi la poésie, expression la plus intime, la plus brillante, la plus distinctive aussi d’une civilisation quelconque, se dégageant désormais de la forme héroïque et restrictivement nationale, doit revêtir le caractère humanitaire, le type d’universalité, qui est celui de l’époque, selon leur dire, du moins.
Oui, il y a quelque chose de vrai dans tout cela; oui, la poésie a besoin de s’humaniser par un côté. L’instinct unanime des littératures à cet égard ne saurait être en défaut; la pacifique révolution qui s’opère généralement, depuis voici bientôt une vingtaine d’années, dans le domaine des lettres, soit par rapport au fonds des idées, soit en ce qui concerne les formes mêmes les plus matérielles de l’expression, c’est là, certes, un fait dont, à l’heure d’aujourd’hui, l’évidence et la portée morale ne souffrent plus de discussion sérieuse dans le monde intellectuel.
Mais on sent, d’une autre part, ce qu’il y a d’aventuré et d’extrême dans la doctrine des proscripteurs du genre héroïque. Qui ne voit d’ailleurs que leur système tend, en définitive, à introduire les nébuleuses et flottantes préoccupations de la Politique dans la région de l’Art immuable et serein? On voudrait faire de l’Art un partisan passionné ; on voudrait, c’est le mot, démocratiser radicalement la Poésie.
L’étroitesse des limites imposées à une simple préface ne me permet pas d’entrer dans les détails d’une entière réfutation. La pensée éclairée du lecteur complètera elle-même les rapides et partielles observations que je vais jeter dans les lignes suivantes.
Non, l’humanité n’est pas, en réalité, arrivée au point de perfectionnement qu’on nous vante dans le programme théorique. Vue à la superficie de la société, la civilisation semblerait, sous certains aspects, justifier les belles annonces des systèmes; mais, sans même creuser à fond, regardez seulement, avec discrétion, un peu avant dans le positif du fait social, même chez les peuples réputés les plus cultivés, et vous ne tarderez pas à être tristement désillusionné. Prenant, dans toutes les questions, l’homme et la société sur le fait palpitant, chacune de vos études d’observation apportera un sec démenti aux théories acceptées sur parole, et chaque expérience journalière un nouveau refroidissement à vos plus fervents enthousiasmes humanitaires, si tant est, ami lecteur, que vous péchiez encore à ce sujet par trop de candeur. Sans vouloir nier le progrès social, ce qui serait un tort aussi grave que de l’exagérer, la bonne foi de l’observateur a le droit de douter si tout ce qu’on décore du nom de progrès civilisateur, en est bien effectivement; si les changements advenus dans l’humanité ne sont pas, en plus d’un cas, une réapparition de sa barbarie originelle sous des formes nouvelles; si, en polissant sa rudesse au contact des idées modernes, le génie des nations a racheté par des avantages suffisants la perte de son ingénuité et de sa droiture antiques. Il est permis peut-être de se demander si le système de nivellement qui tend non-seulement à proscrire du temps présent les grandes individualités, mais encore à les bannir de la place qu’elles se sont faite dans le cadre poétique du passé, à renverser l’autel sur lequel l’Art impartial aime à leur élever des statues, à dépouiller de tout prestige le culte des souvenirs séculaires que leur rend la reconnaissance des nations; il est permis de se demander si un tel système gratifie l’humanité d’une bien précieuse compensation, en faisant surgir d’un coup et en foule, de leur obscure fourmilière, toutes les petites individualités sociales, en proclamant chacune d’elles souveraine indépendante, destinée à jouer un rôle supérieur, en la mettant par là en guerre tantôt ouverte, tantôt clandestine, mais permanente et acharnée toujours, avec tout ce qui l’entoure, et cela de telle sorte qu’il en résulte la rupture de l’unité des sociétés.
Et notez ici par parenthèse combien la littérature est toujours prompte et fidèle à refléter la couleur des théories et des opinions sociales. Adoptés par une portion de l’école poétique moderne, la portion jeune, immodérément enthousiaste, celle qui accueille en chaude amie les nouveautés exorbitantes, ces principes d’indépendance et d’individualisme ont donné naissance à ce genre de poésie intime, étroitement personnelle, qui a été en vogue durant la période de quinze ans qui vient de s’écouler. Laissant de côté les grands sujets qu’offre l’histoire du passé, chacun s’est mis, bravement et sans tant de façons, à se prendre soi-même pour type et, comme cela était reçu alors, à se faire son épopée intérieure à soi, son drame élégiaque à soi. Dans ce genre fébrile, marqué au coin d’une idéalisation démesurément excentrique, le moi égoïste de l’imperceptible individu a pris des dimensions épiques tout d’abord, l’acte le plus simple de la vie privée a été élevé à la hauteur d’un événement social, et la moindre larme du poëte microscopique aux proportions d’une douleur humanitaire. Il n’y avait pas, si exiguë qu’elle fût, d’individualité qui ne se mirât elle seule dans tous les beaux aspects de la création, qui ne se sentit complaisamment vivre dans toutes les palpitations des êtres d’alentour, qui ne remplît le monde entier de son moi, et ne s’imaginât représenter, elle seule, l’immense humanité. Il ne se trouvait pas de poëte, de poëte inconnu, de poëte incompris surtout (et il en foisonnait de ces Prométhées au petit pied) qui ne se construisit son Caucase intime, son Golgotha domestique à la mode; et c’est là que chacun posait comme il l’entendait, s’octroyant gratuitement deux royautés: celle du génie et puis celle de la souffrance expiatrico. Aussi, à chaque pas, en littérature, vous rencontriez un héros ou un martyr, à votre singulier ébahissement.
D’un autre côté, ne sent-on pas que cette Humanité, si fallacieusement prônée, n’est au fond qu’un mot abstrait avec lequel les partisans du système jouent d’une manière trop abusive? Evidemment, il y aurait folie à vouloir appliquer une pareille doctrine à toutes les nations indistinctement, à englober comme ça, à l’aveugle et pêle-mêle, dans un tout-y-va social, la grande, la multiple humanité, si dissemblable de peuple à peuple. La nature humaine est aussi diversement accidentée dans les nations que la nature physique dans les différentes parties du globe qu’elles occupent. L’élévation du niveau de l’intelligence universelle n’est point la même chez chacune d’elles. Chez chacune d’elles la civilisation s’opère par des procédés particuliers. C’est donner, tête baissée, dans les plus graves aberrations, que de ne pas tenir compte du génie national et des mille antécédents qui distinguent tel peuple de tel autre. Ce qui est un moyen d’avancement pour celui-ci, devient souvent un obstacle pour celui-là. Rien donc de général ne saurait être raisonnablement établi sur ce point.
Rentrons dans le cœur de notre question. En ce qui est des individualités héroïques dont nous traitions il y a un moment, les adversaires du genre épique manquent de justice dans l’appréciation qu’il leur plaît d’en faire. Ils s’opiniâtrent à ne reconnaître dans ces glorieuses figures que le type de la force matérielle. Mais cette force n’a pas été la seule puissance par laquelle ils ont exercé une action sociale si étendue. Ils ont aussi influé sur le monde par le génie, par la vertu, par des actes de haute humanité ; et, sous ce rapport, leur mémoire appartient intimement à la poésie, à la religion de l’Art. De tels noms ne peuvent sans injustice être relégués, comme on le prétendrait, dans quelques coins obscurs et poudreux de la froide histoire. — Et puis, qui oserait assurer que les individus transcendants ont disparu sans retour du théàtre des événements sociaux? L’éducation philosophique des masses populaires, est-elle assez avancée? l’horizon du monde politique, assez éclairci? la face de la nouvelle Société, assez nettement dessinée dans le clair-obscur de la scène flottante de l’avenir, pour qu’on soit fondé à prononcer que les personnages hors de pair n’ont plus de rôle à jouer dans le drame futur de l’humanité ? Est-il bien certain que tel et tel peuple, pour traverser des crises sociales commandées par leurs destinées, pour se constituer enfin pleinement, n’auront pas besoin de ces conducteurs des nations, de ces guides extraordinaires qu’on nomme héros? Voilà le problème. Le dernier mot n’est pas dit là-dessus.
Superflu de nous arrêter ici au rêve extravagant, au non-sens social des utopistes outrés qui visent à détruire le sentiment de la nationalité par sa fusion absolue dans celui de l’humanité universelle.
Si le sentiment de la patrie est immortel de sa nature dans le cœur des générations humaines, le souvenir sacré des hommes d’élite qui ont, les premiers, constitué la patrie, et se sont, eux et leur dynastie, identifiés avec elle, ne doit pas vieillir, ne doit pas mourir. A moins de s’abdiquer lui-même, un peuple ne peut oublier les noms synonymes de sa personnalité originelle et répudier les premiers titres authentiques de sa dignité sociale. Ainsi donc, faire revivre à ses yeux les hautes images où l’illustration de son passé se trouve comme incarnée, comme individualisée, lui donner de fois à autre à contempler, de très-près et sous un aspect plus saisissant, ces gloires météoriques au rayonnement desquelles sa physionomie doit l’éclat qui la distingue parmi celles des autres nations, ce sera toujours le plus efficace moyen de réchauffer le patriotisme dans son sein, d’entretenir en lui le culte de toutes les vertus publiques. La religion des glorieux souvenirs est la dernière à s’éteindre, même chez un peuple impie, si jamais tout un peuple pouvait, sans se dissoudre, cesser un seul moment d’avoir une foi!
Maintenant, en ce qui regarde la question littéraire proprement dite, on conçoit assez aujourd’hui que la première condition d’une poésie, pour qu’elle soit acceptée et comprise, c’est d’être appropriée au véritable esprit philosophique et aux mœurs du siècle auquel elle s’adresse. Comme les autres genres poétiques, le genre épique se trouve soumis à cette loi de rénovation périodique en vertu de laquelle la littérature, à certains temps donnés, varie de forme et de mode de composition: métamorphose plus ou moins complète, qui se produit non-seulement dans la nature des idées et des sentiments, mais encore dans la partie la plus superficielle du langage. La connaissance certaine, acquise enfin à notre siècle, de l’instinct du génie humain, a mis hors de contestation cette vérité : que, dans ces époques de mouvement progressif, l’Art, en général, sans pour cela changer de but moral et de tendance civilisatrice, abandonne ses vieux errements et se fraie d’autres voies plus larges, plus droites et mieux éclairées.
Rien donc n’empêche que la poésie épique ne soit aussi bien praticable de nos jours que dans les temps reculés; seulement elle est obligée de procéder diversement, sans dénaturer pour autant le caractère héroïque de ses personnages. Voyez en peinture, par exemple: tous les jours, un même sujet héroïque pris dans l’histoire ancienne est conçu d’une nouvelle manière, rajeuni avec d’autres couleurs, présenté sous une lumière différente. Au fond, la question gît presque entière dans la façon inusitée d’envisager le sujet et surtout dans le mode plus ou moins neuf de son exécution. Qu’on y réfléchisse un tant soit peu, et l’on se convaincra bientôt que c’est de là en effet qu’une œuvre tire en majeure partie son cachet d’actualité.
S’imaginerait-on, parce que l’officine homérique est fermée à toujours, qu’il n’y ait plus moyen de trouver une enclume et des marteaux pour forger une épopée? Certes, le merveilleux n’est pas, comme quelques gens de lettres se le figurent, l’élément essentiel de la poésie héroïque. La mythologie païenne n’est pas la seule source de la beauté épique. Loin de là. Notre civilisation chrétienne, largement comprise surtout comme elle l’est à cette époque, nous a ouvert des trésors nouveaux, livré des ressources de toute espèce; il ne s’agit que de savoir exploiter la carrière. L’auteur des Martyrs nous a montré, lui le tout premier, ce que peut le génie de l’ouvrier dans une semblable exploitation. Plus d’un beau parti en sens divers reste encore à tirer de cette mine inépuisable. Entière latitude est laissée de nos jours aux poëtes, aux puissants faiseurs, pour combiner d’autres éléments, monter d’autres ressorts, calculer des effets inaccoutumés, propres à intéresser au récit épique.
Mais alors, objectera-t-on, une œuvre conçue et exécutée sur ces nouvelles données ne peut plus se qualifier d’épopée. Soit encore. Une intitulation, telle ou telle, antique ou moderne, qu’est-ce que cela fait à la chose? Qu’au mot ne tienne; donnez à l’œuvre le nom que vous voudrez, ou plutôt ne lui en donnez point. Si elle est fortement organisée, si elle réussit auprès du public intelligent, l’œuvre saura bien se nommer d’elle-même; et le nom qu’elle se fera, soyez-en sûr, sera toujours beau, aussi beau que celui d’épopée. En ceci comme en tout, il ne faut pas chicaner sur le mot. Nous arrivons à une époque où l’étiquette ne caractérise plus rien; c’est le fonds des choses qu’il s’agit d’apprécier.
Mis ainsi en harmonie avec les goûts littéraires et les idées sociales du temps présent, le genre dont nous parlons aurait droit, par l’importance et l’étendue de la conception comme par la nouveauté de la forme, d’appeler à lui les sympathies des intelligences élevées; et cela de préférence, nous estimons, au genre poétique qui a semblé prévaloir jusqu’ ici, le chant élégiaque, genre caractérisé par des productions à courte haleine, sans portée sérieuse, et d’un larmoîment monotone bien fait pour lasser les oreilles les plus résignées, genre plus personnel qu’humanitaire, plus sceptique que religieux, quoi qu’on en dise, et dont les intelligences graves commencent déjà à reconnaître le vide désespérant et le danger réel pour l’âme de la génération naissante.
La lyre qui ne rend qu’une note plaintive,
Au cœur des nations ne trouve plus d’échos.
(ALFRED DES ESSARTS, 1843.)
Ce que le monde lettré veut aujourd’hui, ce sont des œuvres viriles, des compositions larges et solidement pensées. Depuis une dizaine d’années, les esprits paraissent se tourner de ce côté ; de jour en jour la tendance devient plus manifeste.
Le succès déjà obtenu par plusieurs productions d’espèce épique, tant dans la variété purement héroïque que dans la variété humanitaire modérée, sorties de la plume des écrivains contemporains, plaidera, du reste, plus démonstrativement que les meilleures raisons, pour la cause du genre épique que nous soutenons.
D’ailleurs, à présent que l’on revient avec une prédilection pleine de curiosité sur les hommes et sur les choses du passé, pourquoi le poëme héroïque, surtout s’il est marqué au sceau authentique de l’histoire, n’aurait-il pas sa part dans les travaux des hommes de lettres et dans l’attention d’un public éclairé, autant que la page d’histoire elle-même, autant que le drame et le roman historiques?
Plus qu’une considération, la plus directe de toutes, et je clos cette préface.
Si le temps propice à l’avénement de l’épopée, c’est, comme on l’a remarqué, le premier âge littéraire des nations, lorsque le doute n’a pas encore fait invasion dans les intelligences, et que les mœurs n’ont pas subi encore ces altérations profondes qui défigurent le type original d’un peuple, il sera vrai de dire que la poésie épique convient aujourd’hui à notre nation plus qu’à aucune autre.
Notre Savoie est à la fois antique et moderne: moderne, par son avancement dans les sciences, dans les arts et dans la voie pacifique de toutes les véritables améliorations sociales; antique, par son isolement des grands centres de dépravation, par son ferme attachement à l’ordre de choses que les siècles ont institué et sanctionné pour elle, par ses affections religieuses et monarchiques, par la solide chaîne de ses traditions locales, par ses mœurs conservées, quant à la majorité de la population, presque dans leur simplicité génuine, par le culte commémoratif des aïeux, enfin, par toute sa physionomie morale aux traits accentués comme les grandes lignes des rochers éternels qui l’encadrent.
Ce qui est dit ici de la Savoie peut s’appliquer à la généralité des Etats sardes, et surtout à la nation piémontaise, cette belle et noble portion de la grande famille monarchique à laquelle nous appartenons: nation pleine encore de sa sève première, sœur antique et fidèle de notre Allobrogie, fille du même passé qu’elle, assise au pied des mêmes Alpes et au pied du même trône, enviablement privilégiée du Ciel, qui envoie sur elle le souffle âpre et pur de la montagne pour vivifier l’air énervant de la tiède Italie.
Pour nous, loin de nous ranger en ceci au sentiment des alarmistes exagérés, nous inclinons à croire que l’action de l’influence externe, en ce qu’elle a de corrupteur, est encore pour le moment présent assez neutralisée par cet ensemble d’éléments primitifs et vivaces qui fait le fonds moral du pays. A notre sens, le sol de la patrie savoisienne n’est point, littérairement parlant, stérilisé par le souffle aride du scepticisme étranger dont l’atmosphère nous environne, au point que le laurier de l’épopée nationale, pure, naïve et primitive, ne puisse plus y fleurir.
Ainsi donc, de même que les autres nations ont eu, chacune, le leur, pourquoi notre pays n’aurait-il pas son poëme épique, à lui? Pourquoi, chez nous, contrairement à ce qui se pratique ailleurs, la haute poésie, demeurant en dehors de la nationalité, se condamnerait-elle à chercher ses sujets autre part que dans les pages historiques qui font l’orgueil du nom savoisien? A en juger d’après le système d’éducation littéraire suivi jusqu’ici parmi nous, à voir nos études se porter d’abord avec une préférence exclusive vers l’histoire des peuples étrangers, et nos admirations vers les gloires qui ne s’appellent pas de notre nom, on serait tenté quelquefois de penser que, semblables aux peuples qui sont d’hier, nous n’avons ni passé, ni histoire, ni gloire, rien, en un mot, à savoir ni à dire sur notre propre compte. Certes, nous n’en sommes pas réduits à cette condition. Heureusement les bons esprits, et, de ceux-là, il y en a chez nous beaucoup plus qu’il n’en paraît à la superficie de notre société, les bons esprits commencent à reconnaître cette dangereuse déviation; ils comprennent qu’une direction plus naturelle, qu’une impulsion plus patriotique doit être donnée dorénavant aux travaux et aux sympathies des jeunes intelligences; qu’avant d’être, dans nos études, Grecs, Romains, Français, voire même Anglais-byroniens, et je ne sais quoi tant encore, il ne nous siérait pas mal, à nous hommes de la Savoie, d’être un peu Savoisiens; qu’au lieu de nous laisser toujours imposer les idées, les goûts, les émotions et les enthousiasmes des autres, il serait plus rationnel, plus digne peut-être, de juger et de sentir par nous-mêmes, de descendre jusqu’au cœur de notre nationalité, de bien regarder s’il ne se rencontrerait point çà et là, dans nos annales domestiques, quelqu’un de ces beaux types, quelqu’un de ces sujets merveilleux, faits pour passionner le sentiment poétique chez tous les hommes et dans tous les temps.
La fibre nationale est toujours forte et vibrante dans notre cœur; il est temps de mettre à notre lyre la corde patriotique qui doit y répondre.
En arrivant avec mon poëme auprès du public, je ne serai donc pas intempestif, non, je ne le serai pas, pour mon pays, du moins; j’en ai la conviction. Ce besoin, senti enfin chez nous, d’une littérature nouvelle et spéciale, j’aime à me persuader que, si je ne l’ai pas satisfait autant que cela était dans mon vœu, je l’ai servi toutefois en partie. J’ose encore espérer que ces lignes si peu poétiques seront pour les littérateurs mes concitoyens un tracé préparatoire, un premier acheminement vers le champ de poésie où la noble palme épique nous reste à moissonner.
J’ai détaché de nos fastes domestiques une seule page, une des plus héroïques, la plus admirable de toutes peut-être, et je l’ai traduite dans l’idiome rhythmé, en cette vue qu’elle devînt l’histoire du COMTE VERT DE SAVOIE la plus vulgaire, la plus savoisienne, la plus complète qui existe jusqu’à ce jour; car, il ne faut pas s’y méprendre, la meilleure histoire, l’histoire vraiment propre à nationaliser un grand nom, à le faire descendre ou, pour parler plus juste, monter jusqu’à l’attention de la foule et vivre dans la mémoire populaire, c’est le poëme.
Je le répéterai, de peur qu’aucune des paroles risquées dans cette préface ne soit accusée de présomption: une large lacune existe toujours dans notre civilisation littéraire. Un monument poétique résumant complétement notre nationalité, demeure à édifier. En attendant que, chez nous ou chez nos compatriotes d’outre-monts, l’homme de génie, l’artiste excellent qui nous manque et que nous désirons pour la construction du grand œuvre, soit trouvé, j’ai cru que je pouvais, moi, ouvrier ordinaire, apporter néanmoins ma fascine au vide à remplir, et mon moellon à l’édifice à élever. Ni plus, ni moins.
Maintenant le public, si mon livre s’en acquiert un, le public, celui de mon pays notamment, me saura-t-il gré de ma bonne intention? Me tiendra-t-il compte des efforts faits pour lui donner une poésie qu’il n’avait pas? Plusieurs nobles intelligences, qui m’appuient de leur sympathie et qui m’ont dit d’oser dans l’entreprise, m’ont promis en même temps que ce suffrage-là ne me manquerait point. J’y compte donc. Ce m’est, je l’avoûrai, toute une récompense déjà, de pouvoir penser que, s’il me refuse l’esprit poétique, mon pays m’accordera en revanche l’esprit national.
Je ne fermerai pas ce livre sans remercier, du meilleur de mon cœur, la Société Académique Royale de Savoie, de l’accueil si bienveillant et si laudatif qu’elle a fait unanimement à toutes les pages que jusqu’ici j’ai soumises à son appréciation. Pour son honneur comme pour le maintien, si salutaire, de son autorité littéraire parmi nous, je souhaite que son jugement à mon égard ne soit accusé par ceux qui liront ces lignes ni de trop d’erreur ni de trop de partialité.