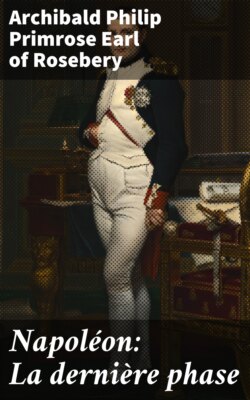Читать книгу Napoléon: La dernière phase - Archibald Philip Primrose Earl of Rosebery - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES SOURCES.
ОглавлениеQui nous écrira la vie de Napoléon comme elle doit être écrite? Jusqu'ici, poser la question eût été peine perdue. Les préjugés et les passions du temps étaient encore trop près de nous pour qu'on pût songer à écrire un tel livre. Et aujourd'hui même nous n'en sommes pas bien éloignés, car la reine Victoria avait déjà deux ans à l'époque de la mort de Napoléon et il existe probablement encore des personnes qui l'ont vu. Puis le second Empire a ranimé, multiplié ces sentiments presque dans leur intensité première et la réaction qui a suivi le second Empire en a prolongé encore l'existence. Peut-être ne sommes-nous pas assez complètement sortis de la sphère d'influence historique de Napoléon pour qu'il soit possible d'écrire sa vie.
D'ailleurs, jusqu'à ces derniers temps, nous ne possédions pas les éléments nécessaires à un tel travail. Les volumes innombrables dont les titres se rangent dans les catalogues à la suite du nom de Napoléon sont pour la plupart des compilations, ou des pamphlets, ou des biographies laborieusement édifiées avec des matériaux douteux et insuffisants, sans solidité comme sans durée. Mais aujourd'hui que la France possède un gouvernement dont les archives sont ouvertes à tous, et grâce à l'apparition successive d'une foule de mémoires plus ou moins authentiques, nous pouvons prévoir le moment où nous n'aurons plus de révélations nouvelles à attendre. La publication des lettres supprimées dans la Correspondance impériale fait disparaître une des critiques qu'on adressait aux éditeurs officiels de cette correspondance et en comble les lacunes. La curiosité passionnée qui entraîne le public depuis quelques années vers tout ce qui tient à Napoléon et qui, chose remarquable, n'est accompagnée d'aucun signe de résurrection du bonapartisme comme facteur politique, a eu pour effet de créer toute une littérature, afin de mettre l'offre en rapport avec la demande, et cette littérature, toute mélangée qu'elle soit d'éléments malsains ou équivoques, nous a, du moins, parmi son exubérance parasite, apporté sa moisson d'utiles renseignements.
Ainsi, l'énorme masse de matériaux de toute sorte est prête pour l'ouvrier de cette grande œuvre, le jour où il paraîtra. Peut-être n'est-il pas loin de paraître. Nous aimons à nous persuader que c'est son ombre qui se projette dans le beau récit des relations de Napoléon et d'Alexandre. Est-ce trop se flatter que d'espérer que M. Vandal couronnera les services qu'il a rendus à la science historique dans cet ouvrage inappréciable en nous donnant, tout au moins, une «Histoire civile de Napoléon»? Ne pourrait-il, en s'associant avec M. Henry Houssaye, qui a, lui aussi, tant et si bien fait dans cet ordre d'idées, mener à fin cette grande tâche? Nous parlons d'une collaboration parce qu'il ne nous semble pas possible qu'un homme, réduit à ses seules forces, entreprenne pareille besogne. Rien que le dépouillement et la critique des documents seraient déjà œuvre de géant avant qu'une seule ligne du livre pût être écrite. Et en vérité nul homme ne serait en mesure, à lui seul, d'aborder, à la fois Napoléon chef d'État et Napoléon chef d'armée. «Napoléon, dit Metternich, juge hostile s'il en fut, était un administrateur, un législateur et un conquérant.» Il aurait pu ajouter que Napoléon était, de plus, un homme d'État né. Pour analyser et célébrer les qualités du conquérant de 1796 à 1812, celles du défenseur de la France en 1813 et 1814, il faudrait un maître consommé dans l'art de la guerre. Pour rendre justice à Napoléon homme d'État, administrateur et législateur, peut-être faudrait-il aussi des historiens distincts, pourvus de facultés différentes. Il y aurait à faire, enfin, l'étude générale de l'homme et de son caractère. Caractère des plus simples pour un admirateur fanatique comme pour un ennemi juré, infiniment compliqué, au contraire, pour qui n'est ni l'un ni l'autre. Pour cette dernière étude, la psychologie de Napoléon, les éléments les plus féconds sont fournis par ces six années suprêmes de Sainte-Hélène, où il a non seulement raconté et commenté sa vie, mais où il a présenté une image précise et parfaitement cohérente de lui-même. «Aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même à Sainte-Hélène, grâce à mon malheur, on pourra me juger à nu.» On n'a peut-être pas encore donné toute l'attention qu'il fallait aux pages qu'il dictait alors sous forme d'autobiographie ou de commentaires. Quelqu'un a dit quelque part que les mémoires dont il est l'auteur semblent avoir été négligés précisément parce que ce sont les documents primordiaux, authentiques, ceux qui font vraiment autorité en ce qui touche la vie de l'Empereur. Les gens aiment mieux boire à n'importe quelle source qu'à la source véritable. Qu'une personne étrangère ait été en contact avec lui, ne fût-ce qu'un moment, c'est cette impression d'un passant qu'ils voudront recueillir de préférence. Mais ce que Napoléon a dit de lui-même, ce qu'il a pensé de lui-même, cela semble aux étudiants de Napoléon chose de peu de prix. Ce qu'il leur faut, c'est Bourrienne, Rémusat, Constant et le reste. Évidemment, ils ont le droit de prétendre que les mémoires de Napoléon sont moins savoureux que ceux de quelques-uns de ses serviteurs, et qu'on ne peut pas invariablement s'y fier comme à une impartiale relation des événements. Ces mémoires restent pourtant comme l'expression directe et réfléchie de ce prodigieux génie parlant de ce qu'il avait fait; et, de plus, ils contiennent des jugements sur les grands capitaines d'autrefois, sur César, Frédéric, Turenne, et ces jugements ne sauraient manquer d'intéresser un historien ou un soldat.
Il ne faut pas, d'ailleurs, quand on veut apprécier Napoléon, attacher d'importance au peu de respect qu'il a montré quelquefois pour l'exactitude. En ces temps-là, on n'attendait guère, on n'exigeait jamais d'un homme d'État européen qu'il dît la vérité, et c'est là ce qui fait qu'un demi-siècle plus tard Bismarck ne trouva pas de meilleur moyen pour tromper son monde que la franchise. Les ennemis les plus acharnés de Napoléon, Metternich et Talleyrand, nous ont maintenant donné leurs mémoires, mais nous nous repentirions, en toute circonstance, de leur accorder une confiance aveugle là où leur intérêt personnel est en jeu. Napoléon, à Sainte-Hélène, écrivait sa propre apologie; il s'efforçait de présenter ses actes sous leur jour le plus favorable, comme il faisait dans ses bulletins. Ces fameux bulletins représentaient ce que Napoléon désirait que l'on crût, c'est ce que représentent également ses mémoires. C'est la vie de Napoléon mise en bulletins par Napoléon lui-même, rien de plus, rien de moins.
Mais il importe de faire ici une distinction. Quand il écrit ses bulletins, Napoléon a souvent un motif pour tromper. A Sainte-Hélène, son unique but est de servir les intérêts de son fils et de sa dynastie. Lorsque ni son fils ni sa dynastie ne sont en cause, les mémoires méritent créance un peu plus que les bulletins.
Les publications venant de Sainte-Hélène s'amoncellent rapidement les unes sur les autres, et on peut prévoir le moment où la dernière aura vu le jour. Quatre-vingt-quatre années ont passé depuis qu'un public avide absorba, en cinq mois, cinq éditions des lettres de Warden, soixante-dix-huit depuis que les acheteurs du livre d'O'Meara envahissaient les boutiques des libraires. Il est permis de souhaiter que son Journal manuscrit, qui dort quelque part en Californie, puisse être bientôt publié dans son intégrité, car il est, dit-on, plein de détails curieux et originaux et, en même temps, il nous expliquera peut-être les contradictions existantes entre la Voix de Sainte-Hélène et les communications adressées par l'auteur soit à l'Amirauté soit au gouverneur[1]. Ensuite nous avons eu la grosse artillerie de Gourgaud, Montholon et Las Cases—dont les passages supprimés, s'il en existe, pourraient aujourd'hui être donnés au public sans le moindre inconvénient—et la riposte faite à leur feu par la lourde apologie de Forsyth et le résumé, plus effectif, de Seaton. Nous avons eu aussi l'artillerie légère de Maitland et de Glover, de Cockburn, de Santini, sans compter cette folle de miss Betsy, qui devint plus tard Mrs. Abell. Nous possédions les histoires de Sainte-Hélène par Barnes et Masselin et, en 1816, un ancien gouverneur, le général Beatson, profita de l'intérêt soudainement attiré vers ce coin du globe pour lancer à la tête du public un énorme in-4o où les particularités du sol et ses productions étaient exposées avec un luxe et une précision de détails à peine concevables s'il s'était agi de décrire le paradis terrestre. Puis, nous eûmes la tragédie d'Antommarchi, qu'on peut juger comme on voudra. Ensuite, les «commissaires» sont entrés en lice; Montchenu, Balmain, Sturmer nous ont, l'un après l'autre, apporté leur témoignage. M. de Montholon nous a, également, offert le sien. Napoléon lui-même, il faut le dire, avait engagé ses compagnons à recueillir tout ce qu'il disait dans leur journal et, à plusieurs reprises, il a fait allusion au résultat de leur travail. «Hier soir, dit Gourgaud, l'Empereur me disait que je pourrais mettre mes loisirs à profit en écrivant ses paroles; je pourrais gagner ainsi cinq cents ou mille louis par jour.» Il connaissait le journal de Las Cases, qui était dicté à Saint-Denis, l'un des domestiques, ou recopié par lui, et Napoléon interrogeait souvent ce serviteur relativement aux matières contenues dans le journal. On lui lut le récit d'O'Meara. Il était persuadé qu'ils tenaient tous leur journal et ne se trompait pas. Car, à l'exception du fidèle Bertrand et de la compagne qui partageait avec l'Empereur son affection, pas un des acteurs de ce lugubre drame n'a gardé le silence.
Dans ces derniers temps deux nouveaux témoignages ont été mis au jour et on peut dire que si tous deux sont très curieux il en est un qui dépasse en intérêt toutes les révélations antérieures au point de vue de la psychologie de Napoléon. Le Journal de Sainte-Hélène, par Lady Malcolm, contient un récit, très vivant, des conversations de son mari, l'amiral Malcolm, avec Napoléon et un portrait impartial de Lowe qui semble, en somme, tourner à la condamnation de ce malheureux homme, troublé par d'écrasantes responsabilités. Quant à l'autre publication, c'est peut-être le livre qui nous en dit le plus, non seulement sur Napoléon à Sainte-Hélène, mais sur Napoléon à tous les autres moments de sa carrière. C'est le journal particulier de Gourgaud, écrit pour n'être lu que de lui seul, bien que la fin, à ce que les éditeurs semblent croire, ait pu être arrangée en vue du cas où Lowe viendrait à s'en saisir. Mais la plus grande partie du journal ne devait évidemment avoir d'autre lecteur que Gourgaud, car elle ne pouvait plaire à personne, si ce n'est à lui, et encore! La vérité est là, croyons-nous, telle qu'elle se montre jour par jour à l'écrivain. Ce journal jette une clarté singulière sur celui qui l'a écrit, mais combien plus étrange et plus nouvelle sur Napoléon! Quand nous l'avons lu nous nous sentons pris d'un doute en ce qui touche tous les autres récits et nous sentons que ce volume nous rapproche de la vérité vraie plus qu'aucune des publications qui l'avaient précédé.
Car il est une règle, presque absolue, j'en ai peur, qui s'applique à toute cette littérature de Longwood: aucun des livres qui viennent de là, pris en lui-même, ne mérite une confiance entière. Si nous faisions une exception, ce serait certainement en faveur de Gourgaud. On peut faire une autre observation: c'est que ces publications deviennent de plus en plus dignes de foi à mesure que la date de leur apparition s'éloigne des événements. Gourgaud, qui est publié en 1898, est plus vrai que Montholon, qui se publie lui-même en 1847, et Montholon, à son tour, est plus vrai que Las Cases, qui livre ses récits au public en 1823. Le moins croyable de tous, peut-être, est O'Meara dont la publication remonte à 1822. Dans tous ces livres, sauf, peut-être, le plus récent, on trouve des allégations fausses et de grossières inventions. Et pourtant il ne serait pas juste d'accuser tous ces auteurs d'avoir sciemment menti. Bien rarement, jamais peut-être, il n'y a eu chez eux intention de tromper. Tantôt c'est l'idolâtrie de Napoléon qui les inspire, tantôt c'est le désir de garder aux scènes de Sainte-Hélène toute leur puissance d'émotion dramatique et d'amener ainsi la libération de l'Empereur, ils omettent ou dénaturent les faits qui peuvent, en quelque manière, nuire à leur idole ou diminuer l'effet qu'ils veulent produire. Il semble qu'il y eût quelque chose dans l'air de Sainte-Hélène qui empêchait la vérité de s'y acclimater, et celui qui compare, sur un point quelconque, les différents récits, y trouvera d'étranges, d'irréductibles contradictions. Il y a probablement de la vérité qui se cache au fond de Forsyth, mais il faut briser la gangue: triste tâche! Et pour d'autres raisons encore, etc... il est difficile de l'extraire des documents contemporains. Une curieuse moisissure recouvre tous ces récits, comme, dans l'île, elle recouvre les livres et les bottes. On est obligé de peser chaque déposition, grain à grain, particule après particule, en se rappelant toujours ce que vaut le témoin. On nous reprochera peut-être d'avoir puisé plus d'une fois à des sources que nous avons indiquées comme impures. Mais où aurions-nous puisé? Là où le témoignage en lui-même nous a semblé acceptable, toutes les fois qu'il ne nous a pas paru inspiré par un autre intérêt que celui de la vérité, nous avons cru pouvoir citer ces documents, les seuls que nous possédions.
Il reste à faire remarquer une circonstance bien particulière. Des trois dernières années de la vie de Napoléon, nous ne savons presque rien. Rien depuis le départ de Gourgaud en mars 1818 jusqu'à la fin de mai 1821. Nous savons ce que les Anglais ont observé du dehors. Nous avons, à l'intérieur, un rapport autorisé, mais non parfaitement croyable. En réalité, nous ne savons rien, ou presque rien.