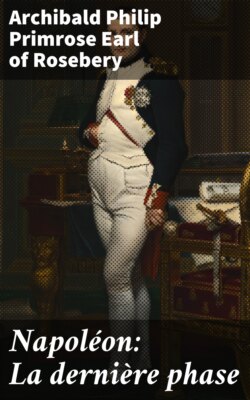Читать книгу Napoléon: La dernière phase - Archibald Philip Primrose Earl of Rosebery - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LAS CASES, ANTOMMARCHI, ETC.
ОглавлениеLe livre de Las Cases, qui est le plus volumineux, et peut-être le plus célèbre, ne manque pas d'un certain charme qui lui est propre. Il parut d'abord en huit volumes, puis il fut abrégé et, sous le titre de Mémorial de Sainte-Hélène, accompagné des originales fantaisies de Charlet, il s'est répandu à travers le monde entier. On dit,—c'est probablement une grosse exagération,—que l'ouvrage n'a pas rapporté à l'auteur moins de 2 millions. Il fut écrit, nous assure-t-on, sous forme de journal, avec l'intention de donner au public un compte rendu parfaitement fidèle des conversations quotidiennes de Napoléon. Mais l'auteur nous déclare qu'une grande partie de ces conversations s'est trouvée perdue, soit parce que le temps a manqué à l'écrivain pour les recueillir, soit par suite des diverses aventures que ses manuscrits ont eu à traverser. Son récit est plein de mouvement, et même d'éloquence. Quand il est corroboré par d'autres témoignages, on peut le considérer comme la reproduction exacte des paroles de l'Empereur, tel qu'il entendait qu'elles fussent rapportées, telles, en tout cas, qu'il les a dictées. Lorsque la confirmation des témoignages étrangers fait défaut, il est impossible de se fier à Las Cases, car, si l'on fait la part de l'exagération habituelle en ce qui touche le régime du prisonnier, la contrainte dont il était l'objet, etc., et si l'on considère, d'un autre côté, l'idolâtrie de l'auteur pour son maître, sentiment qui lui enlevait la nette vision des choses, on comprendra où pèche le Mémorial. C'est un arsenal de documents apocryphes. D'où vient cela? Faut-il s'en prendre à la fertile invention de Las Cases? Napoléon fut-il le complice et l'inspirateur de ces faux témoignages? Impossible de résoudre la question d'une façon décisive. Quoi qu'il en soit, quatre lettres fausses sont imprimées tout au long dans le livre de Las Cases, et il est responsable d'une cinquième qui n'est imprimée nulle part et qui n'a eu, probablement, qu'une existence éphémère.
Le comte Murat, dans son excellent ouvrage: Murat, lieutenant de l'Empereur en Espagne, a établi, par des arguments aussi clairs que péremptoires, la fausseté de la première lettre. Il a prouvé que Las Cases, pour disculper son héros et rejeter les torts sur Murat, a inséré dans le Mémorial une fausse lettre datée du 29 mars 1808. Qui a composé cette lettre? On ne sait, mais qu'elle soit fausse, il n'est pas possible d'en douter, et c'est à Las Cases que revient la responsabilité de l'avoir produite. Le comte Murat accumule des preuves irréfutables. Il fait remarquer l'irrésolution dont cette lettre est empreinte. L'ordre donné à l'armée française de battre en retraite devant les Espagnols lui paraît, comme à nous, en complète opposition avec le caractère de Napoléon. Il appelle notre attention sur les contradictions flagrantes qui existent entre cette lettre et d'autres dépêches,—parfaitement authentiques, celles-là!—de la même époque. Le 27 mars, Napoléon avait écrit à Murat pour lui ordonner de faire un grand déploiement de force à Madrid; dans la fausse dépêche du 29, il condamne jusqu'à sa présence à Madrid. On sait, d'ailleurs, que l'Empereur ne connut l'occupation de Madrid par Murat que le 30. La dépêche n'est pas conçue dans les termes de la correspondance ordinaire de Napoléon avec son beau-frère. Les brouillons, ou minutes, de presque toutes les dépêches de Napoléon existent encore: or on ne possède aucun brouillon de celle-ci.
Dans ses autres dépêches, Napoléon ne fait aucune allusion à la prétendue lettre du 29, et Murat, de son côté, n'en a jamais accusé réception. Le registre détaillé des lettres envoyées et reçues par Murat n'en fait nulle mention. En tous cas, comment cette lettre a-t-elle surgi tout à coup à Sainte-Hélène? Il semble inutile de multiplier les preuves pour démontrer que rarement faux plus audacieux s'est offert à la crédulité publique. Les éditeurs de la Correspondance impériale ne l'impriment qu'avec la rougeur au front, car ils avouent, dans une note, qu'on n'a pu découvrir ni le brouillon, ni la lettre originale, ni aucune copie authentique. Savary, de Beausset et Thibaudeau acceptent la lettre, les yeux fermés, sur l'autorité de Las Cases. Méneval, qui était à cette époque le secrétaire particulier de Napoléon, semble pressentir les doutes du comte Murat et expose certains faits matériels qui ôtent à ce document tout caractère d'authenticité. L'un de ces faits est que la lettre est datée de Paris et que l'Empereur, à ce moment, se trouvait à Saint-Cloud. Méneval se déclare incapable d'éclaircir le mystère, mais toutes ses raisons aboutissent inévitablement à cette conclusion que la lettre est un faux. Son seul argument favorable,—argument bien dangereux,—c'est que Napoléon seul peut avoir composé cette dépêche. L'hésitation de Méneval, lorsqu'on songe à la situation de confiance qu'il occupait auprès de Napoléon, est extrêmement significative, on pourrait dire qu'elle est décisive. Thiers croit que Napoléon a écrit la lettre et qu'il l'a écrite à la date indiquée, mais il admet qu'elle n'a jamais été expédiée. Ses raisons en faveur de cette étrange théorie ne peuvent être examinées ici; mais elles ne paraissent guère autre chose qu'un effort désespéré pour établir l'authenticité du document, en dépit de difficultés écrasantes que, du reste, l'histoire n'a point dissimulées. Montholon l'imprime avec beaucoup d'autres lettres qui lui furent, dit-il, remises par l'Empereur. Cette affirmation nous rend Montholon suspect à son tour. Mais c'est à Las Cases que revient, en fin de compte, la véritable responsabilité. Ce qui est fâcheux pour lui, c'est que, précisément, il était un peu vain de son talent à «composer». Il nous apprend que c'est lui qui a rédigé la protestation de Napoléon à Plymouth. Il en a rédigé d'innombrables pour son propre compte. «Une fois que les rapports épistolaires eurent été établis avec Sir H. Lowe, nous dit-il, avec une ironie très suggestive, ma plume ne chôma guère.» Il fit pleuvoir des documents sur le gouverneur; on le déporta au Cap et là il continua d'écrire. Le gouverneur de cette colonie, les ministres, le Prince Régent, eurent tous à le subir. Revenu en Europe, il bombarda de sa prose tous les souverains et tous les hommes d'État dont le nom lui venait à l'esprit. Enfin, le patient lecteur qui se fraye un chemin à travers ses huit volumes ne peut s'empêcher de penser que rien ne plairait tant à Las Cases que d'improviser quelques lettres de Napoléon pour s'entretenir la main.
Nous ne voudrions pas, sur ce seul exemple, affirmer que Las Cases a forgé la lettre à Murat avec l'intention arrêtée de commettre un faux. Peut-être fut-ce un exercice académique ou peut-être encore a-t-il brouillé les dates ou manqué de mémoire.... On cite dans l'histoire d'autres aventures du même genre. Mais, par malheur, ce n'est pas la seule tentative ou la seule défaillance de Las Cases dans cet ordre d'idées. Dans la cinquième partie de son journal, il donne, dans des conditions à peu près identiques, une lettre de Napoléon à Bernadotte, datée du 8 août 1811. Les éditeurs de la Correspondance impériale la passent sous silence absolument. Elle a été pourtant insérée parmi les Lettres inédites de Napoléon Ier, mais «sous toutes réserves», car les éditeurs en ignorent la provenance. S'ils l'avaient connue, ils l'auraient rejetée sans aucun doute, comme avaient fait les éditeurs précédents. Ils l'empruntent, de seconde main, à Martel, Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte. Martel, qui ne cite point son autorité, l'avait, évidemment, prise à Las Cases.
Dans son sixième volume, Las Cases tire encore de son arsenal occulte et inépuisable un autre document officiel dont il nous gratifie généreusement. Cette fois, c'est une lettre adressée par Napoléon à son frère Louis, roi de Hollande, le 3 avril 1808, du palais de Marrac. Elle porte la même marque de fabrique que les autres. On la voit paraître pour la première fois dans le livre de Las Cases. Aucun brouillon n'en existe: fait dirimant en lui-même. Malheureusement aussi Napoléon n'arriva à Marrac que quatorze jours après le 3 avril. Les éditeurs de la Correspondance font suivre la lettre de cette simple remarque, accompagnée de l'indication significative que «Las Cases est l'unique autorité». M. Rocquain, dans son Napoléon et le roi Louis (p. 166, note), l'écarte sans hésitation, comme étant fausse dans son ensemble, sinon dans toutes ses parties. Nous ne voyons pas de raison pour accepter aucune de ses parties comme authentique et, de son côté, M. Rocquain ne nous en fournit point.
Dans le septième volume il existe une quatrième lettre, de la même espèce. A qui en cherche l'auteur, on peut répondre hardiment: Aut Las Cases, aut diabolus. Ce sont de prétendues instructions destinées à un plénipotentiaire anonyme qui remplit une mission en Pologne; elles sont datées du 18 avril 1812. Les éditeurs de la Correspondance ont laissé de côté cette composition. Elle est, comme à l'ordinaire, produite inopinément par Las Cases, comme une révélation des véritables motifs de l'expédition de Russie. Il paraît que cette guerre désastreuse avait pour but la reconstitution de l'ancien royaume de Pologne. Quand nous nous rappelons qu'à ce moment, alors que la résurrection de la Pologne était l'objet des vœux les plus ardents des Polonais, qu'elle était vivement désirée par l'armée et par quelques-uns des plus dévoués serviteurs de l'Empereur, alors qu'elle était un point essentiel, vital dans ses combinaisons stratégiques et politiques, alors qu'elle lui était manifestement dictée par le sentiment le plus élémentaire d'humanité et de gratitude envers la nation polonaise, Napoléon se refusa énergiquement à cette mesure, nous pouvons juger de la valeur et de l'authenticité d'un pareil document.
Le faux no 5, qu'on ne nous fait pas la faveur de nous montrer, est le plus notable et le plus impudent de tous. Dans un moment d'affectueux abandon, Las Cases tira de ses papiers et exhiba à Warden une lettre du duc d'Enghien, écrite à Napoléon la veille de son exécution et supprimée par Talleyrand dans la crainte qu'elle ne touchât le Premier Consul et ne sauvât la vie du prince. Las Cases paraît avoir eu le monopole de ce document que personne, avant ou après lui, n'a eu la chance d'entrevoir, dont personne, si ce n'est lui, n'a jamais ouï parler. Ses propres déclarations, en ce qui touche l'affaire du duc d'Enghien, sont peut-être ce qu'il y a de plus trouble dans tout son ouvrage. Il fait seulement une allusion timide et brève à la lettre qu'il avait montrée triomphalement à Warden. Le langage de ce dernier est si remarquable qu'il demande à être cité textuellement: «J'ai vu une copie de cette lettre dans les mains du comte de Las Cases. Elle faisait partie, me dit-il, d'une masse de documents, formés ou réunis pour certifier et expliquer certains points obscurs de l'histoire, qu'il était occupé, de temps en temps, à rédiger sous la dictée de celui-là même qui en était le héros.» Suivons un instant les destinées de cette lettre du duc d'Enghien interceptée par Talleyrand et miraculeusement sauvée par Las Cases. Dans les Lettres du Cap, composées, inspirées ou revues par Napoléon, il est question de cette lettre. «L'auteur, y est-il dit, avait eu de fréquentes occasions de parcourir à la hâte des manuscrits du plus grand intérêt, relatifs aux événements mémorables des vingt dernières années; une grande partie de ces manuscrits ont été écrits sous la dictée de Napoléon.» En d'autres termes, Napoléon, auteur des Lettres du Cap, a eu la permission de consulter les manuscrits qu'il a lui-même dictés. Quand le duc d'Enghien était arrivé à Strasbourg, il avait écrit une lettre à Napoléon; il y faisait remarquer que «ses droits à la couronne étaient très éloignés, que, depuis longtemps, sa famille avait perdu le droit de les réclamer, et il promit, si on lui pardonnait, de faire connaître tout ce qu'il savait des complots des ennemis de la France et de servir le Premier Consul avec fidélité. Cette lettre ne fut présentée à Napoléon par Talleyrand que lorsqu'il était trop tard, lorsque le jeune prince n'était plus.» L'auteur continue en disant que, dans le manuscrit qu'on lui avait permis de voir, Napoléon déclarait que, «peut-être, si cette lettre lui eût été remise à temps, les avantages politiques qui auraient résulté de ses déclarations et de ses services auraient engagé le Premier Consul à lui pardonner». Cet extrait est intéressant parce qu'il contient la seule partie de ce curieux document qui ait subsisté jusqu'à nous. Il semble que des bruits relatifs à cette précieuse lettre eussent été répandus à Longwood parmi ceux des membres de la petite colonie qui n'avaient pas été mis dans le secret de Las Cases. Leur curiosité en fut vivement excitée. O'Meara semble s'être tout particulièrement distingué par son esprit de recherche infatigable. En 1817, il se met lui-même en scène, interrogeant l'Empereur sur ce sujet. «Je demandai s'il était vrai que Talleyrand eût gardé une lettre écrite par le duc d'Enghien et ne l'eût remise que deux jours après son exécution. Napoléon répondit: C'est vrai. Le duc m'avait écrit pour m'offrir ses services et me demander un commandement dans l'armée, et ce scélérat de Talleyrand ne m'en donna connaissance que deux jours après l'exécution du duc. J'observai que Talleyrand, en retenant cette lettre d'une manière aussi coupable, s'était réellement chargé de la culpabilité de cette action. L'Empereur répondit: Talleyrand est un briccone, capable de tous les crimes.»
Deux mois plus tard, en mars, O'Meara apprend à Napoléon que Warden a écrit sur lui et publié un livre dont tout le monde s'occupe. Le volume n'était pas encore arrivé à Sainte-Hélène, mais les journaux en donnaient des extraits. Napoléon s'asseoit pour lire les journaux et demande l'explication de certains passages. Sa première question est relative à l'affaire du duc d'Enghien. Qu'a dit là-dessus Warden? «Je répondis, nous raconte O'Meara, qu'il affirmait que Talleyrand avait retenu une lettre du duc longtemps après son exécution, et qu'il attribuait sa mort à Talleyrand. Di questo non c'è dubbio, il n'y a pas de doute là-dessus, répliqua Napoléon.» Plus tard, dans le même mois, Napoléon renouvelle cette déclaration devant O'Meara. «Quand le duc d'Enghien arriva à Strasbourg, il m'écrivit une lettre. Il m'offrait de me faire tout savoir si je lui accordais sa grâce. Sa famille, ajoutait-il, avait renoncé depuis longtemps à ses droits éventuels à la succession. Il terminait en me proposant ses services. La lettre fut remise à Talleyrand qui la tint secrète jusqu'après l'exécution.» Cela paraît assez clair, mais O'Meara voulait une certitude absolue. En avril, il demanda de nouveau à Napoléon si, au cas où Talleyrand lui aurait remis la lettre à temps, il aurait épargné la vie de celui qui l'avait écrite. «Il répondit: Probablement, je l'aurais épargnée, car, dans cette lettre, il s'offrait à me servir. D'ailleurs, c'était le meilleur de la famille.» Il est à remarquer que, bien que Napoléon ait parlé plus d'une fois de l'affaire du duc d'Enghien à Gourgaud, il n'a jamais dit un mot de la lettre devant cet officier dont le sens critique se laissait difficilement convaincre. Enfin la bulle de savon, laborieusement soufflée par Warden, O'Meara et les Lettres du Cap, crève ignominieusement. La lettre s'évanouit et, avec elle, l'accusation portée contre Talleyrand. Nous rentrons dans la vérité historique, grâce à la note bien connue écrite par le duc d'Enghien en marge du procès-verbal de son interrogatoire. C'est à Montholon que revint la tâche de machiner cette curieuse volte-face. Une telle manœuvre, on le comprend, ne pouvait être exécutée avec un plein succès. Mais le pauvre écuyer s'en acquitta d'une façon peu brillante et médiocrement faite pour entraîner les convictions. Il nous dit qu'après le départ d'O'Meara, son journal lui fut confié et qu'il était dans l'habitude de le lire tout haut à Napoléon. L'Empereur remarquait au passage certaines erreurs contenues dans le manuscrit. Quel dommage que Montholon n'ait pas tenu note de ces erreurs! Car l'unique assertion qui soit rectifiée est précisément celle qu'O'Meara avait reproduite solennellement par trois fois d'après le témoignage de l'Empereur en personne. Il faut citer textuellement. «M. O'Meara dit que M. de Talleyrand intercepta une lettre écrite par le duc d'Enghien quelques heures avant le jugement. La vérité est que le duc d'Enghien a écrit sur le procès-verbal d'interrogatoire avant de signer: «Je fais avec instance la demande d'avoir une audience particulière du Premier Consul. Mon nom, mon rang, ma façon de penser et l'horreur de ma situation me font espérer qu'il ne refusera pas ma demande.» C'est là, on le sait, ce que le duc a écrit en effet. Montholon continue ainsi: «Malheureusement l'Empereur n'eut connaissance de ce fait qu'après l'exécution du jugement. L'intervention de M. de Talleyrand dans ce drame sanglant est déjà assez grande sans qu'on lui prête un tort qu'il n'a pas eu.»
Nous regrettons d'avoir à déclarer que nous ne regardons pas cette rectification connue plus authentique que la fameuse lettre du duc d'Enghien, écrite à Strasbourg, pour offrir ses services et solliciter un commandement dans l'armée, lettre que Talleyrand aurait interceptée dans la crainte qu'elle n'amollît le cœur de Napoléon. L'existence et le sens de cette lettre sont clairement exposés par Warden qui a vu la lettre, par Las Cases qui la lui a montrée, par O'Meara qui a questionné trois fois Napoléon à ce sujet, par Napoléon lui-même dans les Lettres du Cap; et le point capital dans l'affaire n'est pas l'appel adressé par le duc à Bonaparte, mais l'infamie de Talleyrand qui l'a empêché d'arriver à sa destination. Warden lança la première affirmation en 1816; les Lettres du Cap suivirent en 1817, O'Meara en 1822, Las Cases en 1824. Enfin, en 1847, trente ans après que le fait avait été, pour la première fois, porté à la connaissance du public, paraît le livre de Montholon. Il y avait longtemps que la fausseté de tout ce récit avait été péremptoirement établie: quantité de brochures explicatives avaient vu le jour. Ce qui n'avait été publié nulle part c'est le document lui-même, si bruyamment annoncé et jamais livré au public. Montholon a donc à se tirer le mieux possible d'un mauvais pas et à se débarrasser comme il pourra d'un mensonge historique qui avait fait long feu. Comme on l'a vu, il imagine une petite mise en scène. Il se montre lisant tout haut le livre d'O'Meara où l'Empereur relève différentes erreurs; Montholon ne cite qu'une seule de ces rectifications, et ce n'est pas une rectification, c'est un démenti pur et simple donné à toute l'histoire et une réhabilitation absolue de Talleyrand. Quant à l'affirmation contenue dans le livre de Warden, affirmation qui sert de point de départ à la conversation de Napoléon avec O'Meara en mars 1817 et aux assertions catégoriques des Lettres du Cap, composées par Napoléon lui-même, Montholon n'y touche pas; il ne peut y toucher. Il est certain que Napoléon n'a pas connu les derniers mots écrits par le duc avant l'exécution, mais ces mots n'étaient ni une lettre écrite de Strasbourg, ni une demande d'emploi dans l'armée française; enfin, Talleyrand n'a intercepté aucun message. Il n'est pas inutile d'observer que le duc d'Enghien, bien loin de solliciter un commandement sous Napoléon, avoua, comme Savary nous l'apprend, qu'il avait demandé à servir dans l'armée anglaise, et c'est cet aveu qui le perdit. Nous admirons le dévouement de Montholon à son maître, mais il nous semble qu'il aurait pu, en abandonnant une position intenable, effectuer sa retraite plus habilement et la couvrir de façon plus plausible.
Quant à Talleyrand, sa conduite dans l'affaire du duc d'Enghien demeure obscure, mais, sur ce point particulier, échappe à l'accusation portée contre lui. Ce qui est singulier et ce qui est malheureux pour Las Cases, c'est que Napoléon a laissé un témoignage, écrit de sa main, qui disculpe entièrement Talleyrand. Méneval a copié dans les annotations marginales écrites par Napoléon sur le livre de Fleury de Chaboulon les lignes suivantes: «Le prince de Talleyrand s'est conduit dans cette occasion comme un fidèle ministre, et jamais l'Empereur ne lui a rien reproché là-dessus.» Ce n'est point ici le lieu de discuter la complicité de Talleyrand dans cette affaire: c'est là une autre question. Mais cette note contredit expressément l'accusation de perfidie que nous discutons en ce moment, et qui est le point important dans le réquisitoire de Las Cases.
Enfin, il ne faut pas oublier de rappeler que Napoléon, à son lit de mort, provoqué par un article d'une revue anglaise qui prenait à partie Savary et Caulaincourt à propos de cet incident, se fit apporter son testament et y ajouta cette phrase: «J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien parce que cela était nécessaire à la sécurité, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français, lorsque le comte d'Artois entretenait, de son aveu, soixante assassins à Paris. Dans une circonstance semblable, j'agirais encore de même.» Voilà, croyons-nous, la vérité, mais non toute la vérité.
Après cela, on ne s'étonnera pas si nous avouons la méfiance profonde que nous inspire «cette masse de documents explicatifs, formés ou ramassés» par Las Cases. Si l'on met à part les diverses protestations, nous ne pouvons nous rappeler une seule lettre citée par Las Cases qui soit véritablement authentique, si ce n'est la lettre d'adieu de Napoléon à Las Cases lui-même. Par une dernière singularité, qui montre quelle fatalité s'attache à toutes les lettres citées dans cet ouvrage, Gourgaud nous donne, de celle-là même, une version toute différente. Pourtant Gourgaud l'a lue dans des circonstances qui auraient dû la graver dans sa mémoire. Le texte de Las Cases, il faut le reconnaître, est appuyé par le témoignage de Lowe et est, indubitablement, le véritable.
D'où sont venus tous ces documents? Quand et où fut réunie cette «masse de documents» destinés à éclairer certains points obscurs du règne de l'Empereur? Faut-il croire qu'à l'Élysée ou à la Malmaison, après Waterloo, Napoléon les détacha à la hâte,—lettre à Louis, lettre à Murat, lettre à Bernadotte,—du milieu de son énorme correspondance? Nous savons qu'il confia alors à son frère Joseph les lettres qu'il considérait comme les plus importantes. Elles étaient insérées dans des volumes reliés. Comment donc se fait-il qu'il eût gardé avec lui ces dépêches détachées dont la valeur était si considérable? Si elles étaient authentiques, Napoléon, seul, aurait pu les remettre à Las Cases. Or Las Cases n'entra dans la confiance de Napoléon que longtemps après l'époque où l'Empereur s'était séparé de ses papiers. D'où proviennent donc ces nouvelles «lettres de la Cassette[2]»? Las Cases pourrait nous le dire, mais il n'en fait rien et personne ne peut nous en instruire à sa place. La seule indication que nous possédions, c'est de Gourgaud que nous la tenons. Parlant de certaines allégations fausses de Warden, il dit que c'est probablement «une partie du journal faux de Las Cases». D'où nous pouvons conclure que Las Cases tenait un journal apocryphe pour l'information des étrangers curieux et du public, et que ce fait était connu des habitants de Longwood.
Nous devons le dire ici avec un profond regret, nous voudrions être sûrs que Napoléon ne savait rien de ces faux. Si nous pouvions fermer les yeux à l'évidence en ce qui touche la main qui a écrit les Lettres du Cap, si nous pouvions seulement considérer ce pamphlet comme un simple ballon d'essai, et non comme l'expression volontaire, réfléchie, définitive de sa pensée, il n'existerait plus de preuve absolument directe et certaine de la culpabilité de l'Empereur. Par malheur, il n'y a pas de doute possible sur la question de savoir qui a écrit les Lettres du Cap. D'ailleurs, Montholon donne la fausse lettre à Murat au cours d'un récit des événements d'Espagne dicté par Napoléon. Dans ce récit, Napoléon s'exprime ainsi: «Le 29 mars, j'écrivis au grand-duc de Berg
comme suit....» et là s'insère la lettre forgée. Donc, si nous en croyons Montholon, Napoléon a affirmé l'authenticité de la lettre. Mais nous n'en croyons pas Montholon. Nous avons rapporté, d'après les chroniques de Sainte-Hélène, l'attitude de Napoléon en ce qui touche le prétendu message du duc d'Enghien, et il nous est bien difficile d'admettre qu'il ait ignoré l'existence de ce document. Las Cases fait pleuvoir sur les pages de son journal des lignes de points qui représentent certains passages des conversations de Napoléon exceptionnellement importants et confidentiels. Dans ces moments-là, il est possible que certaines mystifications aient été préparées, et, si Las Cases a tenu note de ce qui se passait alors entre son maître et lui, il serait intéressant de connaître ce journal secret. Il est difficile de se persuader que l'humble fidèle eût pris de telles libertés avec l'histoire s'il n'avait reçu de son idole quelque signe d'encouragement. Il importe, d'ailleurs, de faire remarquer qu'un officier anglais, à bord du Northumberland, prétend avoir entendu Napoléon dire, en dictant, à Las Cases qu'il avait reçu plusieurs jours après l'exécution du duc d'Enghien les preuves de l'innocence de ce prince et une lettre où il demandait à servir sous le Premier Consul. D'autre part, Thiers, se conformant à l'opinion moyenne de Méneval, déclare positivement que, d'après le style, l'authenticité de la lettre à Murat ne peut être mise en doute. Ce jugement de Thiers, si nous l'acceptons, condamne Napoléon, car personne, aujourd'hui, ne peut croire que la lettre ait été écrite à la date indiquée; mais Thiers n'est pas infaillible. Mettons les choses au pire: est-il admissible que Napoléon ait pu tremper dans une aussi grossière imposture et si facile à démasquer? Il faudrait supposer—ce qui est possible, après tout!—qu'il a consenti à ce qu'on lançât ces mensonges dans le public, sans souci de la postérité ni du jugement de l'histoire, dans l'unique but de produire une impression momentanée en sa faveur, de même qu'aux jours de sa puissance, il lui était arrivé, dit-on, de publier dans le Moniteur des dépêches fausses de ses maréchaux.
Nous ne décidons point, nous ne désirons pas pousser plus avant l'investigation. Notre objet n'est pas de prouver autre chose, sinon qu'il n'est pas possible de se fier à Las Cases. Nous croyons en avoir assez dit pour montrer que tous ces faux forment comme une barre d'illégitimité qui couvre le Journal tout entier et qui rendent impossible de croire aux déclarations de Las Cases, dès qu'il a un intérêt à les produire.
Il devient donc inutile d'appeler l'attention sur certaines inexactitudes de moindre importance et moins artistement mises en œuvre. Par exemple, Pasquier se plaint que Las Cases ait donné un récit de pure fantaisie de l'entrevue qu'il eut, lui, Pasquier, avec Napoléon au moment de sa nomination comme préfet de police. La responsabilité des inexactitudes commises n'appartient probablement pas à Las Cases. Le même Pasquier signale d'autres faits défigurés de la même façon, mais à quoi bon multiplier les exemples?
Nous avons encore un sujet de défiance—quoique beaucoup moins sérieux—contre cet auteur. C'est un faiseur de livres dans toute la force du terme. Jamais il ne manque l'occasion de grossir sa copie. Avec cela, son ouvrage n'est dépourvu ni de charme, ni même de valeur. Car, en beaucoup de cas, il n'a aucun intérêt à servir de complaisant et il rapporte, avec détails, certaines habitudes et certaines opinions de Napoléon que nous ne trouvons point ailleurs. Dans ces cas-là, c'est par l'évidence interne et d'après les vraisemblances que nous sommes mis en mesure de prononcer si le récit est véridique. Et puis, Las Cases est le biographe par excellence, le biographe idéal, celui qui n'oublie jamais un détail, qui ne recule jamais devant le ridicule, et qui, par conséquent, ne refuse pas un moment de gaîté à son lecteur; c'est le Boswell de Napoléon[3]. Il a de magnifiques envolées vers le sublime, au cours desquelles il côtoie de bien près l'autre extrême. Ainsi, le jour où il éprouve une émotion indescriptible en voyant Napoléon se frotter l'estomac. L'Empereur déjeune d'une tasse de café qui lui a fait plaisir: «Quelques moments plus tard il disait, en se frottant l'estomac de la main, qu'il en sentait le bien là. Il serait difficile de rendre mes sentiments à ces simples paroles.»
Un autre jour Napoléon lui dit que quand il parlait à Lowe il était pris d'une telle colère qu'il sentait trembler son mollet gauche. Or, c'était là un de ses plus terribles symptômes et il y avait des années qu'il ne l'avait éprouvé. Toujours à la manière de Boswell, Las Cases raconte que Napoléon l'avait traité de niais, puis l'avait consolé en l'assurant que cette épithète de sa part était toujours un brevet d'honnêteté.
Ailleurs, Las Cases parle avec enthousiasme de l'absence de tout sentiment personnel chez Napoléon. «Il voit les choses tellement en grand et de haut qu'il perd de vue les individus. Jamais on ne l'a surpris en colère contre aucun de ceux dont il a eu tant à se plaindre.» Quand il serait possible, à d'autres points de vue, d'accepter implicitement les récits de Las Cases, cette prodigieuse assertion serait de nature à faire réfléchir.
Les Mémoires de Montholon ressemblent à celui qui les a écrits: un mondain correct et bienveillant. Dans des lettres secrètes aux agents anglais, O'Meara l'accuse d'être un menteur; il devait s'y connaître. Nous ne doutons pas que les Mémoires de Montholon, lorsqu'ils se rapportent à la politique générale de Longwood, ne soient sujets à caution, comme toutes les publications faites moins de trente ans après la mort de Napoléon. Cependant, il est bon de remarquer qu'ils ont paru assez tard, en 1847. Les dates données par Montholon ne sont pas toujours exactes, ce qui ferait croire que ces notes pourraient bien avoir été rédigées à une époque postérieure aux événements qu'elles racontent. Il est à peu près évident que certains passages ont été ajoutés au texte longtemps après le séjour à Sainte-Hélène. Mais sur tous les points, où la réputation de Napoléon et où les souffrances de sa captivité ne sont pas en jeu, on peut lire ces Mémoires avec intérêt. Nous devons également louer le ton de l'ouvrage. Ce ton s'explique par la date de la publication. Le quart de siècle qui s'était écoulé avait calmé bien des passions, apaisé bien des querelles. Gourgaud avait abdiqué ses fureurs et collaboré amicalement avec Montholon à la publication des Mémoires de l'Empereur. Aussi Montholon n'a-t-il pas un mot contre Gourgaud, pas même une allusion indirecte, alors qu'il parle d'un temps où ce porc-épic enragé devait lui rendre la vie insupportable. A la date du cartel que lui avait adressé Gourgaud, il y a un vide de dix jours. Ce silence calculé est-il le résultat d'un remords de conscience? Ou,—chose qui n'a rien d'impossible,—toute cette affaire n'était-elle qu'une comédie? Ou, enfin, après réflexion, jugea-t-on nécessaire de supprimer le passage? Nul ne saurait le dire. Nous penchons vers la dernière hypothèse et nous regrettons, maintenant que le journal de Gourgaud est publié, de ne pas posséder aussi celui de Montholon dans son intégralité. Nous aurions ainsi les deux sons de la cloche. Nous savons qu'il a laissé, en manuscrit, une foule de notes prises d'après des conversations. On en a publié une qui rapporte certain monologue de Napoléon du 10 mars 1819; elle dépasse en intérêt tout ce que contient le livre de Montholon. Il est bien à désirer que le monde connaisse enfin ces notes et qu'elles lui soient livrées sans réserve. Nous aurions là un témoignage historique qui ne serait pas inférieur en intérêt à celui de Gourgaud. Dans le livre tel que nous l'avons aujourd'hui, ce que nous regrettons surtout ce sont les passages qui, manifestement, ont été supprimés, soit par une aveugle adoration pour la mémoire de Napoléon, soit par sollicitude pour les intérêts de son neveu. D'ailleurs, le récit devient insignifiant là où il serait le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire après le départ des autres chroniqueurs, Las Cases, O'Meara et Gourgaud, lorsque nous n'avons plus rien pour satisfaire notre curiosité que les fantaisies d'Antommarchi.
Car, dans les derniers jours, c'est Antommarchi seul qui nous reste et c'est celui de tous qui mérite le moins de confiance. C'était un jeune Corse, non sans quelque mérite comme anatomiste. Il était arrivé à Sainte-Hélène dix-huit mois avant la mort de Napoléon. En sa qualité de Corse, choisi par le cardinal Fesch, il aurait dû être agréable à l'Empereur. Mais il joua de malheur. Plusieurs fois il se trouva absent au moment où Napoléon avait besoin de lui. De plus son illustre malade qui n'avait, du reste, jamais aimé les médecins, le jugeait trop jeune et sans expérience. D'après Montholon, Antommarchi traitait la maladie de Napoléon comme sans importance, ou même comme feinte. Pourtant Montholon parle de lui favorablement. C'était, dit-il, «un excellent jeune homme». On ne lui voit aucune raison pour calomnier Antommarchi. Lorsque Napoléon, en mars 1821, se plaint de sentir, à l'intérieur, des douleurs lancinantes, comme des «coups de canif», causés par l'affreuse maladie dont il mourait, Antommarchi sourit. A sept semaines de la fin, dit Montholon, il est impossible de lui faire comprendre la gravité de l'état de l'Empereur. Il est dominé par la conviction que tout ce que nous lui disons, l'Empereur ou moi, à cet égard, est un jeu politique pour amener le gouvernement anglais à nous rappeler en Europe. Le 20 mars, il déclare, avec un sourire incrédule, que le pouls de Napoléon est dans l'état normal.
Cependant, le 21 mars, il reconnaît que la situation est sérieuse et déclare qu'il aperçoit des symptômes indéniables de gastrite. Là-dessus, Napoléon consent, quoique avec la plus grande répugnance, à prendre une limonade émétisée. Le lendemain donc, un quart de grain de tartre émétique lui est administré dans une boisson. Le malade est pris de nausées violentes et se roule par terre dans d'atroces douleurs. Ce qu'étaient ces douleurs, nous pouvons à peine l'imaginer, nous qui savons de quels horribles ulcères il était rongé. Que dit Antommarchi? Que l'effet a été trop fort, mais que c'est le remède nécessaire. Cependant Napoléon refuse absolument de prendre une nouvelle médecine du même genre. Le lendemain, il ordonne à son valet de lui apporter un verre de limonade; le jeune docteur est en éveil et trouve le moyen d'y jeter une dose de son remède favori. Napoléon sent une odeur suspecte et donne la potion à Montholon qui a, au bout de dix minutes, d'affreux vomissements. Naturellement, l'Empereur entre en fureur, appelle Antommarchi un assassin et déclare qu'il ne le reverra de sa vie.
Depuis quelque temps déjà, le jeune Corse était las de vivre dans la réclusion et d'avoir à soigner un homme en qui il voyait un malade imaginaire. Il passait une grande partie de son temps à Jamestown ou en dehors du domaine, au grand ennui de l'ordonnance dont la mission était de l'accompagner. Enfin, en janvier 1821, il exposa à sir Thomas Reade son intention d'abandonner le service de Napoléon et de quitter l'île. Le 31 de ce mois, il écrit à Montholon qu'il désire retourner en Europe et qu'il sent, avec regret, son impuissance à gagner la confiance de l'Empereur. Napoléon donna immédiatement son consentement par une lettre que Montholon n'a pas tort de trouver «bien dure». Nous en citerons le dernier paragraphe. «Depuis quinze mois que vous êtes dans ce pays, vous n'avez donné à Sa Majesté aucune confiance dans votre caractère moral. Vous ne pouvez lui être d'aucune utilité dans sa maladie, et votre séjour ici quelques mois de plus serait sans objet.» En dépit de cette cruelle phrase, Bertrand et Montholon ménagent un raccommodement, et, le 6 février, Antommarchi reçoit la permission de reprendre son service. Le 23 mars, comme nous l'avons vu, nouvelle scène, et Montholon rapporte que le 31 mars Napoléon persiste à ne pas même permettre qu'on prononce son nom. On lui permet pourtant d'assister le 3 avril à la visite du docteur Arnott. Le 8 avril, il est encore absent lorsqu'on le fait demander et il est informé officiellement que l'Empereur ne le verra plus. Le 9, il va trouver Hudson Lowe pour solliciter la permission de retourner en Europe, vingt-six jours avant la mort de Napoléon. Lowe lui dit qu'il doit en référer au gouvernement. Le 16, Arnott insiste pour que Napoléon consente de nouveau à recevoir Antommarchi. Le 17, l'Empereur dicte une lettre que devait signer Antommarchi. A cette condition expresse, il lui permettait de rester. Ceci avait trait à des indiscrétions et à des plaisanteries qu'on accusait le jeune docteur de s'être permises au sujet des habitudes de son maître. Le 18, il obtient de nouveau l'autorisation d'accompagner Arnott dans la chambre du malade. Le 21, cependant, le médecin anglais visite Napoléon sans qu'il soit présent; et quand, le 29, Montholon veut le faire appeler, Napoléon refuse par deux fois, avec colère. Pendant les cinq premiers jours de mai, qui sont les derniers de la vie de l'Empereur, il lui est permis de veiller dans une chambre voisine de celle où est le malade. Pendant la dernière agonie, toutes les fois qu'il essaye d'humecter les lèvres du mourant, Napoléon le repousse et, du regard, fait signe à Montholon de prendre sa place. Enfin, le 5 mai, Napoléon meurt, et, seul de ses serviteurs, Antommarchi est omis dans son testament.
Pourquoi rappeler si minutieusement toutes ces circonstances?
Pour cette simple raison qu'Antommarchi n'en dit pas un mot dans son livre. Cet ouvrage, au contraire, ne nous parle que du dévouement absolu du médecin et de l'affectueuse gratitude du malade. Ainsi, le jour où Napoléon refusa à deux reprises de le voir, il rapporte que le malade accepta à contre-cœur un de ses remèdes en lui disant: «Je veux que vous jugiez, par ma résignation, de la reconnaissance que je vous porte.» Napoléon, continue le docteur, ajouta des instructions confidentielles au sujet de ses funérailles. Elles devaient avoir lieu à Ajaccio, si Paris était impossible, et, à défaut d'Ajaccio, à Sainte-Hélène, près des sources. Le 26 mars, alors que Napoléon ne veut pas entendre parler de lui, il se représente persuadant à l'Empereur de voir le docteur Arnott. Montholon dit que ce fut le 31 mars que Napoléon consentit pour la première fois à ce qu'on fît venir Arnott, et il ajoute: «Quant à Antommarchi, il persiste à ne pas même permettre qu'on prononce son nom.» Chaque jour Antommarchi rapporte de menus détails, de longues et affectueuses conversations entre son malade et lui. Pas un mot sur la défense d'entrer chez Napoléon, sur le congé méprisant qu'il avait reçu, ou sur ses propres démarches pour quitter Sainte-Hélène. Pourtant, dans les deux volumes qu'il a consacrés à son séjour de dix-huit mois à Longwood, il eût été facile de trouver une place pour y consigner ces incidents. Il est inadmissible que Montholon se soit rendu coupable d'un mensonge gratuit en ce qui le touche. Montholon est bien disposé envers Antommarchi; ses assertions sont d'ailleurs corroborées à la fois par les documents écrits et par le témoignage de Lowe. Non, nous devons prendre le récit d'Antommarchi pour ce qu'il vaut, c'est-à-dire pour très peu de chose. Quant à nous, nous n'acceptons qu'avec la plus grande réserve celles de ses affirmations qui ne sont pas confirmées par d'autres témoignages. Par exemple, comment pourrions-nous croire que, pendant cette période de méfiance et d'aversion, Napoléon lui ait tenu le discours que voici: «Quand je serai mort, chacun de vous aura la douce consolation de retourner en Europe. Vous reverrez, les uns vos parents, les autres vos amis, et moi, je retrouverai mes braves aux Champs-Élysées. Oui, continua-t-il, en haussant la voix, Kléber, Desaix, Bessières, Duroc, Ney, Murat, Masséna, Berthier, tous viendront à ma rencontre: ils me parleront de ce que nous avons fait ensemble. Je leur conterai les derniers événements de ma vie. En me voyant, ils redeviendront tous fous d'enthousiasme et de gloire. Nous causerons de nos guerres avec les Scipions, les Annibal, les César, les Frédéric, etc.» Ces hâbleries, dont le délire seul aurait pu rendre Napoléon capable, sont censées avoir été débitées devant deux auditeurs, Antommarchi et Montholon: Antommarchi, qui était alors en disgrâce, Montholon, qui recueillait alors les moindres mots de son maître, et qui ne dit rien de ces paroles extraordinaires. Nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper: voilà ce que Napoléon n'a jamais dit et voilà ce qu'Antommarchi jugeait que Napoléon aurait dû dire!