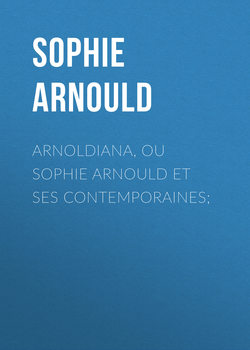Читать книгу Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines; - Arnould Sophie - Страница 2
NOTICE SUR L'OPÉRA
ОглавлениеL'Opéra passe généralement pour le plus étonnant et le plus fastueux des spectacles de l'Europe: c'est dans ce temple, théâtre des brillantes illusions et des illustres galanteries, que le génie, les talens et les grâces se réunissent pour produire le plus magnifique et le plus enchanteur de tous les jeux publics: là de jeunes prêtresses sont formées aux arts aimables qui peuvent émouvoir les sens et les séduire; les unes charment l'oreille en célébrant les louanges des dieux et des déesses; d'autres, par des danses passionnées, en caractérisent les attitudes, en peignent la situation la plus voluptueuse; toutes s'efforcent à l'envi d'allumer dans tous les cœurs ce beau feu, âme de l'univers, qui tour à tour le consume et le reproduit.
Les Italiens sont les premiers qui aient fait jouer des opéras; ils commencèrent à paraître sous le pontificat de Léon X, et l'on prétend que ce fut Ottavio Rinnucini, poëte florentin, qui donna la manière de représenter en musique les ouvrages dramatiques. Sous le règne de Louis XII on composait à la cour des ballets où l'on mettait des récits et des dialogues en plusieurs parties; mais on faisait venir d'Italie les musiciens et les chanteurs. En 1581 le maréchal de Brissac, gouverneur du Piémont, envoya à la reine mère son valet de chambre, surnommé Beaujoyeux, lequel était un bon violon, et qui fit le ballet des noces du duc de Joyeuse avec Mlle de Vaudemont, sœur de la reine. Beaulieu et Salomon, maîtres de la musique du roi, l'aidèrent dans la composition des récits et des airs de ballet; la Chesnaye, aumônier du roi, composa une partie des vers, et Jacques Patin, peintre du roi, travailla aux décorations.
Rinnucini suivit en France Marie de Médicis. Après lui il ne parut que de mauvais ballets, qui consistaient dans le choix d'un sujet bouffon; tel fut celui du ballet des Fées de la forêt de Saint-Germain, dansé au Louvre par Louis XIII en 1625, où Guillemine la quinteuse, Robine la hasardeuse, Jacqueline l'étendue, Alison la hargneuse et Macette la cabrioleuse montrèrent leur pouvoir. La première de ces fées présidait à la musique, la seconde aux jeux de hasard, la troisième aux folies, la quatrième aux combats, et la cinquième à la danse.
En 1651 Pierre Corneille donna, pour le divertissement de Louis XIV, Andromède, tragédie à machines. L'année suivante Benserade composa Cassandre, mascarade en forme de ballet, qui fut dansée par le roi au palais Cardinal.
L'abbé Perrin, de galante mémoire, hasarda des paroles françaises, lesquelles, quoique très-mauvaises, réussirent au moyen de la musique de Cambert, organiste de Saint-Honoré: c'était une pastorale en cinq actes qui fut chantée à Vincennes devant le roi: la nouveauté qu'on y remarqua fut un concert de flûtes.
En 1660 le cardinal Mazarin fit représenter dans la salle des machines des Tuileries, pendant le mariage du roi, Ercole amante, que l'on traduisit en vers français: le roi et la reine y dansèrent; l'abbé Mélany y chanta un rôle; presque tous les acteurs étaient Italiens. Cet opéra était précédé d'un prologue, usage qui a été suivi depuis et qui est maintenant supprimé.
Le marquis de Sourdac, à qui l'on doit la perfection des machines propres aux opéras, donna à ses frais la Toison d'Or, dans son château de Neubourg en Normandie, pour réjouissances publiques du mariage du roi, et ensuite en gratifia la troupe du marais, où elle fut très-applaudie.
Les succès que Pomone, premier opéra français, obtint après avoir été longtemps répété dans la salle de l'hôtel de Nevers, procurèrent à l'auteur, l'abbé Perrin, des lettres patentes pour l'établissement de l'Opéra en France. Les représentations publiques de cette pastorale commencèrent en 1671, dans un jeu de paume de la rue Mazarine. L'abbé Perrin, ne pouvant soutenir seul la dépense d'une telle entreprise, s'associa avec Cambert pour la musique, avec le marquis de Sourdac pour les machines, et pour les principaux frais avec le sieur Champenon, riche capitaliste.
M. de Sourdac, ayant fait beaucoup d'avances et même payé les dettes de l'abbé Perrin, s'empara du théâtre, quitta l'abbé, et prit pour poëte le sieur Gilbert, secrétaire de la reine Christine: les Peines et les Plaisirs de l'Amour, pastorale héroïque, furent son coup d'essai.
Lulli, surintendant de la musique du roi, profitant de cette division, acheta le privilége du sieur Perrin; il prit pour machiniste le signor Vigarini, gentilhomme Modénois, et pour poëte le tendre Quinault; il plaça son théâtre dans un jeu de paume de la rue de Vaugirard, et y donna en 1672 les fêtes de l'Amour et de Bacchus, pastorale composée de fragmens de différens ballets. Dans une des représentations, que le roi honora de sa présence, le prince de Condé, les ducs de Montmouth, de Villeroy, et le marquis de Rassan dansèrent une entrée avec les artistes salariés.
Le Triomphe de l'Amour est le premier opéra dans lequel on introduisit des danseuses. Ce ballet fut d'abord exécuté à Saint-Germain-en-Laye, devant sa majesté, le 21 janvier 1681. Plusieurs princes, seigneurs et dames de la cour y dansèrent. Le mélange des deux sexes rendit cette fête si brillante qu'on crut qu'il était indispensable, pour le succès de ce genre de spectacle, d'y remplacer les dames de la cour par des danseuses de profession, et depuis cette époque elles ont toujours continué d'être une des portions les plus brillantes de l'Opéra.
La réunion de Quinault et de Lulli porta nos opéras à leur plus haut degré de perfection. En 1673, après la mort de Molière, Lulli transporta ses machines à la salle du Palais-Royal, laquelle occupait une partie du terrain où est maintenant la rue du Lycée. Les enfans de Lulli succédèrent à leur père dans la direction de ce spectacle, qui depuis fut confié à différens directeurs et administrateurs.
Un terrible incendie ayant dévoré, le 6 avril 1763, tous les bâtimens de l'Opéra, le duc d'Orléans obtint du roi que la nouvelle salle fût construite à la même place, et l'inauguration s'en fit le 24 janvier suivant. Dans l'intervalle les représentations de l'Opéra eurent lieu sur le théâtre des Tuileries.
Un second incendie consuma, le 8 juin 1781, tout ce qui composait ce riche spectacle; la salle fut réduite en cendres; il n'en resta que les gros murs.
On éleva un nouveau théâtre sur le boulevart Saint-Martin, et, par un prodige presque unique dans les fastes de l'architecture, cette salle fut totalement achevée dans l'espace de six semaines. L'ouverture s'en fit le 27 octobre de la même année.
Mlle Montansier, ancienne directrice de la comédie de Versailles, ayant fait construire en 1793 une vaste salle sur l'emplacement de l'hôtel Louvois, rue Richelieu, le Gouvernement en fit l'acquisition pour l'Opéra, et l'inauguration de ce temple magique eut lieu le 15 juillet 1794.
Le théâtre, créé sous le nom d'Opéra, prit le titre d'Académie royale de musique en 1671; il le garda jusqu'en 1792. Il reçut successivement ceux d'Académie de Musique, d'Opéra national, de Théâtre de la République et des Arts, de Théâtre de l'Opéra, de Théâtre des Arts, et définitivement d'Académie impériale de Musique, qu'il porte actuellement.
Il est certain que le spectacle que nous nommons Opéra n'a jamais été connu des anciens, et qu'il n'est à proprement parler ni comédie ni tragédie. Quoique plusieurs poëtes, en s'unissant à d'habiles musiciens, aient donné de fort beaux opéras, on n'en peut citer qu'un très-petit nombre dans lesquels se trouvent tout à la fois la magnificence des décorations, l'harmonie de la musique, le sublime de la poésie, la régularité de l'action, et l'intérêt soutenu pendant cinq actes.
«L'Opéra, dit Voltaire, est un spectacle aussi bizarre que magnifique, où les yeux et les oreilles sont plus satisfaits que l'esprit, où l'asservissement à la musique rend nécessaires les fautes les plus ridicules, où il faut chanter des ariettes dans la destruction d'une ville et danser autour d'un tombeau, où l'on voit le palais de Pluton et celui du soleil, des dieux, des démons, des magiciens, des monstres, puis des édifices formés et détruits en un clin-d'œil. On tolère ces extravagances, on les aime même, parce qu'on est là dans le pays des fées, et pourvu qu'il y ait du spectacle, une belle musique, de jolies danses, quelques scènes attendrissantes, on est satisfait.»
«Je ne sais, disait La Bruyère, comment, avec une musique si parfaite, une dépense toute royale, l'Opéra a réussi à m'ennuyer.»
«Un opéra, disait l'abbé Desfontaines, est toujours un très-mauvais poëme, et le plus bel ouvrage en ce genre est un monstre.»
Ce spectacle étant plus fait pour le plaisir des yeux et des oreilles que pour celui de l'esprit, tous les arts d'agrément se sont ralliés pour l'embellir, et la danse remplit tellement aujourd'hui les divers actes de nos opéras, que ce théâtre paraît être dressé moins pour la représentation d'un poëme lyrique que pour une académie de danse.
C'est spécialement en cela que l'emporte l'Opéra de Paris sur tous les spectacles de l'Europe. Quelle réunion de talens dans les divers genres! Quelle brillante galerie, si l'on y ajoute cette multitude de filles charmantes qui dans les chœurs et les ballets tapissent les deux côtés du théâtre! Quand on se trouve en cercle avec cette foule d'odalisques on croit être dans le paradis de Mahomet, entouré de houris; ce n'est pas qu'on les jugeât toutes jolies si l'on voulait analiser ces figures; mais la richesse de leurs ornemens, leurs vêtemens voluptueux, leurs coiffures élégantes corrigent ou font disparaître les disgrâces de la nature. En un mot, le désir de plaire donne tant d'activité à ces nymphes agaçantes, qu'on peut difficilement résister à leur séduction. On raconte qu'un capucin, transporté d'un saint zèle, s'écria au milieu de son sermon: Oui, oui, mes chers auditeurs, l'Opéra est le vestibule de l'Enfer!
Ce qui invite tant de femmes à s'évertuer à ce spectacle plus qu'à tout autre, c'est le désir de faire fortune et d'acquérir d'illustres amans, car en fait de chanteuses on observe que les coryphées seuls s'attirent des hommages et des adorateurs; les autres restent dans la médiocrité avec la plus agréable figure. Au contraire, toutes les danseuses réussissent, et il n'en est presque aucune qui n'arrive au spectacle dans un char brillant. On prétend qu'un étranger proposa ce problême à d'Alembert, qui répondit que c'était une suite nécessaire des lois du mouvement.
Cette république lyrique, composée au moins de trois cents personnes, serait bientôt tombée dans le désordre et l'anarchie si quelque magistrat ne veillait constamment sur elle.
Depuis son origine jusqu'en 1790 l'Opéra fut sous la surveillance des gentilshommes de la chambre, et c'était le secrétaire d'état au département de Paris qui en avait la haute police. En 1776 le roi nomma six commissaires pour gouverner ce théâtre avec l'autorité la plus absolue. En 1790 il passa entre les mains de la municipalité. En 1793 les acteurs se chargèrent eux-mêmes de l'administrer, et un an après il fut mis sous une direction de gens de lettres nommés par le ministre de l'Intérieur. Au mois de frimaire an II un arrêté des consuls plaça ces directeurs sous la surveillance et la direction principale de l'un des préfets du palais du Gouvernement. Aujourd'hui c'est le premier chambellan de S. M. l'Empereur et Roi qui est le surintendant de ce spectacle.
Un des anciens priviléges de l'Opéra était de soustraire la jeunesse libertine à l'autorité paternelle ou aux recherches de la police. Il ne fallait avoir que quelques complaisances pour les gentilshommes de la chambre, et sans aucun talent l'administration vous engageait, et cet engagement vous mettait à l'abri des lois. Louis XVI réforma cet abus au commencement de son règne.
Avant l'arrêt de 1776 on entrait librement au foyer des actrices. C'était là qu'elles recevaient les hommages des spectateurs qui s'y rendaient en foule, et chacun pouvait en liberté approcher ces divinités et jouir du coup d'œil séduisant que présentait leur toilette.
C'était là qu'on rencontrait ces aimables roués, êtres sans soucis, se jouant de toutes les femmes en paraissant les adorer; charmans dans un tête à tête, sémillans dans un repas, habiles à raconter l'aventure de la veille, savans dans l'art de bien placer le mot du jour, ils prenaient toutes les nuances du caméléon, et les meilleures sociétés auraient cru manquer d'usage en ne les accueillant pas.
C'était encore là qu'on voyait papillonner ces êtres amphibies, qui n'étaient ni prêtres ni laïcs, connaissant tout, excepté l'étude et la religion, et qui sous le nom d'abbés circulaient dans le monde comme une fausse monnaie.
C'était là enfin qu'allaient et venaient assidûment des milliers de jeunes gens et de vieillards qui seraient demeurés absolument muets s'ils n'avaient eu pour entretien les actrices et les spectacles, les ruelles et les coulisses.
On met en usage dans ce véritable palais d'Armide toutes les ruses que la volupté enseigne pour séduire. Les femmes surtout, convaincues qu'on en impose avec un beau nom, ont grand soin, du moment qu'elles sont initiées, de déposer celui qu'elles ont reçu en naissant pour en prendre de plus conformes à leur nouvelle situation. Cette manie des noms supposés a produit des scènes plaisantes; on a vu plus d'une fois se présenter à la porte de l'Opéra une pauvre journalière couverte de haillons pour réclamer sa fille ou sa nièce, que le jour précédent elle a reconnue dans un brillant équipage, et dont elle a su la profession par un laquais.
Un jeune homme, allant chez une danseuse de l'Opéra, se plaignit de l'impertinence de son portier, et lui dit: – Vous devriez bien chasser ce drôle-là de chez vous. – J'y ai bien pensé, répondit-elle; mais, que voulez-vous, c'est mon père. —
Dans les beaux jours de l'Opéra une jolie actrice se montrait au foyer toute resplendissante de diamans, elle était respectée de ses compagnes en raison de sa robe éclatante, de sa voiture légère, de ses chevaux superbes; il s'établissait même un intervalle entr'elles selon le degré d'opulence; cette nymphe, plus ou moins illustrée par le rang de son amant, recevait avec hauteur celle qui débutait; elle traitait avec les airs d'une femme de qualité le bijoutier et la marchande de modes; le magistrat déridait son front en sa présence; le courtisan lui souriait; le militaire n'osait la brusquer; sa toilette était tous les matins surchargée de nouveaux présens; le Pactole semblait rouler éternellement chez elle. Mais la mode qui l'éleva vient à changer; une petite rivale, qu'elle n'apercevait pas, qu'elle dédaignait, se met insolemment sur les rangs, brille, l'éclipse, et fait déserter son salon. La courtisane superbe, quoique ayant encore de la beauté, se trouve l'année suivante seule avec des dettes immenses; tous les amans se sont enfuis, et quand ses affaires sont liquidées à peine a-t-elle de quoi payer sa chaussure et son rouge.
De toutes les femmes entretenues dix font fortune au bout de quelques années. Que devient le reste? C'est la grenouille qui a profité d'un rayon de soleil pour se reposer sur une belle prairie, et qui se replonge dans son marais.
Voyez Cartou, qui s'est retirée doyenne des chœurs de l'Opéra; elle comptait l'illustre Maurice de Saxe parmi ses conquêtes; elle le suivit au fameux camp de Mulhberg, où elle eut la gloire de souper avec les deux rois Auguste II de Pologne et Frédéric-Guillaume de Prusse, accompagnés des princes leurs fils et leurs successeurs au trône. Cette aimable chanteuse a brillé par ses diamans et ses équipages; elle a donné des fêtes aux beaux-esprits; elle a dit des bons mots qu'on cite encore, et sur la fin de sa carrière un vieux laquais formait toute sa compagnie.
Voyez Gaussin; elle a jeté pendant longtemps le mouchoir à qui elle a voulu: princes, officiers de distinction, graves présidens, sémillans conseillers, auteurs sublimes, fermiers généraux, tout ce monde, aux poëtes près, a contribué à l'enrichir; et cette actrice charmante, qui eût pu comme Rhodope élever une pyramide en se faisant apporter une pierre par chacun de ses amans; cette fille si tendre, vieillie et ruinée, finit par épouser un danseur, qui la rouait de coups, et lui fit faire une rude pénitence de tous les péchés qu'elle avait commis.
Voyez Fel, qui a fait la gloire de l'Académie royale de Musique et du concert spirituel, dont les accens enchanteurs l'ont disputé pendant longtemps à la mélodie du rossignol; elle crut autrefois honorer un souverain en le recevant dans ses bras; elle rendit fou le tendre Cahusac, qui, n'ayant pu l'épouser, alla mourir de chagrin à Charenton. Cette nymphe mangea les revenus de plusieurs provinces, et fut réduite sur la fin de sa carrière à quêter un regard ou à déshonorer son goût.
Voyez Defresne, devenue par spéculation Mme la marquise de Fleury; cette beauté, après avoir été l'entretien de tous les cercles, avoir vu à ses pieds tout ce que la cour et la ville offraient de plus grand; après avoir dissipé la rançon d'un roi, tomba par son inconduite dans une indigence extrême et mourut sans secours, quoiqu'elle laissât deux fils, dont l'un était capitaine de dragons et l'autre d'infanterie, décorés du nom et des armes des Fleury.
Si l'on passait en revue les Laïs anciennes et modernes qui tour à tour ont brillé sur la scène du monde, on formerait un tableau curieux des caprices de la fortune, qui souvent va chercher sous les livrées de la misère la femme qui doit un jour voir à ses pieds les plus grands personnages de l'Etat.
Les courtisanes semblent avoir été plus en honneur chez les Romains que parmi nous, et chez les Grecs que parmi les Romains. Les courtisanes grecques étaient d'autant plus attrayantes qu'aux charmes de la figure, aux attraits d'une coquetterie raffinée, à une parure séduisante, à une élégance recherchée, elles joignaient tous les agrémens de l'esprit, la vivacité, la finesse, la subtilité des réparties; elles assaisonnaient les plaisirs de leur société par tout ce que le sel attique avait de plus piquant. Plusieurs d'entr'elles cultivaient avec succès les belles-lettres et les mathématiques; les plus célèbres sont Aspasie, qui donna des leçons de politique et d'éloquence à Socrate et à Périclès; Laïs, qui tourna la tête à tant de philosophes, et qui compta Aristippe parmi ses amans; Leontium, qui écrivit sur la philosophie, et qui fut tendrement aimée d'Epicure et de ses disciples; Phryné, amante de Praxitèle, et qui fit rebâtir à ses dépens la ville de Thèbes, détruite par Alexandre; Thaïs, qui suivit ce héros dans ses conquêtes, et qui après la mort de son illustre amant se fit tellement aimer de Ptolémée, roi d'Egypte, que ce prince l'épousa; Thargélie, maîtresse de Xerxès, qu'elle aida à faire la conquête de la Grèce, et qui, après avoir longtemps exercé ses talens et ses charmes, termina ses courses en Thessalie, dont elle épousa le souverain.
On peut mettre sur la même ligne l'inimitable Ninon de l'Enclos, l'objet de l'admiration des hommes et de la jalousie des femmes, dont la maison était le rendez-vous de ce que Paris possédait de plus illustre, qui, dans le cours d'une vie de quatre-vingt-dix ans, a vu son pays se renouveler et changer plus d'une fois de goût, sans qu'elle ait jamais cessé d'être de celui de tout le monde, sans paraître jamais différer d'elle-même, et sans ressembler à personne.
Ces aimables enchanteresses, dont la destinée est de faire ou des mécontens ou des ingrats, sont depuis longtemps l'objet de la censure, et nos théâtres, destinés à être l'école des mœurs, sont devenus celle de la galanterie. Mais n'est-ce que sur la scène que les chances heureuses du vice dégoûtent un sexe fragile des hasards de la vertu? Combien dans nos cercles les plus austères de Lucrèces, qui, plus adroites que sages, sous le voile de la pudeur, qui n'est pas toujours celui de l'innocence, ne pourraient pas soutenir devant le crédule Hymen l'épreuve de Tutia, qui, se voyant accusée de n'avoir pas bien gardé son feu sacré, s'engagea pour sa justification à porter de l'eau dans un crible!