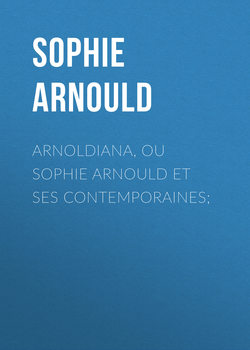Читать книгу Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines; - Arnould Sophie - Страница 3
NOTICE SUR SOPHIE ARNOULD
ОглавлениеSophie Arnould naquit à Paris le 14 février 1740. Son père tenait rue des Fossés-S. – Germ. – l'Auxerrois une vaste hôtellerie, connue sous le nom d'hôtel de Lisieux1. Il avait cinq enfans, deux garçons et trois filles; Sophie était l'aînée de celles-ci. L'aisance dont jouissait M. Arnould lui permit de donner à sa famille une éducation soignée; ses demoiselles eurent différens maîtres, notamment de musique et de chant, ce qui décida la vocation de deux d'entr'elles2.
Sophie Arnould annonça de bonne heure les plus heureuses dispositions. La beauté de sa voix engagea sa mère à la conduire dans quelques communautés, où elle chantait les leçons de ténèbres. Un jour qu'elle était allée au Val-de-Grâce la princesse de Modène, qui y faisait sa retraite, entendit les accens mélodieux de la jeune cantatrice; elle voulut la connaître, et, enchantée de ses grâces et de son amabilité, elle l'honora bientôt de sa protection.
Sophie Arnould joignait à une figure gracieuse un son de voix qui ravissait et une sensibilité qu'elle savait communiquer à tous ceux qui l'écoutaient; sa taille était moyenne et bien prise; elle avait surtout des yeux superbes, et l'ensemble de ses traits lui donnait une de ces physionomies heureuses qui flattent et plaisent au premier aspect.
M. de Fondpertuis, intendant des menus, l'ayant entendue chanter, eut le désir de la faire entrer dans la musique de la reine. Il en parla à Mme de Pompadour, qui la fit demander. Sophie alla chez la favorite avec sa mère, et ne démentit point dans cette épreuve la réputation brillante qu'elle s'était acquise. Mme de Pompadour la combla d'éloges et dit à ceux qui l'entouraient: «Cette jeune personne fera quelque jour une charmante princesse.» Mme Arnould, qui craignait que les talens de sa fille ne lui fissent jouer un trop grand rôle, répondit à la marquise: «Je ne sais, madame, comment vous l'entendez; ma fille n'a point assez de fortune pour épouser un prince, et elle est trop bien élevée pour devenir princesse de théâtre.» Cependant cette bonne mère céda aux insinuations de quelques amis, et consentit à ce que Sophie fût mise sur l'état de la musique du roi. Cet engagement n'était qu'un prétexte pour attirer Sophie sur un plus grand théâtre, et lui faire parcourir une carrière digne de ses rares talens. MM. Rebel et Francœur, surintendans de la musique du roi, la sollicitèrent secrètement d'entrer à l'Opéra. Cette jeune virtuose, subjuguée par tous les prestiges qui l'environnaient, consentit facilement à cette proposition, et bientôt après on lui envoya un ordre de début pour l'Académie royale de Musique. Cet événement imprévu affligea vivement Mme Arnould; elle gémit sur la destinée de sa fille, et, plus jalouse de son bonheur que de sa gloire, elle eût préféré la voir couler des jours purs et tranquilles au sein d'une heureuse obscurité. Elle voulut alors mettre Sophie au couvent; mais une autorité supérieure la força d'obéir. Tout ce qu'elle put faire pour préserver sa chère Sophie des dangers auxquels l'exposaient sa jeunesse et ses charmes, fut de la surveiller sans cesse; elle la conduisait elle-même à l'Opéra, l'attendait dans une loge et la ramenait chez elle quand son rôle était fini.
Sophie Arnould débuta à l'Académie royale de Musique le 15 décembre 1757, et fut reçue l'année suivante. Elle parut aux yeux des connaisseurs l'actrice la plus naturelle, la plus onctueuse, la plus tendre qu'on eût encore vue. Elle est sortie telle des mains de la nature, et son début a été un triomphe3.
A cette époque un jeune seigneur, épris de belle passion pour Sophie, forma le projet de la soustraire à la surveillance maternelle et de la faire jouir de l'indépendance de toutes ses compagnes de l'Opéra. La chose était difficile; mais l'amour est ingénieux; les obstacles l'irritent, et tout finit par lui céder. Le comte de L. usa d'un stratagême dramatique; il déguisa son rang et sa fortune, se fit passer pour un poëte de province qui venait à Paris faire jouer une tragédie, et, sous le nom de Dorval, prit un logement à l'hôtel de Lisieux. Son esprit et sa courtoisie le firent bientôt remarquer; il enivra Mme Arnould de complimens flatteurs, et séduisit Sophie par les plus brillantes promesses; une ancienne gouvernante aida les deux amans à briser leurs entraves, et un soir d'hiver, à la suite d'une lecture larmoyante qui avait obscurci les yeux de toute la famille, Dorval et Sophie disparurent.
Cet enlèvement fit beaucoup de bruit; Mme de L. était généralement estimée, et l'on blâmait hautement l'infidélité de son mari. Il cherchait à se justifier auprès de l'abbé Arnauld en lui faisant l'éloge de sa maîtresse: – Avez-vous tout dit? répondit l'abbé. Mettez le mépris public dans l'autre côté de la balance. – Le comte lui sauta au cou: – Mon cher abbé, s'écria-t-il, je suis le plus heureux des hommes; j'ai tout à la fois une femme vertueuse, une maîtresse charmante et un ami sincère. —
Sophie Arnould se distingua bientôt par de grands talens, et l'on fut étonné de voir sur la scène de l'Opéra, où jusqu'alors on n'avait presque aperçu que des mannequins plus ou moins bien exercés, une actrice remplie de grâces et de sensibilité, qui offrait la réunion touchante et nouvelle d'une voix charmante au mérite rare d'un jeu vrai et puisé dans la nature.
Cette femme célèbre a excité l'enthousiasme des amis de la musique et de l'art dramatique pendant tout le temps qu'elle est restée au théâtre. Dorat, dans son poëme de la Déclamation, a célébré cette voix retentissante dans le fracas des airs, ces sons plaintifs et sourds, et tout l'intérêt qu'inspirait cette grande actrice lorsqu'elle offrait Psyché mourante aux spectateurs attendris. Mais c'est dans Castor et Pollux qu'elle déployait tout ce que l'âme la plus tendre peut produire de sentiment: un jour qu'elle venait de remplir le rôle de Thélaïre elle se donnait beaucoup de peine pour prouver à Bernard qu'il en était l'auteur, car ce poëte sur la fin de sa vie avait perdu la mémoire et presque la raison; enfin il dit, sortant comme d'un rêve: «Oui sans doute, Castor est mon ouvrage, et Thélaïre est ma gloire.»
Ce n'est pas seulement comme actrice que Sophie Arnould s'est fait connaître; son nom est placé à côté de celui de Fontenelle et de Piron, si connus par leurs saillies piquantes. Douée d'une imagination vive et folâtre, elle brillait surtout dans les à-propos, et répandait avec autant de facilité que de grâces les bons mots, les fines plaisanteries, et malgré la causticité de quelques sarcasmes, elle sut se conserver de nombreux amis.
On lui a reproché de faire de l'esprit en y mêlant celui des autres; elle passait surtout pour médisante, et ses camarades mêmes éprouvèrent plus d'une fois ses railleries; mais comme elle n'était ni tracassière, ni haineuse, ni jalouse, ni intrigante, on s'amusait des jeux de son esprit en louant les qualités de son cœur.
Quelquefois on lui rendait les traits piquans qu'elle lançait aux autres: ses dents étaient vilaines, et les moins clairvoyans pouvaient aisément s'en apercevoir; un jour elle disait, en parlant de sa franchise, qu'elle avait le cœur sur les lèvres: «Je ne suis pas surpris, lui répartit Champcenetz, que vous ayez l'haleine si perfide.»
En 1763, époque où la jeunesse, l'esprit et les grâces de Sophie Arnould attachaient à son char l'élite de la cour et de la ville, Dorat lui consacra une longue épître; Bernard, Laujeon, Marmontel, Rulhières et autres poëtes l'ont également chantée. Favart, subjugué par sa voix ravissante, a fait pour elle le madrigal suivant:
Pourquoi, divine enchanteresse,
Me troubles-tu par tes accens?
Tu me fais sentir une ivresse
Qui ne va pas jusqu'à tes sens.
Peut-être que dans ma jeunesse
Mon bonheur eût été le tien:
Je t'aime, et le temps ne me laisse
Que le désir… Désir n'est rien.
Ah! tais-toi; mais non, chante encore;
Qu'avec tes sons voluptueux
Mon reste d'âme s'évapore,
Et je me croirai trop heureux.
Garrick, célèbre acteur et directeur d'un des théâtres de Londres, fit alors un voyage à Paris; il visita tous les spectacles, et lia connaissance avec les principaux acteurs. Mlles Clairon et Arnould furent, dit-on, les deux seules actrices dont il admira les talens.
Une philosophie naturelle, qu'elle dut à ses réflexions plus qu'à son éducation, lui fit rechercher la société des hommes les plus célèbres, dont elle vécut entourée. D'Alembert, Diderot, Duclos, Helvétius, Mably, J. – J. Rousseau et beaucoup d'autres ont eu avec elle des rapports plus ou moins intimes; c'est en vivant avec eux, c'est en lisant leurs ouvrages qu'elle se préparait un automne heureux et tranquille.
Son printemps fut embelli de tous les charmes que la fortune et la beauté peuvent procurer; émule de Ninon de Lenclos, elle vit sur ses pas les hommes les plus aimables et les plus spirituels. Ses talens et son esprit lui ont mérité le surnom d'Aspasie de son siècle, de même que son modèle avait reçu celui de moderne Leontium.
Dans le cours de sa brillante carrière, à une époque où la galanterie française était portée au plus haut degré, il eût été difficile à Sophie Arnould de résister aux séductions qui l'entouraient; on lui a connu plusieurs amans; mais elle a toujours conservé pour le comte de L., le premier et le plus doux objet de son cœur, un attachement tendre et soumis, que l'ascendant qu'il avait pris sur elle fortifiait sans cesse: ils vivaient ensemble comme certains époux; les infidélités de l'un motivaient celles de l'autre; mais Sophie y mettait plus de mystère, et sauvait les apparences autant qu'elle le pouvait. Le comte de L. ne pouvait faire un choix plus analogue à ses goûts, et ses amours, ses bouderies, ses ruptures et ses raccommodemens forment un long épisode dans la vie de cette actrice.
En 1761 M. de L. ayant fait un voyage à Genève pour consulter Voltaire sur une tragédie d'Electre de sa façon, Sophie, excédée de la jalousie de son amant, profita de son absence pour rompre avec lui. Elle avait renvoyé à Mme de L. tous les bijoux dont lui avait fait présent son mari, même le carrosse, et dedans deux enfans qu'elle avait eus de lui; elle s'était tenue cachée pour se soustraire aux fureurs d'un amant irrité; elle s'était même mise sous la protection du comte de Saint-Florentin, dont elle avait imploré la bienveillance. On ne peut peindre le désespoir où cette rupture avait jeté M. de L.; tout Paris était inondé de ses élégies; enfin, à la fougue d'une passion effrénée ayant succédé le calme de la raison, il s'était livré aux sentimens généreux qui devaient nécessairement reprendre le dessus dans un cœur comme le sien. Une entrevue avait eu lieu entre sa maîtresse et lui; il avait poussé la grandeur d'âme au point de lui déclarer qu'en renonçant à elle il n'oubliait pas ce qu'il se devait à lui-même, et lui envoyait en conséquence un contrat de deux mille écus de rentes viagères. Sur le refus de Sophie, Mme de L. était intervenue, et avait sollicité l'actrice sublime de ne point refuser un bienfait auquel elle voulait participer elle-même: elle lui avait déjà fait dire qu'elle prendrait soin de ses enfans comme des siens propres.
Sophie, pour se distraire d'une passion qui faisait le tourment de sa vie, avait passé dans les bras de M. Bertin, nouvelle victime de l'infidélité de Mlle Hus, actrice du théâtre Français. Le trésorier des parties casuelles crut trouver dans Sophie ce qu'il cherchait depuis si longtemps; il n'épargna rien pour mériter la bienveillance de sa nouvelle maîtresse; tout fut prodigué; mais l'excès de sa générosité ne put triompher d'une passion mal éteinte: l'amant tyrannique régnait au fond du cœur; ses écarts disparurent; on oublia ses torts, et l'amour réunit deux amans qui, plus épris que jamais l'un de l'autre, présentèrent un événement qui fit l'entretien de tout Paris. L'infortuné Bertin, aussi honteux de sa tendresse que piqué du changement de sa conquête, tomba dans le plus cruel désespoir.
Ce raccommodement fit moins d'honneur à la constance des deux personnages que de tort à leur bonne foi. M. Bertin avait payé les dettes de la belle fugitive, il avait marié sa sœur, et dépensé pour elle plus de vingt mille écus: il eût fallu pour conserver l'héroïne que l'amant en faveur eût remboursé à l'amant disgracié les frais considérables que lui avaient occasionnés ses nouvelles amours; mais à cette époque la générosité financière s'étendait si loin, on en cite des traits de prodigalité si merveilleux, qu'il semble que le Pactole coulait chez les traitans.
M. de L. lut en 1763, à l'assemblée de l'Académie des Sciences, dont il était membre, un mémoire sur l'inoculation, dans lequel il improuvait l'arrêt du Parlement sur cette matière. Ce seigneur fut en conséquence arrêté par ordre du roi, et conduit à la citadelle de Metz.
Sophie, ennuyée de l'absence de son amant, saisit l'instant de la sensation très vive qu'elle avait faite à la cour en jouant le rôle de Céphise dans l'opéra de Dardanus; elle se jeta aux pieds du duc de Choiseul, et demanda dans cette posture pathétique le rappel du proscrit. Le cœur du ministre galant s'émut; il se prêta de la meilleure grâce du monde à des instances si tendres. M. de L. rendit hommage de sa liberté à son auteur; il lui consacra les premiers jours de son retour, et pour ne point troubler ses plaisirs Mme de L. se retira au couvent.
Mlle Heynel, célèbre danseuse de Stutgard, dont on a tant prôné le succès prodigieux, produisit en 1768 une merveille plus grande encore. Ses charmes subjuguèrent M. de L. au point de lui faire oublier ceux de Sophie; il donna pour cadeau à l'allemande soixante mille livres, et quinze mille à un frère qu'elle aimait beaucoup; il ajouta un ameublement exquis, un équipage complet et un assortiment de bijoux. On estime que la première avait coûté plus de cent mille livres à ce magnifique seigneur: Mlle Heynel ne s'était jugée modestement qu'à mille louis.
En 1769 Sophie, étant à Fontainebleau, manqua si essentiellement à Mme Dubarry, qu'elle s'en était plainte au roi; Sa Majesté avait ordonné que cette actrice fût mise pour six mois à l'hôpital; mais la favorite, revenue bientôt à son caractère de douceur et de modération, demanda elle-même la grâce de celle dont elle avait désiré le châtiment, et sacrifia sa vengeance personnelle aux plaisirs du public, qui aimait cette actrice. Le roi eut de la peine à se laisser fléchir; il fallut toutes les grâces de sa maîtresse pour retenir sa sévérité. Les camarades de Sophie, trop souvent en butte à ses sarcasmes, profitèrent de l'occasion pour s'en venger, et répandirent avec une charité merveilleuse son aventure de Fontainebleau; et lorsque cette actrice paraissait parmi elles on lâchait toujours un petit mot d'hôpital, ce qui humiliait beaucoup cette superbe reine d'opéra.
Sophie voulut se retirer cette année-là; mais on lui refusa la gratification extraordinaire de mille livres, attendu la fréquence de ses absences, ses incommodités et ses caprices continuels, qui l'empêchaient de jouer les trois quarts de l'année. On lui démontra que chacune de ses représentations coûtait plus de cent écus à l'administration; elle se jugea au-dessus de tous les calculs, et parut décidée à quitter le théâtre.
L'annonce de cette retraite mit l'Opéra dans une grande agitation. Des personnes de la cour du plus haut parage se mêlèrent du raccommodement; on engagea les directeurs à pardonner les écarts de cette aimable actrice, et celle-ci à faire soumission aux premiers. Toute cette intrigue demanda beaucoup de temps, de prudence et de soins; enfin on vint à bout de réunir les personnages, et Sophie consentit à rester.
Le comte de L., dont le fond de gaieté inépuisable était merveilleusement secondé par son imagination, fit quelques voyages en Angleterre. Après avoir diverti Londres il voulut amuser Paris de ses plaisanteries ingénieuses, et l'on en cite plusieurs qui furent trouvées charmantes. A son retour dans la capitale il continua de voir Sophie comme la plus tendre de ses amies. Au mois de février 1774 il forma une assemblée de quatre docteurs de la Faculté de Médecine, appelés en consultation. La question était de savoir si l'on pouvait mourir d'ennui: ils furent tous pour l'affirmative, et après un long préambule, où ils motivaient leur jugement, ils signèrent dans la meilleure foi du monde. Croyant qu'il s'agissait de quelque parent du consultant, ils décidèrent que le seul remède était de dissiper le malade en lui ôtant de dessous les yeux l'objet de son état d'inertie et de stagnation.
Muni de cette pièce en bonne forme, le facétieux seigneur courut la déposer chez un commissaire, et y porta plainte en même temps contre le prince d'Hénin, qui, par son obsession continuelle autour de Mlle Arnould, ferait infailliblement périr cette actrice, sujet précieux au public, et dont en son particulier il désirait la conservation. Il requérait en conséquence qu'il fût enjoint audit prince de s'abstenir de toutes visites chez elle jusqu'à ce qu'elle fût parfaitement rétablie de la maladie d'ennui dont elle était atteinte, et qui la tuerait, suivant la décision de la Faculté… Cette plaisanterie un peu forte brouilla plus que jamais ces deux rivaux; ils se battirent, et le prince n'en continua pas moins ses visites chez Sophie, qui, pour le dédommager, finit par lui accorder ses bonnes grâces4.
Dans ces temps de débordement les filles de spectacles se livraient aux goûts les plus condamnables. Sophie, se trouvant compromise dans quelques scènes scandaleuses qui entachaient sa réputation, voulut par un piége adroit détromper le public; un émule de Vitruve la seconda, et Paris fut bientôt instruit d'un prétendu mariage de l'architecte B. avec Mlle Arnould; mais elle négligea de conserver la renommée de cet hymen supposé, et répondit à ceux qui lui reprochaient de bonne foi de s'en tenir à un simple architecte après avoir vécu avec les plus grands seigneurs: «Je n'avais rien de mieux à faire pour employer les pierres qu'on jette de tous côtés dans mon jardin.»
Sophie eut ensuite la fantaisie d'être dévote; sa mauvaise santé affaiblissait sa philosophie, et l'avenir parfois l'effrayait. Deux directeurs à rabat voulurent s'emparer de sa conscience: «O ciel! s'écria-t-elle, c'est encore pis que des directeurs d'opéra.»
Il parut alors une caricature représentant Mlle Arnould aux pieds de son confesseur, et derrière cet homme était Mlle R., qui se désolait; au bas on lisait ces vers:
Ne pleurez point, jeune R***;
Arnould, courtisane prudente,
En quittant l'arène galante
Garde une réserve à l'amour.
La fortune, qui jusque-là avait souri à Mlle R., lui fit éprouver ses disgrâces; l'essor brillant qu'elle avait pris, ses goûts et ses folies occasionnèrent un déficit énorme dans ses finances, et cette actrice, poursuivie par ses créanciers, fut obligée de s'expatrier; enfin l'affaire s'arrangea, les dettes furent payées, et Fanny revint à Paris, où ses talens lui valurent la réception la plus flatteuse.
Sophie, après avoir été quelque temps brouillée avec Mlle R., se rapprocha d'elle, et le comédien F. entra pour beaucoup dans le raccommodement. Cette société, tout en s'aimant beaucoup, ne renonçait point aux gaietés piquantes et saugrenues qui se présentaient. Une Dlle V., amie de Sophie, étant accouchée, fit prier cette dernière d'être la marraine de son enfant, et la proposition fut acceptée: il fallait un parrain; l'accouchée crut faire sa cour en proposant F.; Sophie répondit qu'elle ne le connaissait pas le jour. En remplacement on parla d'A. M., gendre de Sophie: «C'est, reprit-elle, un ennuyeux qui ressemble à ces vieux laquais qu'on appelle la Jeunesse.» Cette épigramme écarta encore le second parrain projeté. Enfin Sophie, après avoir réfléchi, dit: «Nous allons chercher bien loin ce que nous avons sous la main; le parrain sera Fanny;» mais comme un tel parrain ne pouvait passer, elle employa à la cérémonie son fils Camille.
Mlle Arnould se nommait Madeleine; mais elle préférait celui de Sophie, qu'elle avait choisi comme plus agréable et plus noble: c'est sous ce nom que tous ses amis la fêtaient. Voici des couplets qui lui furent adressés par A. M. avant qu'il n'entrât dans sa famille:
AIR: Qui par fortune trouvera Nymphe dans la prairie
Amis, célébrons à l'envi
La fête de Sophie;
Que chacun de nous réuni
La chante comme amie.
Nous ne pouvons lui présenter
De fleur plus naturelle
Qu'en nous accordant pour chanter:
C'est toujours, toujours elle!
Si quelqu'un parle d'un bon cœur,
On cite alors Sophie;
Si l'on décerne un prix flatteur,
Elle est encore choisie;
Si quelqu'un trouve à l'Opéra
Grâce et voix naturelle,
Cet éloge désignera
C'est toujours, toujours elle.
En vain l'Envie aux triples dents
Voulut blesser Sophie;
Elle répand que ses talens
Semblent rose flétrie:
Mais elle parut dans Castor
Si touchante et si belle,
Que chacun,s'écria d'accord:
C'est toujours, toujours elle!
Le Temps cruel, qui détruit tout,
Respectera Sophie;
Par son pouvoir le dieu du goût
Prolongera sa vie.
Le charme de ses doux accens
Nous la rendra nouvelle;
On répétera dans vingt ans:
C'est toujours, toujours elle.
On avait donné à l'abbé Terray le sobriquet de grand Houssoir, nom qui convenait assez à sa figure et à sa besogne; il houssa terriblement les fermes au renouvellement du bail de 1774. Les nouvelles croupes et les intérêts qui furent donnés à la famille Dubarry et aux créatures du contrôleur général des finances firent beaucoup crier les traitans. On dit à Sophie Arnould qu'elle avait une croupe dans le nouveau bail des fermiers généraux, et l'on fit circuler sous son nom la lettre suivante, adressée à l'abbé Terray.
Monseigneur,
«J'avais toujours ouï dire que vous faisiez peu de cas des arts et des talens agréables; on attribuait cette indifférence à la dureté de votre caractère. Je vous ai souvent défendu du premier reproche; quant au second, il m'eût été difficile de m'élever contre le cri général de la France entière; cependant je ne pouvais me persuader qu'un homme aussi sensible aux charmes de notre sexe pût avoir un cœur de bronze. Vous venez bien de prouver le contraire; vous vous êtes occupé de nous au milieu des fonctions les plus importantes de votre ministère. Forcé de grever la nation d'un impôt de 162 millions, vous avez cru devoir en réserver une partie pour le théâtre lyrique et les autres spectacles; vous savez qu'une dose d'Allard, de Caillaud, de Raucourt est un narcotique sûr pour calmer les opérations que vous lui faites à regret. Véritable homme d'état, vous en prisez les membres suivant l'utilité dont ils sont avec vous. Le gouvernement fait sans doute en temps de guerre grand cas d'un guerrier qui verse son sang pour la patrie; mais en temps de paix le coup d'œil d'un militaire mutilé ne sert qu'à affliger; il faut au contraire des gens qui amusent; un danseur, une chanteuse sont alors des personnages essentiels, et la distinction qu'on établit dans les récompenses des deux espèces de citoyens est proportionnée à l'idée qu'on en a. L'officier estropié arrache avec peine et après beaucoup de sollicitations et de courbettes une pension modique; elle est assignée sur le trésor royal, espèce de crible sous lequel il faut tendre la main avant de recueillir quelques gouttes d'eau. L'acteur est traité plus magnifiquement; il est accolé à une sangsue publique, animal nécessaire qu'on fait ainsi dégorger en notre faveur de la substance la plus pure dont il se repaît. C'est à pareil titre sans doute, monseigneur, c'est à la profondeur de votre politique que je dois attribuer le prix flatteur dont vous honorez mon faible talent. Vous m'accordez, dit-on, une croupe; mais c'est une croupe d'or; vous me faites chevaucher derrière Plutus. Je ne doute pas que, dressé par vous, il n'ait les allures douces et engageantes; je m'y commets sous vos auspices, et cours avec lui les grandes aventures.
«Je suis avec un profond respect,
«MONSEIGNEUR,
«Votre, etc.»
Paris, 4 janvier 1774.
Quelle que soit l'authenticité de cette pièce, il est certain que Sophie obtint du contrôleur général, peu de jours avant la mort de Louis XV, un intérêt sur les fermes valant sept mille livres de rente.
Se trouvant à la vente de M. Randon de Boisset, elle porta au double pour première enchère le prix mis par le crieur au buste de Mlle Clairon. L'admiration ferma la bouche à tous les amateurs; on eût rougi de disputer à Mlle Arnould le prix du sentiment; le buste lui resta. Ce fut une espèce de couronne qui lui fut décernée au milieu des applaudissemens de toute l'assemblée, et ce moment a été consacré par le quatrain suivant, qu'un anonime lui envoya sur-le-champ:
Lorsqu'en t'applaudissant, déesse de la scène,
Tout Paris t'a cédé le buste de Clairon,
Il a connu les droits d'une sœur d'Apollon
Sur un portrait de Melpomène.
Sophie Arnould, malgré ses talens, étant devenue en 1776 presque inutile aux directeurs de l'Opéra, ces messieurs, pour exciter son zèle, lui proposèrent de ne plus l'appointer et de lui payer une somme convenue chaque jour qu'elle paraîtrait; elle se fâcha, et menaça de donner sa démission: ce terme était alors devenu à la mode parmi les grands personnages de théâtre.
On donnait un soir un concert dans un appartement du Palais-Royal ayant vue sur le jardin; beaucoup de promeneurs écoutaient: Sophie, malgré son timbre affaibli, s'avisa de chanter un air d'Iphigénie; tout à coup une voix s'élève, interrompt ses chants par des sons lugubres, et fait entendre ces paroles, qu'une divinité infernale adresse à Alceste dans le dernier acte de cet opéra:
Caron t'appelle; entends sa voix.
La cantatrice fut abasourdie, et depuis ce moment, dès qu'elle paraissait en public, des gens charitables ne manquaient pas de fredonner l'air d'Alceste.
Quelque temps après elle reçut une leçon aussi forte et plus désagréable encore; jouant Iphigénie, elle disait à Achilles:
Vous brûlez que je sois partie.
Le parterre lui appliqua ce vers, et se mit à battre des mains. Elle fut d'ailleurs souvent maltraitée dans ce rôle, malgré la présence de la reine, qui la protégeait et qui l'applaudissait.
Sophie Arnould ayant perdu sa belle voix, son grasseyement, autrefois l'un des charmes de sa jeunesse, devint si désagréable qu'elle cessa tout à fait de plaire au public. L'abbé Galiani se trouvant au spectacle de la cour, on lui demanda son avis sur la voix de Mlle Arnould: – C'est, dit-il, le plus bel asthme que j'aie entendu. – Enfin Sophie céda aux sages conseils de ses amis, et elle se retira en 1778 avec une pension de 2,000 liv.
Cette actrice a obtenu autant de succès que de gloire, parce qu'elle unissait le sentiment à la perfection; mais ce qu'on aura de la peine à croire c'est que cette Sophie, si touchante au théâtre, si folle à souper, si redoutable dans les coulisses par ses épigrammes, employait ordinairement les momens les plus pathétiques, les momens où elle faisait pleurer ou frémir toute la salle, à dire tout bas des bouffonneries aux acteurs qui se trouvaient en scène avec elle, et lorsqu'il lui arrivait de tomber gémissante, évanouie entre les bras d'un amant au désespoir, tandis que le parterre criait et s'extasiait, elle ne manquait pas de dire au héros éperdu qui la soutenait: – Ah, mon cher Pillot, que tu es laid! – On peut remarquer que tous les acteurs ont l'habitude de se dire de pareilles folies pendant leur jeu muet; mais ce qui surprendra c'est que celui de cette actrice n'en souffrait point, et il était impossible que le spectateur qui la voyait dans ces momens décisifs supposât qu'elle fût assez peu affectée pour dire des billevesées.
Sophie Arnould a eu de M. le comte de L. trois garçons et une fille; l'aîné s'appelait Louis Dorval, le second Camille Benerville, et le troisième Constant Dioville; Alexandrine était le nom de leur sœur. L'aîné mourut à l'âge de quatre ans, et le troisième, devenu colonel de cuirassiers, fut tué à la bataille de Wagram; Camille est existant, et porte l'un des noms de famille de son père, ayant été légitimé avec son frère Constant.
Alexandrine Arnould, née en 1767, épousa en 1780 A. M.; c'était un jeune littérateur dont on a ébauché le portrait dans les couplets suivans5:
AIR: Vive Henri quatre
Hormis à table,
Il est toujours au lit;
Qu'il est aimable
Quand il sait ce qu'il dit!
Mais c'est pis qu'un diable
Pour cacher son esprit.
A l'art de plaire,
Qu'il esquive souvent,
Par caractère
Il joint heureusement
L'esprit de se taire,
Et chacun est content.
A. M., tout en parcourant la lice académique, ne cessait d'enfanter des madrigaux en l'honneur de mesdemoiselles Arnould, mère et fille; voici des vers qu'il destinait à être mis au bas du buste de Sophie:
Ce buste nous enchante; ah, fuyez, mes amis,
Fuyez! Que de périls on court près du modèle!
Je n'ai jamais vu d'homme en sa présence admis
Qui n'entrât inconstant et ne sortit fidèle.
Ce poëte était si épris de sa future, d'une figure commune et passablement laide, qu'il la considérait comme une Vénus; il lui adressa le quatrain suivant, qui dans le temps parut d'un ridicule rare aux yeux de ceux qui connaissaient l'héroïne:
Celle dont le portrait ici n'est point flatté,
Digne des chants d'Ovide et du pinceau d'Apelle,
N'a rien vu sous les cieux d'égal à sa beauté,
Rien, si ce n'est l'amour que je ressens pour elle.
L'esprit de Mme M. tenait beaucoup de celui de sa mère; ces deux personnes se faisaient parfois des niches assez gaies. Sophie avait aimé le comédien F., et après quelques mois l'avait congédié avec éclat: Mme M. fut enchantée de cette rupture, qu'elle croyait sincère. Un matin elle alla voir sa mère, et la trouva tête à tête avec F.; quand celui-ci se fut retiré elle témoigna son étonnement à Sophie: «C'est pour affaire que cet homme est venu ici, dit-elle, car je ne l'aime plus. – Ah! j'entends, répliqua Mme M.; vous l'estimez à présent;» allusion au conte qui finit par ce vers:
Combien de fois vous a-t-il estimé?
On demandait à cette dame quel âge avait sa mère: – Je n'en sais plus rien, répondit-elle; chaque année ma mère se croit rajeunie d'un an; si cela continue je serai bientôt son aînée. —
L'épigramme, comme on voit, était héréditaire dans cette famille; mais le cœur d'Alexandrine ne ressemblait pas à celui de Sophie. Quoiqu'elle eût deux enfans d'A. M., elle divorça pour épouser un habitant de Luzarches, qu'elle a rendu veuf peu de temps après, en lui laissant aussi deux enfans.
Quelques années avant la révolution Sophie Arnould habitait à Clichy-la-Garenne une maison de campagne où, partagée entre les souvenirs et les jouissances que lui assurait son amour pour les arts, elle se livrait presque entièrement à l'agriculture et aux douceurs d'une vie paisible et retirée.
Elle vendit cette propriété, et acheta à Luzarches, en 1790, la maison des pénitens du tiers-ordre de Saint-François, et sur la porte elle fit graver cette inscription:
ITE MISSA EST.
(Allez vous-en; la messe est dite.)
Elle avait choisi au fond du cloître un endroit qu'elle destinait pour son tombeau, et elle y fit inscrire ce verset de l'Ecriture:
Multa remittuntur ei peccata quia dilexit multum.
Beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé.
Des agens du comité révolutionnaire de Luzarches vinrent un jour chez elle faire une visite domicilière; quelques frères la traitant de suspecte: «Mes amis, leur dit-elle, j'ai toujours été une citoyenne très-active, et je connais par cœur les droits de l'homme.» Un des membres aperçut alors sur une console un buste de marbre qui la représentait dans le rôle d'Iphigénie; il crut que c'était le buste de Marat, et, prenant l'écharpe de la prêtresse pour celle de leur patron, ils se retirèrent très édifiés du patriotisme de l'actrice.
La révolution, qui a rompu tant de liens, dispersa tous les amis de Sophie; elle perdit alors une grande partie de sa fortune, qui se montait à près de trente mille livres de rente, tant en pensions qu'en contrats; néanmoins elle eût pu s'assurer un sort indépendant si elle n'eût pas mis toute sa confiance dans un homme d'affaires dont les malversations achevèrent de la ruiner.
On a vu dans ces temps de confusion cette femme, célèbre par son esprit et par ses conquêtes, cette femme, qui pouvait le mieux rappeler l'image d'une courtisane grecque, implorer vainement des secours auprès du Gouvernement; on a entendu mêler aux concerts mystiques des obscurs théophilantropes cette voix qui tonnait dans Armide, qui soupirait dans Psyché, et on a gémi en pensant à l'incertitude des événemens et aux mystères de la fatalité.
Sophie végétait dans un dénuement presque absolu lorsqu'elle apprit, en 1797, que M. F. venait d'être nommé l'un des premiers magistrats de l'état; son cœur tressaillit et s'abandonna facilement à la douce espérance que son ancien ami, élevé au faîte des grandeurs, viendrait bientôt à son secours; elle lui fit part de sa position pénible, et il l'invita à dîner pour le lendemain.
Mme D., présente à cette réunion, fut enchantée de rencontrer Sophie Arnould, qu'elle ne connaissait que de réputation; elle alla lui faire une visite, et, la voyant misérablement logée chez un perruquier de la rue du Petit-Lion, elle lui proposa un appartement dans sa maison. Sophie accepta avec la plus vive reconnaissance une offre aussi généreuse, et trouva bientôt près de sa nouvelle amie tous les charmes que les bons cœurs répandent autour d'eux.
M. F., redevenu ministre en 1798, fit obtenir à Sophie une pension de 2,400 fr. et un logement à l'hôtel d'Angivilliers, près le Louvre. Alors quelques amis se rapprochèrent d'elle; des gens de lettres et des artistes lui formèrent encore une société agréable.
Sophie Arnould conserva jusqu'au dernier instant tout l'enjouement de son esprit; les grâces semblaient avoir effacé la date de son âge, et la vivacité de ses saillies faisait oublier les ravages que le temps avait fait à ses charmes. Elle était attaquée d'un squirrhe au rectum, qui lui était survenu à la suite d'une chute: un jour, qu'elle avait rassemblé plusieurs docteurs pour examiner le siége secret de ce mal douloureux, elle dit: «Faut-il que je paie maintenant pour faire voir cette chose-là, tandis qu'autrefois…»
Elle mourut à l'hôtel d'Angivilliers sur la fin de 1802; sa dépouille mortelle fut portée dans le champ du repos de Montmartre; aucune pompe funèbre ne l'accompagna, aucun marbre ne lui servit de tombe: un de ses amis, témoin de cette modeste sépulture, s'écria douloureusement:
Ainsi tout passe sur la terre,
Esprit, beauté, grâces, talens,
Et, comme une fleur éphémère,
Tout ne brille que peu d'instans!
1
C'est dans cette maison que périt l'amiral de Coligny pendant le massacre de la Saint-Barthélemi, et non dans l'hôtel Montbazon, rue Bétizi, comme le racontent plusieurs annalistes. L'hôtel de Lisieux présente encore dans ses distributions tout ce qui convenait alors à l'habitation d'un grand officier de la couronne; mais si l'hôtel Montbazon n'a pas la gloire d'avoir appartenu à l'amiral de Coligny, il a, dit-on, celle d'avoir servi de logement à la belle duchesse de Montbazon, si tendrement aimée du célèbre abbé de Rancé. On prétend qu'au retour d'un voyage cet abbé, alors très-mondain, allant voir sa maîtresse, dont il ignorait la mort, monta par un escalier dérobé, et qu'étant entré dans l'appartement il trouva sa tête dans un plat: on l'avait séparée du corps parce que le cercueil de plomb était trop petit. Cet affreux spectacle opéra subitement sa conversion, et l'abbé de Rancé, dégoûté du néant des choses terrestres, alla s'enfermer dans son abbaye de la Trappe, dont il devint le réformateur avec une austérité sans exemple.
2
La cadette, nommée Rosalie, entra dans la musique de la chambre du roi en 1770, et elle y est restée jusqu'en 1792.
3
Mlle Fel lui avait enseigné l'art du chant, et Mlle Clairon avait formé son jeu.
4
Par reconnaissance le prince payait chaque année à sa maîtresse les frais d'un équipage.
5
Ces vers ont été faits il y a longtemps par un des amis d'A. M.; mais cette plaisanterie et beaucoup d'autres n'ôtent rien à son mérite littéraire. Quel est l'homme de lettres à l'abri des épigrammes? Publier un ouvrage marquant, disait Diderot, c'est mettre la tête dans un guêpier.