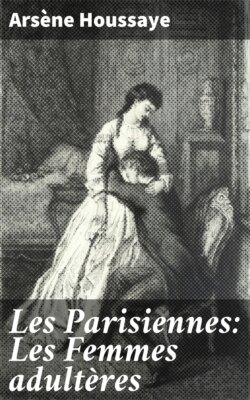Читать книгу Les Parisiennes: Les Femmes adultères - Arsène Houssaye - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
Un Grand d Espagne sans le savoir
ОглавлениеTable des matières
Il y a quatre-vingts ans, un Grand d’Espagne de haute lignée, le duc de Santa-Cruz, dernier du nom, venait se réfugier dans les Pyrénées, sur le versant oriental des Eaux-Chaudes, décidé à mourir parmi les bêtes sauvages, dans son horreur des hommes.
Il avait été condamné à mort dans une révolution de palais; il avait fui de montagne en montagne jusqu’au jour où il avait crié: «Terre!» en saluant la France.
Quand on est condamné à mort dans son pays, la «terre étrangère» est comme le rivage pour le naufragé.
Il pensa d’abord à aller jusqu’à Paris pour demander protection à quelques amis fort bien en cour. Mais c’était à l’heure de la Révolution. Et, d’ailleurs, il arrivait sans ressources dans les Pyrénées: plus un seul maravédis, un manteau déchiré, un feutre percé à jour, des bottes problématiques.
Il prit pied dans une petite baraque abandonnée où venaient s’abriter les pâtres les jours d’orage.
–Enfin, s’écria-t-il, je puis mourir!
L’homme est ainsi fait; Santa-Cruz avait fui la mort parce qu’elle le poursuivait; maintenant qu’il ne la voyait plus il fût allé volontiers vers elle.
Une vache égarée passa non loin de la petite baraque. Il mourait de soif, il remercia Dieu de cette rencontre, mais il regretta de n’être pas un peu pâtre pour pouvoir traire la vache et boire à cette fontaine miraculeuse.
. Sans doute un pâtre vint à son aide, sans doute il trouva la source bonne, car il jura d’oublier le passé, sa Grandesse, son titre de duc; il jura de vivre en homme libre dans la montagne. Ce fut une vraie régénérescence.
Il se reprit bientôt aux douceurs de la vie. Au bout de quelques années, il se retrouva plus ou moins marié avec une montagnarde qui lui donna deux fils et une fille.
Par malheur, la mauvaise fortune devait le frapper jusqu’à la mort: il fut enseveli dans une avalanche avec sa femme et deux de ses enfants. Il ne resta debout que le petit Juan, qui avait douze ans à peine, et qui, ce jour-là, promenait gaiement ses bêtes dans une autre ondulation de la montagne.
L’enfant devint tout à fait sauvage; il fut protégé par les pâtres du voisinage; il vécut de la vie alpestre, ne connaissant plus que ses vaches, ses brebis et son chien. Naturellement, il ne s’appelait pas le duc de Santa-Cruz: on l’avait baptisé sous le nom de Jean Le Roy, parce que le nom originaire de son père était El Rey.
Un fermier, son plus proche voisin, vint toutes les semaines lui prendre ses fromages pour les conduire l’hiver à Pau; aux Eaux-Bonnes, l’été.
Le fermier avait une fille; elle aussi gardait quelques vaches maigres sur les précipices entre la neige et l’abîme. Elle aimait la flûte et les psaumes de Juan El Rey ou Jean Le Roy.
Peu à peu les bêtes se rapprochèrent. Un jour il arriva qu’elles mangèrent la même herbe dans un ravin verdoyant tout bordé de hêtres.
C’était dans la belle saison; sur la lisière du bois on voyait rire les fraises sous les aubépines. Jean Le Roy cueillit un bouquet de fraises et le porta à Marianne Coucou.
Ce fut tout ce qu’il lui dit. Et elle, pour toute réponse, porta les fraises à ses lèvres et s’enfuit pour cacher sa rougeur, rougeur de fraise, car elle avait les fraîches couleurs de sa dix-septième année.
Le lendemain, pareille rencontre; le surlendemain, le père et la mère Coucou, cherchant leur fille, leurs vaches et leurs chèvres avec quelque inquiétude, trouvèrent tout ce monde-là dans le ravin. Ils ne virent pas grand mal à cela. On questionna Jean Le Roy pour savoir si le ravin était pavé de bonnes IV 2 intentions. Le jeune pâtre n’y allait pas par quatre chemins. Il déclara qu’il était prêt à cueillir pour Marianne toutes les fraises de la contrée, à jouer pour elle de la flûte jusqu’à son dernier souffle, à la porter dans ses bras pour remonter le versant à pic chaque fois qu’elle serait descendue, en un mot à la prendre pour sa femme devant Dieu, mais il ne voulait pas l’épouser devant les hommes. C’est-à-dire qu’il était trop sauvage pour aller au village voisin, habillé de noir comme un marguillier, se donner en spectacle sous prétexte de mariage.
Le père et la mère Coucou ne se fâchèrent pas trop contre cet original qui menaçait d’être un bon mari, malgré le sacrement et la loi. On attendit, on séquestra Marianne, mais il n’en voulut pas démordre.
Il menaça de mourir de chagrin. La pauvre Marianne, si rose, si joufflue, si gaillarde jusque-là, pâlit, s’étiola et se coucha pour mourir.
–Notre fille n’est plus qu’un cierge, dit la mère.
–Tu me fais peur avec ton cierge, dit le père. Donnons-là à Jean Le Roy, nous ferons brûler un cierge à l’église, cela leur tiendra lieu de bénédiction.
Quelques jours après, toute la montagne fut réjouie; Jean Le Roy apprit à ses amis les oiseaux, en leur jouant un air de flûte, que les mauvais jours étaient passés. Il cueillit un beau bouquet de fleurs sauvages qui fut le bouquet de la mariée. On fit rôtir un chevreau, et on but du vin de Jurançon, tout comme Henri IV à son berceau.
Dieu qui, sans doute, ne connaît pas le Code civil, bénit ce mariage sans écharpe et sans surplis. Un an après, Marianne Coucou mettait au monde un garçon qui fut baptisé sous le nom de Jean-Achille Le Roy.
Ce jour-là encore on tua un chevreau, mais le troupeau ne s’amoindrissait pas pour cela, au contraire. Jean Le Roy, le génie de la montagne, avait augmenté sa petite fortune en vendant des bois et en achetant des vaches, en défrichant çà et là quelques lambeaux de savarts ou de laris pour y semer de l’orge et du sarrasin. Dans le ravin, il avait créé tout un potager; par malheur, le soleil y était avare de ses rayons, mais enfin «ce que Dieu donnera, on le prendra», disait le pâtre.
En ce temps-là on vendit des communaux dans la montagne. Cette fois, Le Roy osa se montrer: on avait dix ans pour payer; il acheta cent hectares à raison de cent francs l’hectare. Le pâtre savait bien qu’il trouverait tous les ans du bois pour payer la commune. S’il était heureux! vous le pensez bien, d’autant plus que Marianne Coucou lui donna bientôt une fille qui fut baptisée du nom de Marianne; mais le curé d’un seul nom en fit deux, disant que Marie-Anne c’était les deux plus beaux noms de la chrétienté, le nom de la sainte Vierge avec le nom de sa mère.
On commença à parler de Jean à trois lieues à la ronde. Il était devenu moins farouche; il permettait à quelques voisins de traverser son domaine; la petite maison natale n’avait pas grande mine au dehors, mais sa femme avait fait un intérieur charmant par la blancheur du linge, par l’état de la vaisselle, par je ne sais quel parfum de vertu alpestre.
Il était le plus industrieux des hommes de la contrée; il avait bâti lui-même une petite aile pour loger les bestiaux. Dans les rochers, il avait creusé plus profondément l’ancienne étable, si bien que toute une arche de Noé aurait pu y débarquer dans le déluge jusqu’au départ de la colombe. Là aussi Jean avait bâti un petit moulin qu’il faisait tourner par un âne. C’était donc tout un monde autour de lui. On récoltait le blé, on faisait la farine, on cuisait le pain. Le pain n’était pas blanc, mais quel bon pain quand on a soi-même semé le blé, quand la ménagère, en pétrissant la pâte, y a laissé tomber ces belles perles de sueur, qui sont l’auréole des moissonneuses et des mères de famille! C’est le vrai pain du bon Dieu!
Cependant le petit Achille, déjà hardi dans la montagne, ne craignait ni le soleil ni la neige; comme l’autre Achille, son père l’avait trempé dans le Styx, je veux dire dans les sources vives.
–Que ferons-nous de notre fils? demanda un jour Marianne à son maître.
–La belle question! nous en ferons un pâtre comme moi.
–Oui, dit Marianne attristée, mais il ira à l’école.
–A quoi bon? reprit Jean Le Roy, est-ce que j’ai été à l’école, moi! Enfin, puisque c’est la mode, on le mènera à l’école. Mais quand on tient un livre d’une main, on ne fait pas grand’chose avec l’autre.
Et comment aller à l’école? L’école est loin: il faut descendre à Laruns, à travers les rocs, les torrents, les précipices. Descendre le matin, remonter le soir, tout un voyage périlleux pour apprendre la grammaire! Car la mère pourrait lui apprendre à lire et à écrire Mais on parle si mal à la maison!
On décida que l’été, la mère conduirait le fils à l’école, tout en portant du lait à Laruns. Il reviendrait comme il pourrait, avec les enfants des Eaux-Chaudes, tantôt sur le bout d’une charrette, quelquefois en s’accrochant aux voitures des voyageurs; çà et là pourquoi ne monterait-il pas en croupe avec un muletier aragonais passant par Gabas?
Il y a un Dieu pour les enfants. Jamais il n’arriva malheur au gamin de la montagne. Tous les soirs, à la brune, on courait prendre Achille aux Eaux-Chaudes.
Le gamin avait neuf ans; nul n’était plus hardi sur les rochers et contre les ours. Déjà il maniait le fusil de son père; il avait disparu toute une journée pour se risquer au pic de Gazie, où se montrent le coq de bruyère, la perdrix rouge et la perdrix blanche; il comptait sur un régal pour sa mère, mais il n’avait tué qu’un chat sauvage. Au retour de cette chasse incroyable, il fut battu par le père; mais à peine Jean Le Roy le vit-il pleurer tout trépignant d’indignation, qu’il le prit dans ses bras et lui dit: «Je t’achèterai un fusil en t’achetant des livres; j’aime mieux un chasseur qu’un savant.»
Cependant le petit-fils du Grand d’Espagne savait déjà lire; à la fin de la saison il griffonnait d’une main fière, mais le maître remarquait surtout les beaux pataraphes qu’il signait sur la figure des écoliers quand ils le raillaient sur ses airs sauvages. Il devint la terreur de l’école; le maître voulut le rendre à sa mère, mais il se décida à le garder malgré ses manières un peu montagnardes, séduit par sa vive intelligence.
–Ce garnement-là ira loin, dit-il au curé et au médecin à la distribution des couronnes de l’année.
Les premiers jours la mère l’avait conduit, mais après une semaine il partait seul pour l’école et s’en revenait tantôt par ci, tantôt par là, ne craignant pas les sentiers inaccessibles et dangereux. Comme tous les enfants de la montagne Pyrénéenne, il avait le pied d’acier, il s’accrochait aux rochers, il jouait avec le péril.
Quelquefois il remontait par le chemin de tout le monde: c’est qu’il était ces jours-là en compagnie du médecin de Laruns ou du curé de Coust, cette adorable petite colonie, ce nid d’aigle dans les nuages, cette république de quatre-vingts citoyens qui a son conseil des anciens, qui vit en famille dans le pays des neiges, qui ne se mésallie jamais. Ces jours-là, c’était une fête pour l’écolier, car il interrogeait le curé ou le médecin. Or, pour lui, tout ce qui sortait de leur touche était la vraie science; le premier lui montrait Dieu, le second la Nature. Plus d’une fois, il dépassa la maison natale pour les accompagner jusqu’à Goust. Aussi, un jour que Marianne Coucou, depuis longtemps prise par la fièvre, parut très malade à l’enfant, quoiqu’elle ne se plaignît pas, elle vit venir à elle tout à la fois le médecin et le curé. C’était son fils qui les amenait. Le curé parla à l’âme, le médecin réconforta le corps. La mère, revenue à elle, serra bien fort l’écolier dans ses bras.
Cependant, comme il l’avait dit, le père donna un fusil à Achille. Le même jour la mère lui donna un violon trouvé. L’enfant joua bientôt du fusil et du violon. Les jours de récréation, il courait la montagne, s’aventurant aux pics d’Acizai, de Cesque et de Gazie, où il avait déjà tué le chat sauvage. Son premier coup de fusil, qui porta bien, lui donna un coq de bruyère. Le second coup, un isard. Le jour où il rapporta l’isard, le traînant à travers les rochers, il se crut le roi de la montagne; ce jour-là encore, son père coupa la tête à une bouteille de vin de Jurançon.
–Pauvre petite bête! dit la sœur Marie; vois donc comme elle te regarde doucement, toi qui l’as tuée, avec ses beaux yeux encore ouverts.
On sait que l’isard est un joli animal qui ressemble au chevreuil et au chamois. Mais l’homme né chasseur aime le carnage, il tue la colombe comme le hibou, la biche effarée et pleurante comme le loup furieux, avec une cruelle volupté.
Achille eut pourtant un bon mouvement; il embrassa sa sœur et il lui jura de laisser la vie sauve au premier isard qu’il rencontrerait.
–Bien mieux, s’écria-t-il, je lui jouerai du violon.
Il donnait des coups d’archet à faire fuir les ours!
Je m’attarde un peu à cette enfance toute rustique et toute montagnarde. Les années se passèrent, le frère et la sœur grandirent et devinrent les plus beaux enfants des Pyrénées: des cheveux bruns comme l’aile du corbeau, un profil fier, aux lignes fines, un ovale parfait., le teint quelque peu olivâtre mais harmonieux, des sourcils qui semblaient peints, des cils retroussés, des dents éclatantes, de vraies dents de chat, des narines joyeuses, le corps svelte, le pied cambré, la main petite et expressive.
Tout cela était charmant, mais, comme chez tous les Basques, «ces cacheurs d’âme,» la figure n’exprimait pas bravement la pensée. Il n’y a pas un Basque qui ne serait bon diplomate, parce qu’il a l’œil pénétrant et parce qu’il porte un masque trompeur.
Ainsi était la sœur, ainsi était surtout le frère.
Jean Le Roy était resté sauvage; mais Marianne Coucou venait avec ses enfants tous les dimanches d’été aux Eaux-Chaudes. L’hiver, elle les conduisait à la messe à Laruns; on s’était même hasardé une fois jusqu’à Pau pour acheter un habit à Achille et une robe à Marie; il fut décidé que la jolie montagnarde porterait le costume des Ossaloises: sur la tête, le capulet de drap écarlate avec la doublure damassée, le petit bonnet rond de mousseline pour retenir les cheveux, sans toutefois emprisonner les belles tresses qui retombent sur les épaules; le corset de velours noir avec des revers de velours cramoisi; le fichu de soie dont les pointes se perdent dans le corset; les jupes de laine divisées en plis symétriques, celles du dessus s’agrafant derrière la taille à la hauteur des genoux, réminiscence ou inspiration des paniers de l’ancien régime. Voyez comme le ruban bleu court avec art sur les dessins de ces plis étudiés! Ce n’est pas tout: voici le tablier de mousseline blanche unie ou brochée, avec les falbalas qui égaient les jupes. Sur le tablier jouent au vent les deux bouts d’une large ceinture jaune qui viennent flotter jusque sur les bas blancs, ces bas blancs dessinant une jambe nerveuse, se coupant au cou-de-pied et débordant sur le soulier par leurs fines canelures.
Mais si la sœur restait fidèle au costume du pays, le frère s’en voulut affranchir. Il trouvait que si les paysannes sont jolies dans leurs modes séculaires, les paysans ont le costume des paysans de théâtre avec leur veste écarlate, leur gilet de molleton blanc à larges revers, la chemise plissée et serrée au col, la culotte courte de velours noir avec les poches à revers garnies de galons dorés, les jarretières à glands en cordon de soie violette ou jaune ou rouge, l’épingle étincelant sur la chemise, les sandales en fil garnies de bandelettes noires ou rouges qui se croisent sur le pied. Et sur tout cela le célèbre béret béarnais brun.
Jean Le Roy était plus sévère dans son costume. Il portait la culotte courte et la veste brune, mais il se jetait toujours sur les épaules une ample cape de laine blanche, ce qui lui donnait un grand caractère. Aussi son fils le trouvait-il le plus beau des montagnards.
Pour lui, dès qu’il put imposer sa volonté, il voulut être habillé tout de noir, comme le curé et comme le médecin de Laruns.
–C’est bien, dit le père, cela prouve que sa vie sera sérieuse.
Il avait passé toutes ses jeunes années à étudier, à chasser, à jouer du violon et à garder le troupeau; il appelait cela étudier encore. Il emportait toujours un livre, un fusil ou son violon.
Et quel livre emportait-il? L’Iliade et l’Odyssée, un in-18du temps de la Régence avec des figures d’Audran, la plus belle édition de l’Homère de madame Dacier. Quand il n’emportait pas Homère, il emportait l’Ancien Testament. Il commençait bien, cet inculte, puisqu’il mettait la main du premier coup sur les deux Bibles de l’humanité. L’Ancien Testament, c’était le curé de Laruns qui le lui avait donné; l’Homère, il l’avait acheté d’un colporteur qui tous les ans traversait le pays avec l’ancienne Bibliothèque Bleue, appauvrie encore par quelques livres de contrebande, comme l’histoire du chevalier Cartouche ou du sieur Mandrin.
Achille Le Roy avait préféré l’Achille de l’Iliade et le Samson de la Bible aux figures des deux héroïques coquins français. Non pas qu’il les méprisât profondément, car il avait de l’admiration pour l’énergie et pour la vaillance, quel que fût le but, même jusque dans le crime. A ses yeux, celui qui avait peur de la mort était indigne de la vie; il disait que le lâche est le dernier des hommes.
Aussi, tout en s’aguerrissant à la chasse contre les ours, avait-il songé à s’aguerrir contre les hommes; il n’avait pas pris un maître d’armes, mais comme il était bien doué du sentiment de l’attaque et de la défense, il s’escrimait tous les jours avec des couteaux, non pas seulement de la main droite, mais de la main gauche, souvent des deux mains, comme ces jongleurs de l’Inde qui livrent bataille à toute une cohorte, frappant, frappant encore, frappant toujours avec la rapidité de l’éclair.
Un soir, dans un cabaret de Laruns, où il n’était pas entré pour boire mais pour acheter du vin pour sa mère, il se prit de querelle avec des montagnards qui le trouvaient trop fier. Ils étaient quatre; il ne trouva pas de second, mais il les brava en leur montrant son couteau. C’est une arme familière dans. les montagnes; les montagnards tirent le couteau comme les gentilshommes tirent l’épée.
La lutte s’engagea; Achille Le Roy était le plus jeune; ses adversaires s’imaginaient le mettre du premier coup hors de combat. Mais il les désarma en les frappant tous les quatre à la main.
–Êtes-vous contents? leur cria-t-il en leur montrant ses belles dents par un sourire cruel.
Dans leur fureur, ils voulurent se ruer sur lui pour l’écharper, mais il les tint à distance avec une grâce toute féminine. Les spectateurs effrayés mirent fin au combat. Ce soir-là, le nom d’Achille Le Roy courut sur toutes les lèvres.
Il partit avec ses deux bouteilles de vin au milieu des hourras. Tout le monde s’étonnait qu’il fût si brave avec sa pâle figure aux reflets oranges.
Le dimanche, dans la belle saison, il se hasardait au milieu du beau monde des Eaux-Chaudes et des Eaux-Bonnes. Il se drapait d’un petit manteau noir, quelle que fût la chaleur, avec une fierté castillane; il conduisait presque toujours Marie à ses promenades du dimanche. Les Parisiens, amoureux du pittoresque, admiraient au passage le frère et la sœur, qui avaient l’air de s’adorer.
Parmi les admirateurs, il se trouva un jeune officier de spahis, Léon Brack, qui était venu aux Eaux-Chaudes pour ses blessures reçues au Mexique. A la première rencontre, on s’était regardé avec une vive sympathie; à la seconde, on s’était parlé; à la troisième, Léon Brack avait serré la main de la jeune fille. Le dimanche suivant, l’officier parla de sa famille; lui aussi avait une sœur, voilà pourquoi il avait tant de plaisir à regarder Marie. Il invita les jeunes gens à dîner avec lui à l’hôtel de Londres; ce fut une fête pour Marie, non pas à cause du dîner, mais parce qu’elle était assise à côté de l’officier.
L’amour alla bon train. Marie venait le matin à l’hôtel de France et à la maison de Souques. Naturellement, Léon Brack la rencontra sur la promenade Henri IV; il la reconduisit par la route de Gabas; on s’arrêta à la fontaine; Léon Brack prit la main de Marie, la plongea dans l’eau et y but une gorgée avec des lèvres ardentes; il aurait voulu boire la main.
Que dirai-je que vous ne sachiez d’avance? Le lendemain on se rencontra encore, et aussi le surlendemain. On ne suivit pas toujours le grand chemin; sous prétexte de cueillir des fleurs, on descendit au torrent; sous prétexte de cueillir des noisettes, on s’égara dans les broussailles. Marie était la fille la plus vertueuse du monde, mais il y a des jours terribles où la vertu s’évanouit devant l’amour.
A cinq mois de là,–c’était en janvier,– les neiges avaient emprisonné toute la famille dans les âpres solitudes de la montagne. Marie se jeta dans les bras de son frère, un jour que le père et la mère étaient à l’étable.
–Qu’as-tu donc, Marie?
Elle ne parla que par ses larmes.
–Marie! Marie! dis-moi pourquoi tu pleures!
–Tu sais, Léon? Ton ami? Je l’aime, et je vais mourir de chagrin.
Et elle pleurait toujours.
–Pourquoi? Si tu l’aimes, il t’aimera, c’est un cœur loyal, il reviendra au mois de juin aux Eaux-Chaudes.
–Au mois de juin je serai morte.
–Pourquoi?
–Parce que d’ici au mois de juin.
–Tu m’épouvantes!
–Pardonne–moi. Je l’aimais tant, que dans mon affolement j’ai tout oublié; s’il ne m’épouse pas tout de suite, je suis perdue, car mon père me tuera. Voilà pourquoi j’aime mieux me tuer moi-même.
–Je ne te comprends pas.
–Tu ne vois pas que je suis enceinte?
Achille tira son couteau.
–Oh! Marie, qu’as-tu fait!
–Frappe! lui dit-elle.
Le frère referma son couteau.
–C’est lui que j’irai tuer.
–Non, je l’aime!
Elle voulut prendre le couteau.
–Pauvre enfant! dit Achille en regardant sa sœur.
Il la baisa au front.
–Je jure sur mon âme et sur mon couteau qu’il t’épousera. Ah! s’il n’était pas si loin!
–Je ne te l’ai pas dit, sache qu’il est à Pau, toujours un peu malade. Je l’ai vu avant les neiges à Laruns, un dimanche que j’allais à la messe.
–Eh bien! je pars pour Pau.
–Tu serais enseveli dans les neiges; c’est impossible!
Achille se révoltait devant ce mot. Cinq minutes après, sans avertir son père, après avoir embrassé sa mère sans lui dire qu’il partait, il s’aventura à travers les murs de neige, roulant dans la montagne sur une avalanche, toujours énergique et toujours rapide, comme un nageur indomptable qui triomphe des vagues.
Il était onze heures du soir quand il arriva à Pau. A une heure il avait fini par découvrir l’hôtel où demeurait Léon Brack.
Il le réveilla dans son lit.
–Que me voulez-vous? dit le jeune officier, très surpris de cette visite nocturne.
–Vous avez oublié de demander la main de ma sœur, je viens vous l’accorder.
–Vous êtes fou.
Achille se jeta sur l’épée de Léon suspendue à l’espagnolette de la fenêtre.
–Ne dites pas une seconde fois que je suis fou.
Et il tira à moitié l’épée du fourreau.
–Eh bien! reprit l’officier, parlons raison.
–Parlons raison! Vous ne savez donc pas que ma sœur est enceinte?
–Non, dit Léon, très inquiété de cette nouvelle.
Et il dit tout bas:–Pauvre Marie!
–Eh bien! que me répondez-vous?
–Je suis désespéré, mais un mariage est impossible. Ne savez-vous donc pas qu’un officier pauvre comme moi ne peut épouser une jeune fille que si elle lui apporte une dot de vingt mille francs?
Achille était indigné.
–Eh bien! puisque vous le saviez, vous, pourquoi avez-vous déshonoré ma sœur? Marie veut se tuer, mais vous mourrez avant elle!
L’officier s’était assis dans son lit:
–Mon cher ami, vous ne me faites pas peur avec mon épée; j’aime votre sœur, c’est la plus brave créature que j’aie jamais rencontrée, mais que voulez-vous que je fasse?
–Qui vous dit que ma sœur n’a pas une dot de vingt mille francs?
–Eh bien! quoi qu’en pût dire ma famille, je vous jure que j’épouse votre sœur si votre père lui donne cette dot.
–Eh bien! mon frère, je vous serre la main, car si mon père ne donne pas les vingt mille francs, je les donnerai, moi.
–Vous les donnerez? Mais, mon cher ami, ce n’est pas encore dans vos montagnes, sous le pas d’un mulet, qu’on trouve vingt mille francs.
–Adieu! dit Achille, comme s’il ne doutait pas de ses promesses; je n’ai pas une minute à perdre, car pendant que je suis ici, ma sœur se désespère, il faut que je coure la consoler. Le temps a changé, la pluie s’annonce déjà; avant quinze jours nous pourrons descendre à l’église de Laruns pour le mariage; tenez-vous prêt de votre côté, nous serons prêts du nôtre. Vous avez notre parole, j’ai la vôtre, adieu!
L’officier voulait retenir Achille.
–Non, venez dimanche à Laruns, à l’heure de la messe; si ma sœur ne peut descendre, je descendrai, moi.
Et, sans dire un mot de plus, le jeune montagnard disparut par la porte restée entr’ouverte.
Dans la matinée, il aborda son père qui égorgeait un cochon.
–Ce sera pour la noce, dit-il.
–Comment, pour la noce! Est-ce que tu as la prétention de te marier?
–Non; mais un jeune officier qui porte son épaulette à gauche et la croix sur son cœur m’a demandé ma sœur en mariage.
–Et tu t’imagines que je vais donner ta sœur à un soldat qui court le monde? Je n’ai pas fait des enfants pour les perdre.
–Tu as fait des enfants pour qu’ils soient heureux; l’officier aime ma sœur et ma sœur aime l’officier. Il n’est rien à opposer à cela.
–Mais c’est de l’hébreu pour moi, car je n’en ai eu jusqu’ici ni vent ni nouvelles.
–Ah! c’est que les amoureux cachent leur jeu; mais cela est ainsi. Il ne manque plus à ma sœur que vingt mille francs de dot.
–Vingt mille francs de dot! Tu t’imagines donc que je suis millionnaire?
–Non, mais tu les donneras.
–Jamais! Pour un soldat qui m’enlèverait ma fille bien loin!
–C’est ton dernier mot?
–Oui. D’ailleurs avec quelques pans de la montagne, quelques masures et une cinquantaine de bêtes, crois-tu donc que j’aie sous la main les mines du Pérou? Ta sœur est assez folle pour vouloir se marier avant d’avoir vingt ans, je m’en lave les mains; je ne lui donnerai pas un sou, je ne suis pas un argentier. Mais si son capitaine veut la prendre pour rien et passer ses semestres ici, il sera le bienvenu.
Achille connaissait son père; on n’entame pas les rocs des Pyrénées, on les fait sauter. Il ne voulait pas la mort de son père; il se dit à lui-même ce qu’il avait déjà dit à Léon:
–Eh bien! c’est moi qui ferai la dot.
Il repartit pour Pau. Quand il revint le lendemain, il dit à son père:
–Sais-tu ce que j’ai fait? J’ai joué sur parole au café pour gagner la dot de ma sœur. Naturellement j’ai perdu; si tu ne me donnes pas vingt mille francs, adieu, tu ne me reverras jamais, car je vais retrouver mon fusil que j’ai caché dans la montagne.
Le père voulut tuer son fils, mais du bras qu’il avait levé sur lui, il le prit sur son cœur et l’embrassa.
–Enfin, s’écria Achille, j’ai gagné ma cause! Tu vas donner les vingt mille francs à ma sœur, car moi je n’ai rien perdu.
Les noces se firent dans la montagne.
Cependant Achille ne pouvait pas toujours, avec son esprit chercheur et inquiet, vivre en chassant l’isard ou en pêchant la truite. L’amour des livres l’avait envahi. Il avertit un jour son père qu’il partait pour Pau, où il voulait toute une année s’emprisonner au collège.
–Au collége! lui dit son père, mais tu en remontrerais à notre curé, tu écris mieux que notre maître d’école, et tu parles comme notre médecin.
–C’est vrai, mais je ne suis qu’un âne.
Et il partit.
Il étonna bien un peu les collégiens de tous les âges quand il se mit d’une dent presque vierge encore à mordre, impatient, à tous les fruits de la science; voulant goûter en même temps, le même jour, au grec et au latin, à l’histoire et à la philosophie. Et encore il prit des leçons d’escrime et de violon. Pendant le premier trimestre on le jugea un peu fou; pendant le second trimestre il commença à étonner les professeurs; à la fin de l’année, la lumière s’était faite en lui; quelle que fût la thèse, il comprenait tout.
Ce n’est pas le seul exemple de la science violée. Il est temps d’y songer: à force de contraindre les enfants à l’âge où ils ne doivent que jouer, on leur donne l’horreur du travail et on tue l’homme dans l’enfant. Si on attendait l’heure pour les jeter dans le dédale de la science, ils se retrouveraient, parce que dans leur force juvénile ils auraient l’aspiration de la lumière; ils n’aimeraient pas l’étude pour les prix menteurs qu’elle donne, mais pour les joies de l’intelligence.
Quand je songe que dès sa huitième année on condamne un pauvre enfant aux travaux forcés du lycée! On le réveille à six heures du matin, et, jusqu’à huit heures du soir, il est courbé sur des livres qui lui font horreur parce qu’ils ne lui disent encore rien.–Et la récréation? dit le proviseur.–Oui! deux heures à peine sur quatorze, un peu moins que les prisonniers, sans parler des pensums. Qui de nous voudrait repasser par cette horrible enfance? M. Duruy y songera un jour, comme M. Rouland, qui, lui aussi, m’avait promis,–car j’ai toujours plaidé cette cause-là,–de donner une heure de gaieté de plus à ces jeunes condamnés.
Achille Le Roy passa une seconde année au collége de Pau. A la distribution des prix, il lui fallut, bon gré mal gré, se charger des plus belles couronnes; il n’eut pas le prix de mathématiques, mais il eut le prix d’excellence.
Que faire à Pau quand on a eu le prix d’excellence, quand on a fait une révolution dans le vieux château-fort de l’Université?
Il passa les vacances dans la montagne, mais descendant tous les jours aux Eaux-Chaudes et aux Eaux-Bonnes. Grâce à sa belle tête, à son éloquence naturelle, à sa curiosité féminine, il se lia avec tous les buveurs d’eau du meilleur monde. Aux deux salons de conversation comme sur la promenade horizontale, il fut toujours très accueilli et très recherché. Cette fière expression du montagnard qui transperçait dans l’homme assoupli aux coutumes mondaines, charmait tout le monde. Dans l’amitié comme dans l’amour il faut reconnaître la loi naturelle des contrastes.
Cette année-là une dame d’honneur de l’impératrice avait groupé autour d’elle toute une société d’élection dont le comte de Harken était le boute-en-train. On devait faire une grande excursion au pont d’Enfer et à la cascade de Goust, on pria Achille d’être de la fête et du déjeuner. «Et voilà comme quoi, disait-il plus tard, j’ai fait mon entrée à la Cour.»
Comme il était avec des gens de cour, il chanta en pleine montagne la chanson de Francois Ier. Le lendemain il descendit aux Eaux-Bonnes avec son violon qui acheva de lui conquérir tout le monde.
Quand vint l’automne, quand tout ce beau monde eut repris sa volée vers Paris, Achille sentit qu’il avait perdu la moitié de sa famille. Une vague aspiration l’attirait vers ce boulevard des Italiens dont on lui avait tant parlé, où battait le cœur de toute la France mondaine, artiste, chercheuse, héroïque, bohémienne, amoureuse. Il demanda mille francs à son père en lui disant:
–C’est encore une année de collége; c’est Paris qui donne le dernier mot. Quand je reviendrai, je te dirai si je suis soldat, laboureur, avocat, pâtre ou marchand d’or, comme tous ceux de notre pays qui vont faire fortune en Amérique.
Le père ouvrit un vieux coffre du temps de Henri IV, dont les ferrures ornementées indiquaient un travail d’artiste.
–Ecoute bien, lui dit-il, il y a dans ce coffre tout juste cent mille francs, non pas en or ni en argent, mais surtout en titres de propriété. Quand je serai mort, quand ta mère sera morte, vous vous partagerez cela avec ta sœur. Tu songeras ce jour-là que j’avais des bras de fer et que je les ai brisés à un travail surhumain; tous les rochers de la montagne te le diront. Tu pars! et moi je vais pleurer tous les jours. Vois-tu ce pan de montagne que j’ai défriché? Il m’est cher comme toi, comme ta sœur, comme ta mère! Chaque arbre et chaque brin d’herbe me disent la bienvenue. Quand j’y fauche ma moisson, quand j’y fauche mon sainfoin depuis la première coupe jusqu’au regain, je prends les gerbes, je prends les fenaisons sur mon cœur comme des enfants. Je ne vais pas à la messe, moi, mais je sens que le bon Dieu est là-dedans. Si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi je pleure à l’idée que cette montagne sera un jour abandonnée par moi et les miens. Voilà ce que c’est! Mademoiselle a voulu épouser un capitaine, monsieur veut aller se perdre à Paris, chacun a son orgueil! Pour moi, le mien était plus grand que le vôtre; je voulais voir ici, sur ma terre, dans ma maison, mes enfants, me petits-enfants, mes arrière–petits–enfants. N’était-ce pas plus beau de vivre libre dans l’air vif que d’aller vous enchaîner dans toutes les servitudes? Je ne suis pas savant, mais je sais cela.
Achille eut une grande émotion, il pleura lui-même. Il n’avait rien à dire contre cette rude raison de l’homme qui parle selon son cœur.–Après tout, pensait-il, vivre ici c’est peut-être la sagesse!
La folie l’appelait. Il partit le lendemain par la diligence des Eaux-Bonnes à Pau pour prendre le chemin de fer de Paris. Son père et sa mère le conduisirent jusqu’à Laruns. Dans le chemin, pendant que le père s’attardait avec un marchand de cochons, la mère donna deux poignées d’or à son fils.
–Tiens! lui dit-elle, c’est tout mon trésor.
Le père avait donné mille francs, Achille ne voulut pas compter les deux poignées d’or.
Le montagnard débarqua à Paris en plein boulevard des Italiens; il prit pied à l’hôtel de Bade, où il loua une toute petite chambre sous les toits.
Qu’allait-il faire en cet observatoire, lui qui voulait étudier la médecine?
Il prit sa première inscription et regarda face à face son premier cadavre,–puisque c’est la mort qui indique la vie.
Le jour même de son arrivée, il descendit le boulevard jusqu’aux Champs-Élysées, tout ébloui de ce luxe de chevaux et de femmes dont les promenades des Eaux-Bonnes et de Pau ne lui avaient pas donné l’idée. Il était ivre; sa forte nature n’avait pu rester calme devant cette fête des yeux, parce que chez lui l’imagination dominait tout. Il faut se rappeler qu’il n’avait pas eu le prix de mathématiques.
Un proverbe dit qu’à Paris, pour le nouveau-venu, tout tient à la première rencontre.
Que rencontra Achille?
On se le rappelle:–un ami déjà connu, le comte de Harken,–et un ami inconnu, Adolphe de la Chanterie.–On n’a pas oublié comment il entra dans la vie parisienne par la porte de l’Enfer, je me trompe, par la Maison d’Or. On a vu sa belle entrée de jeu pour avoir mis mille francs sur la carte d’un beau joueur. On sait qu’il devint l’ami de la duchesse pour avoir ramassé un sou tombé de son balcon. Je ne redirai pas le mot à mot de sa vie parisienne, ses duels, ses folies, ses équipées galantes jusqu’au jour où il tomba profondément amoureux de Bianca.
Quand il retourna dans les Pyrénées, appelé par sa sœur, du lit de mort de son père, il n’eut pas la consolation de revoir même dans la mort cette austère figure de ce brave homme qui avait vécu dans le rude labeur sans se plaindre jamais, fier de ne devoir qu’à Dieu et à lui-même son pain quotidien. On l’avait enterré la veille du retour de son fils.
Achille, qui avait perdu l’habitude des églises, alla s’agenouiller à l’église de Laruns et de là sur la fosse nouvelle. Il était en compagnie de sa mère et de sa sœur. Ce furent de vraies larmes. Depuis l’enterrement les deux femmes n’étaient pas retournées dans la montagne, le médecin leur avait donné l’hospitalité en disant que la mère ne pouvait vivre désormais seule au milieu des bois et des rochers. Le mari de Marie était en garnison à Toulouse. Il fut décidé que la mère suivrait les hasards de la fortune de sa fille.
Le lendemain Achille retourna seul dans la montagne. Il lui semblait qu’il y retrouverait tout vivant encore le souvenir de son père. Cette image vénérée n’allait-elle pas lui apparaître dans tout ce rude et beau paysage qu’il avait animé de sa main féconde!
La douleur se plaît dans la douleur. Quand on a perdu quelqu’un de cher, plus on le cherche dans la mort, plus on lui donne les larmes du souvenir, plus on est content,–si on peut mettre ce mot sur un tombeau.
Achille Le Roy fit un triste et doux pèlerinage à travers l’héritage paternel. Ce pauvre héritage si laborieusement fertilisé, dont lui n’eût fait qu’une bouchée sur le boulevard des Italiens, qu’allait-il devenir? Les montagnards s’en vont. Trouverait-on des pâtres pour le louer, sinon pour l’acheter? Fallait-il tout vendre, la terre, les bois, la ferme, les bêtes, vaille que vaille?
Un coup de vent fit rentrer Achille dans la maison.
On y respirait comme une odeur de sépulcre. Marianne Coucou avait donné la clef de l’armoire et la clef du coffre. Achille prit l’argent, bien décidé à tout donner à sa mère et à sa sœur. Il y avait quelques milliers de francs en or et argent de France et d’Espagne.
Dans l’armoire, Achille Le Roy remua des papiers. Il fut très surpris de trouver des parchemins anciens qu’il déchiffra peu à peu, quoiqu’ils fussent écrits en espagnol. C’étaient des titres qui conféraient la Grandesse d’Espagne à Juan El Rey de Santa-Cruz.
Ce fut pour Achille comme un éblouissement.
–Comment mon père ne m’a-t-il jamais parlé de cela? se demanda-t-il.
Il se souvint alors que son père n’avait que douze ans quand toute la famille périt dans une avalanche. Mais comment ces titres s’étaient-ils conservés? Sans doute son grand-père les avait emportés dans sa fuite à travers les Pyrénées.
Plus il étudia les parchemins et plus il fut convaincu qu’il était bien le descendant de Juan El Rey de Santa-Cruz, Grand d’Espagne de première classe.
–Et moi qui croyais, dit-il, que mon père s’appelait Le Roy parce qu’il était le roi de la montagne!
Achille trouva aussi le titre d’une grande châtellenie dans la province de Badajoz.
–Qui sait, dit-il, si je n’ai pas des droits par là? Mais je ne demande pas tout à la fois. Me voilà duc et Grand d’Espagne. C’est une fortune, aujourd’hui que tout le monde prêche la démocratie.
Achille dit cela tout haut, parce qu’il était dans la montagne. Devant des Parisiens, il n’eût pas manqué de parler de ses parchemins comme d’une vaine trouvaille.
Il se rappela que le prince Rio s’indignait contre «les vieux clichés» du livre héraldique, disant que depuis qu’il y avait des hommes il n’y avait plus de gentilshommes. Mais si on n’eût pas dit à chaque instant: «Mon cher prince,» il se fût bien plus indigné.
Achille dit adieu à l’héritage sacré. Je ne parle pas des parchemins. Il pensa un instant, comme son aïeul, à se dépouiller de toutes les vanités humaines et à vivre dans la montagne. Roi de la montagne, avec un cortège de courtisans sauvages, avec une liste civile de bois et de prairies, avec une Chambre de représentants composée d’ours, d’isards, de loups et autres aimables démocrates qui veulent manger le roi et qui refusent de payer des contributions, n’était-ce pas réaliser un rêve comme un autre? Mais, tout bien considéré, Achille était trop enraciné à Paris pour vivre aux Pyrénées.
Il conduisit sa mère et sa sœur à Toulouse; il passa quelques jours à Tarbes et à Pau, tout occupé à se faire un attelage de chevaux du pays.
Le comte de Harken, qui était revenu aux Pyrénées, lui conseilla, en voyant ses parchemins, de faire le voyage d’Espagne.
Achille partit pour Madrid. Ce lui fut une vraie joie de voir la reine Isabelle, qui lui dit avec son charmant sourire éclairé par ses yeux bleus:
–Couvre-toi, Santa-Cruz, tu es Grand d’Espagne.
Ce fut la reine elle-même qui lui fit l’histoire de son aïeul. Elle lui donna la commanderie d’Isabelle la Catholique et le grand cordon de Charles III en lui disant avec sa grâce spirituelle:
–Ce sont des chaînes qui t’attachent à l’Espagne.
On lui promit à la Cour qu’il retrouverait les épaves de la fortune de ses ancêtres.
Ce fut à son retour d’Espagne, en s’arrêtant à Pau, qu’il rencontra madame de Campagnac.
On sait déjà son roman avec elle aux Eaux-Bonnes.