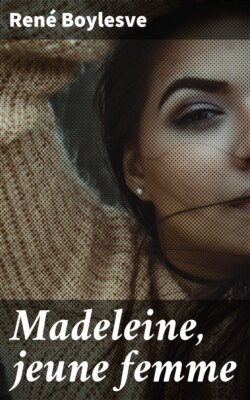Читать книгу Madeleine, jeune femme - Boylesve René - Страница 5
III
ОглавлениеNotre appartement était situé rue de Courcelles, presque au coin de l'avenue Hoche, et on l'eût pu croire riche comme la maison elle-même, comme le quartier; mais en réalité, il était fort exigu, très bas de plafond, et même mansardé, sauf le salon et la salle à manger. En fait, et de l'aveu de mon mari, ce logement extrêmement modeste avait été escamoté par l'architecte, sous les combles d'un immeuble opulent, un peu au détriment de la quantité d'air respirable dans les chambres de domestiques.
D'une fenêtre de mon salon «en rotonde», on surprenait, comme par une porte entre-bâillée, une mince parcelle du parc Monceau, entre deux hôtels. Cela rappelait une de ces images, aux proportions excentriques, qui montent le long du texte d'un roman illustré, et où tous les objets représentés sont taillés, impitoyablement, à la façon des charmilles, mais s'épanouissent, en haut, sur toute la largeur de la page. Dans le haut de la page, je voyais la cime, à cette époque encore feuillue et dorée, des platanes et des ormes.
En m'installant dans mon appartement, je venais souvent à cette fenêtre, et, lorsque je refeuillette aujourd'hui ma vie de femme, qui commence là, cette vue m'apparaît bien en effet comme la vignette-frontispice d'un livre devenu très familier, mais dont on a longtemps regardé les images avant de se décider à le lire...
Dans ma fluette bande de parc Monceau, on voyait passer des coupés, des victorias, des fiacres: jamais tout entiers; du moins, on voyait une fraction de cheval, puis le cheval, et quand la voiture apparaissait, le cheval déjà était éclipsé. On voyait des passants, d'assez beau monde qu'il fallait regarder vite, vite, des nourrices, le marmot au poing, des petits jeunes gens en uniforme des Pères, qui me rappelaient mon frère Paul quand il était au collège, et des fillettes en quantité, fouettant à tour de bras leur «sabot», mais tout cela mouvant et éphémère, emporté et remplacé aussitôt que posé. C'était un peu agaçant, et pourtant attrayant pour moi, car, si étranglé que fût ce spectacle, c'était une réduction infinitésimale de la vie de Paris qui s'offrait là, de cette vie de Paris si prestigieuse pour tous ceux qui lui sont étrangers.
Elle était pour moi si prestigieuse, cette vie de Paris, que j'en avais peur. Loin d'être attirée vers elle par la curiosité, j'éprouvais une appréhension à mettre le pied dans la rue. Pendant des jours, mon mari ne réussit pas à m'entraîner avec lui seulement jusqu'à l'Étoile. Mais il tenait ma claustration volontaire pour une des premières manifestations de mon goût pour la vie d'intérieur, et j'ai su qu'il s'en félicitait. Le dimanche, il fallut bien aller à la messe; mon mari m'y accompagna, et je traversai ainsi pour la première fois le parc Monceau.
Nos concierges, monsieur et madame Bailloche, l'un sur le pas de la porte et fumant sa pipe, l'autre ayant ouvert pour me mieux voir le carreau de sa loge, me firent à mon insu passer un examen détaillé et qui fut, paraît-il, favorable; tous les deux depuis lors se montrèrent pleins de prévenances.
Il s'agissait de ne plus hésiter à présenter nos civilités à la famille de mon mari. Nous avions un peu tardé. Pour un homme formaliste comme l'était mon mari, cela prenait des airs de négligence. Mais, quant à ses devoirs familiaux, précisément, l'homme correct était combattu en lui par l'homme correct lui-même: le père et la mère de mon mari vivaient séparés de corps et de biens depuis plus de vingt ans, ce qui plaçait leur fils, surtout vis-à-vis de moi, jeune provinciale, dans une situation très incommodante; de plus, la sœur de mon mari, qui habitait avec la maman Serpe, était divorcée, et je sentais bien qu'il ne souhaitait pas que j'eusse des relations très assidues avec elle. Cependant, telle qu'elle était, la famille était la famille, et mon mari professait sur les devoirs de famille des principes intransigeants, fondés surtout, par réaction, je le crois, sur l'exemple de sa famille.
Le plus facile à voir, pour moi, était le vieux papa Serpe avec lequel je m'étais assez bien entendue lorsqu'il était venu à Chinon demander ma main pour son fils. Ne me plaisait-il pas même mieux que son fils, ce pauvre bonhomme que nous avions d'abord chargé de tous les torts en son ménage malheureux? Et ce n'était qu'après avoir passé trois jours entiers avec sa femme, au moment de mon mariage, que nos présomptions s'étaient retournées en sa faveur. Au fond, je ne savais rien de mes beaux-parents, tant la correction de mon mari le rendait discret. Mais ce que je redoutais, c'était la visite à ma nouvelle belle-sœur, la divorcée, qui n'avait point assisté à mon mariage. Je ne lui en voulais point, mais la discrétion, alors vraiment excessive de mon mari à l'égard de tout ce qui concernait cette sœur, plus jeune que lui, qu'il avouait «fort jolie», qui vivait avec sa mère et de qui il ne voulait point, c'était évident, que je me fisse une amie, me rendait un peu timorée à l'idée de l'approcher.
Les deux dames Serpe habitaient boulevard Pereire, presque dans notre voisinage, un petit rez-de-chaussée qui me rappela tout d'abord la province, parce qu'en passant devant ses fenêtres, nous vîmes, derrière le rideau de vitrage à demi relevé, la maman Serpe qui observait le va-et-vient du trottoir, de la chaussée, et peut-être aussi les panaches de vapeur produits par le chemin de fer de ceinture. Mais, aussitôt la porte ouverte, le fouillis d'objets hétéroclites, entassés ou pendants aux murs de l'antichambre, l'amas de tentures orientales, de tessons, de ferrailles, d'ombrelles japonaises, de masques grimaçants, de heaumes, de rondaches, de hallebardes, de fez, de gandourahs, et un parfum de vétiver, me transportèrent bien loin de nos maisons économes de Chinon. Et, une fois dans la pièce où se tenaient madame Serpe et sa fille, nous en fûmes à mille lieues de plus. Mais là, je n'eus d'yeux que pour ma nouvelle belle-sœur, bien qu'il fallût à tout instant prendre garde à mes chevilles que mordillait en aboyant à tue-tête une meute de petits chiens,—ces petits chiens dont l'un avait accompagné madame Serpe lors de mon mariage, ce qui avait produit un effet si désastreux sur ma famille...
Ces dames nous attendaient; mais elles ne se séparaient jamais de leurs petits chiens, et pendant un quart d'heure il n'y eut aucun moyen d'échanger deux paroles; nous poussions tous des hurlements pour dominer le vacarme des chiens, et les mots que nous tâchions de faire entendre n'avaient trait, naturellement, qu'à ces intéressantes bêtes. Mon mari, non pas surpris, mais froissé dans son goût de la correction, fronçait les sourcils; sa sœur, au contraire, riait de voir la grimace qu'il faisait. Cette mystérieuse belle-sœur me parut moins jolie que je ne me l'étais imaginée, mais c'est que je n'étais point faite à ce genre de beauté-là. Le type de la beauté, pour moi, n'était-il pas encore celui de madame du Cange, mon ancienne maîtresse générale au couvent du Sacré-Cœur? Une régularité parfaite de tous les traits, la paix de l'âme sur le visage, et une sorte de transfiguration des yeux par le bonheur le plus élevé et le plus pur?... Non, non, ce n'était pas cela le genre de beauté propre à ma nouvelle belle-sœur!... Sa beauté, à elle, me parut indécente. J'avoue cette impression qui paraîtra ridicule, mais qui montre à la fois ce que j'étais, d'où je venais, et ce contre quoi je me trouvais heurtée tout à coup.
Elle était de taille un peu supérieure à la moyenne, et parfaitement proportionnée; elle portait une robe d'intérieur qui moulait la poitrine et découvrait largement le cou rond et frais, quoiqu'elle ne fût plus toute jeune; ses dents magnifiques, ses yeux sombres, cernés, avec une expression à la fois piquante et chagrine, inconnue de moi, et son lourd casque de cheveux formaient un type de femme pour moi étranger et surprenant. Au cours de notre voyage en Italie, mon mari m'avait signalé, à table d'hôte, une femme de ce genre en me disant qu'elle lui rappelait sa sœur d'une façon tout à fait frappante, et il avait été bien ennuyé, ensuite, de m'avoir dit cela, parce que dans le hall de l'hôtel, aux sons d'une valse langoureuse, cette femme s'abandonna, au cou de son compagnon, à des transports qui choquèrent beaucoup les personnes présentes.
Elle me parla de Venise, bien entendu; c'était le sujet de conversation inévitable; elle connaissait Venise, et pour y avoir fait, elle aussi, son voyage de noces, de sorte qu'à tout propos elle disait: «Oui, je sais ce que c'est...» d'un air de deviner ce qui m'y avait frappée le plus; et toutes les fois qu'il y avait une défaillance dans mes souvenirs, elle ajoutait: «Je connais ça, vous étiez distraite!...» et elle avait un sourire malicieux et ambigu qui me gênait et dont je ne compris pas tout de suite le sens. Puis elle m'entraîna à part, sous prétexte de voir ma robe au jour. Elle m'inspectait de la tête aux pieds, me faisait force compliments que je ne sentais pas sincères, car la robe que je portais avait été faite en province et ne devait pas satisfaire une femme de Paris et coquette. Elle me dit: «Vous êtes belle fille! allons, allons, je ne plains pas mon gredin de frère...» Et elle riait, et elle semblait étonnée que je ne rie pas comme elle. Elle sauta tout à coup à une certaine eau qui faisait merveille pour les soins de la peau, à l'hygiène qu'elle employait pour se faire maigrir, à un ténor qu'elle avait vu la veille à l'Opéra et qui était «si beau garçon, si beau garçon!...» au rouge qu'elle employait pour les lèvres, et elle me dit: «Oh! vous, vous n'en avez pas besoin, et, d'ailleurs, il ne tiendrait pas longtemps!...» et de rire, encore, à sa façon un peu vulgaire. J'étais assez incommodée, non pas tant de son genre de conversation, bien nouveau à mes oreilles, que de ne trouver rien du tout à lui dire; et mon amour-propre était molesté parce que j'avais sûrement l'air d'une petite sotte. Elle m'avait appelée d'emblée: «Madeleine... chère Madeleine»; moi, comme il m'échappait encore des «Madame», elle m'obligea à la nommer sans plus tarder «Emma». Puis elle me glissa à l'oreille:
—Comment appelez-vous votre mari dans l'intimité?
Je devins écarlate, parce qu'elle touchait brusquement un de mes soucis: je n'avais jamais pu encore appeler mon mari par son petit nom: «Achille», qui me déplaisait trop, et je n'avais point trouvé d'autre nom intime à lui donner parce que cela ne se trouve que quand on aime. J'eus peut-être l'air très malheureux, peut-être eut-elle pitié de moi, car elle n'était pas méchante; elle m'embrassa tendrement dans le cou en me disant:
—Dieu! que vous sentez bon!
La maman Serpe qui s'entretenait, à l'autre bout de la pièce avec son fils, nous lança:
—Ah! bien, je vois que la connaissance est faite!
Pour la maman, j'avais pu me convaincre, durant son court séjour à Chinon, que je n'aurais jamais à lui parler que de ses chiens, et spécialement de celui qui avait fait le voyage avec elle. J'eus la chance de le reconnaître parmi la «meute» et de l'appeler sans hésitation «Zuli». Ma belle-mère me trouva «décidément charmante». Elle le dit et le répéta, du moins, mais je sentais que pour elle comme pour sa fille, je n'étais qu'une jeune niaise, et qu'en dessous l'une et l'autre blâmaient mon mari d'avoir été chercher au fond de la province une jeune fille assez quelconque et sans fortune.
Ma belle-mère me parla de mon frère qu'elle avait trouvé, lors du mariage, «si joli garçon!» Elle répéta cette expression, voisine de celle que sa fille venait d'employer pour désigner le ténor, ce qui me donna à penser qu'elle était d'usage fréquent chez ces dames. Mon frère était-il encore à Tours, employé chez son carrossier? Avait-il commis quelque nouvelle fredaine? Et la mère et la fille d'éclater de rire à l'idée des premières folies de Paul, qui nous avaient fait tant pleurer nous autres, à la maison, qui avaient achevé de ruiner ma pauvre maman, et contribué pour beaucoup à mon mariage...
Pour terminer cette première visite, je commis, moi, une de ces sottises mémorables qui s'appellent «gaffes», si je ne me trompe, et qui acheva de poser la cloison entre la famille de mon mari et moi. En racontant l'emploi de ma matinée, je dis que mon mari avait eu la gentillesse de m'accompagner à la messe à Saint-François-de-Sales,—ce qui lui suscita des compliments hyperboliques,—je dis que c'était bien commode d'avoir une église aussi proche; et cette constatation ne trouvant pas d'écho, voilà que, prise de timidité, je lance la première question qui se présente à mon esprit:
—Et vous, de quelle paroisse êtes-vous?
La maman eut l'air aussi embarrassé que si on lui eût demandé la nature du terrain sur lequel reposait l'immeuble qu'elle habitait; Emma cita un nom de paroisse que sa mère s'empressa de nier énergiquement; elles se disputèrent, remontèrent à des souvenirs de mariage qui ne signifiaient rien parce qu'on avait, depuis lors, changé plusieurs fois d'appartement, de rue, de quartier. Par là, toutes deux prouvaient qu'elles n'allaient point à la messe; pourquoi ni l'une ni l'autre n'osa-t-elle dire: «Nous n'allons pas à la messe»? Je ne leur en eusse pas fait un crime: j'avais hérité, je crois, le vieux libéralisme de mon grand-père maternel et même de mon père, pourtant si ferme en ses idées; mais le curieux était que ces dames semblaient avoir honte de ne pas aller à la messe, en même temps qu'elles se moquaient certainement de moi, parce que je n'avais pas pensé qu'elles pussent ne point avoir de religion.
Je les quittai après des embrassements nombreux, mais qui ne remédiaient à rien. Bien que je n'eusse pas fait grand fond sur nos futures relations, bien que mon mari semblât plutôt les redouter, j'étais au désespoir comme je le suis toujours lorsque je me trouve en présence de quelqu'un avec qui il est clair que je ne pourrai jamais m'entendre.
Je demeurais muette dans le fiacre qui nous emportait chez mon beau-père, loin de sa famille, au quartier Latin.
Mon mari était d'une circonspection extrême; non seulement il ne se lançait jamais qu'à contre-cœur dans une conversation sur des sujets d'ordre moral, où il était malhabile et craignait sans cesse de se compromettre, mais il avait décidé, dans son for intérieur, de me laisser moi-même me débrouiller dans le chaos d'exemples que la vie de Paris devait me fournir, se fiant beaucoup au bon sens naturel qu'il se plaisait à reconnaître en moi, un peu aussi à mon ingénuité. De cette façon, il évitait, selon son expression, de me «raser» avec des sermons.
Le papa Serpe, lui, habitait, rue Monge, un tout petit appartement composé de deux pièces et d'une cuisine, au quatrième. Une femme de journée montait faire son lit, ses repas; il vivait seul, sur sa maigre retraite d'ancien chef de bureau; «ces messieurs de la Marine», comme il disait, venaient parfois lui faire une petite visite; quand il était ingambe, il descendait jusqu'au square, jusqu'aux quais, ou bien il allait, par la rue Clovis et le Panthéon, au jardin du Luxembourg. Ce pauvre bonhomme solitaire, et pas du tout déplaisant, m'émut d'une sincère pitié, et je témoignai à mon mari l'intention de venir souvent voir son père. Mais mon mari, à mon grand étonnement, et quoiqu'il fût fort respectueux de son père, ne le plaignait point, et il tenait le papa Serpe pour le plus heureux de la famille.
—Il vit en sage, me dit-il, et sans soucis d'aucune sorte.
A quelques paroles qui lui échappèrent par la suite, je devinai que le pauvre papa avait surtout été très malheureux en ménage, et que son état, par comparaison, lui semblait parfait depuis qu'il possédait la paix. Ce fut aussi à propos du papa Serpe qu'une particularité du caractère de mon mari se démêla: il était impitoyable pour les gens maladroits; il se moquait constamment de ceux qui n'avaient pas su arranger leur vie. A son avis, évidemment, son père, ou bien avait fait un mariage mal assorti, ou bien s'était montré incapable de gouverner son ménage.
Outre son père, sa mère et sa sœur, mon mari possédait à Paris ses cousins Voulasne. Cela avait été un vif dépit pour lui de ne point voir à Chinon, lors du mariage, ses cousins Voulasne. Il nous avait tant parlé d'eux! Depuis longtemps il décrivait à ma grand'mère éblouie leur hôtel de la rue Pergolèse, leur villa à Dinard; il nous affolait tous en nous racontant leur existence agitée à Paris, énumérant leurs voyages aux quatre coins du monde, entrepris pour un oui, pour un non; c'étaient de très riches cousins. Madame Voulasne, qu'il appelait «ma cousine Henriette», était une excellente femme, presque jeune encore, quoique mère de deux grandes filles de quinze et dix-sept ans, Isabelle et Irène,—cette dernière surnommée Pipette, sans que personne sût pourquoi,—«assurément, deux futures amies pour moi.» Quant au cousin Gustave, c'était «un tout à fait bon homme, ah! qui, par exemple, n'engendrait pas la mélancolie». Et, à propos de voyages «entrepris pour un oui, pour un non,» au moment où nous allions annoncer aux Voulasne la date assez prochaine de la cérémonie, les Voulasne informaient mon fiancé qu'ils partaient, mieux: qu'ils étaient partis pour une croisière en Norvège! Il est vrai qu'ils nous avaient envoyé de là-bas, avec des vues de fjords, des lettres si gaies! et fait envoyer chez nous à Paris le plus cossu de mes cadeaux: tout mon service d'argenterie. Nous avions bien échangé, mes nouvelles cousines et moi, de ces lettres aussi insignifiantes qu'il est possible entre femmes qui ne se sont jamais vues, mais rien n'avait consolé mon mari de cette croisière inopportune, soudainement entreprise quatre semaines avant son mariage.
La première fois que nous rencontrâmes les cousins Voulasne, rue Pergolèse, un bruit d'une nature extraordinaire et qui ne pouvait me rappeler que celui des fléaux battant le blé, nous frappa les oreilles dès l'entrée. Dans un large escalier où un domestique nous précédait, le vacarme s'accrut; nous levions des yeux effarés; le domestique faisait effort pour ne point sourire. Tout à coup mon mari s'écria: «Ah!... c'est Pipette!...» Et nous vîmes au-dessus de nous, sur le premier palier, la plus jeune des demoiselles Voulasne.
Elle était chaussée d'immenses patins de bois, dont j'ignorais le nom, rapportés de Norvège; en essayant de glisser, elle avait dû bousculer tous les meubles, ou bien elle marchait comme avec des bottes de sept lieues. Et elle allait bel et bien s'élancer sur les marches. Mon mari se précipita pour l'en empêcher; mais elle, assurée du sauvetage, raidit les jambes, étendit les bras, et s'abandonna... Mon mari reçut la jeune Pipette contre sa poitrine, tandis qu'un des patins démesurés s'implantait entre les rinceaux de la rampe, si malencontreusement, qu'il fallut s'employer à délier les courroies qui l'attachaient à la cheville.
Pendant cette opération, mon mari, soutenant Pipette comme une gamine, me présentait à elle. Ah! bien, c'était une présentation dénuée de cérémonie!
Elle était d'ailleurs charmante, cette jeune Irène ou Pipette. La figure animée par le singulier exercice dont nous n'avions connu que le finale, ses yeux bleus, allongés, retroussés aux tempes, étincelaient comme ses cheveux de mousse blonde; elle avait le teint d'une fleur de pêcher. Elle m'apprit sans plus tarder que les instruments qu'elle venait de quitter se nommaient des «skis» et elle m'en dit l'usage dans les pays de neige.
—Isabelle, ajouta-t-elle, n'est pas fichue de se tenir debout là-dessus... Quant à Gustave et à Henriette, n'en parlons pas!...
—Qui ça, Gustave?... Qui ça, Henriette?...
Mon mari me souffla que c'étaient le père et la mère de Pipette.
Je souris et songeai à la figure que ferait ma grand'mère si je lui apprenais que j'avais des cousines qui appelaient leur père Gustave et leur mère Henriette!
Enfin, on nous introduit dans un salon qui me paraît vaste et splendide, où j'avise tout de suite un très beau piano à queue, une partition ouverte sur le pupitre: quelle chance!... une maison où l'on fait de la musique!... Et mon mari qui ne m'avait pas dit cela!... Quelle musique joue-t-on ici?... Ah! voyons!... Chansonnette chantée au Concert-Parisien par mademoiselle Dédé:
| Moi, j'cass' des noisettes | } bis |
| En m'asseyant d'sus. | } |
Et il y a sur ce magnifique Érard des piles de cahiers; pas un ne porte le nom des maîtres avec qui j'ai passé de si belles années d'enthousiasme... Mon mari me vantait les grandes dimensions de la pièce, la hauteur des fenêtres; c'était lui qui avait édifié la belle cheminée à hotte d'après un modèle du château de Blois. On entendait des pas à l'étage supérieur, et un lustre énorme faisait tintinnabuler ses pendeloques de cristal. Nous marchions sur des tapis épais; des portes à double battant étaient ouvertes sur d'autres pièces; on apercevait au loin un billard. Tout à coup un monsieur se trouva près de moi, sans que je l'eusse entendu venir, un homme grisonnant, de mine un peu chafouine, des moustaches de chat, relevées au fer, et qui dit:
—Bonjour, mon cher Serpe; présentez-moi donc, je vous prie, à votre charmante femme...
Mon mari me présenta, sans commentaire aucun:
—Monsieur Chauffin.
M. Chauffin, dont je n'avais jamais entendu parler, m'adressa un compliment.
Là-dessus Henriette et Gustave entrèrent, épanouis, joyeux, me donnant tout de suite l'idée d'enfants qui viennent de jouer. Pipette leur ressemblait à l'un et à l'autre.
Henriette vint à moi les bras tendus et m'embrassa ferme sur les deux joues; son mari, le visage souriant et rose, le crâne rond et brillant, me prit les deux mains et me dit sans façon que j'avais bien raison de venir habiter Paris. Ils étaient si francs, si jeunes et si gentils que ce n'étaient pas des gens à qui l'on pût songer à reprocher quelque chose: il ne fut aucunement question de leur absence au mariage. La fille aînée Isabelle était jolie, mais me parut, de toute la famille, la moins aimable. Elle s'avança, la lèvre un peu boudeuse, derrière son père, et me souhaita la bienvenue comme tout le monde, mais d'un air détaché et lointain. Pipette, qui avait décidément le diable au corps, souffla à l'oreille de mon mari:
—Les amours de mademoiselle ne vont pas!
Je l'entendis et ne pus m'empêcher de rire.
Sa mère, sans savoir de quoi il s'agissait, me dit:
—Elle vous scandalisera plus d'une fois, je vous en avertis...
—Mais, ma cousine, je vous prie de croire...
—Oh! oh! je sais, je sais! dit-elle, mon cousin a de la chance d'avoir su dénicher l'oiseau bleu dans le Jardin de la France... A Paris, vous verrez ce que c'est...
Moi, qui étais plutôt disposée à croire que tout était mieux à Paris qu'à Chinon, et qu'en particulier mon éducation offrait beaucoup de points critiquables, je commençai de protester en faveur des usages de Paris. Mais je m'aperçus vite que ces sortes de questions étaient totalement étrangères à la famille Voulasne: ni Gustave ni Henriette ne s'étaient jamais préoccupés de savoir si la méthode des religieuses ou des grand'mères provinciales était ou non supérieure à leur méthode à eux qui consistait à laisser pousser leurs filles au petit bonheur. Madame Voulasne me demanda si j'avais déjà été au théâtre depuis notre arrivée à Paris, si j'avais joué la comédie dans mon pays, et si je chantais. Alors, et aussitôt, M. Chauffin, qui était demeuré là, prit part à la conversation. On préparait chez les Voulasne une soirée pour le mois de décembre, où il s'agissait de jouer une «Revue de fin d'année». La maman y devait tenir le rôle de commère; chacune des filles y figurerait; on me montra les dessins des costumes qu'elles devaient revêtir; on me fit juge dans la question de savoir si Pipette ne pouvait pas s'y montrer en travesti: «Elle est si enfant, disait Henriette, je vous demande un peu si cela tire à conséquence!... Il y a des gens, dit-elle, en se tournant vers Isabelle, l'aînée, la boudeuse, qui sont décidés à voir le mal partout...» Gustave, entre autres rôles qui lui étaient échus, se promettait grand plaisir de jouer le «kanguroo boxeur». Madame Voulasne m'entraîna à part pour me dire:
—Est-ce que vous ne seriez pas heureuse, ma chère cousine, d'entendre applaudir votre mari?... Tâchez donc de le décider à faire assaut avec le kanguroo!...
Je dus promettre mon intervention, moyennant quoi je remarquai que je pénétrais dans les bonnes grâces des cousins Voulasne. Gustave lui-même, qui, au début, et malgré ses gentillesses, semblait un peu méfiant vis-à-vis d'une ex-jeune fille aussi bien élevée que moi, me fit mille grâces, me promit maints agréments dans sa maison, et, enfin, croyant m'être tout à fait agréable, me dit:
—Et puis, vous savez, ce n'est pas ici qu'on vous demandera jamais de jouer du Wagner!...
Et il riait, mon bon cousin Voulasne, et il était si satisfait de m'avoir dit cela, que c'en était touchant!
Les choses allaient si bien que l'on nous fit, séance tenante, les honneurs d'une répétition partielle.
D'un portefeuille de ministre, M. Chauffin, sans se départir de son flegme, tira des partitions corrigées à la main et des pages manuscrites, s'assit au beau piano et chantonna d'une voix grise et sale, où il mettait, disait-il, «toute la canaillerie voulue». Dans la revue, c'était lui qui composait les couplets.
Mon mari était radieux en quittant la rue Pergolèse; il me dit:
—Vous avez gagné les cousins, j'en suis bien aise!
—Qui est-ce donc, demandai-je, que ce monsieur Chauffin?
—Un ami qui leur a fait acheter l'hôtel où vous les avez vus, et qui les distrait.
—Mais à qui votre cousine faisait-elle allusion en disant: «Il y a des gens qui sont décidés à voir le mal partout?»
—C'est aux Du Toit. Les Du Toit ont un fils, nommé Albéric, qui aime Isabelle et qu'Isabelle aime davantage. Monsieur Du Toit est président du tribunal civil. Ce sont des gens d'une correction un peu rococo, qui ne se plaisent pas beaucoup chez les Voulasne, surtout depuis que les cousins sont lancés, mais qui y viennent cependant, parce que leur fidélité envers leurs anciennes relations est à toute épreuve. Ils blâment le travesti pour une jeune fille. Ma cousine ne peut pas les souffrir.
—Alors, la pauvre Isabelle qui aime son Albéric?
—Oh! le mariage se fera quand même, tôt ou tard; parce que les parents d'aujourd'hui ne s'opposent plus guère à un mariage qui plaît à leurs enfants...
Mais je dus exposer à mon mari la raison qui m'avait valu de «gagner» ses cousins. Lorsque je lui eus confessé la mission acceptée par moi, il fut tout chagrin. Il n'aimait pas à se costumer, à moins que ce ne fût, disait-il, «en personnage noble», à cause de sa situation. Déjà, à plusieurs reprises, il avait dû recourir à des stratagèmes pour échapper aux instances de ses cousins Voulasne qui refusaient obstinément d'admettre qu'on ne s'amusât pas là où ils prenaient, eux, leur plaisir.
—Ils m'en gardent une dent, disait-il; je suis sûr que c'est à cause de cela qu'ils ne sont pas venus au mariage...
Pendant des jours, il ne sut à quel parti se résoudre. Il me demandait mon avis, et j'étais bien embarrassée de le lui donner. Pour moi, l'idée de se déguiser en kanguroo me paraissait puérile ou ridicule, mais je ne jugeais pas selon l'opinion de Paris; je jugeais avec le dédain que mes parents, qui, sur les spectacles, n'étaient pas loin de penser comme Bossuet, professaient pour tout ce qui était susceptible de ravaler «la dignité de l'homme». Mais je sentais que de si grands motifs ne seraient pas de mise. Depuis mon mariage, je remarquais que les raisons de juger les choses et les gens diminuaient progressivement de gravité, et, accoutumée que j'étais à mesurer tous les actes par rapport à une certaine altitude, j'avais de plus en plus de peine à savoir que penser et que dire. Dès que ce n'est plus Dieu qui est le point de départ et l'aboutissement de tout, comme tout change!...
Jusqu'à présent, aux heures où je me trouvais seule avec mon mari, surtout aux repas et dans la soirée, le sujet de la conversation entre nous avait été presque uniquement notre installation, ce qu'elle avait d'incomplet, ce par quoi nous pourrions l'améliorer; le transport d'un meuble d'une place à une autre, le tamponnement d'une patère, le vide de telle encoignure où une console était indispensable, faisaient le principal objet des pensées d'un architecte ami du confortable; et j'avoue humblement que j'y prenais intérêt, en attendant mieux. L'affaire du kanguroo vint donner un peu d'ampleur à nos propos. Jamais les bons cousins Voulasne ne se doutèrent de l'angoisse où leur proposition nous plongea. Et cette angoisse était accrue chez mon mari par la crainte qu'il ne m'en demeurât une impression défavorable aux Voulasne. A tout prix, je le sentais bien, il tenait à ce que les Voulasne m'eussent conquise, comme j'avais conquis, affirmait-il, les Voulasne; aussi n'agitait-il la question du kanguroo qu'en y mêlant d'hyperboliques louanges de ses cousins, mais il ne pouvait se retenir d'agiter la question du kanguroo. J'en souriais, bien qu'elle m'ennuyât autant que lui, et par la difficulté présente et par ce qu'elle me faisait augurer de difficultés à venir. Nous devions revoir les Voulasne avant la fin de la semaine, et il fallait qu'à cette date une détermination fût prise.