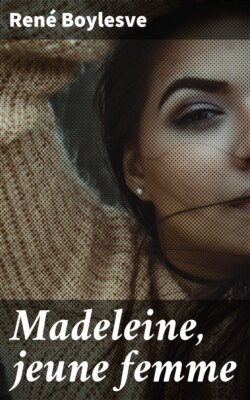Читать книгу Madeleine, jeune femme - Boylesve René - Страница 9
VI
Оглавление—Mais, dis-je un jour, en souriant, à mon mari, je m'aperçois que vous n'avez que de mauvaises fréquentations!...
Je ne voulais pas dire qu'il ne voyait qu'un monde inavouable, mais que, étant célibataire, il n'avait pas songé à se ménager les gens qu'on aime, une fois marié, à réunir à sa table. Et c'est un choix qu'il n'est pas si aisé d'improviser.
Voyait-il l'entourage de sa mère et de sa sœur? Et quel était, d'ailleurs, cet entourage? Impossible de le faire parler là-dessus; ce voile tendu sur son passé ne me fut découvert que par lambeaux qui tombèrent d'année en année. Les amis des Voulasne, voilà quels étaient ses amis. Eh bien! les allait-il renier, ou se disposait-il à me les faire adopter? Le loisir nous manquait déjà pour méditer ou discuter ensemble cette question, car, sans plus tarder, les amis des Voulasne nous priaient à dîner.
La plupart de ces messieurs étaient des industriels, des fabricants; il y avait un parfumeur, un chemisier, quelques gens de bourse, un commissaire-priseur, et parmi les intimes des Voulasne, des oisifs tout simplement. Leur éducation, en général, avait été rudimentaire; ils étaient à peu près illettrés, informés tout au plus des livres qui faisaient scandale, et n'ayant lu, d'un bout à l'autre, que les gauloiseries d'Armand Silvestre. Mais, comme tout Paris, ils connaissaient le théâtre. Ils me faisaient, à moi, l'effet d'êtres mal équarris, mais ils étaient pleins d'une grosse vie, d'un fort appétit, et leur audace était sans bornes. Leurs femmes étaient ou élégantes, et alors tout toilettes, ou franchement sacrifiées, réduites à néant, telle la pauvre madame Grajat, pour qui j'éprouvais une pitié profonde à cause de la vie désordonnée de son mari et de la misérable mine qu'elle faisait au milieu des papotages sur les couturiers, les courses, les coulisses, et toutes les sortes d'histoires amoureuses.
Grajat avait été un des témoins de mon mari lors du mariage; il était un de ses plus vieux amis, son «grand confrère». Grajat était un homme d'une cinquantaine d'années, mais d'aspect encore jeune, très robuste, grand, bel homme, avec des cheveux gris épais et drus comme un poil de brosse, des yeux d'un bleu céleste, angéliques, inquiétants, l'encolure d'un taureau, des mains de terrassier. Officier de la Légion d'honneur, inspecteur des travaux de la Ville, une fortune faite, il avait de l'argent dans cinq ou six théâtres, et une liaison affichée avec une artiste du Palais-Royal. Il était un adjudicataire important des travaux de l'Exposition universelle qui se préparait, et il avait procuré à mon mari quelques reconstitutions historiques, qui devaient, affirmait Grajat, surtout en ma présence, lui rapporter sinon de gros bénéfices,—car je ne sais quelle combinaison lui barrait le Pactole,—du moins beaucoup d'honneur, et la croix.
Il venait dîner à la maison une fois par semaine. Mon mari invitait avec Grajat quelques-uns de ses anciens camarades. Nous ne pouvions guère être plus de quatre ou cinq à table, car notre salle à manger était celle d'un ménage de poupée, et je n'avais, pour servir, qu'une petite femme de chambre, à la grande humiliation du maître de maison qui, plus que la croix, peut-être, ambitionnait les moyens d'avoir un domestique en livrée.
Entre ces messieurs, il n'était question, dans ce temps-là, quand ce n'était pas du général Boulanger, que de l'Exposition universelle. Il était question de l'Exposition universelle, non pas à un point de vue général, au point de vue du pays, par exemple, ou des sciences, ou des arts, ni même de l'architecture, mais au point de vue des affaires personnelles de tel et tel d'entre eux, en concurrence ou en conflit avec tel ou tel autre, et cela tout le temps du moins que la réunion était dominée par la personne considérable de Grajat. Il est vrai que si la personne considérable de Grajat n'était plus là, elle laissait une trace indélébile sur laquelle tous marchaient à la queue-leu-leu, suivant comme une piste la direction de l'aîné qui avait, en toutes ses entreprises, réussi.
Leur langage m'étonna longtemps par le contraste qu'il offrait avec celui des hommes que j'avais écoutés autour de ma famille. Ni mon grand-père ni mon père n'agissaient en vue de gagner de l'argent; ils avaient une profession dont ils s'acquittaient presque religieusement, en sachant se contenter de ce qu'elle rapportait; et leur esprit était tourné de telle sorte que l'intérêt national, général, ou l'intérêt moral, occupât en toutes circonstances le premier plan.
Grajat était «un entrepreneur»; son souci se bornait à exécuter des opérations fructueuses. Toute considération d'un ordre plus élevé eût entravé son élan. C'était un homme utile, indispensable peut-être, et tous ces messieurs, ses amis, qui se trouvaient autour de lui, à ma table, étaient aussi des hommes utiles, indispensables peut-être, à sa suite, et des hommes dont il serait un peu présomptueux à moi de dédaigner le rôle; mais aucun de ces messieurs, autour de Grajat, n'a jamais dit un mot qui pût me laisser seulement soupçonner qu'il pensait à rien hormis à ses honoraires, à ses affaires, et, pour moi, fille et petite-fille d'hommes voués à la vie morale, étaient et devaient demeurer, en dépit de ces amis de mon mari, entachés d'infériorité.
Nous retrouvions le même état d'esprit chez les Kulm, chez les Lestaffet, chez les Baillé-Calixte, d'autres amis encore des Voulasne, mais avec cette différence que les femmes, dans ces maisons, tenant une grande place et prétendant à l'élégance, chacun s'y efforçait aux belles manières, s'y parait de son mieux, on pourrait dire: s'y endimanchait tous les jours; avec cette différence aussi que, ces maisons étant opulentes, attiraient une clientèle nombreuse où les débris d'une société ancienne et plus polie se mêlaient, quêtant des emplois lucratifs, chantant, dansant, faisant mille pitreries, allant jusqu'à aimer pour obtenir une bouchée de pain.
Madame de Lestaffet d'origine slave, avait conservé, de ce premier chapitre, incertain, de sa biographie, un accent léger qui charmait dans sa bouche. Elle avait une physionomie peu expressive, mais sa grâce de bel animal était encore très puissante sur les hommes. Madame Kulm appartenait à une honorable famille parisienne; elle avait eu, jeune fille, une aventure beaucoup trop retentissante. Elle montrait une figure chiffonnée, un nez de trottin, des dents de souris, des yeux de gavroche crevant de malice. Ces messieurs se racontaient avec stupeur ses audaces. Elle avait le goût vulgaire et s'en flattait. «Avec elle, disaient ces messieurs, à la bonne heure, on est à l'aise!»
Quant à madame Baillé-Calixte, née Calixte, elle était fille d'un restaurateur connu. C'était une femme très instruite, la plus intelligente et de beaucoup, dans ces réunions. Elle avait pour son mari, et pour la situation de son mari, qu'elle confondait avec lui, un dévouement sans limites. Toutes ses inclinations, on le voyait,—on le voyait trop, dans ce monde-là,—étaient pour la vie bourgeoise la plus traditionnelle et conventionnelle, mais, une fois admis le principe qu'une femme peut servir son mari et la situation de son mari, elle ne concevait plus aucun discernement, aucun choix dans les moyens d'atteindre cette fin. Elle adoptait cette société non par penchant mais par vertu; elle l'adoptait de propos délibéré, et elle en adoptait tous les rites, ayant la terreur d'y être suspecte, d'y paraître déplacée. Son mari venait de donner toute l'ampleur d'une industrie à la fabrication des bicyclettes, il avait une foi d'apôtre dans le succès prochain des moyens mécaniques de locomotion. Madame Baillé-Calixte suivait son mari, et «travaillait» avec son mari, dans les milieux où celui-ci trouvait des hommes, des capitaux, et tout un public neuf, pour seconder ses entreprises. Madame Baillé-Calixte, excellente mère de famille, qui avait été la nourrice de ses quatre enfants, qui élevait ses filles avec un soin et des scrupules inouïs, adoptait le ton de madame Kulm et de madame de Lestaffet, se laissait dire des choses «colossales», et parfaitement serrer de près par les jeunes gens, dans l'angoisse qu'on l'accusât d'avoir des mœurs rétrogrades, enfin professait avec une éloquence de brevet supérieur ces théories anarchistes et cette philosophie de courtisanes, qui commençaient à s'insinuer à cette époque parmi nous.
Les Voulasne, eux, eux seuls, en tout cela, s'amusaient franchement et s'amusaient en toute innocence. Pour eux, point de soucis d'affaires, nulle ambition, pas davantage de coquetterie, de flirts, ni de vice non plus à satisfaire. Cousins entre eux, ils avaient joué l'un avec l'autre depuis l'enfance. C'étaient des gens, lui comme elle, dont les parents avaient, de longue date, amassé une fortune par le vieux procédé français du bas de laine, sans laisser soupçonner autour d'eux qu'ils pussent être autres que de petits rentiers vivant convenablement, rue de Turenne, dans le vieux quartier du Marais, sur un budget annuel qui ne dépassait pas dix mille francs. Et ils fussent demeurés là, toute leur vie, c'est probable, sans relations que quelques vieux amis de famille, dont étaient les Du Toit, si M. Chauffin ne leur eût démontré un beau jour, de connivence avec Grajat, qu'ils pourraient être logés dans un hôtel, et dans le plus riche quartier futur de Paris, tout en faisant une magnifique opération, le prix du terrain devant tripler en dix ans, et l'hôtel, tout construit, à demi meublé, étant laissé par-dessus compte. Aussitôt transplantés, installés et guidés par Chauffin ami des plaisirs, ces bonnes gens avaient ouvert les yeux à la vie comme des enfants à leur premier voyage. Changé le quartier, changée l'habitation, changés les témoins ordinaires de leur petite existence, et, surtout, décédés les derniers parents ascendants, il n'avait pas fallu plus de cinq ou six ans pour que le ménage adoptât le train de vie qui aujourd'hui était le sien. Tous deux, d'un naturel enjoué, heureux, un peu puéril, avaient lâché leurs anciens jeux, comme un gamin qu'on met dans une pension nouvelle, et ils appartenaient dorénavant à qui saurait leur indiquer de nouvelles façons de se divertir. Plus que personne, ils étaient disposés à se laisser éblouir par tout ce qui prenait un air de fête; et, sans profession, sans soucis, ils se croyaient, eux, perpétuellement à la fête, rien qu'à la fête, tout entiers à la fête. Ah! que leur façon d'y prendre part et de n'en voir, en bon public, que la face agréable et bonne, était touchante! Je commençais à leur rendre justice. C'étaient vraiment d'excellentes gens.
Lors d'un certain dîner chez les Kulm, on vit pour la première fois, je m'en souviens, une ombre ternir le front des excellents Voulasne. Et la chose était si insolite qu'elle ne put passer inaperçue de personne. Nous en savions la cause; d'autres la devinèrent. Leur fille, Isabelle, contrariée dans son amour pour Albéric Du Toit, menaçait de faire une maladie, sinon pis. Elle refusait de boire et de manger; refusait réunions, parties de plaisir; refusait de s'habiller; refusait même de quitter le lit; elle faisait grève. Les parents, dénués totalement d'autorité, n'ayant jamais accompli un acte de répression, et gâtés par la facilité des relations de parents à enfants tant qu'il ne s'agit entre eux que de plaisirs et tant que les plaisirs sont des jeux, se montraient plus décontenancés que si leur fille se fût compromise. Les bons Voulasne, qui ne croyaient certainement appliquer aucun principe à la vie, étaient en proie à un courroux tout pareil à celui de ma grand'mère Coëffeteau, lorsque je m'étais avisée, moi, d'aimer un jeune homme sans son assentiment: ils obéissaient, comme tout le monde, à de vieilles idées, et entre autres à celle qui veut que l'autorité s'exerce de haut en bas. Cet ordre étant détruit, si près d'eux, ils ne comprenaient plus rien à rien, donnaient leur langue au chat. Henriette hochait la tête, à tout propos, comme si, des jours à venir, pas un ne fût plus fait pour elle; Gustave, morne et boudeur, en voulait à tous de son désagrément domestique, comme un grand gamin qu'il était; et ce qui l'affectait, je crois, davantage, c'était que sa femme avait décidé, pour éloigner Isabelle des Du Toit, de partir pour le Midi, précipitamment, devançant la saison et le groupe d'amis qui servaient à y tuer le temps en leur compagnie. Il y avait, en outre, en perspective, un «dîner de têtes» chez les Baillé-Calixte, pour le Mardi Gras. Gustave eût consenti à tout mariage d'Isabelle qui lui eût permis, à lui, de ne pas quitter Paris demain et de préparer sa «tête» pour le prochain carnaval. Mais Henriette essayait de lui faire entendre que ce n'était pas un gai dîner qu'il manquerait, une fois uni aux Du Toit, mais dix, mais vingt dîners, car ils étaient gens à vous accommoder subrepticement à l'eau bénite, témoin Isabelle, en quelques mois rendue par eux, même à distance, méconnaissable...
J'étais, quant à moi, fort embarrassée, parce qu'Henriette non seulement m'autorisait à lui parler de son ennui, mais me comblait de ses confidences. Ce mariage n'était pas, évidemment, de ceux qu'on juge tout indiqués, étant donnée la dissemblance des mœurs dans l'une et dans l'autre famille; mais enfin, Isabelle était amoureuse... Je ne pouvais me défendre d'en souhaiter la réalisation, personnellement, puisque les Du Toit me plaisaient et puisque j'eusse donné beaucoup pour que leur influence balançât celle des Kulm, des Lestaffet, et des Grajat et Cie. Mon mari, lui, flattait sans vergogne les désirs de ses cousins. Madame Baillé-Calixte trouva moyen d'être initiée aux chuchoteries. On s'aperçut que les Kulm et les Lestaffet savaient tout. Puisqu'il en était ainsi, pourquoi ne pas tenir franchement conciliabule? Henriette Voulasne espérait précisément que l'opinion de ces messieurs déciderait son mari à boucler ses malles au plus vite.
A notre grand étonnement, Grajat, le dernier informé, au seul nom des Du Toit, entama, d'emblée, avec la décision foudroyante qui lui était coutumière, la louange du président, de sa femme, de son fils, de toute sa famille. Il ne prenait l'avis de personne, lui; il se moquait de se jeter à la traverse des intentions de monsieur ou de madame Voulasne; il avait, en cela comme en toutes choses, son idée à lui; quelle était-elle? Nous devions le savoir un jour. En tout cas, chacun pouvait remarquer qu'il mettait, à parler des Du Toit, le feu qu'il employait à traiter une affaire. Mon mari le tira par la manche, le pinça, l'attira à part, lui dit en propres termes qu'il contristait gravement ses cousins. Tous les témoins étaient incommodés de cette indécente ingérence dans une discussion de caractère intime et provoquée par une confidence.
Il se produisit dans les esprits un phénomène que j'ai observé maintes fois depuis, chez ce monde qui faisait fi des délicatesses d'épiderme: c'est qu'une opinion violente les pénétrait comme un caillou lancé dans la glaise. La force la plus hostile, pourvu qu'elle fût un peu rude, et bien assénée, s'imposait à eux comme à des êtres stupides. Tous ces gens avaient de la santé, de la vigueur, un élan de vie merveilleux; ils semblaient très forts; eh bien! leur organisme excellent était d'une insigne lâcheté. Ils capitulaient, faute d'arguments moraux. La balourdise de Grajat, qui avait paru incongrue, par le fait seul qu'elle se maintenait, et sur le ton péremptoire, se gagna des approbateurs. Ah! les grandes capacités de M. Du Toit, son crédit, son influence au Palais, nous furent révélés ce soir-là! Pour certains de ces messieurs, sans cesse à l'affût des puissances, les ressources que pouvait offrir la parenté du président Du Toit étaient d'un effet sûr; mais de cela les Voulasne, seuls, justement, auraient pu se moquer, insouciants, sans besoins, sans affaires, et qui, d'ailleurs, depuis toujours avaient eu à eux les Du Toit. Eh bien! les Voulasne subirent le mouvement que suscitait la volonté brutale de Grajat. Henriette, l'innocente Henriette en était abasourdie tout d'abord; puis, en très peu de temps, si pauvre était sa résistance, qu'on la vit rougissante, humiliée, presque honteuse... Alors, vraiment! tout le monde était d'avis qu'Isabelle fût unie aux Du Toit?... Elle semblait, et son mari comme elle, nous regarder d'en bas, comme font les enfants. Elle et son mari regardèrent de même leur ami Chauffin.
Tout le monde était d'avis qu'Isabelle fût unie aux Du Toit.
Il y avait une pointe de comique dans l'attitude de nos bons cousins. Je ne pus m'empêcher de le faire remarquer à mon mari, aussitôt dans la voiture qui nous ramenait à la maison. Il fut très étonné. Rire des Voulasne, fût-ce sans malice, mon mari y était d'autant moins disposé qu'il obéissait comme eux à la direction de Grajat. Grajat lui avait beaucoup parlé, en particulier, vers la fin de la soirée. Que lui avait-il pu dire, pour que le mariage d'Isabelle Voulasne et d'Albéric Du Toit fût devenu chez nous comme un commandement de Dieu?
—Grajat?... dis-je à mon mari, Grajat a tout simplement voulu m'être agréable, à moi personnellement, car il savait ma sympathie pour les Du Toit...
Mon mari ne prisa pas non plus cette allusion aux galanteries dont Grajat, en effet, me comblait depuis le jour de mon mariage, mais me comblait avec une liberté, une outrance, qui les rendait bénignes, insignifiantes.
J'aurais voulu qu'on m'accordât que j'avais bien jugé, du premier coup, les Du Toit, puisque, après moi, un homme comme Grajat les déclarait si précieux à posséder parmi ses proches. Ah! bien, ouiche! les raisons qu'avait Grajat de prôner le président du tribunal civil étaient d'une autre qualité!...
En attendant, me voilà d'accord avec Grajat, obligée à tenir Grajat pour un sauveteur, à lui manifester ma reconnaissance, à me montrer son alliée dans une entreprise conforme à mes vœux! Grajat, malgré ses galanteries, se souciait assez peu, je crois, que je lui fisse bonne ou mauvaise figure; on eût même dit que mon hostilité secrète le piquait favorablement; il me taquinait davantage ou me prodiguait plus de grâces, à sa façon, quand je lui opposais cette froideur glaciale qui me valut de lui le surnom de «Banquise». Lorsqu'il nous emmenait au théâtre, ou nous en ramenait, dans sa voiture, il ne manquait pas de dire: «La voiture de madame la Banquise est avancée», et c'était un mot qui déridait mon mari. Toutefois, comme je me défendais moins de ses loges ou de ses fauteuils depuis que nous menions même campagne, nous allions, grâce à lui, souvent avec lui, au moins deux fois la semaine au théâtre. Je serais mal venue à le regretter, car cela ne m'était ni désagréable, ni inutile, et s'il est vrai que sans son intervention nous serions allés tout de même au théâtre, je n'aurais cependant pas vu le quart des pièces que je connus à cette époque-là, car nous étions très économes.
Il va sans dire qu'un Grajat, même galant, n'allait pas me demander quels spectacles je préférais. Pour mon mari, d'ailleurs, tout coupon était le bienvenu, où qu'il vous donnât le droit d'aller, du moment qu'il était de faveur.
Va donc pour les théâtres auxquels Grajat s'intéresse! Va pour les pitreries qui font le bonheur des Voulasne!...
Et avec cela, mon mari tenait à ne point me laisser perdre le type qu'il aimait en moi, le type de la femme irréprochable, le type de ce qu'on nommait encore, dans ce temps-là, «la femme comme il faut». Ce n'était pas, chez lui, une exigence de forme tyrannique et qui se traduisît par des paroles précises, mais c'était une exigence plus tenace que celles qui s'expriment; je la sentais fondamentale, instinctive, peut-être même inconsciente.
Avec sa complaisance pour le goût de bouis-bouis des Voulasne, pour les spectacles pimentés de son ami Grajat, se douterait-on de la préférence de mon mari? C'était de voir et de me faire voir, en quelque pièce qu'elle jouât, mademoiselle Bartet, de la Comédie-Française, qui incarnait à ses yeux l'idéale figure de la femme distinguée. Pour aller voir mademoiselle Bartet, il payait ses fauteuils; il l'allait voir sans hésitation, si par hasard Grajat, les Voulasne ou son monde ordinaire lui manquaient. «Que faisons-nous ce soir?... Si nous allions voir jouer Bartet?...» Alors par exemple, je partageais son plaisir. J'aimais autant que lui mademoiselle Bartet; j'aimais à le voir admirer cette femme exquise, et je me disais: «Pour qu'il l'admire, il faut qu'il comprenne ou sente et apprécie tout ce que cette artiste met de profond, de délicat et même de subtil dans le ton de sa voix, dans la réserve de ses attitudes et dans tout ce qu'elle laisse à deviner de son âme pudique et ardente. Celui qui est capable de s'enthousiasmer pour une si totale absence de mauvais goût, quel goût ne doit-il pas avoir? Et celui qui a ce goût-là, comment ne serait-il pas écœuré de ce que nous voyons en fait de spectacles ou en fait de gens, tous les jours? Pendant longtemps j'ai voulu croire que mon mari avait, lui aussi, une pudeur de montrer quelque chose de délicieux en lui-même. Pendant longtemps j'ai imaginé que sous son enveloppe si mate et si impénétrable, peut-être cachait-il une sensibilité effarouchable et d'autant plus charmante.
Je me souviens de lui avoir fait remarquer, un jour:
—Mais des femmes comme les héroïnes qu'incarne mademoiselle Bartet, c'est une puissante vie intérieure qui les fait, c'est une vie morale très élevée qui leur donne tant d'attraits en leur permettant de si bien parler de ce qui se passe en elles; des femmes si intéressantes, ce sont des femmes chez qui il se passe beaucoup de choses; il leur faut de la retenue, mais aussi de la passion, des émotions, noblement refrénées, mais qui résultent de conflits terribles, et il faut, par-dessus tout cela, l'usage d'un monde où l'esprit soit délié et cultivé, soit honoré par tous et mis au premier plan!...
Il ne disait pas non, il ne disait pas oui; il avait trop de mal à analyser les caractères et jusqu'à ses propres sentiments.