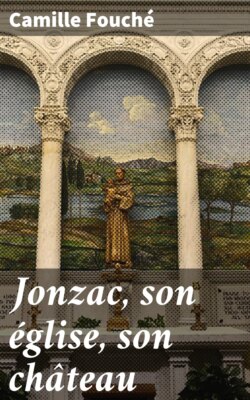Читать книгу Jonzac, son église, son château - Camille Fouché - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE IV
Table des matières
Histoire
L’église de Jonzac était à l’origine une simple chapelle faisant partie de la paroisse de Saint-Germain de Lusignan. Elle subit le sort de celle-ci, lorsque Charlemagne en fit don à l’abbaye de Saint-Germain des près à Paris. Elle devint dans la suite un Prieuré-cure.
Au point de vue hiérarchique elle dépendait de l’archiprêtré d’Archiac et était placée sous le patronage du Prieur de St Vivien de Saintes qui en nommait le titulaire. L’évêque de Saintes donnait seulement les pouvoirs de Juridiction. Il en fut ainsi jusqu’à la Révolution.
Le Prieuré royal de St-Vivien de Saintes appartenait à l’Ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Chancelade. Il avait le privilège de nommer à quinze bénéfices ecclésiastiques parmi lesquels se comptait Jonzac. Une cure était en effet un bénéfice: elle comprenait l’Eglise, le presbytère, les fondations pieuses, les terres données «en franche aumône» et les droits que la loi autorisait à percevoir.
Bien que le nominateur fût un religieux, il ne s’ensuivait pas nécessairement que les bénéficiaires fussent des moines. C’est ainsi que les prieurs-curés de Jonzac ont été tantôt des prêtres séculiers, tantôt des chanoines réguliers. Toutefois, il est à remarquer que, pendant tout le XVIIIe siècle, ils appartenaient à l’ordre des Augustins.
En quoi consistaient exactement les revenus de ce bénéfice?
Il serait peut-être aujourd’hui difficile de l’établir et jusqu’ici nos recherches ont donné peu de résultats.
Après la mort sur l’échafaud révolutionnaire, en 1794, du dernier prieur, Simon-Pierre de Ribeyreys, on déclara qu’il ne laissait personnellement que des meubles qui furent vendus au profit de la nation. Le presbytère ainsi que les autres biens de la cure furent confisqués, en vertu de l’inique jugement qui le condamnait à mort. C’était une maison peu confortable qu’il avait lui-même fait rebâtir et dans laquelle cependant se logea provisoirement le sous-Préfet dès que Jonzac devint chef-lieu d’arrondissement .
Mais, sur quoi étaient établis ces revenus?
D’après le Pouillé du diocèse de 1683, ces revenus étaient de 1.200 livres; mais, au moment de la Révolution, ils étaient de 4000 livres.
Lorsqu’en 1326, pour subvenir aux pressants besoins de l’église romaine, le Pape, Jean XXII ordonna une levée de subsid s dans la province de Bordeaux, la part contributive du prieur de Jonzac fut de VI florins d’or. Cela suppose un certain revenu, car le quantum de chaque bénéfice dans cet impôt forcé était matière à débat. Dans le diocèse de Saintes en particulier cette opération financière fut longue et pénible. Il faut donc conclure que si la contribution du prieur de Jonzac fut si élevée, c’est que sa situation n’était pas mauvaise.
«L’église de Jonzac est, nous l’avons dit, sous le vocable de St Gervais et St Frotais, martyrs du 1er siècle, et tout porte à croire que c’est sous le patronage de ces deux saints qu’avaient été successivement placés les édifices sur l’emplacement desquels a été construit le monument actuel.
A ce sujet, il n’y a pas lieu, semble-t-il, d’admettre l’hypothèse du savant auteur de la Chronologie des Evêques de Saintes insinuant que c’est à Charlemagne qu’il faudrait attribuer cette dédicace. «Il n’est pas sans intérêt, dit-il, de relever que l’église de Jonzac a pour patrons Gervais et Protais, martyrs du 1er siècle, à Milan, dont les statues se trouvent au portail de St-Pierre de Saintes. Sans doute Charlemagne qui conquit la Lombardie ne fut point étranger à l’apport de ces saints à Jonzac et à Saintes. Le Prélat diocésain était alors Aton, proche parent de la reine Hildegarde, et intime ami d’Alcuin, familier de Charlemagne.»
Ces raisons ne sont pas sans valeur. Mais, si la parenté de l’évêque de Saintes avec la reine peut permettre de supposer l’apport de reliques de saint Gervais et de saint Protais dans la cathédrale de Saintes, on pourrait toujours se demander pourquoi pareille faveur aurait été réservée à Jonzac?
Rangeons-nous plutôt à l’opinion émise par Mgr Barthe dans sa savante étude sur saint Anthême:
«Cette hypothèse, dit-il, serait impressionnante s’il était démontré que l’église gallicane ignorait le culte des deux martyrs de Milan avant que Charlemagne, de retour de son expédition de Lombardie (772), l’eût propagé dans son royaume. Or, saint Grégoire de Tours nous apprend que le culte et les reliques des deux martyrs milanais étaient répandus déjà de son temps (580) dans toute la Gaule, horum reliquiœ.. per totuni ambitum, Deo propitio, (miracles à l’appui) dilatatœ sunt. Quant aux statues du portail de Saint-Pierre (de Saintes), il est bon de rappeler que si l’évêque Pierre de Confolens a été le fondateur de cette magnifique église, il ne fut pas seul à l’embellir; ses successeurs y prirent leur part, notamment Guillaume II, dit Gardras. Ce prélat appartenait à une famille de seigneurs des environs de Jonzac. Il a pu offrir au saint particulièrement honoré dans son pays natal, un culte d’honneur dans sa cathédrale, et c’est ce qui expliquerait d’abord, le culte de saint Gervais dans la cathédrale du XIIe siècle, ensuite la présence de sa statue au grand portail sculpté au XVe siècle.»
Il ne semble donc pas douteux que l’église de Jonzac était déjà sous le vocable de saint Gervais et saint Protais lorsque Charlemagne y déposa le corps de saint Anthême en 779.
Il ne serait peut-être pas téméraire d’affirmer que cette église fut placée sous le patronage de ces deux saints dès que leur culte se fut répandu dans les Gaules. Qui sait si cette dédicace ne coïncide pas avec une réparation importante ou une reconstruction de l’édifice primitif?