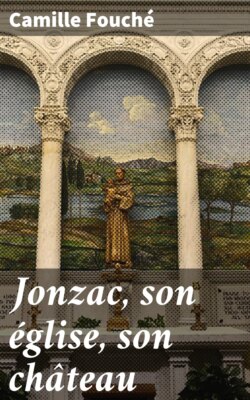Читать книгу Jonzac, son église, son château - Camille Fouché - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’Eglise
ОглавлениеUn décret du 17 février 1800 a fait de la petite ville de Jonzac un chef-lieu d’arrondissement. Cette date est le point de départ de son extension et de son embellissement. Comme la Salente de Fénelon elle semble s’être élevée comme par enchantement, tant ses pacifiques habitants ont eu à cœur de justifier un choix déterminé cependant plutôt par sa position géographique que par son importance. Ils ont voulu surtout mériter pour leur cité le titre de «ville» qui jusque là lui avait été contesté.
Son passé n’est pas cependant sans gloire.
Depuis l’occupation romaine, pendant laquelle elle était une des stations militaires de la grande voie de Blaye à Ebéon par Cognac; surtout depuis les temps héroïques où Charlemagne, luttant contre les Sarrasins d’Espagne, a rempli notre Saintonge du bruit de ses exploits jusqu’au jour où son curé monta sur l’échafaud, victime de la fureur des Jacobins, nombreux sont les hauts faits qui forment la trame de sa longue histoire. Les épaisses murailles de son antique château-fort nous renvoient les échos des chevauchées du moyen âge, des tragiques épisodes de la guerre de Cent ans, des patriotiques efforts de la Gabelle, des luttes fratricides de la Réforme et de nombreuses visites royales. L’intéressante physionomie des hauts et puissants seigneurs qui ont vécu à l’ombre de ses murs a été mise en relief par l’abbé Bertrand de Cognac et nous espérons que la plume de quelque érudit chercheur fera un jour complètement revivre le glorieux passé de la gracieuse cité.
Plus modeste est notre ambition.
Nous voudrions simplement interroger l’antique «basilique» qui depuis huit siècles couronne avec tant de majesté le rocher de Montguitmar. Qui sait si ces vieux murs n’ont pas à nous conter des histoires capables de nous émouvoir? Nos églises ne ressemblent-elles pas à des aïeules recueillies, avares de discours, qui sourient, écoutent et ne répondent que si on les interroge avec tendresse et vénération?
Dieu sait combien nous aimons notre vieille Eglise!
Quels mystères va-t-elle donc nous révéler?
Une église est une page d’histoire sur laquelle chaque siècle a apposé sa griffe. Elle est souvent le seul témoin du passé, car les vieilles pierres offrent à l’action destructrice du temps plus de résistance que la mémoire des hommes. Il est donc louable d’étudier les monuments anciens tant que subsiste leur physionomie générale parce qu’ils évoquent des souvenirs qui constituent l’histoire locale et satisfont les dévots du passé.
Cela est vrai surtout de l’église de Jonzac.
Il suffit en effet de jeter un coup d’œil sur sa façade pour déterminer les différentes époques de sa construction et revivre les événements dont elle a été le témoin.
Lors de l’importante réparation, faite de 1849 à 1854, cette façade fut maintenue dans son état primitif. Malgré son délabrement, elle fournit des indications précieuses: le centre qui correspond par ses dimensions à la nef principale constituait dans le principe l’église tout entière. Cette partie est du XIIe siècle; les bas-côtés, au contraire, sont du XVe. — «Quelques personnes, dit à ce suiet P. D. Rainguet, se sont demandées s’il n’était point de limite au culte de l’antique et si, malgré une détérioration trop évidente, il importait d’enchasser dans une construction moderne une portion quelconque d’édifice minée par le temps et défigurée par la main souvent plus dévastatrice de l’homme ».
Ne nous en plaignons pas; car cet amour de l’antiquité nous permet du moins de fixer aujourd’hui l’époque des différentes restaurations du vieux monument.
L’église de Jonzac se compose d’une vaste nef et de deux bas-côtés. Sa longueur totale est de 37 mètres en œuvre et sa largeur de 22 mètres.
Ces trois nefs dont la principale se prolonge au-delà des collatéraux de la longueur d’une travée ont été — comme il est facile de le constater — restaurées dans la suite des siècles, selon les besoins des temps et surtout selon les ressources dont on disposait. Le peu de symétrie des contreforts, les mutilations dont les murs portent les traces, les vestiges des fenêtres aujourd’hui fermées sont autant de preuves des modifications que le temps et les circonstances ont fait subir au vieil édifice.
La plus importante de ces réparations fut faite de 1849 à 1854. On s’efforça de mettre en harmonie le grand portail de la façade avec la construction d’un clocher qui, depuis le commencement du siècle dernier, avait fait l’objet des vœux de la population. Ce désir était d’ailleurs bien justifié et il semblait naturel que la petite cité moyennageuse, devenue tout à coup un centre administratif important, fût dotée de monuments dignes de son nouveau titre. Un décret du 17 février 1800 avait en effet érigé Jonzac en sous-préfecture; le château-fort était devenu la demeure du représentant du gouvernement; la mairie et la justice de paix y avaient aussi trouvé asîle; la chapelle des Carmes avait été transformée en palais de Justice et les habitants, pris d’une noble émulation, avaient rivalisé de zèle pour donner à leur cité l’aspect d’une ville moderne. On eût dit la Salente de Fénelon sortant du sol comme par enchantement sous l’impulsion puissante d’un nouvel Idomenée.
L’autorité religieuse avait ajouté encore à l’importance de la petite ville en lui donnant un Curé.
En exécution du Concordat qui venait d’être conclu, Jonzac était en effet devenu une Cure de seconde classe et l’évêque de La Rochelle, Mgr Couet du Vivier de Lorry, en avait choisi le titulaire parmi les nobles victimes de la Révolution dont Taillet avait fait un si magnifique éloge; et, le 2 vendémiaire, an XI, René-Antoine de St-Légier, ancien chanoine de Saintes, avait été nommé à la Cure de Jonzac dont il ne put cependant prendre possession qu’après avoir, sur l’ordre de Mgr Michel-François Demandox, prêté le serment de fidélité au gouvernement dans la cathédrale St-Pierre de Saintes, le 6 prairial suivant.
Le modeste Campanile ne suffisait donc plus...
Etait-ce d’ailleurs un Campanile que les deux pilliers informes placés au chevet de l’Eglise pour soutenir la cloche? En 1830, ce massif de maçonnerie était même dans de telles conditions que pour sonner, il fallait «laisser à la toiture une ouverture par laquelle la pluie tombait sur le maître-autel».
On vota alors une somme de 500 francs pour obvier à ce grave inconvénient. Mais, c’était une mesure provisoire; le clocher faisait toujours l’objet des préoccupations et des vœux de tous. Et cependant il fallut attendre vingt ans encore et se résigner à conserver ce que pour satisfaire l’amour-propre l’on décorait du nom de Campanile.
Il fallait donc un clocher, mais un clocher qui ne fût pas seulement «un doigt levé nous montrant le ciel», mais un monument architectural digne de la vieille Eglise et répondant au sentiment de légitime orgueil dont le chauvinisme local était alors pénétré.
La réparation de 1849-1854 a-t-elle réalisé ces espérances?
En tout cas, le but fut poursuivi avec une persévérance digne des plus grands éloges. Le 28 septembre 1854, l’Evêque de La Rochelle, Mgr Clément Villecourt, vint consacrer l’Eglise complètement restaurée et, en félicitant la Municipalité d’avoir par sa persévérance réalisé la pensée de tous, il put à bon droit rendre hommage à l’architecte, M. Fontorbe, à son auxiliaire M. Robin, et à l’entrepreneur, M. Elie Coudin, pour l’œuvre accomplie. Ils avaient réussi, en remplaçant le vieux Campanile par un clocher de style roman, placé au-dessus de la porte principale, à faire de cette construction nouvelle et de l’antique façade un tout harmonieux.
Ce ne fut cependant qu’en 1877, sur l’initiative de M. le Dr Gauron, que les fenêtres ogivales des collatéraux furent achevées par M. Ruth.
Hâtons-nous cependant d’ajouter que cette passion de l’harmonie obligeant l’architecte à supprimer une travée de la grande nef pour y placer le clocher a détruit les proportions de l’édifice qui, elles, étaient parfaitement harmonisées.
C’est tout à fait regrettable.
Du reste, l’extérieur du monument, à l’exception de la façade, donne plutôt une fâcheuse impression et il faut déplorer qu’une raison d’économie sans doute, ait fait placer les trois nefs sous une toiture uniforme, donnant ainsi à l’extérieur de cette église l’aspect d’une vaste halle.
Tout autre est l’impression quand on pénètre dans l’édifice: on ne peut s’empêcher de lui appliquer ce mot de l’Ecriture: omnis gloria filiœ Sion ab intùs, toute la gloire de la fille de Sion est à l’intérieur.
Jonzac. Intérieur de l’Eglise St-Gervais et St-Protais.
L’ensemble est parfait. On se croirait dans une crypte du XIIe siècle aux voûtes surbaissées sur lesquelles toutefois le temps n’aurait pas marqué son empreinte... Une colonnade romane formant six travées, sépare la nef principale de ses bas-côtés et indique tout à la fois ce que devait être l’Eglise primitive et quelle importance avait dû avoir la restauration du XVe siècle.
Pas de transept. Chacun des collatéraux était comme il l’est encore terminé par un mur plat percé d’une large fenêtre romane. Il devait en être ainsi de la nef principale, du moins au moment de la construction des nefs latérales; car les murs de prolongement du chœur sont également de construction romane, percés à droite et à gauche d’une fenêtre de même style et les contreforts qui les terminent indiquent suffisamment que la restauration du chœur et celle des bas-côtés sont de la même époque. Quant à la Rosace remplaçant la fenêtre du fond dans la grande nef, elle date de 1850. Pour agrandir le santcuaire et placer l’autel, on abattit le mur du fond où se trouvait le campanile et on le remplaça par un parpaing dans lequel on perça la Rosace dont il est question.
Peut-on cependant conclure quel’Eglise primitive dont les proportions correspondent à celles de la grande nef actuelle ne se terminait pas par une abside? Nous ne le pensons pas. Le rétrécissement du chœur et la partie du mur précédant les faisceaux de colonnes qui marquent l’entrée du sanctuaire actuel semblent au contraire être l’indice d’une ancienne abside. Cependant, cette hypothèse ne pourrait être admise que pour la construction du XIIe siècle; car les murs actuels semblent bien appartenir à la réparation du XVe, lorsqu’on adjoignit des bas-côtés à l’église primitive.
Mais que reste-t-il des constructions des XIIe et XVe siècles?
Quelques chapiteaux de la nef de gauche: deux couronnent les premières colonnes de la même nef et représentent Adam et Eve tenant la pomme du paradis terrestre; un troisième, surmonte la dernière colonne de droite de la même nef et nous montre un oiseau de proie «bourrant le crâne» d’un patient. Peut-être quelques centimètres de murs et le faisceau de colonnes marquant l’entrée du chœur... C’est tout!!
Le symbolisme est facile à saisir; mais, ce qui est plus évident encore, c’est, à côté de l’action destructrice du temps, l’admirable persévérance de l’homme relevant sans cesse des ruines pour affirmer son immortalité. Ces vestiges des anciens âges semblent dire avec Malherbe:
Je suis vaincu du Temps, je cède à ses outrages,
Mon esprit toutefois, exempt de sa rigueur,
A de quoi témoigner en ces derniers ouvrages
Sa première vigueur.
Les réparations intelligemment faites à ce vieux monument au milieu du siècle dernier lui ont conservé son caractère primitif; la réfection des fenêtres ogivales de la façade des nefs latérales par M. Ruth en 1877, l’ont précisé pour cette partie de l’édifice; et on peut ajouter que la légère peinture dont on a recouvert les murs vers 1895 lui a donné le cachet d’antiquité qui convient à son style.
Enfin, si cet édifice n’est pas digne de passionner un archéologue, du moins, rien n’y peut choquer le goût le plus délicat, et le clair-obscur qui règne sous ses voûtes en fait un sanctuaire propre à élever l’âme et à fortifier la foi du croyant au Dieu caché qui, sous les espèces eucharistiques, substantiellement y réside.
Mais, qu’est-ce qui avait rendu nécessaires ces importantes réparations?
Pourquoi, indépendamment de l’action destructrice du temps, l’antique édifice a-t-il subi toutes les transformations dont il porte les traces!
Il ne semble pas difficile de le conjecturer.
C’est bien sur la colline de Montguitmar que s’établirent les premiers habitants de Jonzac. Ce lieu convenait à merveille pour une station militaire: un rocher assez facile à défendre; au bas de ce rocher, un cours d’eau suffisant pour satisfaire aux nécessités de la vie. Les Romains ne s’y étaient pas trompés. Au centre de cette agglomération que notre imagination peut nous représenter toujours grandissante, un lieu de culte pour rendre à la divinité l’hommage qui lui est dû et satisfaire au besoin de surnaturel qui se trouve en toute créature humaine.
Ce lieu de culte, ce fut un Temple, à l’époque gallo-romaine; ce Temple devint une chapelle après l’établissement du christianisme; c’était une chapelle encore, mais de proportions assez vastes pour être considérée comme une église, lorsque, au VIIIe siècle, Jonzac était un fief relevant de St-Germain de Lusignan et que Charlemagne en faisait don à l’Abbaye de St-Germain des prés à Paris.
Mais déjà Jonzac et son église avaient une certaine importance, puisque c’est cette ville et son église que choisit ce prince, à son retour de sa campagne d’Espagne, en 779, pour y réunir un Concile et y faire déposer les restes de St Anthème, évêque de Poitiers, massacré en haine de la foi, à Cordies par un parti de Sarrasins, quelques années après leur défaite à Poitiers.
Il est même probable que, dès ce temps-là, l’église de Jonzac avait un certain caractère architectural. C’est peut-être pour ce motif que quelques auteurs l’ont décorée du nom de Basilique.
En tout cas, ce fut sur les ruines de cet antique monument que fut édifiée l’Eglise romane du XIIe siècle dont les proportions correspondaient à celles de la grande nef actuelle.
Avec le temps la population s’accrut: la vieille Eglise devint insuffisante; et, au XVe siècle, on y ajouta les bas-côtés qui lui ont donné l’aspect et les dimensions que nous lui voyons aujourd’hui.
Deux cents ans plus tard, pendant les guerres de Religion, à l’action destructrice du temps vint s’ajouter l’action dévastatrice des hommes. La prise de Jonzac par les Réformés lui fut fatale. Agrippa d’Aubigné se vante «d’avoir ravagé la petite ville et d’avoir passé au fil de l’épée tous les habitants qui n’avaient pu se réfugier dans le château». L’Eglise fut saccagée, et, selon leur habitude, les protestants vainqueurs en abattirent les voûtes.
Après la paix, on se mit à réparer le désastre, mais seulement dans la mesure possible: les voûtes abattues furent simplement remplacées par un tillis en bois! C’est ce tillis, qui, maintes fois rapiécé, menaçait ruine lorsqu’eut lieu de 1849 à 1854 la réparation considérable qui s’imposait.