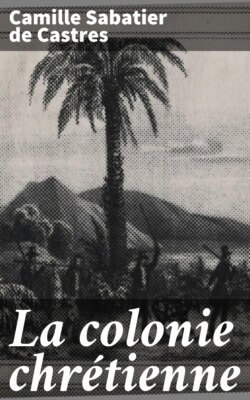Читать книгу La colonie chrétienne - Camille Sabatier de Castres - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introduction.
ОглавлениеTable des matières
Soixante-quinze déportés qui n’avaient pu trouver place sur la Décade, furent le 12avril1798embarqués sur la Capricieuse. La populace de Rochefort prévenue de leur départ, avait fait irruption dans le port et se tenait sur deux files depuis la prison Saint–Maurice jusqu’à la Charente. Quand ils parurent, ayant à leur tète le commissaire du pouvoir exécutif en grande tenue e, le sabre au côte, le chapeau rehaussé d’un énorme plumet tricolore, et la figure radieuse comme en un jour de fête, la populace fit éclater une e joie sauvage et les poursuivit de ses cris et de ses imprécations jusqu’au navire; ensuite elle se dispersa dans la ville, racontant partout le beau spectacle dont elle venait d’être témoin et se vantant d’avoir hurlé anathème contre des proscrits enchaînés qui allaient à deux mille lieues expier dans les déserts de Conanama et de Sinnamary, le crime impardonnable d’avoir laissé voir leurs vertus auprès des vices de leurs tyrans.
Les deux tiers de ces déportés étaient des ecclésiastiques dont quelques uns, simples clercs tonsurés, avaient à peine atteint leur vingtième année, tandis que le plus grand nombre, prêtres blanchis dans les travaux du saint ministère, n’avaient sauvé de la persécution qu’un reste de vie qui semblait devoir bientôt s’éteindre. L’autre tiers renfermait des gens de toutes conditions; députés au conseil des Cinq-Cents, médecins, principaux de collège, cultivateurs, etc., etc., On y remarquait jusqu’à des perruquiers, des cochers et des cordonniers; car malgré les séductions et les, menaces de l’impiété–, la religion comptait dans toutes les classes de fervens prosélytes, et c’était elle surtout qu’en les proscrivant on espérait détruire. Tous entassés sur la Capricieuse, dans un étroit espace, furent en proie à mille privations, a mille souffrances. Les dispositions du local occupé par les déportés, leur nourriture, les réglemens auxquels on les astreignit ayant été sur la Capricieuse et sur la Décade absolument semblables, nous transcrirons ici quelques passages des Mémoires de M. Aymé, embarqué sur ce dernier vaisseau, qui mieux que tout ce que nous pourrions dire, donneront au lecteur une juste idée des maux qu’eurent à supporter durant leur traversée les personnes dont il sera question dans cette histoire.
«Nous fûmes, dit M. Aymé, placés dans l’endroit appelé l’entrepont, situé entre la cale et la batterie. Ce local occupait l’espace entre le mât de misaine et le grand mât, à peu près le quart de la superficie du bâtiment, et avait environ quatre pieds et demi de hauteur. Il ne recevait de jour que par les écoutilles, c’est à-dire par deux ouvertures de trois pieds en carré qui nous servaient d’entrée et de sortie par le moyen d’une échelle dont les échelons avaient à peine trois pouces de saillie. Il n’y avait pas de jour où plusieurs déportés ne tombassent en descendant, et quoique ce ne fût pas de fort haut, les chutes ne laissaient pas que d’être très douloureuses. J’en ai fait deux dont je me suis senti fort long-temps, et quand il fallait entrer avec précipitation, comme le portait la consigne dans les cas qu’elle avait prévus, les accidens étaient bien plus fréquens. Ils se répétaient très souvent dans la descente des passavants à la batterie; elle offrait la même difficulté.
On avait dressé dans cet entrepont des séparations avec des pièces de bois appelées rambardes, qui figuraient un parc dans lequel on enferme le bétail. On y entrait par une porte que l’on fermait à clef. C’était là qu’étaient entassés, pressés, foulés, cent quatre-vingt treize individus la plupart vieux et infirmes. Nous étions couchés sur deux plans formant deux étages, dans des hamacs de grosse toile extrêmement étroits. Le plan supérieur était autant que possible rapproché du pont; mais le poids du corps le faisait tellement baisser qu’il touchait presque le plan inférieur, ce qui était d’une insupportable incommodité pour les malheureux placés dans celui-ci. Les premiers ne pouvaient soulever leur tête sans se heurter rudement au pont, les seconds sans heurter les premiers. Aucun de nous ne faisait le moindre mouvement sans ébranler tous ses voisins, car nous nous touchions tous et ne formions qu’une seule masse. Nous n’avions point d’espace pour nous déshabiller, aussi couchions-nous. habillés, nous borna-nt quand nous étions parvenus à nos places dans nos hamacs, ce qui n’était pas très aisé, à ôter une partie de nos vêtemens. Et pour que rien ne manquât à l’horreur d’une telle situation, comme il ne nous était pas permis de sortir de quatorze heures et quelquefois davantage, on avait placé des baquets au milieu de nous pour satisfaire aux beso ins indispensables. On n’y arrivait qu’en se glissant sous les hamacs et en se traînant sur le ventre; mais quelle insupportable infection ne répandaient-ils pas dans un lieu si resserré, si peu élevé, si mal aéré1-déjà empoisonné par nos seules exhalai-sons! Aussi la colonne d’air qui sortait de ce gouffre était si fétide et si brûlante que les sentinelles placées extérieurement aux écoutilles pour nous garder, demandèrent la diminution de leur faction à un poste si dangereux..
Le matin, après que l’équipage avait lavé le bâtiment, l’ordre était donné de nous faire sortir. C’était un spectacle digne de pitié de nous voir paraître le corps trempé de sueur, les cheveux mêlés, le visage en feu, cherchant à respirer et à tremper par un air pur, l’air pestilentiel dont nous étions gonflés. Nous courions avidement à l’eau de la mer pour nous laver les mains et le visage. Plusieurs de nous ne dédaignaient pas de s’en rincer la bouche malgré son amertume, l’eau douce étant exclusivement réservée pour la boisson. Mais comment présenter le tableau du plus dégoûtant fléau que des hommes accoutumés à la propreté puissent éprouver et dont les soins ni le changement de linge ne peuvent garantir sur un navire, lorsqu’on y est entassé comme nous l’étions? Comment montrer des hommes accoutumés à l’aisance, continuellement occupé, à se garantit.... Ceux qui ont vu quelquefois à la porte de nos temples, des malheureux dévorés par les insectes, livrés à la même occupation, m’entendront suffisamment et pourront se former une idée de cette partie de nos misères.
On nous avait classés de sept en sept pour la distribution des vivres. A huit heures on nous donnait à déjeuner. C’était une petite portion de biscuit à demi pourri et le plus souvent plein de vers, qui nous était délivrée dans un seau de bois appelé gamelle, avec un petit verre d’eau-de-vie pour chacun, dans un vase de bois appelé bidon. A onze heures on nous donnait à dîner. C’était encore du même biscuit avec du lard, ou du bœuf salé, ou de la morue (car nous avions tour à tour l’un de ces trois articles), et un quart de vin, c’est-à-dire, à peu près la quatrième partie d’une bouteille. A quatre ou cinq heures, on nous donnait à souper. C’était toujours du même biscuit, encore un quart de vin et une soupe de grosses fèves, vulgairement appelées gourganes, que l’on donne communément aux chevaux. Outre la mauvaise qualité de ces alimens grossiers, il y avait encore malpropreté et insuffisance. Le cuisinier de l’équipage, qu’on appelle le coq, était bien l’homme le plus sale que j’aie jamais connu; il n’était pas rare de trouver jusqu’à des cheveux dans nos distributions. Les portions étaient très exiguës, et si sur le grand nombre il ne s’était trouvé plusieurs personnes qui, par dégoût, mangeaient fort peu et dont la portion profitait à d’autres, il y en aurait eu beaucoup de ceux-ci qui n’auraient pas eu de quoi se nourrir. J’ai entendu souvent faire des plaintes à ce sujet, je n’ai jamais vu qu’on y ait eu égard. Quant à l’eau, nous en avions à discrétion pour boire, mais quelle eau, grand Dieu! surtout après le tropique, son infection était telle, qu’il fallait se bouc her le nez pour en avaler.
Nous n’avions pour tous ustensiles que la gamelle et le bidon dont j’ai parlé, dans lesquelles se faisaient les distributions de nos repas; on ne nous donna ni couteaux, ni cuillères, ni fourchettes, ni gobelets, chacun y pourvut comme il put. La batterie nous fut affectée pour réfectoire, depuis le grand mât jusqu’au mât de misaine, c’est-à-dire que nous avions à peu près autant d’espace pour manger que pour coucher, avec cette observation néanmoins, que la batterie était sur les extrémités latérales occupée par les canons, et dans le centre par les chaloupes; nous étions donc obligés de manger debout dans l’intervalle qui était entre les chaloupes et les canons, n’ayant ni moyens, ni local suffisant pour nous asseoir; quelques uns se plaçaient sur les canons. A peine les individus de chaque table, se serrant les uns contre les autres et se tournant de biais, avaient-ils au milieu d’eux assez d’espace pour mettre la gamelle et le bidon en les plaçant l’un sur l’autre, et pour peu qu’il y eût de roulis, nous tombions les uns sur les .autres, nous répandions le vin, nous laissions aller sous les pieds et dans les ordures les alimens que nous tenions aux mains et que plusieurs de nous ne relevaient pas moins, car enfin il fallait manger quelque chose. Nous ressemblions à des troupeaux d’animaux qui puisent dans un baquet commun la nourriture qu’on leur donne, avec cette différence qu’ils sont ou peuvent être tranquilles et que nous ne l’étions pas, L’officier de distribution venait ordinairement s’égayer de notre situation, et pour la rendre plus pénible, nous voyions chaque jour passer devant nous les mets aussi abondans que délicats destinés à-l’état-major.
Lorsque nous atteignîmes le tropique, la maladie avait gagné beaucoup d’entre nous. Quelques uns avaient la fièvre, d’autres le scorbut, et le nombre des malades grossissant chaque jour, le capitaine eut peur pour son équipage, peut-être pour lui-même. Comme le principe du mal était essentiellement le mauvais air que nous respirions dans notre tombeau, il décida que de deux heures en deux heures il sortirait pendant la nuit vingt-cinq d’entre nous pour aller sur le pont. Cet adoucissement était fort peu de chose et avait ses inconvéniens, car depuis huit heures jusqu’à six, on venait faire des appels très bruyans; la sortie et la rentrée des vingt-cinq ajoutait encore à ce bruit, en sorte que nous étions éveillés toutes l’es deux heures ou pour mieux dire toute la nuit, car à peine commencions-nous à nous endormir, que la même cérémonie recommençait et produisait le même effet.
D’un autre côté, lorsque nous entrions tous à la fois à six heures dans l’entrepont dont l’air avait été renouvelé dans la journée, nous nous accoutumions insensiblement à sa fétidité; mais lorsqu’au milieu de la nuit nous rentrions dans cette fournaise pestilentielle, c’était une chaleur, c’était une odeur insupportables; à peine avait-on la moitié du corps dedans, qu’on sentait une chaleur aussi pénétrante que si l’on eût été plongé dans un bain très chaud, à peine y était-on en entier qu’on se sentait empoisonné. Je n’ai profité que deux fois de la permission et beaucoup d’autres déportés l’ont refusée; quelques uns cherchaient à se cacher lorsqu’il fallait rentrer, mais ils étaient poursui vis avec le plus grand acharnement par le capitaine d’armes. Il était spécialement chargé de nous faire rentrer au moment du coucher et ne s’acquittait jamais de cette fonction sans fredonner à nos oreilles:
Tyrans, descendez au cercueil!
C’était bien un véritable cercueil que l’endroit où il nous faisait descendre, mais l’on ne se serait pas douté que c’était nous qui étions les tyrans.»
Tout affreuse que fut cette situation des déportés, elle était loin cependant d’égaler en horreurs celle qu’on leur avait préparée à la Guiane. Les mauvais traitemens, les travaux pénibles, les privations de tous genres, l’ardeur du climat, le scorbut, les fièvres les enlevaient par centaine dans cette colonie. Le jeune homme doué d’un tempérament robuste, le mercenaire endurci aux fatigues, succombaient comme le débite vieillard, comme l’homme élevé au sein des douceurs et des loisirs de l’opulence. Aussi, condamner à la déportation était-ce véritablement condamner à la mort. De tous ces malheureux proscrits, il n’en était même pas tin seul qui n’eût préféré la guillotine et les antres supplices en usage avant le18fructidor, à la mort lente et cruelle qui attendait sur le rivage ceux qui avaient échappé durant la traversée. Qui le croirait cependant? de faibles femmes demandèrent comme une grâce et obtinrent de s’embarquer avec leurs maris, leurs frères, leurs enfans, décidées qu’elles étaient à partager leur sort, afin de pouvoir adoucir leurs maux en leur prodiguant ces consolations que sait si bien suggérer un cœur d’épouse, de sœur ou de mère.
Deux femmes animées de ce dévouement sublime, n’ayant pu se faire condamner à la déportation, étaient parvenues à s’embarquer comme passagères sur la Capricieuse ; elles espéraient qu’arrivées à la Guiane, on ne leur refuserait pas d’accompagner leurs époux, et que dans tous les cas elles pourraient leur rendre la traversée moins pénible. Mais, hélas! elles furent cruellement déçues dans leurs espérances. Le commissaire du pouvoir exécutif leur interdit à bord toute communication avec les objets de leur amour.
Pendant la tourmente révolutionnaire qui remua si profondément la société et ramena toute la fange à sa surface, personne ne se montra plus que ce commissaire ingénieux à torturer les victimes que le pouvoir livrait entre ses mains. C’était lui qui avait réglé les dispositions du local occupé par les déportés sur la Décade. Il présida également aux dispositions faites sur la Capricieuse, et comme les déportés devaient y être en moins grand nombre, il resserra proportionnellement l’espace, de manière qu’ils fussent aussi incommodément entassés.
Les déportés de la Décade avaient été placés sous l’autorité immédiate du capitaine, il n’en fut pas ainsi sur la Capricieuse. Ce bâtiment marchand, mis en réquisition par le gouvernement, était commandé par un homme qui n’avait pas su capter sa confiance, ou qui peut-être n’avait pas jugé honorable de la mériter. Aussi le Directoire prescrivit–il à son commissaire d’accompagner les prisonniers non plus jusqu’au lieu de l’embarquement, mais jusqu’à la Guiane, et il lui donna sur eux un pouvoir illimité dont il usa de la manière la plus barbare.
Sous les plus frivoles prétextes il retenait les déportés captifs dans l’endroit où ils étaient parqués, au delà du temps fixé par la consigne.
Un calme plat ayant arrêté la marche du navire à la hauteur du cap Vert, il mit dès le second jour les prisonniers à la demi-ration, bien que la ration entière fut déjà insuffisante.
La Capricieuse ayant capturé sur les côtes de Portugal un brick anglais chargé de sel et d’oranges (car bien que bâtiment marchand, elle portait quatre canons sur le gaillard d’arrière), et les oranges ayant été distribuées aux matelots de l’équipage, il menaça ceux qui en vendraient aux déportés, de les traduire en jugement à son retour en France, comme suspects de conspiration ayant pour but la délivrance des prisonniers.
Ayant surpris une des femmes héroïques dont il vient d’être question montrant de loin le ciel à son mari, comme pour lui dire qu’il y trouverait le prix de ses souffrances, il fit enfermer celui-ci dans une espèce de cachot, ou plutôt dans une armoire tellement étroite et si bien close, que lorsqu’on alla pour l’en faire sortir on l’y trouva étouffé. La malheureuse épouse, folle de désespoir d’avoir involontairement occasioné sa mort, se laissa tomber à la mer.
Notre tâche serait longue si nous voulions raconter tous les traits de révoltante cruauté dont quelques personnes gardent encore le souvenir. Abrégeons:
La Capricieuse, sortie du port de Rochefort le14avril1798, deux jours après l’embarquement des déportés, ne parvint pas au lieu de sa destination. Suivant leurs craintes ou leurs espérances, les uns pensèrent que le bâtiment avait fait naufrage, les autres que les déportés avaient pu s’en emparer et se réfugier ensuite sur quelque terre hospitalière; mais aucune nouvelle ne vint confirmer ou détruire ces conjectures. En des temps moins agités, le sort de la Capricieuse eût, de même que le vaisseau monté par La Peyrouse, de même que la Lilloise, dont on ignore encore la destinée, fait naître de vives et générales inquiétudes; mais les dernières convulsions de la république, et plus tard les trophées de l’empire, captivèrent tellement les esprits qu’on cessa promptement de s’en occuper. Elle fut totalement oubliée; de sorte que s’il existe encore quelques parens, quelques amis des personnes embarquées sur ce vaisseau, ils sont certainement les seuls qui aient conservé le souvenir de son départ.
Jusqu’à quel point peut-il être utile de rappeler cet événement qui a passé sans laisser la moindre trace, c’est une question que nous ne voulons point examiner. En ramenant sur la scène le nom de la Capricieuse, en tirant le rideau qui cachait l’écueil sur lequel elle s’est brisée, nous ne voulons pas ici raviver des haines mal éteintes, ni remuer des remords impuissans. Si dans les débris du naufrage nous n’eussions trouvé une grande leçon pour tous les hommes, quels que soient leurs gestes et leurs opinions politiques, nous aurions gardé le silence. Mais l’Océan n’a pas fait sa proie de tous les déportés de la Capricieuse se; plusieurs, échappés à ses fureurs, ont trouvé refuge sur une terre déserte, où ils sont devenus le noyau, la souche de tout un peuple qui vit de la vie des justes, parmi lequel fleurissent toutes les vertus. C’est cette vie si pure, ces vertus en même temps si simples et si sublimes, que pour l’enseignement et l’édification de tous nous voulions raconter. Il fallait donc d’abord, sans nous arrêter devant aucune considération, exhumer de l’oubli le nom de la Capricieuse, et dire par quelle funeste catastrophe elle y était tombée.
Voici maintenant les circonstances qui nous ont fait connaître ce qu’est devenu ce bâtiment:
Nous fîmes en1834un voyage au Brésil. Nous avions pris passage sur la Durance, gabarre de trente tonneaux, qui n’était montée que par sept hommes d’équipage.
Les vents contraires nous ayant fort écartés de la route que nous devions suivre, et les vivres commençant à nous manquer, nous étions menacés d’une horrible famine lorsque nous découvrîmes, s’élevant du sein des eaux, une côte verdoyante, coupée de nombreux ruisseaux. En consultant ses cartes et ses livres, le capitaine vit que cette côte n’avait encore été signalée par aucun voyageur. Nous en approchâmes avec précaution et la sonde à la main, de crainte de donner contre des écueils à fleur d’eau sur lesquels se brisaient les vagues; ensuite nous jetâmes l’ancre, et laissant seulement deux hommes à bord, nous descendimes dans la chaloupe et nous abordâmes à la côte.
A peine nous l’avions atteinte que nous vîmes sa principale éminence se couvrir d’hommes, de femmes et d’enfans que notre présence semblait inquiéter. Quoique sous une latitude très méridionale, leur visage était blanc; plusieurs parties de leurs vêtemens rappelaient même, à notre grande surprise, les anciens costumes français.
Les hommes les plus âgés se réunirent en un groupe comme pour délibérer; puis, quelques minutes après, l’un d’eux, vêtu de noir à la manière des ecclésiastiques, s’avança vers nous et nous demanda dans notre langue quelle circonstance nous amenait à la côte.
Lorsque nous lui eûmes appris que nous manquions d’eau et de vivres et que nous cherchions à nous en procurer, il nous invita à le suivre, nous conduisit dans l’intérieur des terres à un petit village d’un aspect riant, et ouvrant la porte d’un très vaste bâtiment: «Voici, dit-il, notre magasin; car parmi nous tous les biens sont en commun, personne ne possède rien en– propre. Prenez les grains et la farine qui vous seront nécessaires. Nous vous procurerons ensuite autant de fruits et de viandes fraîches que vous pourrez en désirer. Tout ce que nous avons est à votre service. Enfans de Jésus-Christ, et par conséquent nos frères, vous avez droit de partager ce que nous tenons de sa libéralité. Lors même d’ailleurs que nous ne serions pas tous enfans d’un même père, votre qualité de Français, et surtout de Français dans le besoin, vous assurerait ici tous les secours que réclament votre position.
«Nous sommes heureux, continua-t-il, de pouvoir vous obliger, et nous ne voulons mettre à nos services aucune condition; cependant nous souhaiterions en vous obligeant ne pas nous nuire à nous-mêmes. Promettez-nous donc sur l’honneur de ne faire connaître à qui que ce soit l’île où vous venez d’aborder. Depuis quarante ans bientôt que nous l’habitons, elle n’a été visitée par aucun navire e; nous craindrions, si on venait à la connaître, d’y voir arriver des voyageurs ou des commerçans qui, avec les objets de leur trafic, nous apporteraient des passions et des vices dont nos jeunes gens auraient peut-être de la peine à se garantir.»
Nous promîmes sans hésiter ce qu’il demandait; nous jurâmes sur l’honneur de ne faire connaître à personne sous quelle latitude était située son île. Puis, aidés par les habitans de la colonie, nous transportâmes à notre bâtiment l’eau et les vivres dont nous avions besoin.
Comme nous devions rester long-temps en mer avant de parvenir au terme de notre voyage, nous commençâmes à saler ou fumer sur le rivage une partie des viandes que nous devions emporter. Cette opération nous prit plusieurs jours durant lesquels je fus logé chez le chef de la colonie, respectable ecclésiastique qui nous avait si bien accueillis à notre arrivée. Désireux de savoir comment s’était fondée cette colonie française dans une île si éloignée de tout pays habité et jusqu’alors inconnue, je priai le vieillard de me l’apprendre. Il se rendit à mon désir; mais, au lieu de me conter de vive voix l’histoire de cette fondation, il me dit seulement que la colonie devait son origine à sept personnes échappées comme par miracle au naufrage de la Capricieuse, et me donna ensuite à lire des mémoires que lui-même avait composés et qui m’apprirent tout ce que je souhaitais connaître. Ces mémoires m’intéressèrent vivement. Non content de les lire, j’en copiai les principaux chapitres. Ce sont eux que je livre aujourd’hui au public sous le titre de La Colonie chrétienne.
Si l’on demande pourquoi je me suis ar rêté à ce titre plutôt qu’à tout autre, je répondrai: Parce que la colonie dont ces chapitres renferment l’histoire est placée sous l’autorité spirituelle et temporelle d’un vénérable prélat, et surtout parce que plus qu’en aucun autre lieu de la terre la religion y est honorée et fidèlement pratiquée. Nous tenons du reste fort peu à ce titre, et nous adoptons à l’avance tous ceux qu’on voudrait lui sub stituer. L’essentiel pour un ouvrage est qu’il intéresse, et nous espérons que ces mémoires, dont nous sommes heureux d’être l’éditeur, intéresseront autant ceux qui les liront qu’ils nous ont intéressés nous-mêmes.
Encore un mot avant de terminer cette introd uction.
Bien que le patriarche de la colonie nous eût fait promettre de ne révéler à personne en quel lieu du monde était située l’île que le hasard venait de nous faire découvrir, et qu’il eût ainsi témoigné le désir de n’avoir aucun rapport avec les autres peuples, nous aurions été bien aises de voir rendues à leur patrie ces intéressantes victimes de nos troubles révolutionnaires, nous imaginions même que le plus grand nombre ne devait rien tant désirer que de retourner en France. Le capitaine offrit donc de prendre à son retour du Brésil, ceux qui voudraient le suivre; mais personne n’accepta son offre. Si vous avez envie de nous obliger, dit un vieux médecin avec lequel le lecteur ne tardera pas à faire connaissance, et que vous puissiez revenir en ces contrées sans compromettre vos intérêts, ne nous parlez pas de retourner avec vous, mais rapportez-nous de France tous les livres de religion et de science que vous pourrez vous procurer, en ne dépensant toutefois que ce que vous auriez payé dans un autre pays pour les vivres que nous vous avons donnés. Des livres, voilà la seule chose dont nous ayons besoin. Eh mais ! poursuivit-il en riant à cette pensée, je me rappelle avoir empêché qu’après notre naufrage, on ne jetât à la mer les belles pièces d’or et d’argent trouvées sur la Capricieuse. Elles formaient ma foi une assez forte somme; si nous parvenons à découvrir en quel endroit elles ont été reléguées, vous pourrez sans débourser un sou de votre poche nous rapporter une superbe bibliothèque.
Il appelle aussitôt ses enfans, ses petits-en fans, les envoie à la recherche du trésor sauvé des ondes, et quelques heures après nous remet cent quarante mille francs retrouvés dans un souterrain sous des monceaux de ferraille.
Au commencement de cette année18836, le capitaine de la Durance ayant complété sa cargaison de livres, je voulus l’accompagner. Nous fûmes cette fois tant pour l’allée que pour le retour singulièrement favorisés par les vents, notre voyage se fit en très peu de temps.
Avant de revenir, nous fîmes de nouvelles instances auprès des colons dans l’espoir d’en déterminer quelqu’un à nous suivre. Mais les jeunes gens répondirent qu’ils ne croyaient pas pouvoir être plus heureux ailleurs que dans leur île, qu’ils ne consentiraient jamais, même pour un temps très court, à se séparer de leur famille; et les personnes âgées se montrèrent moins disposées encore à accepter les offres du capitaine.
Nos pères et mères sont morts, nous dit le chef de la colonie; que trouverions-nous donc maintenant dans notre patrie? La guerre au lieu de la paix dont nous jouissons ici, des troubles continuels, des révolutions qui ne s’éteignent que pour se rallumer aussitôt, jamais de calme. Selon le récit que vous nous avez fait, la France depuis notre départ a changé dix fois de maître. Les partis y sont perpétuellement aux prises, ils se disputent le pouvoir comme une troupe de loups affamés le cadavre jeté à la voirie, et ceux qui s’en emparent, n’en usent que pour pressurer le peuple et lui faire rendre de l’or, pour emprisonner, proscrire, traîner à l’échafaud ceux qui leur ont fait obstacle avant leur triomphe, ou qui essaient ensuite de les renverser. Votre révolution de1830a, disiez-vous, été pure et sans tache, le peuple s’est pris corps à corps avec l’ancienne dynastie, il l’a terrassée, repoussée sur la terre étrangère, mais le sang n’a coulé que durant le combat, le crime n’a pas comme autrefois levé sa tête hideuse; après la tempête le ciel est tout-à-coup redevenu serein, le peuple a remis le sceptre en des mains plus habiles, sa fureur de même que celle de l’océan qui soulève ses vagues menaçantes et rompt les digues qu’on lui oppose e, sa fureur n’a duré qu’un instant: il est calme maintenant et demeure soumis au chef qu’il s’est donné.
Tout cela, j’en conviens, peut, quand On est à deux mille lieues de la France, et qu’on n’a point d’âme pour réfléchir, ni de cœur pour plaindre les malheureux, paraître beau, sublime, mais ces trois journées sanglantes, ces bateaux remplis de cadavres qui descendent la Seine, ces mères qui pleurent leurs en nfans s, ces familles privées de leur pain qui vont dans .d’obsc ures soli tudes cacher leurs peines et leurs misères, tout cela forme-t-il un spectacle assez a trayant pour que nous allions avant de mourir en attendre une seconde représentation? Et ne dites pas que ce sont des malheurs inséparables de toute révolution; c ar alors il faudrait sans nulle exception toutes les maudire; ne dites pas non plus que ces malheurs ne se renouvelleront pas, que l’abime des révolutions est fermé pour toujours, car la révolution de1830venant après tant de révolutions, prouverait encore le contraire: de même que les plaines sablonneuses du désert, le sol de la France est un sol mouvant qui s’agite au moindre souffle, un sol qui menace touj ours de se dérober sous le pied qui le foule, d’engloutir l’imprudent qui s’y repose. Que nous arrivions aujourd’hui dans notre patrie, et demain peut-être, nous serons dans la triste alternative de fuir ou d’y être témoins de nouveaux troubles, de nouvelles convulsions, de nouvelles horreurs ().
Ne nous priez donc plus de partir; laissez-nous ici terminer en park notre longue carrière. Nous sommes heureux dans notre île. Tous ceux qui l’habitent sont nos enfans, nous les aimons et ils nous, aiment. Au lever du soleil et après les travaux de la journée, tous se réunissent. Nous élevons ensemble nos cœurs vers le ciel, nous implorons, et j’ose dire que ce n’est pas en vain, ses bénédictions. Ah! personne ici n’a jamais laissé tomber l’impiété ni le blasphème de sa bouche. Tout le monde adore, bénit le Dieu créateur et sauveur, tout le monde est soumis à sa loi sainte. L’amour de Dieu, l’amour du prochain’, voilà les douces chaines qui nous unissent: ne nous demandez plus de nous éloigner de cette île; en nous séparant, nous croirions les rompre.
Nous n’insistâmes pas davantage. Ce que nous dirent les autres colons, ce que nous vîmes, nous persuada même si bien que nous trouverions dans ce séjour mieux que partout ailleurs le bonheur après lequel tout homme soupire, que nous demandâmes et obtînmes, le capitaine et moi, d’y aller passer les années qui nous restent à vivre. Cette faveur sera même accordée aux hommes de notre équipage, qui ne devront pas dépasser le nombre de sept, et qui devront avant notre départ de France être munis d’un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le curé de leur paroisse.
Si quelqu’un, après avoir lu ces mémoires, désirait nous accompagner, et consentait à faire durant la traversée l’office de matelot, office laborieux, mais facile à remplir, nous le recevrions à bord. Avant de se décider, cependant, qu’on réfléchisse; car, nous en prévenons, aussitôt que nous aurons touché l’île, nous brûlerons notre vaisseau.
Après avoir terminé quelques affaires, dans deux ou trois mois au plus, nous ferons connaître l’époque de notre départ et nous indiquerons l’endroit où devront être adressés franco les lettres et les certificats de ceux qui seraient disposés à faire, en qualité de matelots, deux mille lieues pour jouir de la paix et du bonheur qu’on ne trouve plus en France.