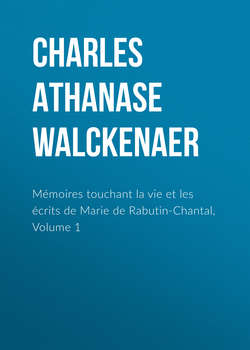Читать книгу Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1 - Charles Walckenaer, Charles Athanase Walckenaer - Страница 7
CHAPITRE VII
ОглавлениеInfluence de l'éducation et des préjugés de rang et de naissance sur le sentiment de l'amour.—Différences entre le siècle de Louis XIV et le nôtre sous ce rapport.—Des personnages de la haute classe qui firent leur cour à madame de Sévigné.—Du prince de Conti.—De Turenne.—Du marquis de Noirmoutier.—De Servien.—De Fouquet.—Du comte du Lude.—Sa passion pour madame de Sévigné.—Ce que Bussy a dit de la nature de leur liaison.—De Bussy.—Toute sa vie se trouve liée à celle de madame de Sévigné.—Nécessité de la connaître.—Portrait de Bussy.—Son caractère.—Désordres de sa jeunesse.—Ses premières aventures galantes.—A Guise avec une jeune veuve.—Il va à Châlons.—Devient amoureux de mademoiselle de Romorantin.—Sa liaison avec une bourgeoise de la ville.—Dernière conversation de Bussy avec mademoiselle de Romorantin.—Ce qu'elle devint depuis.—Suite et fin de la liaison de Bussy avec la bourgeoise de Châlons.—Bussy va en garnison à Moulins.—Son intrigue avec une comtesse.—Il devient amoureux d'une de ses parentes.—Se montre délicat et généreux envers elle.—Son père s'oppose au mariage qu'il veut contracter.—On le marie avec mademoiselle de Toulongeon.—Il revoit sa parente mariée.—Renoue sa liaison avec elle.—Il devient amoureux d'une autre parente, dont il n'obtient rien.—Il devient amoureux de sa cousine Marie de Rabutin-Chantal aussitôt après qu'elle fut mariée au marquis de Sévigné.—Il regrette de ne l'avoir pas épousée, et forme le projet de la séduire.
L'homme change par la civilisation; et à mesure qu'elle se complique on voit s'altérer en lui jusqu'à ces penchants irrésistibles que le Créateur lui a donnés pour l'accomplissement de ses fins les plus universelles. L'amour même, cette loi générale de tous les êtres vivants, cette grande nécessité de la création, se modifie selon l'état des sociétés humaines, et subit aussi les conséquences des révolutions qu'elles éprouvent. Dans les premiers âges des nations, l'objet de toutes les pensées, le but de toutes les ambitions, c'est la satisfaction des besoins physiques; chez les peuples depuis longtemps civilisés, familiarisés avec le luxe et les arts, le cœur et l'imagination se créent d'autres éléments de bonheur, des jouissances d'un autre ordre; et les rapports entre les deux sexes s'imprègnent de toutes les conditions auxquelles l'existence est soumise, et sans lesquelles elle devient un fardeau insupportable. L'amour alors a besoin, pour naître, de la conformité d'idées, de sentiments, qui résultent du même genre de vie, des mêmes habitudes; et, parmi ceux que la fortune a dispensés de tous soins matériels, les causes morales qui le produisent sont plus énergiques que les causes physiques. C'est dans l'âme et non dans les sens que s'allume d'abord le foyer de cette passion. Les beaux traits, les charmes ravissants d'une femme de la classe inférieure, commune dans son langage, ignoble dans ses manières, pourront bien exciter, pour quelque temps, le désir de celui qui a été habitué à rechercher dans celle qu'il aime tout ce qu'il estime le plus dans lui-même; mais jamais ils ne feront naître cette passion qui nous fait vivre en autrui, qui transporte notre existence tout entière dans l'objet aimé.
C'est pourtant à la confusion des rangs, au nivellement des diverses classes de la société, qu'est dû ce débordement de mœurs qui prévalut en France dans le dix-huitième siècle. Lorsque les plus grands seigneurs eurent mis leur amour-propre à ne pas se distinguer, par leurs manières et leurs façons de vivre, de l'artiste et de l'homme de lettres; lorsque les femmes des financiers, des marchands opulents, n'offrirent plus de différence par leur éducation, par leur habillement, avec les dames du plus haut rang; quand l'égalité fut reconnue entre tous les gens du monde comme une condition essentielle aux relations sociales, alors disparurent tous les obstacles qui s'opposaient à la réciprocité des sentiments. La politesse, l'instruction, le savoir-vivre, les déférences mutuelles, la liberté du discours, tout fut égal entre des personnes qui présentaient d'ailleurs tant d'inégalités sous les rapports du rang, de la naissance et de la fortune. Bien plus, tant d'admiration fut prodiguée aux talents agréables, qu'on mit dans les plus hautes classes de l'orgueil à y exceller. Dès lors il ne dut plus y avoir de conquête trop relevée pour un musicien ou un danseur; c'était le maître qui consentait à se livrer à son élève.
Il n'en était point ainsi du temps de madame de Sévigné. Les diverses classes de la société se mêlaient entre elles, sans se confondre. Jusque dans la familiarité d'un commerce journalier, elles maintenaient les degrés de subordination, et les nuances de ton et de manières qui les distinguaient aussi sûrement que la diversité de leurs habits. L'inégalité des rangs et des conditions établissait des barrières dont l'amour s'effarouchait, et qu'il cherchait rarement à franchir.
Ainsi donc, parmi ceux qui aspiraient aux faveurs de madame de Sévigné, les hommes de la cour et ceux de la haute noblesse étaient les seuls qui pouvaient l'attaquer avec avantage, les seuls qui fussent réellement dangereux pour elle. Son humeur libre, gaie, joviale, et sa coquetterie naturelle, firent qu'il s'en présenta plusieurs; et comme nous les retrouvons presque tous au nombre de ses amis les plus dévoués et les plus assidus, il est essentiel de les faire connaître au lecteur.
Le premier de tous, par son rang et sa naissance, était le prince de Conti, frère du grand Condé. Moins habile que lui sur le champ de bataille, il était auprès des femmes plus spirituel et plus aimable, et obtint auprès d'elles plus de succès, quoiqu'il fût contrefait127.
Le grand Turenne eut toujours pour les femmes le penchant le plus décidé; et ses instances auprès de madame de Sévigné furent assez vives pour la forcer de se dérober à ses visites, devenues trop fréquentes pour ne pas la compromettre128. On trouve aussi dans cette liste le marquis de Noirmoutier et le comte de Vassé, qui se battit en duel, en 1646, avec le comte Rieux de Beaujeu, capitaine de cavalerie dans le régiment de Grancey129. Il faut ajouter encore les deux surintendants des finances Servien et Fouquet, surtout ce dernier, pour lequel madame de Sévigné fit voir un attachement si sincère et si vif dans sa disgrâce.
Mais tous ces amants n'osèrent concevoir l'espoir de réussir auprès de madame de Sévigné qu'après qu'elle eut perdu son mari; tandis que le comte du Lude et Bussy-Rabutin voulurent surprendre son inexpérience aussitôt après son mariage, et cherchèrent à tirer parti, au profit de l'amour, des justes mécontentements de l'hymen.
Le comte du Lude, quoique assez laid de visage, était grand, bien fait; et, ce qui n'était pas alors un avantage médiocre, même pour un homme, il avait une belle chevelure. Il excellait à tous les exercices, dansait avec une grâce remarquable, maniait un cheval avec une hardiesse et une dextérité merveilleuses, et était habile à l'escrime. A toutes ces qualités du corps il joignait encore celles de l'esprit130; c'était un des hommes de France dont on citait le plus de bons mots. On ne doutait point de son courage; il en avait donné des preuves dans plusieurs combats singuliers; mais la douceur de son caractère et son naturel enclin à la mollesse lui donnaient de l'éloignement pour les fatigues et les violences de la guerre. Ce fut la faveur du monarque plutôt que ses exploits et ses services qui le portèrent successivement jusqu'aux premiers grades militaires. Il fut par la suite nommé grand maître de l'artillerie, puis créé duc; par héritage et par le revenu de ses charges, il se vit possesseur d'une immense fortune131. Il aimait le plaisir, et s'était acquis auprès des femmes cette sorte de réputation qui se concilie les bonnes grâces de toutes, parce qu'elle suppose plus de vivacité dans l'attaque, plus d'excuses dans la défaite, plus de gloire dans la résistance. Ce qui contribuait à lui conserver la bienveillance générale du beau sexe, c'est que, quoique volage en amour, il n'était jamais perfide. Il n'aimait pas longtemps, mais il aimait fortement; souvent ses larmes témoignaient de la violence et de la sincérité de sa passion, et attendrissaient celles que ses séductions n'avaient pu fléchir. Il portait jusque dans les déréglements de la volupté les sentiments d'un homme juste. Souvent infidèle, jamais il ne cherchait à se venger d'une infidélité; toujours discret et modeste dans ses triomphes, il prenait autant de soin pour ménager la réputation des femmes qu'il avait autrefois aimées, que de celles dont l'intérêt présent de son amour lui faisait un devoir de cacher les écarts à la malignité publique132.
Si sa passion pour madame de Sévigné fut connue, ce fut par le coupable libelle de Bussy. Cette publicité fit que madame de Sévigné plaisantait de cet amour longtemps après dans une lettre à sa fille. Cette lettre nous apprend que les deux mariages que le comte du Lude contracta successivement dans le cours de sa vie ne firent point cesser ses intrigues galantes. Madame de Coulanges fut au nombre de celles dont il parvint à se faire aimer133.
Bussy est forcé de rendre hommage à la vertu de sa cousine. Il avoue qu'elle sut résister à l'amour du comte du Lude; mais en même temps, comme il fallait que l'animosité qui guidait sa plume se satisfit, il prétend que le comte du Lude n'a pas mis assez de constance dans ses poursuites, et qu'au moment même où il tourna ses vœux d'un autre côté madame de Sévigné inclinait à se rendre.
Bussy était bien convaincu du contraire de ce qu'il écrivait, et lui-même s'est reproché ces lignes coupables, et les a démenties avec l'expression du plus sincère repentir. Il savait d'ailleurs qu'il était alors pour sa cousine un séducteur autrement dangereux que le comte du Lude. Madame de Sévigné n'a eu en effet avec aucun homme des rapports aussi longs, aussi multipliés qu'avec Bussy-Rabutin, et, si on excepte son mari et son tuteur, des rapports aussi intimes. Nul ne l'a si longtemps et constamment aimée; nul ne l'a louée aussi souvent et plus sincèrement; nul n'a eu pour son esprit une admiration plus grande, pour sa vertu une estime plus profonde; nul ne lui a inspiré des sentiments plus tendres et ne lui a causé des peines plus amères.
La vie de Bussy-Rabutin se trouve presque constamment liée à celle de madame de Sévigné. La correspondance qu'elle a entretenue avec lui est la seule, de toutes les correspondances qui la concernent, qui nous reste entière; car nous n'avons point les réponses de nombreuses lettres qu'elle adressa à sa fille, tandis que Bussy a eu grand soin de nous conserver les lettres qu'il a reçues de sa cousine et celles qu'il lui a écrites. Il est donc nécessaire, pour notre sujet, de bien faire connaître Bussy et de raconter la suite de ses aventures galantes avant qu'il fût devenu amoureux de madame Sévigné et qu'il eût employé pour en triompher tout l'art d'un séducteur expérimenté, et peu délicat sur le choix de ses moyens. Il faut aussi rechercher quel était alors l'état de sa fortune, son rang et sa position dans le monde, les motifs d'intérêts ou d'ambition qui le faisaient agir.
A l'époque du mariage de madame de Sévigné, quels que fussent les qualités brillantes et les avantages que réunissait le comte du Lude, il était cependant, sous bien des rapports, inférieur à Bussy. Celui-ci, relativement à l'ancienneté et à l'illustration de sa naissance, n'avait rien à lui envier, et lui était supérieur par son rang et ses services personnels. Le comte du Lude n'avait alors fait qu'une seule campagne comme volontaire. Il semblait avoir renoncé à la guerre, et n'avait aucun grade dans l'armée; tandis que Bussy, au contraire, avait commencé dès l'âge de seize ans une carrière militaire aussi brillante que rapide134. Il avait combattu avec gloire sous le duc d'Enghien, et mérité les éloges de ce jeune et grand capitaine. Il avait été nommé colonel à vingt ans, et on lui avait confié le commandement du régiment de son père. Par la mort de celui-ci il se trouvait, au temps dont nous parlons, c'est-à-dire à vingt-six ans, lieutenant de roi du Nivernais135, et de plus revêtu de la charge de capitaine lieutenant des chevau-légers du prince de Condé, qu'il avait achetée. L'année suivante il fut nommé conseiller d'État. A trente-cinq ans il était déjà lieutenant général et mestre de camp de la cavalerie légère. Quant aux facultés de l'esprit, Bussy avait encore une grande supériorité sur le comte du Lude; malgré les brillantes reparties de ce dernier. Une ode de Racan, adressée au père de Bussy, avait inspiré au fils, à sa sortie du collége, un goût vif pour les belles-lettres136; et au milieu des camps, de la cour et du monde, il s'y appliqua avec assez de succès pour que par la suite personne ne crût que l'Académie Française lui eût fait une faveur en l'admettant dans son sein. Il a peut-être été trop loué par la Bruyère, qui louait si peu; il a peut-être eu de son vivant une réputation littéraire exagérée; mais on ne peut disconvenir qu'il ne soit un écrivain spirituel, élégant et pur, et ce mérite l'emporte sur celui de diseur de bons mots. Sous les rapports physiques, relativement aux avantages extérieurs, il avait encore une plus grande supériorité sur son rival. Sa taille était majestueuse, ses yeux grands et doux; son nez tirait sur l'aquilin; sa bouche était bien faite, sa physionomie ouverte et heureuse; ses cheveux blonds, déliés et clairs137. Sa position à l'égard de madame de Sévigné favorisait ses desseins sur elle, et faisait qu'avec des armes égales il était difficile de lutter avec lui. Il jouissait auprès de sa cousine de privautés qu'excepté son mari, elle ne pouvait accorder à aucun autre homme, puisqu'il n'y en avait pas d'autre qui fût son parent d'aussi proche.
Dans ce siècle, c'eût été aux yeux de tous un sujet de blâme, une sorte d'aberration morale, une manière de penser basse et vulgaire, que de n'être pas sensible aux avantages de la naissance. Plusieurs passages des lettres de madame de Sévigné, durement tancés par un de ces ignorants commentateurs qui n'ont étudié l'histoire que dans les carrefours et le cœur humain que dans les tabagies, nous prouvent que, malgré son bon sens naturel et sa philosophie si vraie, et quelquefois si profonde, madame de Sévigné était fortement imbue des opinions que de son temps on nommait de nobles sentiments, un orgueil légitime, et que dans le nôtre nous avons taxées de préjugés ridicules et de vanités puériles. L'esprit de famille, si puissant alors, secondait fortement les inclinations de notre jeune veuve pour son cousin, et la rendait fière de toutes les qualités qui brillaient en lui et de tous les succès qu'il obtenait. Il était en effet le seul héritier du nom des Rabutins; ce nom ne pouvait plus se perpétuer que par ce dernier et unique rejeton de la branche cadette138, puisque la branche aînée n'était représentée que par madame de Sévigné, et se trouvait perdue dans la maison avec laquelle elle s'était alliée.
Bussy chercha à mettre à profit tous ces avantages pour séduire sa cousine, et y joignit même la perfidie. Il se vengea par un moyen plus cruel encore de n'avoir pu réussir; et il ne dut enfin qu'au bon naturel de celle à qui il aurait pu inspirer de l'amour, de pouvoir conserver avec elle un commerce amical, qui était devenu nécessaire à tous deux.
Mais pour Bussy, il en fut toujours ainsi: son orgueil, son caractère malin et envieux, sa vanité de bel esprit, son égoïsme firent avorter tous les projets formés par son ambition, et rendirent inutiles pour son bonheur toutes les faveurs de la fortune, tous les dons de la nature. Nous ne nous occuperons qu'en passant de sa vie politique et militaire, et qu'autant qu'elle se ralliera à notre sujet; mais il est essentiel d'examiner quelles étaient les femmes avec lesquelles il avait été en relation jusqu'à l'époque du mariage de madame de Sévigné et lorsqu'il porta ses vues sur elle.
Rien ne prouve mieux que le détail de son premier amour le respect que les jeunes gens de ce temps avaient pour les femmes, et les changements qui se sont introduits dans les moyens employés pour leur plaire. Bussy se montra dès son entrée dans le monde dissipateur et déréglé dans sa conduite. Il abusa de la procuration qui lui fut donnée pour assister au conseil de famille relatif
à la nomination d'un tuteur pour sa cousine Marie de Rabutin-Chantal; et par une ruse coupable, il arracha, au moyen de cette procuration, au médecin Guinaut trois cents pistoles sur une somme plus forte que son père avait confiée à ce dernier139. Bussy dépensa cette somme en débauches; puis il se battit ensuite en duel pour des causes très-légères. Tous ces faits n'annonçaient pas un jeune homme scrupuleux et timide auprès des femmes. Cependant, en 1638, et alors âgé de près de vingt ans140, se trouvant en garnison à Guise, une jeune veuve de qualité, fort belle, brune, qui comptait environ vingt-cinq ans, et la fille d'un bourgeois de la ville, beaucoup plus jeune et très-jolie, devinrent toutes deux les objets de ses attentions particulières, et il paraissait être bien accueilli de l'une et de l'autre. Il décrit très-bien l'hésitation et la timidité d'un premier amour, et toutes les délices d'un premier succès141. Nous ne le suivrons pas dans ces récits; mais nous n'omettrons pas de rapporter ses tentatives infructueuses auprès de mademoiselle de Romorantin, parce qu'elles font connaître les mœurs relâchées de la haute société de cette époque, et les dangers où se trouvait exposée une jeune femme telle que madame de Sévigné, au milieu d'un tel monde.
Bussy avait conduit son régiment en garnison à Aï. Il l'y laissa, et se rendit à Châlons en Champagne pour rendre ses devoirs à François de l'Hospital, connu alors sous le nom de du Hallier142, et qui fut depuis maréchal de France. Il commandait alors dans la province. Bussy vit chez lui pour la première fois mademoiselle de Romorantin, blonde, petite, mais d'une beauté éblouissante; il en devint aussitôt amoureux. Mademoiselle de Romorantin était la fille de madame du Hallier. Bussy dit de cette dame qu'elle avait eu des enfants de beaucoup de gens, et pas un légitime. En effet, madame du Hallier était cette Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, célèbre par ses liaisons avec Henri IV, et qui surpassait en beauté toutes ses autres maîtresses143; elle eut du roi deux filles, toutes deux légitimées. Elle vécut ensuite avec Louis de Lorraine, cardinal-duc de Guise, et archevêque de Reims. Elle en eut cinq enfants. On prétendit (et cette prétention fut portée par la suite devant les tribunaux) qu'il y avait eu un mariage secret entre elle et le cardinal de Guise, par dispense du pape. Du Hallier, intéressé à prendre la chose sur ce pied, la reconnut, dans son contrat de mariage, comme veuve de ce prince; mais, avant d'épouser du Hallier, elle avait vécu avec de Vic, archevêque d'Auch. Ce fut une singulière destinée que celle de du Hallier. D'évêque de Meaux, il devint maréchal de France; et de deux femmes qu'il épousa successivement, la première avait été la maîtresse d'un roi et de deux archevêques; et la seconde, simple lingère dans sa jeunesse, se maria en troisièmes noces à un abbé commendataire, précédemment roi de Pologne (Jean-Casimir)144. Ces contrastes en disent plus sur les effets des révolutions d'État et des guerres civiles, et sur les déréglements des mœurs pendant les deux règnes qui précédèrent celui de Louis XIV, que des volumes entiers d'histoire.
Bussy nous apprend qu'il était parent de madame du Hallier, et il parle en ces termes de l'accueil qu'elle lui fit: «Quelque vieille que fût madame du Hallier, elle aimait à rire et à faire bonne chère; et comme elle se faisait assez de justice pour croire que cela ne suffisait pas pour retenir la jeunesse auprès d'elle, elle prenait soin d'avoir toujours la meilleure compagnie de la ville et les plus jolies femmes dans sa maison. Elle me trouvait, à ce qu'elle disait, un garçon de belle espérance, et digne de sa nourriture; et, me voyant de l'inclination à la galanterie, elle me faisait souvent des leçons qui m'auraient dû donner de la politesse. Son grand chapitre était les ruses des dames et leurs infidélités; et je m'étonne qu'après les impressions qu'elle m'en a données, j'aie pu me fier à quelques-unes, et n'être pas le plus jaloux des hommes145.»
Louise de Lorraine, qu'on nommait dans le monde mademoiselle de Romorantin, était la seconde des filles que Charlotte des Essarts avait eues du cardinal de Guise, toutes deux reconnues par leur père. Bussy remarque que madame du Hallier ne manquait jamais l'occasion de rappeler à mademoiselle de Romorantin qu'elle était née princesse; et il dépeint cette jeune personne comme naturellement enjouée, permettant de grandes libertés dans la conversation, et à qui on pouvait tout dire, pourvu que les paroles fussent décentes.
Avec deux femmes de ce caractère, Bussy crut qu'il lui serait facile de mettre à profit les leçons qu'il avait reçues de sa veuve. Il avait débuté à Guise par une double conquête, ce qui lui avait donné la présomption de croire qu'aucun cœur de femme ne pouvait lui résister. Mais il fut cette fois trompé dans ses espérances. Quoique mademoiselle de Romorantin fût plus jeune que lui146, elle avait déjà beaucoup plus d'usage du monde et de pénétration. Sa fierté naturelle, celle qu'elle tirait de sa naissance et du rang de son beau-père, éloignait d'elle jusqu'à la pensée qu'elle pût se rendre coupable d'une faiblesse: elle était d'ailleurs soigneusement gardée par sa mère, et la surveillance d'une femme aussi expérimentée ne pouvait être facilement déjouée. «Je lui rendais, dit Bussy, plus de devoirs, comme à ma maîtresse, que je n'eus fait à une reine que je n'eusse point aimée… Je l'appelais mademoiselle,… elle m'appelait son cousin… Elle était assez bonne princesse pour moi… Elle en faisait assez pour m'empêcher de la quitter, n'en faisait pas assez pour que je fusse content. J'avais de quoi satisfaire la vanité d'un Gascon, mais pas assez pour remplir les desseins d'un homme fort amoureux, et qui va au solide147.»
Un heureux hasard, ou plutôt un heureux succès, semblait aider Bussy à sortir de cette situation pénible. Il s'était lié d'une étroite amitié avec un nommé Jumeaux, de la maison de Duprat, capitaine de cavalerie, beau, jeune, bien fait, brave, gai, spirituel, et, comme lui, en quartier d'hiver en Champagne. Selon l'usage de ces temps, ces deux amis n'avaient qu'un même lit, et se confiaient mutuellement leurs secrets. Bussy avait donc fait confidence de son amour pour mademoiselle de Romorantin à Jumeaux, et il avait persuadé à celui-ci de choisir aussi, à son exemple, une maîtresse à séduire; même il lui avait épargné l'embarras du choix, en lui désignant une jolie brune de la ville. Jumeaux, qui n'aimait que la vie des camps et la débauche, ne se prêta qu'imparfaitement à ce projet. Pour lui en rendre l'exécution plus facile, Bussy usa de son influence, et fit inviter chez madame du Hallier la maîtresse de son ami. La dame fut sensible aux soins que Bussy se donnait pour elle, et les attribua à l'amour qu'elle crut lui avoir inspiré. Alors, comme rien ne s'y opposait, elle se livra au penchant de son cœur, qui l'entraînait vers Bussy. Les chagrins que causait à Bussy l'inutilité de ses efforts auprès de mademoiselle de Romorantin suggérèrent à Jumeaux l'idée de le consoler, en le laissant libre d'aimer celle qui le préférait à lui. Bussy était trop amoureux pour pouvoir profiter entièrement de la générosité de Jumeaux; mais il consentit cependant à ce qu'il proposait, dans l'espérance que la jalousie produirait quelques effets heureux pour son amour sur mademoiselle de Romorantin, et que la crainte de le perdre la forcerait, pour n'être pas abandonnée, à se montrer plus facile à son égard.
Ce fut tout le contraire; et elle le désespéra en lui avouant, dans une explication qui fut le résultat de son changement de conduite, qu'elle s'était sentie de l'inclination pour lui; mais en même temps elle lui déclara qu'un cœur capable de se partager était indigne d'elle. «Et souvenez-vous, dit-elle, mon cousin, que le peu de douceurs que vous aviez près de moi valait mieux que toutes les faveurs que vous allez chercher.» Bussy, plus amoureux qu'il ne l'avait jamais été, exprima son repentir, implora son pardon, mais en vain. Jamais il ne put parvenir à se replacer auprès de cette fière beauté dans la même situation qu'il avait trouvée si pénible, et que la violence de son amour lui faisait trouver digne d'envie depuis qu'il en était déchu. Pour se délivrer de ses instances, elle lui fit connaître qu'elle avait trop d'orgueil pour avoir contre lui de la haine ou de la colère, et qu'elle le servirait pour son avancement, auprès de son beau-père, plus ouvertement qu'auparavant; mais qu'il ne fallait plus qu'il songeât à elle: qu'elle se considérait comme entièrement dégagée, et que si elle ne l'était pas, elle ferait les plus grands efforts pour l'être.
Ces derniers mots ayant réveillé dans le cœur de Bussy une faible espérance, il essaya de nouveau tout ce que les prières et les larmes ont de plus touchant, tout ce que les protestations d'une ardente passion ont de plus persuasif. Tout fut inutile. Mademoiselle de Romorantin se montra inflexible, et la fermeté de ses paroles ne permit plus de douter de la fixité de ses résolutions.
Bussy s'attacha alors à celle qui avait conçu pour lui l'amour le plus passionné; mais celle-ci devint excessivement jalouse de mademoiselle de Romorantin, quoique Bussy se réduisit à l'égard de cette dernière aux termes de la simple amitié. Elle voulut exiger qu'il ne la vît point et qu'il cessât d'aller chez madame du Hallier. Bussy ne voulut point céder à cette exigence. Elle prit d'autres résolutions, et fit entendre à mademoiselle de Romorantin qu'elle savait que Bussy lui avait parlé de son amour, qu'il avait offert de lui en faire le sacrifice, et qu'elle n'avait pas voulu l'accepter. Mademoiselle de Romorantin, sans se déconcerter, lui dit qu'elle ne savait pas si Bussy était discret; mais qu'elle avait peine à croire qu'il fût menteur, et qu'elle lui parlerait de cette affaire148. Alors la dame, prévoyant que sa ruse serait bientôt découverte, se repentit de l'avoir employée. Elle en fit l'aveu à Bussy, en fondant en larmes. Bussy lui dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de réparer sa faute que d'aller faire à mademoiselle de Romorantin la confidence de sa liaison avec lui et de toutes ses faiblesses, et de lui demander pardon de l'offense que les tourments de la jalousie lui avaient fait commettre. La dame suivit d'autant plus volontiers ce conseil, qu'elle y vit un moyen d'empêcher Bussy de tromper mademoiselle de Romorantin sur la nature de leur liaison, et de mettre l'orgueil de sa rivale dans l'intérêt de sa passion. La confession qu'elle fit donna ensuite lieu à un entretien entre Bussy et mademoiselle de Romorantin, qui nous prouve combien à cette époque il y avait dans la haute classe de liberté dans le commerce entre les deux sexes, et jusqu'où pouvait aller la licence des entretiens avec les nobles demoiselles et les dames auxquelles on devait le plus de respect149.
Ce fut la dernière conversation que Bussy eut avec mademoiselle de Romorantin. Le lendemain, elle partit avec sa mère. Bussy nous dit qu'il ne l'a pas revue depuis, et il n'en fait plus mention dans ses Mémoires. Nous savons cependant par d'autres qu'elle tint tout ce que le récit de Bussy pouvait faire présumer d'elle. Peu de mois après avoir quitté Châlons, elle épousa (le 4 novembre 1639) Claude de Pot, seigneur de Rhodes, grand maître des cérémonies de France. Elle devint veuve en 1650, fut mêlée à toutes les affaires de la Fronde, eut des liaisons particulières avec le garde des sceaux Châteauneuf, et de plus intimes encore avec le duc de Beaufort, et mourut à Paris, le 15 juillet 1652, à l'âge de trente-trois ans, laissant la réputation d'une des femmes les plus galantes et les plus intrigantes de son temps150.
Le départ de mademoiselle de Romorantin causa une grande joie à la maîtresse de Bussy, qui crut être par là délivrée de tout motif de tourment. Elle se trompait. La jalousie s'attache à l'amour comme l'envie au bonheur, pour en troubler toutes les jouissances; et lorsque la destinée se complaît à écarter les causes qui pourraient alimenter ces deux passions haineuses, elles s'en créent d'imaginaires, qui produisent des angoisses aussi douloureuses que si elles étaient réelles.
Le père de Bussy n'ignorait pas la liaison amoureuse de son fils à Châlons. Il lui écrivit qu'il y avait dans cette ville une fille riche, qui donnerait en dot à son mari quatre cent mille francs, et qu'il ferait bien de ne pas laisser échapper une aussi belle fortune; que c'était une occasion de mettre à profit le talent de plaire aux dames, qu'il paraissait avoir acquis. Bussy trouva l'avis de son père fort bon, résolut de le suivre, et chercha à se dégager des liens qui l'enchaînaient.
D'après les dispositions où se trouvait Bussy, ce fut avec satisfaction qu'il vit arriver le temps d'entrer en campagne: il se rendit à l'armée devant Thionville, qu'assiégeait M. de Feuquières.
L'hiver suivant (en 1640), Bussy fut envoyé en garnison à Moulins, où il eut une nouvelle intrigue avec une comtesse qu'il eut à disputer au marquis de Mauny, fils du maréchal de la Ferté, et au fils d'Arnauld d'Andilly, alors militaire, depuis abbé, le même qui fut lié avec madame de Sévigné, et dont nous avons les Mémoires.
Quelque forts que fussent les attachements de Bussy, jusqu'ici aucun n'avait duré plus longtemps que son séjour dans la ville où il les contractait; lorsqu'il cessait d'y être en garnison ou qu'il fallait se rendre à l'armée, il reprenait sa liberté, et il n'était plus question de rien. Il n'en fut pas de même de l'amour qu'il éprouva pour une de ses parentes. Il venait de passer cinq mois en captivité à la Bastille; on l'avait rendu responsable de la conduite de son régiment, qui à Moulins avait pratiqué le faux saunage, et donné lieu à de grandes plaintes de la part de l'administration des gabelles. Cette rigueur, qui était méritée, puisque son absence des lieux où son devoir l'obligeait à résider était la principale cause du désordre, lui parut injuste. Il vint à la cour en 1642, dans l'intention de quitter le service; et, en attendant quelque occasion favorable d'y rentrer, il résolut de chercher fortune par un mariage. Ennemi de toute contrainte, il eût désiré rester garçon; mais il voulut satisfaire son père, qui désirait fortement le voir établi. «J'aurais voulu, dit-il, de ces mariages de riches veuves qui s'entêtent d'un beau garçon, et qu'on m'eût pris avec mes droits, sans demander autre chose.» Son nouvel amour vint fort mal à propos contrarier les desseins de son père et ses propres résolutions. Sa parente était fort belle, mais n'avait point de fortune. «Croyant d'abord, dit-il, m'amuser, en attendant que j'eusse rencontré quelque bon parti, je finis par en devenir amoureux. Dans les commencements de ma passion, je fus assez mon maître pour ne la vouloir point épouser, ne désirant pas me ruiner pour l'amour d'elle; et quand l'amour m'eut mis en état de ne plus songer à mes intérêts, je songeai aux siens, et je ne voulus pas la rendre malheureuse en l'épousant malgré mon père, ni la ruiner pour l'amour de moi… Et sur cela j'admire la bizarrerie de mon amour, qui n'avait d'autre but que soi-même; car je ne voulais ni débaucher ma maîtresse ni l'épouser.»
La parente de Bussy répondait sans aucun détour à sa tendresse, et se livrait avec lui à d'innocentes caresses avec la plus intime confiance et le plus entier abandon. Il arriva un jour que, dans un de ces entretiens qui les rendaient si heureux, Bussy, emporté par son désir amoureux, parut vouloir oublier ses généreuses résolutions; et elle, se sentant aussi incapable d'opposer aucune résistance, prit une attitude suppliante, et lui dit: «Vous êtes le maître, mon cousin, si vous le voulez absolument; mais vous ne le voudrez pas si vous désirez me donner la plus grande marque d'amour qui soit en votre pouvoir…» Et cette marque d'amour, si difficile à donner dans un tel moment, il la lui donna151. Ce fut un beau trait de Bussy, et peu d'accord avec la conduite de toute sa vie. Il nous montre qu'il a du moins une fois éprouvé ce sentiment si rare qui rend l'âme, plus que les sens, avide des jouissances qu'il procure, et qui ne s'empare du cœur que pour en chasser tous les penchants impurs et n'y plus laisser de place qu'aux vertus généreuses.
Cependant l'amour que Bussy inspirait à sa parente ne paraît pas avoir été égal à celui qu'il ressentait pour elle. Dès qu'elle eut appris que le père et la mère de Bussy, inquiets de la liaison de leur fils avec elle, s'étaient hâtés d'arrêter son mariage avec Gabrielle de Toulongeon, elle rompit tout commerce avec son cousin, et son attachement sembla cesser dès qu'elle eut perdu l'espoir de devenir sa femme. Bussy en fut surpris, et profondément affligé. Son père, craignant qu'il n'en tombât malade, l'emmena avec lui en Normandie, afin de chercher à le distraire.
Les préliminaires du mariage de Bussy traînaient en longueur, et six mois s'étaient écoulés depuis sa rupture avec sa cousine, lorsque, au moment où il s'y attendait le moins, il la rencontra à Dijon avec sa sœur. Cette sœur était mariée, et c'était chez elle que s'était formée et entretenue leur liaison. Toutes deux témoignèrent leur surprise et leur joie en revoyant Bussy. Il resta huit jours à Dijon, par suite de cette rencontre; et il y serait demeuré plus longtemps, sans la crainte d'exciter la jalousie de mademoiselle de Toulongeon. Il avait alors moins d'amour pour sa cousine, et en même temps moins de respect; de son côté, elle avait moins d'abandon et plus de réserve. «Je prenais d'autorité, dit-il, ces faveurs qu'elle accordait autrefois à mes prières; si elle m'avait laissé faire alors, je ne l'aurais pas tant ménagée que je faisais: mais elle n'avait garde de se remettre à ma discrétion, ne doutant pas que je n'en abusasse.»
Bussy épousa, peu de temps après, mademoiselle de Toulongeon152, et fut près d'un an sans entendre parler de sa cousine. Il la revit à Paris, plus belle, plus séduisante qu'elle n'avait jamais été, mais engagée, ainsi que lui, dans les liens du mariage153. «Je ne voulus pas, dit-il, perdre mes services passés: je lui rendis donc quelques soins; et comme je ne craignais rien, je ne perdis pas mes peines. Depuis ce temps-là je n'ai point douté que la hardiesse en amour n'avançât fort les affaires. Je sais bien qu'il faut aimer avec respect pour être aimé; mais assurément pour être récompensé il faut entreprendre, et l'on voit plus d'effrontés réussir sans amour, que de respectueux avec la plus grande passion du monde154.» Mais pour Bussy, plus que pour tout autre, la possession devenait promptement un remède à l'amour; et cette femme qui avait été pour lui l'objet d'une affection si forte et si pure, qui lui avait inspiré des sentiments si délicats et si tendres, cessa promptement de lui plaire. Il trouva qu'elle manquait entièrement de ces manières agréables, de ce je ne sais quoi qui nous enchaîne et qu'on ne peut exprimer. «Plus on connaissait ma cousine, dit-il, moins on avait d'amour pour elle; et son corps, son esprit et sa conduite lui faisaient perdre les amours que son visage lui avait attirés155.»
Il est probable que le prompt refroidissement que Bussy ressentit pour cette cousine provenait de l'amour dont il s'était épris pour une autre cousine, non aussi belle peut-être, mais plus spirituelle et plus aimable. Cet amour dura plus longtemps que tous les autres, précisément parce qu'il ne put jamais se satisfaire. L'époque où Bussy se mit à rechercher les bonnes grâces de la marquise de Sévigné coïncide en effet avec celle de sa rupture avec la comtesse des environs de Moulins, et avec la fin de sa liaison avec cette parente dont nous venons de parler. Ce fut entre 1642 et 1644, pendant les deux années que Bussy resta sans emploi, qu'il fit marcher de front le plus d'aventures galantes, au milieu desquelles vint se placer son mariage. Lui-même nous apprend que ce ne fut qu'après que sa cousine Sévigné fut mariée qu'il devint amoureux d'elle156. Le père de Bussy, qui convoitait les grands biens de mademoiselle de Rabutin-Chantal, aurait voulu que son fils l'épousât; mais celui-ci, préoccupé de son amour pour son autre parente, seconda mal les projets paternels. Sa cousine Chantal était d'ailleurs alors fort jeune; et son caractère jovial et folâtre, l'habitude qu'il avait de la voir, la familiarité avec laquelle il s'était accoutumé avec elle, la lui faisaient considérer comme une enfant. Il n'ouvrit les yeux sur tous les agréments dont elle était pourvue que lorsqu'elle fut mariée, et qu'il eut été témoin de ses succès dans le monde: alors il regretta le trésor qu'il avait laissé échapper, et résolut de le ravir à celui qui s'en était rendu possesseur. C'était cependant son ami, mais un ami qui n'était pas plus scrupuleux que lui sur ces matières.
D'après ce que nous savons de la vie de Bussy jusqu'à cette époque, on ne peut s'empêcher de reconnaître que ses avantages personnels, son amabilité, l'expérience qu'il avait acquise des faiblesses du cœur chez les femmes, l'assurance que lui donnaient de nombreux succès en amour, et son immoralité même, ne le rendissent un séducteur des plus dangereux. Madame de Sévigné n'avait que dix-huit ans lorsque Bussy commença contre elle son plan d'attaque. Il connaissait la tendresse qu'elle avait pour son mari; et dans les premiers temps de son mariage, n'espérant pas pouvoir la distraire de ce sentiment, il chercha seulement à lui rendre sa présence agréable, et à obtenir sa confiance: il y réussit. Il était en même temps le confident de l'époux. Celui-ci lui racontait ses prouesses amoureuses, et madame de Sévigné les chagrins qu'elle en ressentait. Cependant à cette époque même Bussy acheta la charge de lieutenant de la compagnie des chevau-légers du prince de Condé, et rentra au service. D'un autre côté, le marquis de Sévigné emmena sa femme à sa terre près de Vitré en Bretagne. Bussy se vit donc forcé de se séparer de sa cousine. Cette absence ne fit qu'accroître sa passion naissante. Les procédés du marquis de Sévigné envers sa femme augmentaient dans Bussy l'espoir qu'il avait de se faire aimer. Aussi, pour ne pas se laisser oublier, il eut grand soin d'entretenir avec sa cousine un commerce de lettres.
127
SÉVIGNÉ, Lettres, t. I, p. 17; lettre de Bussy en date du 16 juin 1654.
128
SÉVIGNÉ, Lettres, t. I, p. 42; lettre de Bussy en date du 7 octobre 1655.
129
BUSSY, Mém., t. I, p. 113, édit. in-12, p. 141 de l'édit. in-4o.—TALLEMANT DES RÉAUX, Mém. mss., in-folio, p. 566 et 567.
130
Ménagiana, t. I, p. 205.
131
SÉVIGNÉ, édit. de Monmerqué, 1820, in 8o, t. V, p. 343, note B.—DANGEAU, Journal des 30 et 31 août 1685, t. I, p. 71, édit. 1830.
132
BUSSY-RABUTIN, Hist. amoureuse des Gaules, édit. 1754, t. I, p. 260 à 262, et p. 42 de l'édit. de Liége.
133
SÉVIGNÉ, Lettres, t. VI, p. 157, édit. Monm., lettre du 1er mars 1680, no 716.
134
BUSSY, Mémoires, édit. 1721, t. I, p. 2, 6, 13, 19, 23, 41, 43, 94, 96 et 105.—Ibid., Hist. amour. des Gaules, édit. 1754, t. I, p. 160; édit. de Liége, p. 43.
135
BUSSY, Discours à ses Enfants, édit. 1694, p. 184, 207-211, t. III des Mémoires, p. 272, 280 et 281; Mémoires, t. I, p. 93, 94, 96, ou édit. 1696, in-4o, t. I, p. 130.—D'OLIVET, Hist. de l'Académie, in-4o, ou t. II, p. 212.
136
BUSSY, Discours à ses Enfants, 1694, in-12, p. 175; Mémoires, 1721, t. I, p. 268.—D'OLIVET, Hist. de l'Académie, 1709, in-4o, ou t. II, p. 250.
137
BUSSY, Amours des Gaules, p. 18; Hist. am. des Gaules, 1654, in-12, t. I, p. 283.
138
Généalogie des Rabutins, dans les Lettres inédites, 1819, p. 18.
139
BUSSY, Mémoires, édit. in-12, t. I, p. 13, 14; édit. in-4o, t. I, p. 16, 17. Voyez ci-dessus, p. 10, chap. III.
140
BUSSY, Mém., édit. in-4o, t. I, p. 47 et 67; in-12, t. I, p. 3, 19, 38, 41, 47, 54.—D'OLIVET, Hist. de l'Académie franç., t. II, p. 253.—SÉVIGNÉ, Lettres, t. I, p. 12.
141
BUSSY, Mémoires, t. I, p. 37, édit. 1696, in-4o, ou t. I, p. 30, édit. in-12.
142
BUSSY, Mém., in-12, t. I, p. 42; de l'édit. in-4o, t. I, p. 52.—Supplément aux Mémoires, 1re partie, p. 2.
143
Voyez TALLEMANT, Historiettes; Paris, 1834, in-8o, t. I, p. 105.
144
ANSELME, Histoire généalogique de la Maison de France, t. VII, p. 523.—DE LA CHESNAYE DES BOIS, Dictionnaire de la Noblesse, t. VIII, p. 102, et t. VI, p. 137.—Mademoiselle DE GUISE, les Amours du grand Alexandre, suivies de pièces intéressantes pour servir à l'histoire d'Henri IV (par LA BORDE, valet de chambre du roi), 1786, in-12, t. II, p. 198.—MONTPENSIER, Mémoires (année 1658), t. XLII, p. 277 de la collection de Petitot.
145
Supplément aux Mémoires et Lettres de M. le comte de BUSSY-RABUTIN, 1re partie, an du monde 7539417, p. 3.
146
BUSSY, Supplément aux Mémoires, t. I, p. 2 et 4.
147
Ibid., p. 6.
148
BUSSY, Supplément aux Mémoires, partie I, p. 17.
149
Ibid., p. 18.
150
NEMOURS, Mémoires, t. XXXIV, p. 460.—MOTTEVILLE, Mémoires, t. XXXVIII, p. 173.—PETITOT, Introduction aux Mémoires sur la Fronde, t. XXXV, p. 145.—RETZ, Mémoires, I. XLV, p. 37, 105, 115, 147, 157, 186, 187, 192.—JOLY, Mém., t. XLVII, p. 105.—LORET, Muse historique, 15 octobre 1650, t. I, p. 63.—SÉVIGNÉ, lettre en date du 25 février 1685, t. VII, p. 34.
151
BUSSY-RABUTIN, Mémoires, t. I, p. 91.—Ibid., in-4o, t. I, p. 112.
152
BUSSY, Mémoires, t. I, p. 91 à 93, édit. in-12; de l'in-4o, t. I, p. 114.
153
Ibid., p. 93; de l'in-4o, p. 115.
154
Ibid., p. 93.
155
Ibid., p. 94.
156
BUSSY, Histoire amoureuse des Gaules, t. I, p. 25 de l'édit. 1754, et p. 33 de l'édit. de Liége.