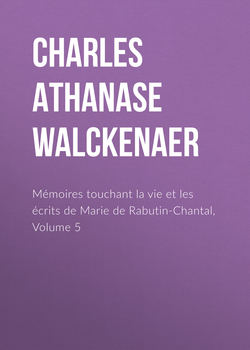Читать книгу Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 5 - Charles Walckenaer, Charles Athanase Walckenaer - Страница 4
CHAPITRE IV.
1673-1674
ОглавлениеMadame de Sévigné retrouve son cousin Bussy à Paris.—Lettre de Bussy à madame de Sévigné.—Leur amitié s'était refroidie.—Bussy veut se réconcilier avec madame de la Baume.—Il avait un procès au conseil, qu'il gagna.—Il va voir madame de la Morésan.—Exemple de Martel, mis à la Bastille pour défaut de soumission.—Détails sur l'origine de la liaison de madame de Sévigné avec la marquise de Martel.—Effrayé par l'exemple de Martel, Bussy demande une nouvelle prolongation de séjour.—Il écrit au duc de Montausier, à madame de Thianges, pour qu'elle le réconcilie avec la Rochefoucauld.—Elle échoue dans cette négociation.—La duchesse de Longueville intercède pour Bussy auprès de Condé.—La colère de Condé contre Bussy subsiste.—Bussy écrit à madame de Sévigné une lettre pour être montrée à madame Scarron.—Madame de Sévigné va à Saint-Germain en Laye, et couche chez M. de la Rochefoucauld.—Billet de madame de Sévigné à Bussy, qui lui transmet la réponse faite par madame Scarron.—Bussy fait demander au roi une nouvelle prolongation de séjour.—Le refus en était connu de madame de Sévigné avant d'avoir été notifié à Bussy.—Bussy fait ses adieux à tout le monde, et reste à Paris caché.—Il va voir secrètement madame de Sévigné et madame de Grignan.—Il est visité par le duc de Saint-Aignan.—Deux entretiens du roi et du duc de Saint-Aignan.—Le roi permet à Bussy de rester encore trois semaines.—Il part, et retourne en Bourgogne.—Le roi en Franche-Comté fait venir la reine à Dijon.—Bussy écrit à MADEMOISELLE pour offrir son château à la reine et à elle.—A chaque victoire, Bussy adresse une lettre au roi.—La guerre de Franche-Comté s'achève, et Bussy n'obtient rien.
Lorsque, à la fin du mois d'août 1673, madame de Sévigné, alors au château de Grignan, écrivait à Bussy: «Je me console de ne point vous voir à Bourbilly, puisque je vous verrai à Paris141,» elle croyait déjà son cousin dans la capitale. Il n'y arriva que le 16 septembre, et ce ne fut que lorsqu'il se trouvait menacé de ne pouvoir plus y rester qu'il répondit à cette lettre.
Voici cette réponse, un peu énigmatique:
«Paris, ce 10 octobre 1673.
«Je viens de demander au roi plus de temps qu'il ne m'avait accordé pour faire ici mes affaires. Je crois qu'il m'en accordera. Je suis d'accord avec vous, madame, que la fortune est bien folle; et j'ai pris mon parti sur ce que sa persécution durera toute ma vie. Les grands chagrins même ne sont pas sus; et, comme je vous ai déjà mandé, ma raison m'a rendu fort tranquille. Faites comme moi, madame. Il vous est bien plus aisé, car le secret de vos peines est fort au-dessous du mien142.»
On s'aperçoit facilement, d'après le ton et le ralentissement de leur correspondance, que l'amitié qui existait autrefois entre Bussy et sa cousine n'était plus la même. La susceptibilité orgueilleuse, le caractère vindicatif et l'immoralité de Bussy avaient considérablement refroidi cette chaleur de cœur que madame de Sévigné avait éprouvée pour son cousin. Les années seules l'auraient guérie d'une inclination qui, dans son jeune âge, n'avait pas été sans péril. Intimement liée avec tous ceux auxquels Bussy avait déplu et qui, ainsi qu'elle, brillaient à la cour et dans les hautes sphères de la société, madame de Sévigné devait souvent entendre des railleries sur ce courtisan émérite et disgracié, vivant solitairement en province, et qui dans ses manières, ses discours, ses écrits voulait toujours paraître le type parfait du gentilhomme, du guerrier, du bel esprit et de l'honnête homme, c'est-à-dire de l'homme à bonnes fortunes. Madame de Sévigné avait trop d'usage et de discernement pour ne pas s'apercevoir des ridicules de Bussy; et dans plusieurs passages des lettres à sa fille elle y fait allusion, mais avec finesse et avec ménagement. Elle n'avait plus autant d'admiration pour le talent épistolaire si vanté de Bussy; il en montrait moins qu'autrefois dans les lettres qu'elle recevait de lui, et par cette raison peut-être, sans le vouloir, elle en mettait moins aussi dans les réponses qu'elle lui adressait. Elle lui avait dit jadis: «Vous êtes le fagot de mon esprit.» Le fagot manquait, et le feu qu'il devait allumer ne pouvait se produire. Cependant l'étroite parenté qui les unissait, les souvenirs de jeunesse qui leur étaient communs, l'habitude d'une longue liaison, surtout l'intérêt du nom que tous deux portaient, dont tous deux étaient fiers et dont ni l'un ni l'autre certainement ne ternissait l'éclat, formaient entre eux un attachement indissoluble et entretenaient une intimité d'autant plus égale qu'ils ne s'aimaient plus assez pour se quereller.
La seule lettre que madame de Sévigné reçut de Bussy pendant son voyage fut celle que nous venons de transcrire; mais elle eut de ses nouvelles par d'autres personnes, car de Bourbilly elle écrit à sa fille: «Bussy est toujours à Paris, faisant tous les jours des réconciliations; il a commencé par madame de la Baume. Ce brouillon de temps, qui change tout, changera peut-être sa fortune143.»
Madame de Sévigné était mal informée; cette réconciliation qu'elle redoutait n'eut pas lieu. On en avait parlé dans le monde. Bussy voulait se faire la réputation d'un homme à qui on devait pardonner toutes ses fautes, parce que lui, disait-il, n'éprouvait aucun ressentiment contre ceux qui avaient eu des torts envers lui; et il entrait dans ses desseins de ne point accréditer ni démentir le bruit de sa réconciliation avec madame de la Baume. Dès son arrivée à Paris, il s'empressa d'aller rendre visite à madame de Thianges, «sa parente et sa bonne amie.»—«Elle me demanda, dit-il, s'il était vrai que je fusse raccommodé avec madame de la Baume. Je lui dis qu'elle m'avait fait faire des honnêtetés, auxquelles j'avais répondu de même, et que j'étais résolu non-seulement de recevoir les amitiés que me pourraient faire ceux qui m'avaient fait du mal, mais encore de leur faire des avances144.»
Le principal motif du séjour de Bussy à Paris était une contestation qu'il avait au conseil pour une somme de 60,000 fr. qu'on lui disputait. Il gagna son procès145.
Il est bien vrai qu'il fit des tentatives de réconciliation; mais il ne réussit dans aucune, comme le sut bientôt madame de Sévigné, dont les secours ne lui faillirent point en cette circonstance. Quand Bussy écrivait à sa cousine, l'époque de la permission qu'il avait obtenue pour rester dans la capitale était expirée depuis deux jours, et il avait demandé à M. de Pomponne une prolongation de séjour, qui lui fut accordée146.
Depuis un mois qu'il était à Paris, il avait employé son temps aux projets de son ambition plus encore qu'au profit de ses affaires. Il n'ignorait pas que le roi, bien disposé pour lui par le duc de Saint-Aignan, consentirait volontiers à faire cesser son exil s'il pouvait se réconcilier avec Condé et empêcher Louvois de lui être contraire. Ce fut de ce côté qu'il dirigea d'abord ses efforts. Lorsque la marquise de la Baume eut la perfidie de laisser publier le manuscrit des Amours des Gaules qu'il lui avait confié, il rompit entièrement avec elle, et il ne parlait de ses attraits et de sa personne qu'avec ce dédain et ce dénigrement qu'aucune femme ne peut pardonner147. Depuis il ne chercha point à renouer une liaison avec une femme qu'il n'aimait pas et qu'il ne pouvait estimer; mais, comme toujours, il s'efforça de profiter de ses amitiés de femmes pour se réconcilier avec ceux qui lui étaient contraires. Il raconte dans ses Mémoires qu'il était depuis trois ans assez bien vu de madame de la Morésan, qui, par ses attraits, son esprit caustique et son caractère décidé et tranchant, par son alliance avec son beau-frère Dufresnoy, le principal commis de Louvois, était recherchée et redoutée148. Le jour où Bussy l'alla voir149, il y trouva Dufresnoy. «La conversation, dit-il, avec madame de la Morésan et moi se passa à nous renouveler des assurances d'amitié. Comme j'y fus jusqu'à l'entrée de la nuit, il y vint beaucoup de gens, et entre autres mesdames de la Baume et Louvois; j'en sortis bientôt après, ne pouvant soutenir la présence de gens que j'aimais si peu150.» Lorsque Bussy écrivait à Paris ce fragment de ses Mémoires, madame de Sévigné s'y trouvait aussi; elle dut donc être dissuadée par lui de l'opinion qu'elle avait eue de sa réconciliation avec madame de la Baume.
Bussy s'était empressé de demander une nouvelle permission pour continuer son séjour à Paris. Il avait alors un exemple récent du danger que l'on courait, sous un roi tel que Louis XIV, de ne pas se soumettre aux ordres de ses supérieurs. Le marquis de Martel, vieil officier de marine, avait passé par tous les grades avant de devenir lieutenant général à la mer; il trouva dur d'être obligé d'obéir au comte d'Estrées, vice-amiral d'une plus grande noblesse, mais moins ancien que lui comme officier, et qui avait gagné son grade de lieutenant général dans le service de terre. D'Estrées transmit à Martel, par écrit, un ordre sous une forme qui ne convenait pas à ce dernier151; il ne refusait pas d'obéir à l'ordre, mais il voulait que la rédaction en fût changée. Pour ce léger tort, il fut arrêté par ordre du roi le 31 octobre, et mis à la Bastille. Cette rigueur dut faire de la peine à madame de Sévigné, qui était liée avec la femme du marquis de Martel depuis que celui-ci avait donné, sur le beau et célèbre Royal-Louis, vaisseau qu'il commandait152, une fête à madame de Grignan lorsqu'elle alla voir le fort de Toulon vers le milieu du mois de mai 1672. La femme du lieutenant général gouverneur de Provence parut si belle alors, dansa si bien, que tous les jeunes officiers invités à cette fête en conservèrent un long souvenir, et que, plusieurs années après, un d'eux citait madame de Grignan comme le modèle le plus parfait de grâce et de légèreté dans la danse, en présence de madame de Sévigné, qu'il ne connaissait pas et dont la satisfaction et l'émotion furent grandes153. La prolongation de séjour accordée à Bussy, par l'entremise de M. de Pomponne154, était de deux mois; elle lui fit concevoir l'espérance de pouvoir obtenir durant ce temps, par ses démarches, la fin de son exil et la permission de paraître à la cour; puis enfin d'avoir un commandement, et de prendre sa part de succès et de gloire dans les guerres qui agrandissaient la France. C'était un noble orgueil, un rêve chéri auquel Bussy ne put jamais renoncer et qui, ne s'étant point réalisé, fit le malheur de sa vie.
Il écrivit d'abord au duc de Montausier pour demander d'être présenté au Dauphin et de le voir: «curiosité, dit-il, que j'aurais, quand je serais du Japon.» Il reçut une réponse polie et presque affectueuse155. Pendant le temps de son séjour à Paris, Bussy vit encore madame de Thianges; elle lui apprit qu'on avait rapporté de lui de mauvais propos qui entachaient la valeur du prince de Marsillac lors du fameux passage du Rhin à Tholus. Il protesta à madame de Thianges que c'était sans doute une fausseté et une perfidie de mademoiselle de Montalais, «parce que, disait-il, il n'y a qu'elle au monde assez méchante et assez folle pour inventer une chose dont la fausseté est aussi facile à découvrir que celle-là.» Bussy avait été très-bien avec cette spirituelle et intrigante sœur de madame de Marans; mais depuis peu (Montalais n'était plus jeune) il s'était brouillé avec elle156. Après cet entretien, Bussy écrivit une longue lettre à madame de Thianges pour se disculper des torts qu'on lui imputait envers la Rochefoucauld et son fils Marsillac. Il n'y a personne en France, selon Bussy, qui puisse rendre de plus assurés témoignages que lui «de la valeur du père et de celle du fils. Ils ont été blessés eu deux occasions où j'avais l'honneur de commander; l'une à Mardick et l'autre à Valenciennes157.» Il paraît que le duc de la Rochefoucauld fut peu touché de lire un certificat de service militaire, pour lui et pour son fils, tracé de la main du comte de Bussy-Rabutin; car après que madame de Thianges lui eut communiqué cette lettre, il ne répondit à cette avance de Bussy par aucune parole polie158.
Bussy, qui connaissait l'influence que la Rochefoucauld et Marsillac avaient auprès du roi, de Condé et du duc d'Enghien, fit taire son orgueil, et s'adressa à madame de Sévigné; il la pria de faire en sorte, par madame de la Fayette, que le duc de la Rochefoucauld consentît à le voir, afin qu'ils pussent être ensemble sur de meilleurs termes.
«Madame de Sévigné, dit Bussy dans ses Mémoires, s'en chargea; et, quatre ou cinq jours après, elle me dit que le duc de la Rochefoucauld avait répondu à son amie que, puisque avant que nous fussions brouillés nous ne nous voyions pas les uns les autres et que nous nous contentions de vivre honnêtement ensemble quand nous nous rencontrions, une plus grande liaison n'était pas nécessaire; que, pour lui, il serait très-aise de me rencontrer souvent, et qu'il se clouerait où je serais: ce furent ses propres termes.»—«Cette réponse, ajoute Bussy, me fit juger que j'aurais toujours à craindre de ce côté-là, et que je ne devais espérer de soutien que de la bonté du roi159.»
Si Bussy faisait cette réflexion, c'est qu'en même temps qu'il avait fait des démarches pour se réconcilier avec la Rochefoucauld il en avait tenté auprès du prince de Condé qui avaient encore moins réussi. Comme c'était la princesse de Longueville qu'il avait blessée par ses écrits et ses discours, et qu'il connaissait les sentiments chrétiens qui l'avaient déjà portée à le protéger contre la colère du prince lorsque l'outrage était récent160, il jugea avec raison qu'elle interviendrait en sa faveur avec toute la chaleur qu'inspire la céleste charité aux âmes pénétrées de repentir. Il ne se trompait pas: la duchesse de Longueville fit de grands efforts pour calmer le ressentiment de Condé; elle ne put y parvenir. Elle fut obligée de lui annoncer par mademoiselle Desportes161, dont Bussy, pour cette négociation, avait réclamé le secours, que monsieur son frère ne voulait point pardonner, et que même il lui avait dit «qu'il ne souffrirait pas que Bussy fût sur le pavé de Paris.»—«Ce discours, dit Bussy, me surprit; et je répondis à mademoiselle Desportes qu'il n'appartenait qu'au roi de parler ainsi: elle en convint.»
Bussy n'en fut que plus ardent à chercher des appuis contre une si puissante inimitié. Il savait que madame Scarron, dont l'influence auprès de madame de Montespan était connue, avait contre lui des préventions qui n'étaient que trop motivées; il écrivit à sa cousine pour la faire consentir à être son intermédiaire entre lui et cette gouvernante des enfants naturels du roi, avec laquelle il n'avait jamais eu de liaison ni de correspondance162.
Madame de Sévigné reçut la lettre que Bussy lui écrivit à ce sujet au retour d'un voyage à Saint-Germain. Elle y était allée pour voir ces mêmes personnes si contraires à Bussy et pour elle si amicales. Voici ce qu'elle dit de ce voyage en écrivant à sa fille: «Je viens de Saint-Germain, où j'ai été deux jours avec madame de Coulanges et M. de la Rochefoucauld; nous logions chez lui. Nous fîmes, le soir, notre cour à la reine, qui me dit bien des choses obligeantes pour vous… Mais s'il fallait vous dire tous les bonjours, tous les compliments d'hommes et de femmes, vieux et jeunes, qui me parlèrent de vous, ce serait nommer quasi toute la cour. J'ai dîné avec madame de Louvois; il y avait presse à qui nous en donnerait. Je voulais revenir hier; on nous arrêta d'autorité pour souper chez M. de Marsillac, dans un appartement enchanté, avec madame de Thianges et madame Scarron, M. le Duc et M. de la Rochefoucauld, M. de Vivonne, et une musique céleste. Ce matin, nous sommes revenues163.»
Ce fut deux jours après qu'elle reçut de Bussy la lettre suivante164:
LETTRE DE BUSSY A MADAME DE SÉVIGNÉ
«Paris, le 13 décembre 1673.
«Vous pouvez vous souvenir, madame, de la conversation que nous eûmes l'autre jour. Elle fut presque toute sur les gens qui pouvaient traverser mon retour; et quoique je pense que nous les ayons tous nommés, je ne crois pas que nous ayons parlé des voies dont ils se servent pour me nuire. Cependant j'en ai découvert quelques-unes depuis que je vous ai vue; et l'on m'a assuré, entre autres, que madame Scarron en était une. Je ne l'ai pas cru au point de n'en pas douter un peu; car, bien que je sache qu'elle est aimée des personnes qui ne m'aiment pas, je sais qu'elle est encore plus amie de la raison, et il n'en paraît pas à persécuter, par complaisance seulement, un homme de qualité, qui n'est pas sans mérite, accablé de disgrâces. Je sais bien que les gens d'honneur entrent et doivent entrer dans les ressentiments de leurs amis; mais quand ces ressentiments sont ou trop aigres ou poussés trop loin, il est (ce me semble) de la prudence de ceux qui agissent de sang-froid de modérer les passions de leurs amis et de leur faire entendre raison. La politique conseille ce que je vous dis, madame, et l'expérience apprend à ne pas croire que les choses sont toujours en même état. On l'a vu en moi; car enfin, quand je sortis de la Bastille, ma liberté surprit tout le monde. Le roi a commencé de me faire de petites grâces sur mon retour, dans un temps où personne ne les attendait; et sa bonté et ma patience me feront tôt ou tard recevoir de plus grandes faveurs. Il n'en faut pas douter, madame: les disgrâces ont leurs bornes comme les prospérités. Ne trouvez-vous donc pas qu'il est de la politique de ne pas outrer les haines et de ne pas désespérer les gens? Mais quand on se flatterait assez pour croire que le roi ne radoucira jamais pour moi, où est l'humanité? où est le christianisme? Je connais assez les courtisans, madame, pour savoir que ces sentiments-là sont très-faibles en eux; et moi-même, avant mes malheurs, je ne les avais guère. Mais je sais la générosité de madame Scarron, son honnêteté et sa vertu; et je suis persuadé que la corruption de la cour ne les gâtera jamais. Si je ne croyais ceci, je ne vous le dirais pas, car je ne suis point flatteur; et même je ne vous supplierais pas comme je fais, madame, de lui parler sur ce sujet; c'est l'estime que j'ai pour elle qui me fait souhaiter de lui être obligé, et croire qu'elle n'y aura pas de répugnance. Si elle craint l'amitié des malheureux, elle ne fera rien pour avoir la mienne; mais si l'amitié de l'homme du monde le plus reconnaissant (et à qui il ne manquait que la mauvaise fortune pour avoir assez de vertu) lui est considérable, elle voudra bien me faire plaisir.»
A cette lettre verbeuse, mais assez adroite, madame Scarron fit une prudente et courte réponse, contenue dans le billet suivant de madame de Sévigné à Bussy165.
BILLET DE MADAME DE SÉVIGNÉ A BUSSY
«A Paris, ce 15 décembre 1673.
«Je fis voir hier soir à madame Scarron la lettre que vous m'avez écrite. Elle m'a dit n'avoir jamais entendu nommer votre nom en mauvaise part. Du reste, elle a très-bien reçu votre civilité. Elle ne trouvera jamais occasion de vous servir qu'elle ne le fasse. Elle connaît votre mérite et plaint vos malheurs.»
Dans une longue lettre à sa fille166, écrite le même jour que le billet qu'on vient de lire, madame de Sévigné annonce très-laconiquement, en ces termes, que Bussy va quitter Paris: «Bussy a ordre de retourner en Bourgogne. Il n'a pas fait la paix avec ses principaux ennemis.»
La permission accordée à Bussy de prolonger son séjour à Paris finissait le jour même où madame de Sévigné écrivait le billet que nous avons transcrit167. Mais Bussy avait, dès le 2 décembre, écrit au roi et à M. de Pomponne pour obtenir une nouvelle prolongation de séjour, et ces lettres furent envoyées à Saint-Germain en Laye, où était la cour. Ce ne fut que par une lettre de M. de Pomponne, datée de Saint-Germain le 17 décembre, que Bussy fut informé du refus du roi168. Madame de Sévigné, par son intimité avec de Pomponne, savait donc avant Bussy que la permission ne lui serait pas accordée; et on voit, d'après la suite des Mémoires de celui-ci, qu'elle ne lui en a rien dit. On n'est jamais pressé d'annoncer une mauvaise nouvelle à un ami. Ce refus affligea beaucoup Bussy, et le mit dans une grande perplexité. Ses affaires n'étaient point terminées, ses espérances de rentrer en grâce s'évanouissaient, et il craignait de déplaire au roi et de s'attirer sa colère s'il prolongeait son séjour à Paris. Il prit cependant ce dernier parti, et fit ses adieux aux secrétaires d'État, à tous ses amis et à toutes les femmes de sa connaissance; de sorte qu'on le crut en Bourgogne, tandis qu'il était caché dans Paris. Il confia son secret au seul duc de Saint-Aignan; et, de la retraite où il se tenait renfermé, il faisait parvenir des lettres qu'il datait de son château de Bussy. Il écrivit au roi, au secrétaire d'État Châteauneuf, au comte de Vivonne, à madame de Thianges et à divers puissants personnages169.
Néanmoins, malgré toutes ces précautions, le secret transpira; Bussy n'avait pu se résoudre à le cacher à sa cousine170. Madame de Sévigné avait depuis un mois le bonheur de posséder sa fille avec elle lorsqu'elle apprit que Bussy était resté à Paris, et elle s'empressa d'aller rendre visite au captif volontaire; le billet qu'il lui adressa le lendemain de cette visite, en lui envoyant du vieux vin de Cotignac qui lui avait été donné autrefois par madame de Monglas, prouve évidemment que Bussy avait reçu des reproches de la mère et de la fille. Il s'ensuivit des explications et des épanchements réciproques, dont le cœur de Bussy dut être satisfait; il écrit alors à sa cousine: «Je ne vous aime pas plus que je ne vous aimais hier matin; mais la conversation d'hier soir me fait plus sentir ma tendresse; elle était cachée au fond de mon cœur, et le commerce l'a ranimée. Je vois bien par là que les longues absences nuisent à la chaleur de l'amitié aussi bien qu'à celle de l'amour171.»
Le duc de Saint-Aignan, ce fidèle ami de Bussy, vint souvent le visiter secrètement. Il se chargea de remettre ses lettres au roi et de plaider sa cause. Bussy demandait qu'il lui fût permis d'aller combattre en Flandre comme volontaire, sous les ordres de Condé; et Saint-Aignan suppliait le roi de lui accorder au moins cette faveur172. Les entretiens qui eurent lieu à ce sujet entre Louis XIV et son complaisant courtisan sont des scènes d'intérieur des plus curieuses, qui confirment tout ce que nous avons dit sur les sentiments du monarque à l'égard de Bussy.
Le roi dit: «Saint-Aignan, on accuse Bussy d'être l'auteur des chansons qui courent contre les ministres et contre quelques personnes de ma cour. Je ne crois pas cela, mais on le dit.»
Saint-Aignan répond: «Bussy trouve bien étrange, sire, d'être toujours accusé et jamais convaincu; et, pour déconcerter la malice de ses ennemis, il demande à Votre Majesté de trouver bon qu'il se remette à la Bastille et que les accusations soient de nouveau jugées.»
«Bussy perd l'esprit,» dit le roi.
«Nullement, sire; et pour être convaincu que Bussy n'est pas fou, il prie Votre Majesté de lire la lettre qu'il a écrite au roi, et de prendre un recueil de pièces qu'il m'a chargé de lui remettre, et qui, j'en suis certain, divertiront le roi, s'il veut se donner la peine d'y jeter les yeux.»
Louis XIV répondit qu'il recevrait tout cela quand il serait habillé; et en effet il fit appeler Saint-Aignan au sortir de son prie-Dieu, reçut les manuscrits et les lettres, et rentra dans son cabinet173.
Ainsi se termina ce premier entretien. Le duc de Saint-Aignan promit de faire plus, et il tint parole.
Le jeudi 19 avril (le jour même où Louis XIV partit de Versailles pour aller conquérir la Franche-Comté), Bussy reçut une longue lettre du duc de Saint-Aignan, dans laquelle celui-ci lui rendait compte de deux autres entretiens qu'il avait eus avec le roi à son sujet. «Je m'approchai, dit le duc, du lit du roi, mardi 17, à neuf heures du matin, et, m'étant mis à genoux, je pris la liberté de lui dire: Oserai-je, sire, demander à Votre Majesté si elle a lu le livre que je lui ai donné de la part du comte de Bussy; et, au cas qu'elle ne l'ait pas encore lu, si elle l'emportera avec elle?»
«Le roi me répondit:
«A propos, Saint-Aignan, j'ai un reproche à vous faire! Bussy est à Paris, et vous ne m'en avez rien dit.»
«Je lui répondis:
«Mon Dieu! sire, y va-t-il du service de Votre Majesté de lui donner ces sortes d'avis? Un pauvre homme de qualité, malheureux, est accablé d'affaires; pour y mettre quelque ordre, il se cache le plus qu'il peut, et cependant il se trouve des gens assez lâches pour lui rendre en cet état de méchants offices.»
«Mais enfin (me répliqua le roi), après que le temps que je lui avais donné est expiré, il faut qu'il s'en aille. Cela a trop paru, et si vous ne voulez vous charger de lui dire de ma part (à cause que vous êtes son ami), je serai contraint de le lui faire dire par quelque autre moins doucement.»
Saint-Aignan osa répliquer, et le roi s'adoucit et dit: «Je n'ai pas encore lu son recueil; il est dans ce petit cabinet, sur ma table.»
Saint-Aignan répondit:
«Sire, il faut l'emporter; et je voudrais que Votre Majesté y voulût joindre le premier tome de ses Mémoires. Outre qu'il est bien écrit, le roi y verrait de petites histoires galantes qui le divertiraient.»
Le roi termina en disant:
«Songez seulement à lui dire ce que je vous ai dit, et à mon retour toutes choses nouvelles.»
Saint-Aignan ne se rebuta pas; fidèle ami et habile courtisan, il connaissait tout le pouvoir de l'importunité sur une volonté flottante. Il retourna à Versailles le surlendemain, jour fixé pour le départ du roi, et pénétra de très-grand matin et lorsque le roi était encore couché. Après avoir pris congé de lui et baisé un bout de ses draps, il lui déclara, les yeux humides, qu'il n'avait pu encore se résoudre à parler au pauvre comte de Bussy de ce qu'il lui avait commandé de lui dire, parce que Bussy serait parti à l'instant même, au préjudice d'une affaire importante toute prête à être jugée; et que, d'ailleurs, lui Saint-Aignan espérait encore de la bouche du roi un ordre moins rigoureux.
«Eh bien! dit le roi, qu'il demeure encore quinze jours ou trois semaines, et qu'il s'en aille chez lui après. Entendez-vous, Saint-Aignan? Dites-lui cela au moins, n'y manquez pas.»
«Je le ferai, sire,» répliqua Saint-Aignan.
En effet, quatre jours après ce dernier entretien, Bussy gagna son procès. Il écrivit au roi, qui alors était au camp devant Besançon, pour lui témoigner la reconnaissance de cette nouvelle permission. Il adressa sa lettre au secrétaire d'État Châteauneuf, dont la réponse, quoique très-polie et même affectueuse, ne lui parut pas, par la souscription, assez respectueuse pour être adressée par un ministre à un ancien lieutenant général mestre de camp de la cavalerie légère, tel que lui. Le 12 mai, les trois semaines qui lui avaient été accordées par le roi étant expirées, Bussy partit avec sa fille Françoise, et retourna en Bourgogne174.
Dans les circonstances qui avaient accompagné le refus fait à Saint-Aignan, Bussy trouvait des motifs d'espérance. La guerre faite en Franche-Comté avait déterminé le roi à faire venir la reine à Dijon, et l'on croyait généralement que Louis XIV en prendrait occasion de rappeler près de lui un personnage aussi utile en Bourgogne que l'était Bussy. C'est ce que nous apprend MADEMOISELLE dans une réponse qu'elle fit à une lettre que Bussy lui avait écrite. Elle-même souffrait cruellement du refus du roi de consentir à son mariage avec Lauzun, et plaignait Bussy; elle lui écrivait en parlant du roi: «Il est comme Dieu; il faut attendre sa volonté avec soumission et tout espérer de sa justice et de sa bonté sans impatience, afin d'en avoir plus de mérite.» Bussy écrivit aussi à MADEMOISELLE pour la prier d'offrir à la reine de venir s'installer dans son château. «Le bruit est en ce pays-ci, dit-il dans sa lettre, que la reine viendra faire ses dévotions à Sainte-Reine. Si Sa Majesté prend cette pensée, je voudrais lui pouvoir offrir ma maison; et j'en sortirais, pour ne pas me présenter devant elle en l'état où je suis à la cour. Elle serait mieux logée que dans le village de Sainte-Reine, et n'en serait qu'à une demi-lieue. En tout cas, MADEMOISELLE, si la reine ne me faisait pas cet honneur, je l'espérerais de V. A. R.; je l'en supplie très-humblement175.»
La reine ne vint pas à Sainte-Reine. Bussy, à chaque nouvelle victoire, écrivait une lettre au roi; mais la conquête de la Franche-Comté s'acheva, et Louis XIV était de retour à Versailles sans que Bussy eût rien obtenu de lui176.
141
SÉVIGNÉ, Lettres (23 août 1673), t. III, p. 171 et 172, édit. G.; t. III, p. 97, édit. M.—Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, p. 41, ms. de l'Institut. (Dans ce ms., la lettre est datée du 27 août.)
142
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Institut, p. 42 verso.
143
SÉVIGNÉ, Lettres (21 octobre 1673), t. III, p. 195; t. III, p. 117.
144
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst., p. 44 verso.
145
Lettre de Bussy-Rabutin à Louis XIV (26 avril 1674) et à Châteauneuf, secrétaire d'État, dans la Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst., p. 65 et 66.
146
Lettre de Bussy-Rabutin à M. de Pomponne, datée de Paris le 8 octobre 1673, et de M. de Pomponne à Bussy, datée de Nancy le 15 oct., dans la Suite des Mém. de BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst., in-4o, p. 42 et 44.—ROGER DE RABUTIN, comte DE BUSSY, édit. 1737, t. V, p. 85. Mais la lettre est à tort datée du 15 septembre; c'est le 15 octobre qu'il faut lire. (Voy. la 4e partie de ces Mémoires, p. 156 et 344.)
147
Voyez la lettre du comte de Bussy insérée dans les Mémoires de COLIGNY-SALIGNY, 1841, p. 127, en date du 18 mai 1667.
148
MONTPENSIER, Mémoires, t. XLIII, p. 379.—Supplément aux Mémoires de BUSSY, 2e partie, p. 14 et 17.—BUSSY-RABUTIN, Lettres (20 juin et 28 novembre 1671), t. V, p. 190 et 315.
149
BUSSY-RABUTIN, Lettres (28 novembre 1673, de madame de la Morésan au comte de Bussy), t. V, p. 319.
150
Supplément aux Mémoires de M. le comte DE BUSSY, t. II, p. 17.—Au lieu de madame Damorisan, il faut lire la Morésan, comme le prouvent le Recueil des lettres de BUSSY, t. V, p. 319 et 190, et les Mémoires de MONTPENSIER, t. XLIII, p. 379 (année 1674).
151
LOUIS XIV, Œuvres (Lettre du roi au duc de Beaufort, en date du 8 décembre 1665), t. V, p. 338 et 342.
152
SÉVIGNÉ, Lettres (20 mai 1672), t. III, p. 31, éd. G.; t. II, p. 442, édit. M.—Mémoires du marquis DE VILLETTE, 1844, in-8o, p. 14. Martel, capitaine en 1635, lieutenant général en 1656-1679, n'est plus porté sur les états de la marine en 1682.
153
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Institut, p. 46 et 47.—SÉVIGNÉ, Lettres (13, 16 et 20 mai 1672; 23 août 1675, 6 août 1680), t. III, p. 15, 27, 31; t. IV, p. 48 et 49; t. VII, p. 156 et 157, édit. G.; t. II, p. 428, 439, 442; t. III, p. 422 et 423; t. VI, p. 413, édit. M.
154
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Institut, in-4o, p. 42 et 44.—Lettre de Bussy à M. de Pomponne, des 8 et 10 octobre 1673, et de M. de Pomponne à Bussy, datée de Nancy le 15 octobre 1673.
155
Lettre de Bussy au duc de Montpensier (Paris, le 11 octobre 1673).—Réponse du duc de Montpensier à Bussy (Versailles, 20 octobre 1673). Dans la Suite des Mém. de BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst., in-4o, p. 43 et 44.
156
Suite des Mém. de BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst, p. 45.—SÉVIGNÉ, Lettres (8 juillet 1672 et 5 juin 1675), t. III, p. 97 et 108, édit. G.; t. III, p. 31, 237, édit. M.—CHOISY, Mém., t. III, p. 264.—MOTTEVILLE, Mém., t. XLIII, p. 22.—LOUIS XIV, Œuvres, t. V, p. 90, 103, 340. (Voy. 4e partie de ces Mémoires, p. 212.)
157
Suite des Mém., ms., p. 45. (Lettre de Bussy à madame de Thianges, Paris, 25 octobre 1673.)
158
Suite des Mém., etc., ms. de l'Inst., p. 50.
159
Suite des Mémoires, etc., ms. de l'Inst., p. 50.
160
VILLEFORT, Vie de madame de Longueville, Amsterdam, 1739, in-12, t. II, p. 161, ou Paris, 1738, in-8o, p. 169; et 4e partie de ces Mémoires, p. 351 et 352.
161
Bussy dit: «Mademoiselle Desportes, ma bonne amie, fille d'une rare vertu et d'un mérite extraordinaire.»
162
Voyez ci-après, chap. VIII.
163
SÉVIGNÉ, Lettres (11 décembre 1673), t. III, p. 257, 258, édit. G.; t. III, p. 167, édit. M.—Sur les anciens plans gravés de Saint-Germain en Laye comme sur ceux de Fontainebleau, on trouve l'emplacement de tous ces hôtels des grands de la cour, et entre autres de ceux de Condé, de la Rochefoucauld et de Vivonne.—Conférez 1re partie, p. 365, 483; IVe, p. 273.
164
Suite des Mémoires de BUSSY-RABUTIN, ms. de l'Inst., in-4o, p. 51.
165
Suite des Mémoires de BUSSY-RABUTIN (ms. de l'Inst.), p. 52 verso. Ce billet de madame de Sévigné est inédit et a échappé à ses soigneux éditeurs.
166
SÉVIGNÉ, Lettres (15 décembre 1673), t. III, p. 265, édit. G.; t. III, p. 173, édit. M.
167
Suite des Mémoires (ms. de l'Inst.), p. 48, 49, 50 et 52 verso.
168
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN, p. 48 et 50.—Lettres de Bussy au roi et à M. de Pomponne, Paris, ce 2 décembre 1673, p. 54 et 55.—Lettre de Pomponne à Bussy, Saint-Germain en Laye, le 17 décembre 1673.
169
Suite des Mémoires, p. 58 (ms. de l'Inst.).—Lettre de Bussy au roi, datée de Bussy, le 31 décembre 1673—Bussy-Rabutin, lettres, t. V, p. 322, 323, 327, à la marquise de Villeroy, le 15 décembre, au duc de Montpensier, à madame de Thianges; 2e édit., p. 58, 59.—Lettre de Bussy au comte de Vivonne à Bussy, Paris, 13 janvier 1674; à madame de Pisieux, le 19 décembre; à mademoiselle Armantières, le 28 décembre 1673.
170
BUSSY-RABUTIN, Mémoires. Manuscrit cité par M. Monmerqué, Lettres de SÉVIGNÉ, t. III, p. 236, no 1, édit. M.
171
SÉVIGNÉ, Lettres (Paris, 20 mars 1674), t. III, p. 338, édit. G.; t. III, p. 236, édit. M.
172
Suite des Mémoires de BUSSY-RABUTIN, p. 61 verso.—Le duc de Saint-Aignan rapporte sa conversation avec le roi au 7 avril 1674.
173
Suite des Mémoires (ms. de l'Inst.), p. 62 verso.—Supplément aux Mémoires et Lettres de M. le comte DE BUSSY-RABUTIN, 2e partie, p. 23.—Conférez LOUIS XIV, Œuvres, t. V, p. 445 (mémoires militaires).
174
Suite des Mémoires du comte DE BUSSY-RABUTIN (ms. de l'Inst.), no 221, p. 67 verso.
175
Suite des Mémoires de BUSSY-RABUTIN, p. 67-68. Lettre de Bussy à MADEMOISELLE, en date de Bussy, du 28 mai 1674, p. 74.—Lettre de MADEMOISELLE à Bussy, Dijon, le 2 juin 1674. La lettre est signée ANNE-MARIE-LOUISE D'ORLÉANS.—Conférez sur cette signature l'État de la France, 1677, p. 468 et 469.—BUSSY, Lettres, t. V, p. 334.
176
LOUIS XIV, Œuvres, t. III, p. 512 (lettre datée de Versailles, le 1er juillet 1674, au maréchal de Turenne).—Suite des Mémoires de BUSSY-RABUTIN, p. 75 et 75 bis. (Lettre de madame Scudéry à Bussy, à Paris, 23 juin 1674.—Réponse de Bussy, datée de Bussy, le 26 juin 1674.)