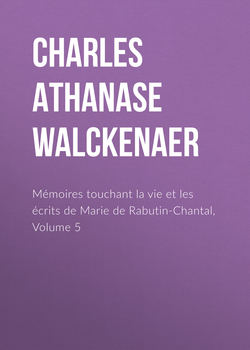Читать книгу Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 5 - Charles Walckenaer, Charles Athanase Walckenaer - Страница 6
CHAPITRE VI.
1674-1675
ОглавлениеLe parti religieux et le parti mondain se disputent l'influence sur Louis XIV.—Réforme dans la maison de la reine.—Les filles d'honneur sont remplacées par les dames du palais.—Effets de cette mesure.—Scrupules religieux de madame de Sévigné.—Sa visite à Port-Royal des Champs.—Son admiration pour le P. Bourdaloue.—Mort du grand Condé.—Bourdaloue console le duc de Gramont après la mort du comte de Guiche.—Madame de Sévigné détrompe sa fille, qui croit que l'on peut être à la cour longtemps triste.—Changement dans les spectacles de la cour.—Pour quelle raison le Malade imaginaire ne fut pas joué à la cour.—Molière et Lulli étaient rivaux.—Après la mort de Molière, Louis XIV charge Colbert de réorganiser les spectacles de Paris.—L'Opéra devient le spectacle dominant.—Alliance de Quinault et de Lulli.—On répète chez madame de Montespan l'opéra d'Alceste.—La Rochefoucauld est appelé à ces représentations.—Éloge que fait de cet ouvrage madame de Sévigné.—Le chœur des suivants de Pluton cité.—L'impulsion donnée à l'Opéra ne profite qu'à la musique instrumentale.—L'Italie reste supérieure à la France pour tout le reste.—Madame de Sévigné va à un opéra.—Des musiciens.—Molière chez Pelissari.—Des sociétés de Paris à cette époque.—Madame Pelissari réunit chez elle les littérateurs médiocres.—Composition de l'Académie française.—Madame de Sévigné annonce à sa fille la mort prochaine de Chapelain.—Cause de son peu de sympathie pour cet ancien maître de son enfance.—Elle devient l'admiratrice de Boileau.—Elle entend la lecture de son Art poétique chez Gourville et chez M. de Pomponne.—Ce poëme est livré à l'impression.—L'auteur y intercale, au moment de la publication, quatre vers pour célébrer la seconde conquête de la Franche-Comté.—Ces quatre vers nuisent à ceux qui les suivent, auparavant composés.
Il y avait à la cour deux partis qui se disputaient l'influence sur le roi. L'un, composé de tous les courtisans dévoués qui avaient part à ses largesses, de ceux qui désiraient obtenir à tout prix des grades, des commandements militaires, des gouvernements, de grandes charges, des intendances, des ambassades, des emplois lucratifs, des distinctions honorifiques: ceux-là pensaient que Louis XIV devait continuer le cours de ses conquêtes; que ses maîtresses, le faste de ses palais, de ses fêtes, de sa maison étaient des démonstrations obligées de sa grandeur et des manifestations nécessaires de sa puissance. Louvois et Montespan étaient les appuis naturels de ce parti. Le parti contraire aurait voulu que Louis XIV renonçât à ses maîtresses; qu'il épargnât à ses sujets le scandale de ses amours avec une femme mariée; qu'il restreignît ses dépenses et mît un terme à son ambition et qu'il n'excitât pas la haine des souverains et de toute l'Europe contre lui et contre la France. Dans ce parti étaient tous ceux qui voyaient le bien public dans le règne de la religion et des mœurs. Colbert, homme réglé dans sa conduite, pensait ainsi; mais il ne pouvait avoir sur son parti la même influence que Louvois sur le sien230. Chargé de l'administration des finances, il était obligé de mettre sans cesse de nouveaux impôts pour suffire à des dépenses qui s'accroissaient sans cesse; il ne le pouvait qu'en appesantissant de plus en plus le joug du despotisme sur les parlements, les assemblées des états, les magistrats municipaux, les membres de toutes les corporations qui jouissaient de quelque liberté, tous partisans de la paix et d'une sage réforme. La confiance que Louis XIV avait en Colbert comme habile administrateur était encore un obstacle qui lui faisait perdre tout crédit sur les hommes les plus honorables. Louis XIV ne lui imposait pas seulement le devoir de régler les finances de l'État, d'organiser la marine, le commerce; il ne se fiait qu'à lui pour ses dépenses privées, et il le chargeait du détail de celles qui concernaient ses maîtresses. Il n'oublia jamais que Colbert avait été sous Mazarin un excellent intendant; il s'en servait toujours comme tel, et rendait ce grand ministre complice des désordres que celui-ci aurait voulu empêcher. Plus que Louvois, et avec juste raison, Colbert excitait l'envie. Il est vrai qu'en travaillant sans cesse au bien de l'État il travaillait aussi à l'accroissement de sa fortune et à l'élévation de sa famille. Dans le clergé, dans la diplomatie et dans la marine les Colbert occupaient les principaux emplois, étaient revêtus des plus hautes dignités. Ne pouvant restreindre le roi dans son penchant à la profusion, Colbert en profitait pour son compte. Il laissa à sa mort douze millions, qui font vingt-quatre millions de notre monnaie actuelle. Cette fortune n'était pas, comme celle de Fouquet, le fruit de coupables manœuvres; mais, en définitive, c'était le trésor et les impôts sur les peuples, ruinés par la guerre, qui subvenaient aux générosités du monarque et à celles des provinces et des villes en faveur des ministres, de leurs parents et de leurs amis. Cependant ce parti, qui était véritablement celui des bonnes mœurs et le plus favorable aux intérêts du roi et du pays, ne manquait pas de soutiens à la cour: la religion lui en créait, pleins d'activité et de zèle. Parmi eux on comptait le duc de Beauvilliers et le maréchal de Bellefonds, Pomponne et beaucoup d'autres; enfin, il avait dans Bossuet et dans Bourdaloue deux apôtres sublimes.
Tous fondaient leur espoir sur l'auguste empire de la religion, qui parvient toujours à faire entendre sa voix puissante quand les passions sont apaisées. La foi était vivante dans l'âme de madame de Montespan comme dans celle de Louis XIV, et elle se manifestait dans tous les deux par leur exactitude à s'assujettir aux pratiques religieuses que l'Église prescrit.
Ce parti considéra avec raison comme un premier succès la religieuse retraite de la Vallière, et comme un second le renvoi des filles d'honneur. Quel qu'ait été le motif qui fit agir Montespan, il est certain que ce fut elle qui eut la principale part à cette réforme, qu'elle la désira et la voulut avec toutes ses conséquences. Madame de Sévigné, en donnant à madame de Grignan des détails sur l'intérieur de Quantova (c'est le nom chiffré par lequel elle désigne madame de Montespan), dit: «Il est très-sûr qu'en certain lieu on ne veut séparer aucune femme de son mari ni de ses devoirs; on n'aime pas le bruit, à moins qu'on ne le fasse231.»
On avait pensé à madame de Grignan pour être dame du palais; mais sans doute que madame de Montespan la trouva trop jeune et trop belle232.
Madame de Grignan dut peu regretter de n'avoir pas été nommée. Avec les filles d'honneur disparurent les joies et la gaieté de cette cour brillante: toute liberté en fut bannie; le service pénible et l'étiquette sévère auxquels les dames du palais furent assujetties firent souffrir celles qui avaient brigué avec ardeur ces charges lucratives et honorifiques. La contrainte et l'ennui s'appesantirent jusque sur les bals et les divertissements que le roi donnait fréquemment233.
Cependant cette réforme eut un très-heureux effet sur les mœurs; madame de Sévigné elle-même, qui plaisante sur les femmes devenues subitement dévotes, fut alors plus fortement tourmentée par les scrupules que lui causait souvent son amour excessif pour sa fille; elle trouva très-bien que l'animosité que celle-ci lui avait inspirée contre l'évêque de Marseille lui eût attiré un refus d'absolution. Elle dit à madame de Grignan: «Ce confesseur est un fort habile homme; et si les vôtres ne vous traitent pas de même, ce sont des ignorants, qui ne savent pas leur métier234.»
On voit par là que madame de Sévigné avait lu le traité du grand Arnauld sur la fréquente communion. Dans la lettre où elle dit à sa fille que d'Hacqueville ne voudrait pas des douceurs d'un attachement tel que celui qu'elle a pour elle, parce qu'il est mêlé de trop d'inquiétude et de tourments, elle ajoute: «D'Hacqueville a raison de ne vouloir rien de pareil; pour moi, je m'en trouve fort bien, pourvu que Dieu me fasse la grâce de l'aimer encore plus que vous: voilà ce dont il est question. Cette petite circonstance d'un cœur que l'on ôte au Créateur pour le donner à la créature me donne quelquefois de grandes agitations. La Pluie (M. de Pomponne) et moi nous en parlions l'autre jour très-sérieusement. Mon Dieu, qu'elle est à mon goût cette pluie! Je crois que je suis au sien; nous retrouvons avec plaisir nos anciennes liaisons235.» On ne peut douter que madame de Sévigné, lorsqu'elle écrivait cette lettre, n'eût alors la mémoire toute fraîche de l'admirable petit traité de saint Eucher sur le mépris du monde, dont son ami Arnauld d'Andilly venait de publier une traduction236, puisqu'elle reproduit une pensée d'Eucher en se servant des mêmes expressions.
Quand ses scrupules la préoccupent, elle se rapproche de ses anciens amis les jansénistes, surtout d'Arnauld d'Andilly; et alors les rigueurs de l'hiver ne peuvent l'arrêter. Ce fut un 23 janvier (1674) qu'elle alla voir pour la première fois Port-Royal des Champs; et elle écrit à sa fille: «Je revins hier du Mesnil (de chez madame Habert de Montmor), où j'étais allée pour voir le lendemain M. d'Andilly. Je fus six heures avec lui; j'eus toute la joie que peut donner la conversation d'un homme admirable; je vis aussi mon oncle Sévigné, mais un moment. Ce Port-Royal est une Thébaïde; c'est un paradis; c'est un désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée; c'est une sainteté répandue dans tout le pays, à une lieue à la ronde. Il y a cinq ou six solitaires qu'on ne connaît point, qui vivent comme les pénitents de saint Jean-Climaque. Les religieuses sont des anges sur terre. Mademoiselle de Vertus y achève sa vie. Je vous avoue que j'ai été ravie de voir cette divine solitude, dont j'ai tant ouï parler: c'est un vallon affreux, tout propre à inspirer le goût de faire son salut. Je revins coucher au Mesnil, et hier ici (Paris), après avoir embrassé M. d'Andilly en passant. Je crois que je dînerai demain chez M. de Pomponne; ce ne sera pas sans parler de son père (Arnauld d'Andilly) et de ma fille. Voilà deux chapitres qui nous tiennent au cœur237.»
Le penchant de madame de Sévigné pour ses amis les jansénistes ne diminuait en rien son admiration pour le jésuite Bourdaloue. Elle dit: «Le P. Bourdaloue fit un sermon le jour de Notre-Dame238 qui transporta tout le monde; il était d'une force à faire trembler les courtisans, et jamais prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes239.»
On connaît ce mot du grand Condé, qui, à l'église, lorsque le P. Bourdaloue montait en chaire, appuyant une main sur l'épaule de la duchesse de Longueville assoupie et de l'autre lui montrant la chaire, lui disait: «Ma sœur, réveillez-vous; voilà l'ennemi!»
Mais c'est lorsque madame de Sévigné peint le père Bourdaloue consolant le vieux maréchal de Gramont de la perte de son fils aîné, l'espoir de sa race, qu'elle nous montre toute l'influence de ce prédicateur sur les grands de cette époque. Elle trace de cette scène un admirable tableau. Guiche, qui fut exilé pour ses amours avec l'aimable Henriette et pour son intrigue avec Vardes contre la Vallière, n'était point généralement aimé. Madame de Sévigné, qui lui plaisait beaucoup par son esprit, trouvait le sien guindé, ceinturé comme sa personne. Cependant sa mort fit une sensation profonde. On comprit qu'en lui disparaissait l'homme de la cour le plus beau, le plus brillant, le plus chevaleresque, le plus instruit; le comte de Guiche aurait eu toutes les qualités qui font le héros s'il n'avait eu les défauts qui empêchent de le devenir: la vanité et la présomption. Ce fut lui qui, en s'élançant le premier dans le courant rapide du Rhin, assura le passage de ce fleuve. Louis XIV, témoin de son courage impétueux, lui eût accordé toute sa faveur s'il avait pu abattre en lui cet orgueil hautain qui le mettait mal à l'aise avec toute supériorité. Un léger revers à la guerre lui fut si sensible qu'il en mourut de chagrin240.
«Il faut commencer, ma chère enfant, par la mort du comte de Guiche. Le P. Bourdaloue l'a annoncée au maréchal de Gramont, qui s'en douta, sachant l'extrémité de son fils. Il fit sortir tout le monde de sa chambre. Il était dans un petit appartement qu'il a au dehors des Capucines. Quand il fut seul avec ce père, il se jeta à son cou, disant qu'il devinait bien ce qu'il avait à lui dire; que c'était le coup de sa mort; qu'il la recevait de la main de Dieu; qu'il perdait le seul et véritable objet de toute sa tendresse et de toute son inclination naturelle; que jamais il n'avait eu de sensible joie et de violente douleur que par ce fils, qui avait des choses admirables. Il se jeta sur un lit, n'en pouvant plus, mais sans pleurer, car on ne pleure plus dans cet état. Le père pleurait, et n'avait encore rien dit. Enfin il lui parla de Dieu comme vous savez qu'il en parle. Ils furent six heures ensemble; et puis le père, pour lui faire faire son sacrifice entier, le mena à l'église de ces bonnes Capucines, où l'on disait vigiles pour ce cher fils. Le maréchal y entra en tremblant, plutôt traîné et poussé que sur ses jambes; son visage n'était plus connaissable. Monsieur le Duc le vit en cet état, et, en nous le contant chez madame de la Fayette, il pleurait. Le maréchal revint enfin dans sa petite chambre; il est comme un homme condamné. Le roi lui a écrit; personne ne le voit241.»
Ce touchant récit fit croire à madame de Grignan que sa mère, ses amis étaient inconsolables de la mort du comte de Guiche. Mais dans cette cour, tout occupée de plaisirs et d'ambition, et de gloire et d'amour, personne ne pouvait paraître triste, surtout lorsque le roi avait daigné vous consoler. Aussi madame de Sévigné écrit à sa fille: «Hors le maréchal de Gramont, on ne songe déjà plus au comte de Guiche: voilà qui est fait242.» Mais elle fut obligée de s'y reprendre à plusieurs fois pour ramener madame de Grignan à son unisson. «Ha! fort bien; nous voici dans les lamentations du comte de Guiche. Hélas! ma pauvre enfant, nous n'y pensons plus ici, pas même le maréchal, qui a repris le soin de faire sa cour.» Quelques jours après, nouvelle réprimande: «Vous vous moquez avec vos longues douleurs! Nous n'aurions jamais fait ici si nous voulions appuyer autant sur chaque nouvelle: il faut expédier; expédiez, à notre exemple243.»
Elle expédie en effet; et il est impossible de trouver dans aucune correspondance autant de faits intéressants sur les événements publics, les personnages du temps, les spectacles, la littérature et la vie de toute une époque, touchés avec tant de concision, d'esprit, de finesse et de gaieté.
Un grand changement eut lieu dans les spectacles à la cour et à la ville, car alors Paris se conformait à la cour; c'était le roi qui réglait l'un et l'autre.
Louis XIV a dit, dans ses Instructions au Dauphin, qu'il est du devoir d'un monarque de donner des amusements à sa cour, à son peuple, à lui-même244. Les spectacles publics furent donc par lui mis au nombre des affaires d'État. La mort de Molière les avait désorganisés. Cependant la comédie n'était pas le genre de spectacle que préférait Louis XIV: il aimait par-dessus tout la danse, la musique, les belles décorations; il n'oubliait pas qu'il avait autrefois brillé dans les ballets composés pour lui. Il avait été, dans sa jeunesse, un très-bon joueur de guitare245; ce qui n'étonne pas quand on sait qu'on lui donna un maître de cet instrument lorsqu'il était à peine âgé de huit ans246. C'est cette préférence du roi pour la musique qui avait fait le succès de l'opéra, introduit en France par Mazarin. Mais Molière, aussi habile directeur de spectacles qu'auteur illustre et bon acteur, pour donner au roi le goût de la comédie, imagina de joindre à ses pièces des danses, des chants, des ballets-mascarades, bien ou mal motivés247. Il chargeait Lulli d'en faire la musique; et même, dans la composition de la tragi-comédie-ballet de Psyché, il fit concorder heureusement, pour aller plus vite, Lulli, Quinault et Corneille. Le grand tragique fut lui-même étonné qu'en remplissant le cadre qui lui était donné sa muse, affaiblie par l'âge, eût retrouvé, pour une déclaration d'amour, tout le feu de la jeunesse. C'est ainsi que Molière soutint son théâtre florissant contre les dangereuses rivalités du théâtre de la rue Guénégaud, où se jouait l'opéra; du théâtre de l'hôtel de Bourgogne et de celui du Marais, où l'on représentait les pièces de Racine et celles de Corneille248.
La musique est un art qui ne parle au cœur et à l'imagination que par les sons. Par cela même elle convient mieux que les compositions dramatiques à ceux que l'âge ou la multiplicité des affaires ont rendus, dans leurs moments de distraction, peu capables d'une attention soutenue. Tel commençait à être Louis XIV. Lulli s'aperçut du déclin de son goût pour la comédie. Il s'associa avec Quinault, dont il espérait avec raison obtenir des opéras meilleurs que ceux de l'abbé Perrin249; et, pour empêcher que Molière ne pût réunir dans ses compositions la comédie et l'opéra, il obtint une ordonnance (22 avril 1672) qui portait défense aux comédiens d'avoir, pour leurs représentations, plus de deux voix et plus de six violons. Dès lors Molière, brouillé avec Lulli ne put se servir de lui pour les ballets du Malade imaginaire, et il en fit composer la musique par Charpentier, musicien aussi habile, mais non aussi goûté que Lulli, qui le persécuta par jalousie250. Le Malade imaginaire fut cependant représenté sur le théâtre du Palais-Royal, le 10 février 1673, avec toute sa musique, et imprimé la même année251; mais il ne fut joué à la cour que l'année suivante252. Débarrassé d'un redoutable rival par la mort de Molière, Lulli resta le directeur favorisé des divertissements du roi. Quatre des principaux acteurs de la troupe de Molière s'en étant séparés pour entrer dans la troupe de l'hôtel de Bourgogne, Colbert fut chargé par Louis XIV de former, des débris de la troupe du grand comique et de celle du Marais, une nouvelle troupe qui fut transportée rue Mazarine; et le théâtre du Palais-Royal fut donné à Lulli pour y établir l'Opéra, décoré du nom d'Académie royale de musique. L'ancien Opéra du marquis de Sourdac disparut, et le nouvel Opéra fut fondé par l'association de Lulli, de Quinault, de Vigaroni; le musicien, le poëte et le décorateur formèrent un spectacle tout nouveau, d'une grandeur et d'une magnificence fort au-dessus de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Il devint célèbre dans toute l'Europe, et n'a cessé de contribuer aux progrès de la chorégraphie, de la musique vocale et instrumentale. Quoique toujours onéreux pour l'État, il a survécu à tous les désastres de nos révolutions. Malgré la réunion des talents qui contribuaient à sa réussite, il causa, dans la nouveauté, plus d'admiration que de plaisir253, et il ne se soutint que par la volonté et la munificence de Louis XIV, qui le mit à la mode. Jamais, depuis, l'empressement du public ne suffit pour entretenir ce spectacle dans la splendeur et le luxe qui est de son essence; pour qu'il pût subsister il a fallu que tous les gouvernements qui se sont succédé en France fussent pour lui plus prodigues encore que n'avait été Louis XIV.
Ce fut madame de Montespan qui eut la principale part à cette rénovation de l'Opéra. Pour faire cette révolution théâtrale, elle s'appuya sur l'opinion de la Rochefoucauld, alors, à la cour, le grand arbitre du goût. «M. de la Rochefoucauld, dit madame de Sévigné à sa fille, ne bouge de Versailles; le roi le fait entrer chez madame de Montespan pour entendre les répétitions d'un opéra qui passera tous les autres: il faut que vous le voyiez254.» Cet opéra était celui d'Alceste ou le Triomphe d'Alcide, qui fut le premier que composa Quinault depuis qu'il avait fait alliance avec Lulli et que la salle du Palais-Royal avait été accordée à ce dernier pour son spectacle255. Le succès de ce nouvel ouvrage fut grand, et fit oublier à ce public ému et flatté que Molière, dans cette même salle, en le bafouant le faisait rire. Madame de Sévigné écrit le 8 janvier 1674: «On joue jeudi l'opéra qui est un prodige de beauté; il y a des endroits de la musique qui m'ont fait pleurer; je ne suis pas seule à ne le pouvoir soutenir; l'âme de madame de la Fayette en est tout alarmée256.» Je le crois sans peine: celle qui n'avait jusqu'alors entendu que les opéras de François Perrin, les maigres instruments de Gabriel Gilbert et les accompagnements monotones de Cambert257 devait être agréablement surprise de cette variété d'instruments, de ces timbales, de ces trompettes qui produisaient, par leur éclatante harmonie, des effets inconnus à la musique française. Les récitatifs du musicien florentin, admirés encore de nos artistes modernes par la vérité de la déclamation et la justesse de la prosodie, ne devaient pas médiocrement toucher des femmes d'un goût aussi exercé que madame de la Fayette et madame de Sévigné. Le beau chœur des suivants de Pluton, qui se réjouissent de la venue d'Alceste dans les enfers, rehaussé par la musique de Lulli, était surtout propre à alarmer la constitution maladive et vaporeuse de madame de la Fayette:
Tout mortel doit ici paraître:
On ne peut naître
Que pour mourir.
De cent maux le trépas délivre:
Qui cherche à vivre
Cherche à souffrir.
Chacun vient ici-bas prendre place;
Sans cesse on y passe,
Jamais on n'en sort.
Est-on sage
De fuir ce passage?
C'est un orage
Qui mène au port.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaintes, cris, larmes,
Tout est sans armes
Contre la mort.
Chacun vient ici-bas prendre place;
Sans cesse on y passe,
Jamais on n'en sort258.
Cependant l'impulsion donnée par la faveur de Louis XIV au théâtre de l'Opéra, décoré du nom d'Académie, ne profita bien qu'à la musique et à la danse. La France resta toujours inférieure à l'Italie sous le rapport des machines et des décorations comme sous celui du chant et de la poésie. Les plus belles pièces de Quinault ne sont pas comparables aux plus médiocres de Métastase; et néanmoins aucun de nos poëtes, depuis Louis XIV, n'a réussi mieux que Quinault dans ce genre de composition. Mais l'Opéra français devint, dès son début au Palais-Royal, supérieur dans la musique instrumentale. Le poëme, les danses, les ballets n'excitaient qu'un plaisir secondaire en comparaison des belles symphonies que Lulli composait; ses opéras ressemblaient à des concerts. C'est ce dont se plaint amèrement la Bruyère, ce grand peintre de la société française dans le grand siècle259. Les imitateurs du Florentin profitèrent du goût régnant pour composer des opéras courts, presque sans récitatifs, tout en symphonies et qui pouvaient se passer des prestiges du théâtre. Un musicien nommé Molière (qui n'avait rien de commun que le nom avec le grand comique) paraît avoir particulièrement réussi dans ces opéras-concerts, dont l'abbé Tallemant composait les paroles et qu'il faisait chanter chez lui et dans des fêtes particulières260. Le 5 février (jour anniversaire de sa naissance), madame de Sévigné écrit à sa fille: «Je m'en vais à un petit opéra de Molière, beau-père d'Itier261, qui se chante chez Pelissari; c'est une musique très-parfaite. M. le Prince, M. le Duc et madame la Duchesse y seront.»
Pelissari était un riche financier, ami de Gourville et de d'Hervart262. Madame de Sévigné l'avait connu chez Fouquet au temps de la Fronde, et avec lui, comme avec Jeannin de Castille, elle était restée liée. Déjà les plus grands personnages de ce temps aimaient à se réunir chez ces riches roturiers, qui acquirent dans le siècle suivant une influence toujours croissante. Le jeu, la bonne chère faisaient éprouver à tous ces hommes de la cour des plaisirs plus vifs que ceux qu'ils devaient à la magnificence du monarque, parce que les plus élevés parvenaient, par la familiarité même de leur excessive politesse, à faire régner dans ces cercles, honorés par leur présence, tout le charme d'une parfaite égalité sans rien perdre des avantages que leur donnait la supériorité de leur rang et de leur naissance; et depuis lors ce fut là le triomphe du savoir-vivre et du suprême bon ton. Ainsi nous voyons madame de Sévigné, vivement pressée de se rendre à une invitation de la duchesse de Chaulnes avec les cardinaux de Retz et de Bouillon, préférer un souper chez Gourville263, où elle devait se réunir avec toute sa société, M. de la Rochefoucauld, madame de la Fayette, M. le Duc, le comte de Briord264, son aide de camp, madame de Thianges, madame de Coulanges, Corbinelli. Madame de Sévigné ne pouvait être attirée chez Pelissari que les jours de concerts et de grandes réunions. La société de madame Pelissari était toute différente de la sienne. Celle-ci recevait beaucoup d'hommes de lettres, mais c'étaient précisément ceux qui régnaient alors à l'Académie et qui n'avaient aucun succès à l'hôtel de la Rochefoucauld. Pavillon était le Voiture de ce pastiche de l'hôtel de Rambouillet265. Le jour que madame de Sévigné se rendit chez madame Pelissari pour entendre l'opéra de Molière, elle dut y trouver Cotin, qui récita peu après, en séance publique, des vers à la louange du roi; Gilles Boileau266, l'ami de Cotin et l'ennemi de Despréaux, son frère; puis Furetière, Charpentier, l'abbé Tallemant, Perrault, le vieux Bois-Robert, Quinault, Regnier, Desmarais, Benserade et d'autres moins connus. C'étaient alors les coryphées de l'Académie française, peuplée en majeure partie de grands seigneurs, loués par leurs confrères en vers et en prose. Ceux-ci formaient une ligue en faveur des médiocrités intrigantes; ils exaltaient le siècle présent, et dépréciaient tous les siècles qui l'avaient précédé. Leur règne allait cesser. A la vérité Despréaux et la Fontaine devaient attendre dix ans encore leur admission à l'Académie; mais déjà depuis deux ou trois ans l'ennemi avait commencé à pénétrer dans la place. Bossuet avait été reçu de l'Académie en 1671, Racine et Fléchier en 1673, le savant Huet, qui écrivait des poëmes charmants dans la langue de Virgile, en 1674. Benserade, sans beaucoup d'avantages pour l'illustre compagnie, allait y remplacer Chapelain. Madame de Sévigné ne manque pas de donner à madame de Grignan des nouvelles de ce dernier, si connu d'elle et de toute sa famille: «M. Chapelain se meurt; il a une manière d'apoplexie qui l'empêche de parler; il se confesse en serrant la main; il est dans sa chaise comme une statue: ainsi Dieu confond l'orgueil des philosophes. Adieu, ma bonne267.»
On est étonné du peu d'affection que manifeste en cette circonstance madame de Sévigné pour l'ancien précepteur des MM. de la Trousse, ses parents; pour celui qui, avec Ménage, lui avait donné à elle-même des leçons dont elle avait si bien profité. Mais Chapelain, qui avait été une des grandes notabilités littéraires chez la marquise de Sablé268, dans les réunions hebdomadaires de mademoiselle de Scudéry et à l'hôtel de Rambouillet, où Arnauld d'Andilly l'avait introduit269, où ses liaisons avec les solitaires de Port-Royal lui donnaient de l'importance; cet auteur tant prôné, si magnifiquement récompensé par les ducs de Longueville et de Montausier; ce juge souverain en matière de goût, selon Balzac270, était devenu ridicule par la publication de son grand poëme et par son avarice271. On convenait que Boileau Despréaux, pour répondre aux reproches que lui adressait le spirituel de Coupeauville272 d'avoir si maltraité le chantre malencontreux de la célèbre Pucelle, avait eu raison de dire: «Mais je n'ai été que le secrétaire du public; je ne suis coupable que d'avoir dit en vers ce que tout le monde dit en prose273.» Madame de Sévigné fut tout étonnée de voir le satirique «s'attendrir pour le pauvre Chapelain,» et elle lui pardonnait de s'être montré si cruel en vers, puisqu'il était si tendre en prose274. Elle admirait plus que personne le talent de Despréaux, et recherchait les réunions ou il faisait des lectures de son Art poétique, qui devait bientôt paraître et faire époque dans la littérature française.
Le 15 décembre (1673), elle écrit: «Je dînai hier avec M. le Duc, M. de la Rochefoucauld, madame de Thianges, madame de la Fayette, madame de Coulanges, l'abbé Têtu, M. de Marsillac et Guilleragues, chez Gourville. Vous y fûtes célébrée et souhaitée; et puis on écouta la Poétique de Despréaux, qui est un chef-d'œuvre275.»
Elle n'entendit cette fois qu'une portion du poëme; car, un mois après, elle écrit encore: «De Pomponne m'a priée de dîner demain avec lui et Despréaux, qui doit lire sa Poétique.» Le surlendemain, elle commence ainsi une autre lettre: «J'allai donc dîner samedi chez M. de Pomponne, comme je vous avais dit; et puis (on dînait alors à midi), jusqu'à cinq heures, il fut enchanté, enlevé, transporté de la perfection des vers de la Poétique de Despréaux. D'Hacqueville y était. Nous parlâmes deux ou trois fois du plaisir que j'aurais de vous la voir entendre276.»
J'ai dit que madame de Sévigné entendit la lecture de l'Art poétique en entier. En effet, ce poëme était achevé, puisque Boileau l'inséra dans la première édition de ses œuvres, dont il devait bientôt faire commencer l'impression et qui parut six mois après la date de la lettre de madame de Sévigné. Il y a cependant des vers, dans ce poëme, que l'auteur ne composa qu'après la lecture qu'il en avait faite chez M. de Pomponne: ce sont ceux où la conquête de la Franche-Comté est célébrée. Cette conquête ne fut commencée que six semaines après cette lecture et terminée seulement cinq jours après l'impression des Œuvres diverses du sieur D***. (Despréaux).
Condé, qui, lorsqu'il s'était révolté, avait servi et commandé chez les Espagnols, connaissait leurs hommes d'État et leurs guerriers; il lui fut donc facile de préparer la seconde conquête de la comté de Bourgogne277. Rentrée, par le traité d'Aix-la-Chapelle, sous la domination espagnole, cette province était mécontente des dons gratuits et des subsides que l'Espagne avait exigés d'elle pour le rétablissement des fortifications détruites par la France et pour l'entretien des garnisons que la guerre forçait d'y placer. Mais cette fois aussi, mieux fortifiée, plus garnie de troupes et préparée depuis longtemps pour l'état de guerre, on ne pouvait plus la surprendre; et la conquérir était devenu plus difficile. Louis XIV empêcha très-habilement les Suisses, qui craignaient de devenir les voisins de la France, de se joindre aux Espagnols, en offrant au roi d'Espagne de déclarer la neutralité de la Franche-Comté. Il s'y refusa, quoique sollicité par les Suisses, qui s'étaient joints à Louis pour cette négociation. Dès lors l'état de guerre qui existait entre l'Espagne et la France légitima l'attaque de la Franche-Comté, et les Suisses n'eurent aucune raison valable pour s'y opposer. Gourville, l'homme de Condé, Bouchu, l'intendant de la Bourgogne, le marquis de Vaubrun préparèrent les succès de cette attaque par leurs secrètes négociations avec le prince d'Aremberg, le marquis de Listenay et don Guignones278. Le maréchal de Navailles commença l'invasion; il prit Gray en trois jours, le 1er mars; Vesoul, le 10279. Le siége de Besançon, fait par le roi en personne, fut pénible: cette place ne se rendit qu'après huit jours de tranchée, le 15 mai; et la citadelle, le 22. Dôle ouvrit ses portes le 6 juin, après sept jours de tranchée; et la Feuillade entra dans Salins le 22 juin, après un siége de sept jours. Mais la conquête de la Franche-Comté ne fut complétée que le 5 juillet, lorsque le marquis de Renel (ami et allié de Bussy) eut pris Lure et Fauconier280.
Comme le volume des œuvres diverses de Despréaux ne fut achevé d'imprimer que le 10 juillet, et qu'après les vers où il célèbre la conquête de la Franche-Comté près des deux tiers de son volume étaient à imprimer, et que le privilége du roi est daté du 12 juin, il en résulte que ce fut après avoir livré son manuscrit à l'imprimeur, c'est-à-dire après le 22 juin, et sur les épreuves mêmes de son ouvrage, que Boileau, sans craindre qu'on lui révoquât son privilége, ajouta les vers suivants, adressés, comme ceux qui les précèdent, aux auteurs qui voudront célébrer les victoires de Louis XIV:
Mais tandis que je parle une gloire nouvelle
Vers ce vainqueur rapide aux Alpes vous appelle.
Déjà Dôle et Salins sous le joug ont ployé;
Besançon fume encor sur son roc foudroyé.
Remarquons que ce fut au détriment du poëme que ces quatre vers furent intercalés. Les vers qui les suivent étaient, avant cette intercalation, à la suite de ceux sur le passage du Rhin et de la conquête de la Hollande, et s'appliquaient mieux à ce passage et à cette conquête qu'au siége de Besançon et de Salins. Quel auteur, dit le poëte,
Chantera le Batave, éperdu dans l'orage,
Soi-même se noyant pour sortir du naufrage;
Dira les bataillons sous Mastricht enterrés,
Dans ces affreux assauts du soleil éclairés?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Où sont ces grands guerriers dont les fatales ligues
Devaient à ce torrent apporter tant de digues?
Est-ce encore en fuyant qu'ils pensent l'arrêter
Fiers du honteux honneur d'avoir su l'éviter281.
Quand Despréaux écrivit ces vers, on était à la fin de l'année 1673. Le Rhin avait été passé le 12 juin 1672, et Maestricht s'était rendu au roi le 29 juin 1673. Ces exploits, quoique récents, étaient déjà anciens; ils avaient fatigué les muses adulatrices, et ces vers, au moment de leur publication, formaient un anachronisme. Louis XIV, dès la fin d'octobre de l'année précédente, pour mieux attaquer l'Espagne, avait commencé à retirer ses troupes de la Hollande: le Batave éperdu, au lieu de fuir, rentrait dans ses foyers. Les forces qui avaient envahi la république étaient postées sur le haut Rhin; et Bonne, mal fortifiée, avait capitulé le 12 novembre 1673, après huit jours de siége. La conquête de la Franche-Comté, célébrée par le poëte avant même d'être achevée, avait pour les lecteurs le mérite si grand de la nouveauté; mais les vers qui suivaient, depuis l'évacuation des places conquises sur la Hollande, n'étaient plus d'accord avec l'histoire. Le Batave, ligué avec toute l'Europe, après avoir fait rebrousser le torrent dévastateur, espérait l'anéantir ou lui imposer des digues qu'il ne pourrait franchir: il ne parvint alors qu'à en détourner le cours. Condé, à la tête d'une poignée de troupes, soutint, dans les plaines des Pays-Bas, le choc des puissances armées; Luxembourg, son disciple, leur ferma les passages de la Suisse; Turenne, ceux de l'Alsace, et il les rejeta au delà du Rhin282. Louis XIV, couvert par l'habileté de ses grands capitaines, put, en achevant la conquête de la Franche-Comté, compléter ainsi le sol de la France, depuis maintenu par la Providence dans son intégrité, malgré soixante ans de délire révolutionnaire et d'usurpations insensées283.
230
DEPPING, Correspondance administrative de Louis XIV. Lettres du roi à Colbert (18 mai et 19 juin 1674), dans les Documents historiques tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale, 1843, in-4o, t. II, p. 524, 525 et 526.
231
SÉVIGNÉ, Lettres (8 janvier 1674), t. III, p. 299, édit. G.; t. III, p. 203, édit. M.
232
SÉVIGNÉ, Lettres (18 décembre 1673), édit. G., t. III, p. 268.
233
SÉVIGNÉ, Lettres (22 et 29 janvier 1674), t. III, p. 324 et 331, édit. G.; t. III, p. 225 et 231, éd. M.—Lettres des FEUQUIÈRES (25 janvier 1674), t. II, p. 248.
234
SÉVIGNÉ, Lettres (4 décembre 1673), t. III, p. 249, édit. G.; t. III, p. 160, édit. M. Voyez ci-après chap. X, p. 198.
235
SÉVIGNÉ, Lettres (18 décembre 1673), t. III, p. 268; t. III, p. 177, édit. M. (1820).
236
SAINT-EUCHER, Du mépris du monde, traduit par ARNAULD D'ANDILLY dans Pierre le Petit, 1687, in-12 (81 pages), p. 54. Après le privilége il est dit: «Achevé d'imprimer pour la première fois le 3 décembre 1671.» Ainsi il y a eu une édition antérieure, et nous apprenons par l'avertissement que cette édition contenait aussi le latin. Il manque dans la nôtre.
237
SÉVIGNÉ, Lettres (26 janvier 1674), t. III, p. 326 et 327, édit. G.; t. III, p. 227, édit. M.
238
Le jour de la Purification, le 2 février, ou peut-être le dimanche 28 janvier; car cette fête commençait le dimanche qui précédait ce jour et se continuait jusqu'au jour même. Voyez BOSSUET, Catéchisme des festes, 1687, p. 86.
239
SÉVIGNÉ, Lettres (5 février 1674), t. III, p. 336, édit. G.; t. III, p. 234, édit. M.
240
Voyez PROSPER MARCHAND, Dictionnaire historique, 1758, in-folio, p. 296-300.—Mémoires du comte DE GUICHE, Utrecht, 1744, in-12, deux volumes.—Conférez ces Mémoires sur madame de Sévigné, I, 302; II, 139, 191, 312; IV, 134, 212.—HAMILTON, Œuvres, t. I, p. 25.
241
SÉVIGNÉ, Lettres (8 décembre 1673), t. III, p. 251, édit. G.; t. III, p. 161, édit. M.—Le comte de Guiche mourut le 29 novembre 1674 à Creutznach dans le palatinat du Rhin, entre les bras de son frère le comte de Louvigny.—Conférez SÉVIGNÉ, Lettres (27 septembre et 4 octobre 1671), t. II, p. 243, 254, 350, édit. G.; et Mémoires et fragments historiques de MADAME, duchesse D'ORLÉANS, princesse Palatine, édit. 1832, p. 207.—Lettres des FEUQUIÈRES, t. VI, p. 321.
242
SÉVIGNÉ, Lettres (18 décembre 1673), t. III, p. 266, édit. G.; t. III, p. 175, édit. M.
243
SÉVIGNÉ, Lettres (25 décembre 1673), t. III, p. 276, édit. G.; t. III, p. 183, édit. M.—Ibid. (28 décembre 1673), t. III, p. 283, éd. G.; t. III, p. 189, édit. M.
244
DUC DE NOAILLES, notes sur les Mémoires de Louis XIV; appendice à la Vie de Maintenon, 1848, in-8o, t. I, p. 558.
245
Mémoires de Noailles, dans Petitot, t. LXIV, p. 104. Lettre de la princesse des Ursins (11 juillet 1698).
246
État général des officiers, domestiques et commensaux du Roi, mis en ordre par le sieur DE LA MARTINIÈRE, p. 116. Ce maître de guitare se nommait Bernard Jourdan, sieur de la Salle, et c'est le 29 avril 1651 que de la Salle fut placé près du jeune roi, afin de lui enseigner à jouer de la guitare. Le maître de luth n'avait que le quart des appointements du maître de guitare.
247
Conférez Mémoires sur Sévigné, t. I, p. 513, 525; t. II, ch. XXIII, p. 332, 340; t. III, ch. V, p. 98.
248
Vie de PHILIPPE QUINAULT, dans l'édition de ses Œuvres, 1715, in-12, t. I, p. 33-35.—CHAPUZEAU, le Théâtre français, divisé en trois livres, 1674, in-12, p. 198-211.
249
Les frères PARFAICT, Histoire du Théâtre français, t. XI, p. 293.
250
TITON DU TILLET, Parnasse françois, Paris, 1732, in-folio, p. 490.—ROQUEFORT, dans la Biographie universelle, t. VIII, p. 244, article Charpentier (Marc-Antoine). Ce savant maître de musique de la Sainte-Chapelle naquit à Paris en 1634, et y mourut en 1702, âgé de soixante-huit ans.
251
Avec le Prologue, 36 pages in-4o, Paris, 1663, chez Christophe Ballard.
252
FÉLIBIEN, les Divertissements de Versailles, p. 28.
253
Conférez LA FONTAINE, Épître à M. Nyert sur l'Opéra, et nos notes dans les Œuvres, édit. 1827, t. VI, p. 108 à 119.—RAGUENET, Parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde la musique et l'Opéra, in-12, Paris, 1702, p. 124.—LA BRUYÈRE, Caractères, ch. XLVII, t. I, p. 164, édit. W., 1835, in-8o et in-12.
254
SÉVIGNÉ, Lettres (20 novembre 1673), t. III, p. 231, édit. G.; t. III, p. 146, édit. M.—Vie de QUINAULT, dans les Œuvres de QUINAULT, édit. 1715, p. 34.
255
Le premier opéra de ces deux auteurs, joué dans cette salle, fut Cadmus et Hermione, représenté le 17 avril 1673; mais cette pièce avait déjà été jouée au jeu de paume du Bel-Air. Conférez Vie de Quinault, dans les Œuvres de QUINAULT, édit. 1715, in-12.
256
SÉVIGNÉ, Lettres (8 janvier 1674), t. III, p. 299, édit. G.; t. III, p. 283, édit. M (Corrigez la note dans les deux édit.).
257
DE BEAUCHAMPS, Recherches sur les théâtres de France, t. III, p. 202-207.
258
QUINAULT, Alceste, tragédie, acte III, scène 3, t. IV, p. 182 du Théâtre de M. QUINAULT, 1715, in-12.
259
LA BRUYÈRE, Caractères, ch. I, no XLVII, p. 165.
260
B. DE BEAUCHAMPS, Recherches sur les théâtres de France, t. III, p. 178.—PAVILLON (lettre à mademoiselle Itier), Œuvres, édit. 1750, in-12, p. 96.
261
SÉVIGNÉ, Lettres (5 février 1674), t. III, p. 335, édit. M.; t. III, p. 233, édit. M.
262
DE GOURVILLE, Mémoires (1657), collect. de Petitot, t. LII, p. 317-341.
263
SÉVIGNÉ, Lettres (5 février 1674), t. III, p. 335, édit. G.; t. III, p. 233, édit. M.—PAVILLON, Œuvres, édit. 1750, t. I, p. LXXVIII, Remarques sur Briord.
264
Voyez Lettres de LOUIS XIV au comte de Briord, la Haye, 1726, pet. in-12, 209 pag.; pièces justificatives, 50 pag.
265
PAVILLON, Œuvres, édit. 1750, t. I, p. 154. Conférez t. I, p. 146, 148, 152, 157, 165, et t. II, p. 202, 205, 284.
266
D'OLIVET, Histoire de l'Académie françoise, édit. in-4o, 1729, t. II, p. 158.
267
SÉVIGNÉ, Lettres (13 novembre 1673), t. III, p. 223, édit. G.; t. III, p. 139, édit. M.—Chapelain ne mourut que plusieurs mois après cette lettre, le 22 février 1674.
268
TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, t. II, p. 399, 416, édit. in-8o; t. IV, p. 152, 170, édit. in-12.—D'OLIVET, Histoire de l'Académie françoise, édit. 1729, in-4o, t. II, p. 124.
269
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, t. III, p. 470.
270
Vie de Costar, t. VI, p. 263 des Historiettes de TALLEMANT DES RÉAUX, et ibid., p. 264 et 265. Lettres autographes d'Arnauld d'Andilly et de Chapelain.
271
D'OLIVET, Histoire de l'Académie françoise, édit. in-4o, t. II, p. 128.
272
CLAUDE DUVAL DE COUPEAUVILLE, abbé de la Victoire, mort en 1676. Conférez sur ce personnage SÉVIGNÉ, Lettres (27 février 1671), éd. G.; t. I, p. 265, édit. M. (M. M. a corrigé sa note ailleurs.)—TALLEMANT DES RÉAUX, Historiettes, t. II, p. 303-332 (et la note 726 à la page 330), édit. in-8o; t. IV, p. 87, 88, et la note 1.—Ménagiana, t. II, p. 1; t. III, p. 79.
273
Œuvres de BOILEAU DESPRÉAUX, édit. de Saint-Marc, 1747, t. I, p. 154. Note sur le vers 203 de la satire IX.
274
SÉVIGNÉ, Lettres (15 décembre 1673), t. III, p. 264, édit. G.; t. III, p. 173, édit. M.
275
SÉVIGNÉ, Lettres (15 décembre 1673), t. III, p. 262, édit. G.; t. III, p. 171, édit. M.
276
SÉVIGNÉ, Lettres (13 et 15 janvier 1674), t. III, p. 307, édit. G.; t. III, p. 209, édit. M.
277
Voyez la 3e partie de ces Mémoires, p. 82, ch. V.
278
GRIFFET, Recueil de lettres pour servir d'éclaircissements à l'histoire militaire de Louis XIV, 1760, in-12, t. II, p. 262 et 270. Depuis le 7 janvier 1674 jusqu'au 11 mars, toutes ces lettres sont à tort datées de 1673; c'est 1674 qu'il faut lire. Ces fautes ne sont pas corrigées dans la table.
279
Mémoires du duc DE NAVAILLES et DE LA VALETTE, 1702, in-12, p. 285.—DU LONDEL, Fastes des rois, 1697, in-8o, p. 213, 214.
280
GRIFFET, Recueil de lettres pour servir à l'éclaircissement de l'histoire militaire de Louis XIV, t. II, p. 320.
281
Œuvres diverses du sieur D***, avec le Traité du sublime de Longin; Paris, chez Denis Thierry, 1674, in-4o, p. 140 et 141. (Au dernier feuillet: «Achevé d'imprimer pour la première fois le 10 juillet 1674).»
282
DESORMEAUX, Histoire de Louis, prince de Condé, 1769, in-12, p. 380.—RAMSAY, Histoire du vicomte de Turenne, 1773, in-12, t. II, p. 240 à 304.—DESCHAMPS, Dernières campagnes de M. de Turenne, dans l'Histoire du vicomte de Turenne, t. III, p. 306-406—PELLISSON, Histoire de Louis XIV, Paris, 1749, in-12, t. III, p. 227-228.
283
LOUIS XIV, Œuvres, fragment sur la conquête de la Franche-Comté.—Et le général GRIMOARD, Précis sur la conquête de la Franche-Comté, dans les Œuvres de LOUIS XIV, t. III, p. 453 et 473.—Recueil de lettres pour servir d'éclaircissement à l'histoire militaire de Louis XIV, 1760, in-12, t. II, p. 273, 286.