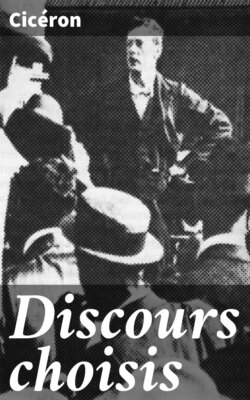Читать книгу Discours choisis - Cicéron - Страница 5
PREMIER DISCOURS CONTRE CATILINA
PRONONCÉ AU SÉNAT.
ОглавлениеANALYSE.–Après avoir échoué dans sa demande du consulat, Catilina. appuyé sur tout ce que Rome renfermait d’hommes corrompus, avait résolu le meurtre des plus illustres citoyens et l’incendie de la ville. Informé du complot, Cicéron, en présence même de Catilina, dans le temple de Jupiter Stator où le sénat était assemblé, dénonce l’attentat horrible qui menace la patrie. Il accable sous l’énumération de ses vices et de ses crimes le chef de la conjuration; il lui démontre l’inutilité de ses sinistres desseins, l’engage à sortir au plus tôt d’une ville où il n’y a pas un honnête homme qui ne le haïsse et ne le craigne. Quant à lui, il ne redoute rien, car il met toute sa confiance dans sa piété envers les dieux et dans son amour pour son pays.
I. Jusques à quand enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur impie? Jusqu’où se déchainera Ion audace effrénée? Quoi! ni les postes chargés de veiller la nuit sur le mont Palatin, ni les forces répandues dans toute la ville, ni la consternation du peuple, ni le concours de tous les honnêtes gens, ni le choix que j’ai fait d’un lieu fortifié pour y réunir cette assemblée, ni l’aspect, ni les regards de ceux qui la composent, rien n’a pu t’ébranler! Tu ne sens donc pas que tes projets sont découverts? Tu ne vois pas que tous ici sont dans le secret de ta conjuration, et qu’ils la tiennent comme enchaînée? Tes démarches de la nuit dernière, celles de la nuit précédente, les endroits où tu es allé, les complices que tu as réunis, les résolutions que tu as prises, crois-tu que tout cela soit un mystère pour un seul d’entre nous"?
Otemps! ô mœurs! le sénat connaît ces complots, le consul les voit, et cependant cet homme vit encore! Il vit! que dis-je? il vient au sénat; il prend place parmi les conseillers de la république; il choisit, il marque de l’œil parmi nous ses victimes. Et nous, hommes pleins de courage, nous croyons être quittes envers la patrie, si nous avons su éviter la fureur et les poignards dont il nous menace. T’envoyer à la mort, Catilina, voilà l’ordre que le consul devait donner depuis longtemps; il devait faire retomber sur ta tête le glaive que depuis si longtemps tu aiguises contre chacun de nous.
Rappelez-vous ce que fit un homme illustre, P. Scipion, grand pontife: Tibérius Gracchus portait aux institutions de la république une atteinte bien légère; Scipion, sans être magistrat, le mit à mort. Et quand Catilina s’apprête à faire du monde entier un théâtre de carnage et d’incendie, nous, consuls, nous le laisserons faire! Je ne veux point rappeler l’exemple trop ancien de C. Servilius Ahala, qui, voyant Spurius Melius préparer une révolution, le tua de sa propre main. C’est qu’il y avait autrefois, dans cette république, oui, il y avait assez d’énergie pour que des hommes de cœur n’hésitassent pas à frapper avec plus de rigueur un citoyen dangereux que l’ennemi le plus redoutable. Aujourd’hui, un sénatus-consulte nous arme contre toi, Catilina, d’un pouvoir étendu, terrible; ce qui manque à la république, ce n’est ni la sagesse des conseils, ni l’autorité de cet ordre: c’est nous seuls, je le dis ouvertement, nous consuls, qui manquons à nos devoirs.
II. Autrefois un décret du sénat chargea le consul Opimius de veiller à ce que la république n’éprouvât aucun dommage. La nuit n’était point encore venue, et déjà l’on avait frappé de mort, parce qu’on le soupçonnait de quelques projets séditieux, Caïus Gracchus, malgré toute la gloire de son père, de son aïeul, de ses ancêtres; déjà l’on avait fait périr avec ses enfants M. Fulvius, un consulaire. Lorsqu’un autre décret du sénat remit aux mains des consuls C. Marius et L. Valérius le salut de l’État, s’écoula-t-il un seul jour avant que L. Saturninus, tribun du peuple, et C. Servilius, préteur, fussent mis à mort et que la république fût vengée? Mais nous, voilà déjà vingt jours que nous laissons s’émousser entre nos mains le glaive de l’autorité sénatoriale; car, nous aussi, nous sommes armés d’un sénatus-consulte, mais il reste sur les tablettes qui le renferment, comme une épée qu’on laisse dans le fourreau, sans la tirer. En vertu de ce décret, Catilina, tu devais périr à l’instant même, et pourtant tu vis: tu vis, non pour abjurer ton audace, mais pour t’y fortifier. Je voudrais, pères conscrits, pouvoir être clément; je vaudrais aussi, en présence du péril extrême de la république, ne point paraître manquer d’énergie; mais, déjà, je condamne et mon inertie et ma coupable faiblesse.
Campée au cœur même de l’Italie, prête à marcher contre la république, une armée occupe les gorges de l’Étrurie; de jour en jour le nombre des ennemis s’accroît, et le général de cette armée, le chef de ces ennemis est dans nos murs; que dis-je, il est dans le sénat, où nous le voyons tous les jours méditer, au sein même de la république, quelque complot pour la renverser. Qu’en ce moment, Catilina, je te fasse saisir et livrer au supplice, et je m’imagine que si j’avais quelque chose à craindre, c’est que tous les honnêtes gens ne trouvassent ma justice bien tardive, et non pas que quelqu’un pût m’accuser de cruauté. Eh bien! ce que j’aurais dû faire depuis longtemps, j’ai de puissants motifs pour ne pas m’y décider encore. Je veux attendre, pour te livrer à la mort, qu’on ne puisse plus trouver un seul homme assez méchant, assez pervers, assez semblable à toi pour ne pas reconnaître qu’on a eu raison de te faire périr.
Aussi longtemps qu’il y aura au monde un seul homme qui ose te défendre, tu vivras; mais, tu vivras comme tu vis maintenant, entouré par moi d’une surveillance multiple, impossible à déjouer, et qui saura bien t’empêcher de faire un mouvement contre la république. Partout mille regards, mille oreilles, sans que tu t’en aperçoives, continueront de t’épier et de te surveiller.
III. Et en effet, Catilina, qu’as-tu désormais à espérer, si les ténèbres de la nuit ne peuvent dérober a nos regards tes assemblées criminelles, si les murs d’une maison particulière n’étouffent pas la voix de ta conjuration, si tout apparaît au grand jour, si tout éclate? Renonce à tes projets, crois-moi; cesse de rêver meurtres et incendies: tu es enveloppé de toutes parts; tous tes projets sont pour nous plus clairs que le jour. Je vais même, si tu veux, les passer en revue avec toi.
Te souviens-tu que, le douze des kalendes de novembre, je dis dans le sénat qu’on verrait en armes, à un jour que je désignai, c’est-à-dire le six des kalendes de novembre, C. Mallius, le satellite et l’instrument de ton audace? Me suis-je trompé, Catilina, je ne dis pas seulement sur un fait si grave, si atroce, si incroyable, mais, ce qui est bien plus surprenant, me suis-je trompé sur le jour? J’annonçai également au sénat que tu avais fixé le massacre des plus illustres citoyens au cinq des kalendes de novembre, ce jour où beaucoup des principaux Romains, moins pour sauver leur vie que pour déconcerter tes plans s’éloignèrent de la ville. Peux-tu nier que, ce jour-là même, ce ne soit la surveillance dont j’eus soin de t’entourer étroitement, qui te mit dans l’impuissance de faire un mouvement contre la république, lorsque tu te consolais du départ des autres en disant que, puisque j’étais resté, ma mort te suffisait?
Et le jour des kalendes de novembre, quand tu te croyais assuré de surprendre Préneste, pendant la nuit, as-tu bien compris que c’était grâce à mes ordres, grâce aux troupes, aux sentinelles, aux postes placés par moi, que cette colonie avait été mise à l’abri d’un coup de main? Il n’y a pas une de tes actions, une de tes résolutions, une de tes pensées dont je ne sois instruit, bien plus, que je ne pénètre, et à laquelle je ne sois complétement initié.
IV. Revois enfin avec moi cette avant-dernière nuit, et tu reconnaîtras aussitôt que je veille avec bien plus d’ardeur pour le salut de la république que toi pour sa perte. Je dis que, la nuit qui a précédé celle-ci, tu te rendis dans le quartier des fabricants de faux (je parlerai sans déguisement), dans la maison de M. Léca; que là se réunirent en grand nombre les complices de ta démence et de ton crime. Oses-tu dire le contraire? Eh bien, tu gardes le silence? Je saurai te convaincre, si tu le nies, car je vois ici, dans le sénat, certaines personnes qui y étaient avec toi.
O dieux immortels! en quel pays sommes-nous? quel gouvernement est le nôtre? dans quelle cité vivons-nous? Ici, ici même, pères conscrits, dans ce conseil auguste et vénérable, arbitre de l’univers, il y a des hommes capables de méditer ma perte, la vôtre à tous, la ruine de Rome, et par suite celle du monde entier. Ces hommes, je les vois, moi, consul, et je prends leur avis sur les grands intérêts de l’État, et, quand le fer devrait déjà les avoir frappés, ma voix hésite encore à leur faire une blessure! Ainsi, Catilina, tu as été chez Léca la nuit en question; tu as fait à tes complices le partage de l’Italie, et assigné à chacun d’eux le poste où il devait se rendre; tu as choisi ceux que tu laisserais à Rome, ceux que tu emmènerais avec toi; tu as désigné à chacun les quartiers de la ville où il devait mettre le feu; tu as déclaré que tu étais au moment de partir, et que, si tu tardais un peu, c’est parce que je vivais encore. Alors il s’est trouvé deux chevaliers romains qui, pour te délivrer de cette préoccupation, t’ont promis de venir chez moi, cette nuit-là même, un peu avant le jour, et de m’égorger dans mon lit.
Tous ces détails, vous étiez à peine séparés que je les connaissais déjà. Je fis garder et défendre ma maison par des postes plus nombreux; je fermai ma porte à ceux que tu avais envoyés chez moi de bon matin pour me rendre leurs devoirs; car ils y vinrent en effet, et c’étaient justement ceux dont j’avais d’avance annoncé à plusieurs de nos premiers citoyens la visite chez moi, pour cette heure-là précisément.
V. Puisqu’il en est ainsi, Catilina, poursuis tes desseins; sors enfin de Rome, les portes sont ouvertes; pars. Depuis trop longtemps ton armée, celle de Mallius, réclame son général. Emmène aussi avec toi tous tes complices, ou du moins le plus grand nombre; que la ville en soit purgée: tu me délivreras d’une grande crainte, le jour où il y aura un mur entre nous deux. Ta présence au milieu de nous est désormais impossible; je ne puis la supporter; je ne la souffrirai pas, je ne saurais la tolérer.
Assurément, nous devons de grandes actions de grâces aux dieux immortels, et surtout à Jupiter Stator, le plus antique protecteur de cette cité, pour avoir permis que ce monstre abominable, horrible, ce fléau déchainé contre la république, n’ait pu jusqu’ici nous atteindre. Mais il ne faut pas qu’un seul homme puisse ainsi compromettre une fois de plus le salut de la patrie. Tant que je fus consul désigné, Catilina, les complots auxquels je fus en butte de ta part, je les repoussai sans recourir à l’intervention de l’État, par ma propre vigilance. Lorsque, aux derniers comices consulaires, tu voulus m’assassiner au champ de Mars, moi consul, et avec moi tes compétiteurs, je déjouai tes efforts sacriléges, grâce au courage et au nombre de mes amis, sans provoquer le moindre mouvement dans la ville. Enfin, toutes les fois que tu m’as attaqué, je me suis défendu par moi-même; et, cependant, je voyais bien que ma perte entraînerait pour l’État les plus grands malheurs. Mais aujourd’hui, c’est à la république tout entière que tu en veux ouvertement; ce sont les temples des dieux immortels, les demeures des hommes, la vie de tous les citoyens, enfin toute l’Italie, sur lesquels tu appelles le meurtre et la dévastation.
Ainsi donc, puisque le parti le meilleur, celui que me conseillent et la dignité dont je suis revêtu et l’exemple de nos ancêtres, je n’ose encore le prendre; j’en prendrai un autre, à la fois moins rigoureux et plus utile au salut commun. Si j’ordonne ta mort, la république ne sera pas pour cela débarrassée de tes complices; mais si tu pars, comme je ne cesse de t’y exhorter, tes compagnons te suivront, et ainsi s’écoulera loin de nos murs cette vaste et pernicieuse sentine.
Eh bien, Catilina, tu hésites à faire, pour m’obéir, ce que tu étais en train de faire, de ton propre mouvement? C’est le consul qui donne à un ennemi l’ordre de sortir de Rome. Tu me demandes si c’est l’exil que je t’impose? Je ne te l’impose point; mais, si tu me demandes mon avis, je te le conseille.
VI. Et en effet, Catilina, quel charme peut désormais avoir pour toi le séjour d’une ville où, à l’exception de ces hommes perdus qui sont tes complices, il n’est personne qui ne te craigne, personne qui ne te haïsse? Quelle est la turpitude domestique dont ta vie ne porte les stigmates? Quelle est la flétrissure épargnée à l’infamie de ta vie privée? As-tu jamais fait grâce d’une souillure à tes regards, d’un crime à tes mains, d’une impureté à toute ta personne? Est-il un jeune homme, une fois enlacé par toi dans les piéges de la corruption, dont tu n’aies armé le bras pour le crime ou éclairé les pas dans le sentier de la débauche?
Et dernièrement encore, quand par le meurtre de ta première femme tu eus fait place dans ta maison à une nouvelle épouse, n’as-tu pas encore, par un monstrueux forfait, mis le comble à ce crime? Je ne veux point insister là-dessus, et je consens volontiers à ce qu’on n’en parle point, pour qu’il ne soit pas dit que. dans cette ville, un attentat aussi monstrueux ait pu être commis ou demeurer impuni. Je passe également sous silence la perte de ta fortune, et cette ruine complète que tu verras fondre sur toi aux ides prochaines: j’arrive aux faits qui se rapportent, non plus à l’ignominie dont te couvrent tes désordres personnels, non plus aux embarras et aux turpitudes de tes affaires domestiques, mais aux intérêts de la république tout entière, mais à notre vie, mais à notre salut à tous.
Est-il possible, Catilina, que cette lumière qui nous éclaire, que cet air que nous respirons aient pour toi quelque douceur, quand tu sais que personne de nous n’ignore que, la veille des kalendes de janvier, sous le consulat de Lépidus et de Tullus, tu te présentas dans les comices armé d’un poignard: qu’une troupe d’assassins, apostée par toi, devait tuer les consuls et les principaux citoyens? Que, si ta fureur criminelle demeura sans effet, ce ne fut ni par repentir ni par crainte de ta part, mais grâce à la bonne fortune du peuple romain? Cependant, ces premiers crimes, je n’y insiste point; d’ailleurs, ils sont connus de tous, et bien d’autres les ont suivis. Que de fois, lorsque j’étais consul désigné, que de fois, depuis mon entrée en charge, n’as-tu pas voulu me tuer? Que de coups tu m’as lancés, avec une habileté qui semblait devoir les rendre inévitables, et qu’une légère déviation, un mouvement du corps, comme on dit, m’ont seuls permis de parer. Tu ne fais rien d’efficace, tu n’arrives à rien, tu ne produis rien, et cependant ni tes efforts, ni tes projets ne sont découragés.
Combien de fois le poignard n’a-t-il pas été arraché de tes mains! Combien de fois un hasard imprévu l’en a-t-il fait tomber ou échapper! Tu ne saurais, néamoins, l’en passer un instant. Par quelles cérémoinies l’as-tu consacré et dévoué, je l’ignore, pour que tu te croies obligé de l’enfoncer dans le sein d’un consul.
VII. Et à présent, quelle vie est la tienne? car je vais te parler, cette fois, non plus avec la haine qui doit m’animer, mais avec la pitié dont tu es si peu digne. Tu viens d’entrer dans le sénat: eh bien, dans une assemblée si nombreuse, où tu as tant d’amis et de proches, qui donc t’a salué? Si, de mémoire d’homme, jamais personne n’a subi pareil affront, pourquoi attendre que le sénat formule l’arrêt insultant sous lequel son silence t’a déjà si cruellement écrasé? N’as-tu pas vu, à ton arrivée, le vide qui, sur ces bancs, s’est fait autour de toi? et tous ces consulaires, dont tu as si souvent résolu la mort, n’ont-ils pas, dès que tu t’es assis, laissé déserte et solitaire cette partie de la salle où je te vois?
Quel courage ne te faut-il pas pour supporter cet opprobre! Ah! certes, si mes esclaves me redoutaient comme te redoutent tous tes concitoyens, je me croirais obligé d’abandonner ma maison; et toi, tu ne crois pas devoir quitter la ville! Si mes concitoyens, même injustement prévenus, me soupçonnaient et me haïssaient aussi énergiquement, j’aimerais mieux me priver de leur vue, que de rencontrer partout des regards irrités. Mais toi, ta conscience criminelle te dit trop que cette haine universelle est méritée, que depuis longtemps elle t’est due; et pourtant, ceux dont ton aspect blesse également l’esprit et les sens, tu hésites à fuir leurs regards et leur présence? Si ceux qui t’ont donné le jour te craignaient et te haïssaient, et que tu n’eusses aucun espoir de les fléchir, sans doute tu chercherais une retraite pour te dérober à leurs yeux. Eh bien! la patrie, notre mère commune à tous, te déteste et te craint; depuis longtemps elle n’attend de toi que des complots parricides. Ne montreras-tu ni respect pour son autorité, ni déférence pour son jugement, ni crainte de sa puissance?
Elle s’adresse à toi, Catilina, et, quoique muette, elle semble te dire: «Aucun forfait, depuis quelques années, ne s’est commis sans que tu en sois l’auteur; point de scandale auquel tu n’aies pris part; toi seul as pu égorger de nombreux citoyens, tyranniser et piller les alliés en toute impunité, en toute liberté; tu as été assez puissant, non-seulement pour ne tenir aucun compte des lois et des enquêtes judiciaires, mais encore pour les fouler aux pieds et les anéantir. Ces premiers attentats, tout intolérables qu’ils étaient, je les ai cependant supportés comme j’ai pu; mais maintenant, être condamnée à de perpétuelles alarmes à cause de toi seul; au moindre bruit,avoir peur de Catilina; penser qu’il ne peut se tramer contre moi aucun complot, qui ne soit lié à tes détestables projets, voilà ce que je ne saurais Supporter. Éloigne-toi donc, et délivre-moi de ma terreur; si elle est fondée, pour que je ne succombe pas; si elle est chimérique, pour que je cesse enfin de trembler.»
VIII. Si la patrie, comme je te l’ai dit, te tenait ce langage, ne devrait-elle pas être écoutée, lors même qu’elle n’aurait pas le moyen de se faire obéir par la force! Et, d’ailleurs, n’as-tu pas voulu toi-même te constituer prisonnier? N’as-tu pas déclaré que, pour éloigner les soupçons, tu voulais habiter la maison de M. Lépidus? Repoussé par lui, tu as eu l’audace de venir me trouver, et tu m’as prié de te garder dans ma maison. Et moi aussi j’ai refusé, en te disant que je ne saurais me croire en sûreté dans la même demeure que toi, alors qu’il y avait pour moi un péril extrême à ce que la même ville nous renfermât tous deux. Tu t’adressas à Q. Métellus, le préteur; il te repoussa également. C’est alors que tu cherchas un asile chez ton ami, l’honnête M. Marcellus, te croyant sans doute assuré et de sa vigilance à te surveiller, et de sa perspicacité à pénétrer tes desseins, et de son énergie à les réprimer. Mais semble-t-il bien loin de mériter la prison et les fers l’homme qui, de lui-même, se juge indigne de la liberté?
Puisqu’il en est ainsi, Catilina, peux-tu hésiter encore? Si tu n’as pas le courage nécessaire pour mourir, fuis dans quelque autre pays, et cette vie, qu’ont tant de fois épargnée les supplices les plus justes et les mieux mérités, cache-la dans l’exil et dans la solitude. «Mais, me diras-tu, soumets la question au sénat,» car c’est là ce que tu demandes; et, si cette assemblée déclare que tu dois aller en exil, tu promets d’obéir. Non, je ne ferai point une proposition qui répugne à mon caractère; mais, je vais te mettre en état de te rendre compte des sentiments du sénat. Sors de Rome, Catilina; délivre la république de ses craintes; pars pour l’exil, si c’est ce mot que tu attends; pars. Eh bien, Catilina? remarques-tu, comprends-tu le silence des sénateurs? Ils ne réclament pas; ils se taisent. Pourquoi donc attendre de leur bouche la sanction d’un arrêt, que leur silence te fait si manifestement connaître?
Ah! si j’avais tenu le même langage au jeune et vertueux P. Sextius, ou à M. Marcellus, cet homme généreux, ni mon titre de consul, ni la sainteté de ce temple n’auraient empêché, et à juste titre, le sénat de donner contre moi un libre cours à son indignation. Mais, quand c’est à toi que je m’adresse, Catilina, son impassibilité m’approuve, son calme te condamne, son silence crie à haute voix ton arrêt. Et cela est vrai, non-seulement pour ces sénateurs, dont l’autorité sans doute t’est précieuse, quand tu fais si peu de cas de leur vie, mais encore pour ces chevaliers romains, hommes honorables et vertueux, et pour tous ces généreux citoyens qui entourent le sénat, et dont toi-même, il n’y a qu’un instant, tu as pu remarquer l’affluence, juger les sentiments, entendre les murmures. Ce n’est pas sans peine, depuis longtemps, que je retiens leurs bras armés pour te frapper; cependant j’obtiendrai facilement, si tu te décides à quitter ces murs dont tu médites depuis longtemps la ruine, qu’ils te fassent cortége jusqu’aux portes de la ville.
IX. Mais que dis-je là? Toi, que quelque chose puisse t’ébranler? que jamais tu t’amendes? que tu songes à fuir? que Lu penses à t’exiler? Puissent les dieux immortels t’en inspirer la résolution! Et cependant je n’ignore pas ce qui m’attend si, effrayé par mes discours, tu te décides enfin à partir en exil: quelle tempête de haine, sinon aujourd’hui, où la mémoire de tes crimes est encore présente à tous, du moins dans l’avenir, se déchaînera contre moi! Cependant je m’y résigne volontiers, pourvu que le malheur me frappe seul, et que la république n’ait rien à redouter. Mais, que tu aies horreur de tes crimes, que tu redoutes le châtiment des lois, que tu fasses à l’intérêt de la république la moindre concession, voilà ce qu’il ne faut pas te demander. Tu n’es pas homme, Catilina, à te laisser détourner de l’infamie par la honte, du péril par la crainte, d’un funeste égarement parla voix de la raison.
Ainsi donc, je te le dis encore une fois, pars; et, si je suis ton ennemi, comme tu le répètes, si tu veux, à ce titre, soulever contre moi toutes les haines, va droit en exil: j’aurai peine à soutenir les clameurs qui éclateront contre moi, si tu prends ce parti; et l’odieux de ton bannissement, si c’est l’ordre du consul qui te l’impose, pèsera lourdement sur moi. Mais si, au contraire, tu aimes mieux servir ma réputation et ma gloire, sors avec la foule odieuse de tes complices, va retrouver ton Mallius, soulève tous les mauvais citoyens, sépare-toi des bons, porte tes armes contre ta patrie, abandonne-toi aux fureurs d’une guerre impie, d’une guerre de brigands. Alors on ne pourra plus dire que je t’ai rejeté parmi des étrangers; je n’aurai fait que t’inviter à rejoindre tes amis.
Mais qu’est-il besoin, après tout, de t’y inviter, quand je sais que tu as déjà envoyé en avant des affidés qui doivent, au forum d’Aurélius, t’attendre les armes à la main; que tu as réglé et fixé avec Mallius le jour de votre rendez-vous? Et cette aigle d’argent, qui, j’en ai la confiance, vous conduit à votre perle, et vous sera fatale, à toi et à tous les tiens; cette aigle à laquelle tu as dressé, dans ta maison, un autel consacré par tes crimes, ne sais-je pas que tu l’as déjà envoyée devant toi? Pourrais-tu rester plus longtemps séparé de cette divinité, que tu ne manquais jamais d’adorer en partant pour un assassinat, et dont plus d’une fois tu ne quittas les autels que pour aller tremper tes mains impies dans le sang de tes concitoyens?
X. Tu vas donc enfin partir là où, depuis longtemps, un désir effréné et furieux t’entraînait. Ce départ, loin de t’affliger, te cause une sorte de joie inexprimable. Voilà pour quelles fureurs la nature t’a fait naître, tes inclinations t’ont préparé, la fortune a préservé tes jours! Ennemi du repos, la guerre elle-même, si elle n’était sacrilége, n’eut jamais de charmes pour toi. Aussi as-tu su trouver une armée composée d’hommes perdus, abandonnés de la fortune et même de l’espérance, un ramassis des plus vils scélérats.
Au milieu d’eux, quel contentement tu vas goûter! quelle joie, quel ravissement, quel délire et quelle ivresse, lorsque, dans cette foule immense des tiens, tu n’entendras pas un seul honnête homme, tu n’en verras pas un seul! C’était sans doute afin de te préparer à cette glorieuse vie que tu t’exerçais à ces travaux tant vantés, à coucher sur la dure, pour attenter à l’honneur des familles et pour guetter l’occasion d’un meurtre; à veiller toute la nuit, non-seulement pour profiter du sommeil des maris, mais encore pour dépouiller tes victimes. Allons, voici le moment de signaler cette merveilleuse énergie à supporter la faim, le froid, et et les privations de toutes sortes dont tu vas bientôt te sentir accablé.
J’ai du moins gagné quelque chose en te faisant écarter du consulat; grâce à moi, la république pourra bien être attaquée par un banni; elle ne sera pas déchirée par un consul: ton impie attentat pourra s’appeler une attaque de brigands; une guerre, jamais.
XI. Maintenant, pères conscrits, il est un reproche que la patrie pourrait m’adresser avec une sorte de justice, et contre lequel je veux protester et me défendre. Prêtez, je vous en conjure, une oreille attentive à mes paroles, et gravez-les profondément dans votre cœur, dans votre mémoire. Si la patrie, en effet, qui m’est bien plus chère que la vie, si toute l’Italie, si la république entière venait me dire: «M. Tullius, que fais-tu? voici un homme que tu as reconnu être mon ennemi; que tu vois prêt à porter la guerre dans mon sein; que des rebelles attendent, tu le sais, dans leur camp, pour saluer en lui leur général; qui, auteur de la plus criminelle entreprise, chef d’une conjuration, soulève les esclaves et les plus mauvais citoyens; et cet homme, tu le laisses partir, sans voir que ce n’est point l’expulser de Rome, mais le déchaîner contre elle? et tu n’ordonneras pas qu’il soit chargé de fers, traîné à la mort, livré au dernier supplice?
«Après tout, qui L’arrête? Les usages de nos ancêtres? mais, plus d’une fois, de simples particuliers, dans cette république, voyant des citoyens en compromettre la sûreté, les ont frappés de mort. Les lois relatives au supplice des citoyens romains? mais jamais, dans cette ville, ceux qui se sont révoltés contre l’État, n’ont conservé leurs droits de citoyens. Craindrais-tu les reproches de la postérité? ce serait témoigner une belle reconnaissance au peuple romain, qui, ne te connaissant que par toi-même, et sans que tu fusses recommandé par le nom de tes ancêtres, t’a si promptement élevé, de dignités en dignités. jusqu’à la magistrature suprême, si la crainte de l’opinion ou de je ne sais quels périls, t’empêche d’assurer le salut de tes concitoyens!
Mais, si c’est le blâme que tu redoutes, pourquoi craindre plu tôt celui qui s’attacherait à une courageuse sévérité que celui qui flétrirait une coupable faiblesse? Ah! quand l’Italie sera désolée par la guerre, que les villes seront saccagées, les maisons en feu, penses-tu alors n’être pas dévoré par les flammes vengeresses de l’indignation publique?»
XII. A ces paroles sacrées de la patrie, aux secrètes pensées de ceux qui les approuvent, je répondrai en peu de mots. Oui, pères conscrits, si j’avais cru que le meilleur parti à prendre fût de mettre à mort Catilina, je n’aurais pas laissé ce misérable gladiateur vivre une heure de plus. Car si autrefois les plus grands, les plus illustres citoyens, en frappant Saturninus, les Gracques, Flaccus, et tant d’autres avant eux, bien loin de ternir leur propre gloire, l’ont au contraire rendue plus éclatante, à coup sûr je n’avais pas à craindre que la mort d’un parricide, de l’assassin de ses concitoyens, attirât jamais sur ma tête la réprobation de la postérité. Et quand même je serais certain de ne pouvoir m’y soustraire, j’ai toujours vécu dans ces sentiments, que la disgrâce encourue pour avoir fait son devoir est moins une disgrâce qu’un titre d’honneur.
Mais il est. dans cette assemblée même, quelques hommes assez malheureux pour ne pas voir les périls qui nous menacent, ou pour feindre de ne les point voir: ce sont eux qui ont entretenu les espérances de Catilina, par le peu d’énergie de leurs résolution, et qui, en refusant de croire à la conjuration naissante, l’ont fortifiée. Leur opinion est une autorité pour bien des gens, ou méchants, ou trompés, qui, si j’avais sévi contre Catilina, n’auraient pas manqué de crier à la cruauté, à la tyrannie. Une fois au contraire qu’il aura exécuté son projet et qu’il se sera rendu au camp de Mallius, personne, je le vois bien, ne sera assez aveugle pour ne pas comprendre qu’il existe une conjuration, ou assez pervers pour ne pas en convenir. D’un autre côté, que Catilina seul périsse, et le mal dont la république est menacée pourra bien être conjuré un instant, mais il ne saurait être détruit pour toujours. C’est quand lui-même se sera jeté hors de ces murs, qu’il aura emmené avec lui tous ses complices, ramassé de toutes parts et réuni autour de lui tous ces misérables engloutis dans le naufrage de leur fortune, c’est alors seulement que sera éteint et étouffé cet incendie qui couve depuis si longtemps au sein de la république, et avec lui disparaîtra le germe, la semence de tous les fléaux.
XIII. Voilà bien longtemps en effet, pères conscrits, que cette conjuration nous fait vivre au milieu des alarmes et des périls; mais, je ne sais par quelle fatalité, tous ces crimes, toute cette fureur invétérée, ces audacieux attentats ont lentement mûri pour éclater précisément sous mon consulat. Si, dans cette troupe de brigands, vous frappez seulement celui-ci, nous pourrons bien paraître délivrés pour quelque temps de nos inquiétudes et de nos craintes, mais le danger n’en subsistera pas moins, enfermé en quelque sorte au cœur même et dans les entrailles de la république. Voyez l’homme atteint d’une grave maladie, quand l’ardeur de la fièvre le consume, s’il boit de l’eau glacée, il semble un instant ranimé; mais c’est pour retomber bientôt sous l’étreinte d’un mal plus grave et plus violent. Il en est de même du mal dont souffre la république; calmé un instant par le châtiment de Catilina, il reparaîtra plus violent, si nous laissons vivre les autres coupables, et s’aggravera encore.
Ainsi donc, pères conscrits, que les méchants se retirent; qu’ils se séparent des bons; qu’un mur enfin, je le répète encore, les sépare de nous; qu’ils cessent d’attenter à la vie du consul jusque dans sa maison, d’environner le tribunal du préteur urbain, d’assiéger en armes le sénat dans le lieu de ses délibérations, de préparer des torches et des flèches incendiaires pour mettre le feu à la ville; enfin que chacun porte gravés sur son front les sentiments qui l’animent. Alors je vous le promets, pères conscrits, telle sera notre vigilance, à nous, consuls, telle sera l’autorité de vos décrets, tel sera le courage des chevaliers et l’accord de tous les gens de bien, qu’à peine Catilina sorti de Rome, vous verrez tous ses complots à découvert, au grand jour, puis étouffés et punis.
Que ces présages, Catilina, t’accompagnent, pour le salut de la république, pour ton malheur et ta ruine, pour la perte de ceux qui te sont unis par les liens du crime et du parricide; pars pour cette guerre impie et sacrilége. Et toi, Jupiter Stator, dont le culte fut fondé par Romulus sous les mêmes auspices que cette ville elle-même; toi, le conservateur de Rome et de l’empire, car c’est le nom que nous te donnons à juste titre, tu protégeras contre les fureurs de ce monstre et de ses complices les autels et les temples des autres dieux, les maisons de la ville, ses remparts, la vie, la fortune de tous les citoyens. Et tous ces persécuteurs des honnêtes gens, ces ennemis de la patrie, ces dévastateurs de l’Italie, ces scélérats unis entre eux par un pacte abominable, tu les châtieras, vivants et morts, par d’éternels supplices.