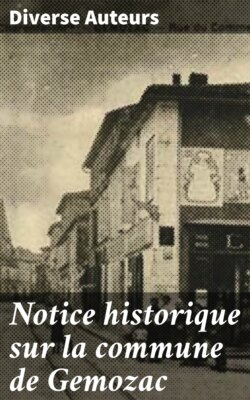Читать книгу Notice historique sur la commune de Gemozac - Diverse Auteurs - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ETHNOGRAPHIE
ОглавлениеNous avons passé en revue le plus grand nombre des habitants de la commune de Gemozac, moins leur maître à tous, l’Habitant par excellence, le bipède à deux pieds sans plumes, le bimane, ou l’être à deux mains et sa féminine moitié, l’Homme et la Femme, puisqu’il faut les nommer; et encore en avons-nous déjà dit quelque chose.
Les Gemozacais sont Saintongeais pur sang, s’il est permis de s’exprimer ainsi: c’est cette race brune et solide, peu brillante de traits et de mouvements, mais intelligente en dessous, patiente, tenace et persévérante; bien prise dans sa petite taille, conservant, même sous d’autres climats, la santé robuste que son sol et sa sobriété lui ont faite, ayant tout à la fois les premières qualités du marin, le calme et le sang-froid, et les premières du bon soldat, la marche infatigable et la tempérance. Les développements physiques qui font le plus défaut sont celui de la poitrine dans les hommes (il y a chaque année beaucoup de réformés pour cette cause), et celui de la partie opposée dans les deux sexes (qui ne motive aucune espèce d’exemption). Hélas! oui, les Saintongeaises ont dû accueillir avec un double plaisir la crinoline aux amples suppléments, et c’est peut-être une d’entre elles qui l’a inventée. Toujours est-il qu’un plaisant se permettait de dire d’elles (en leur absence) que si c’étaient des anges tombés du ciel, ils n’étaient pas tombés sur le nèz. A part ca léger tort qui leur est fait dans la succession d’Eve, les Gemozacaises ont largement hérité de ses autres dons: pureté de formes, douceur de traits, beaux yeux noirs ou châtains, fraîcheur et vigueur un peu mate, mais d’autant plus solide, du teint; modestie surtout, économie et propreté : ne sont-ce point la les trois véritables grâces? De bonnes femmes de ménage, d’excellentes mères de famille, voilà ce que l’on trouve à Gemozac, à tout le moins autant qu’ailleurs.
Parler femmes sans parler costume n’est pas chose possible: la feuille de figuier, si amplement développée et si diversement modifiée, est une partie bien essentielle de leurs charmes.
L’ancien costume des Gemozacaises était fort simple: des souliers à boucles d’argent (qui le pouvait) pour les jours de fête; des bas de la laine du troupeau, de la main d’oeuvre et de la teinture de celle qui les porte, suppléés, les autres jours par la pure nature dans les galoches gauloises; le «cotillon simple» de Perrette, dans La Fontaine, soit en étoffe ou droguet, soit en cotonnade ou indienne, en basin, pour le suprême bon ton; un ta blier ou devantau; un just, abrégé de justaucorps, de couleur rouge, par préférence; une pièce de poitrine d’une autre vive couleur; un mouchoir de cou à fleurs, en guise de fichu, dont elles ne voudraient pas aujourd’hui pour mouchoir de poche ou mouche-nez, comme elles disent encore très-justement; un collier de valours à cœur d’or ou à croix de Jeannette, selon le culte; enfin le bonnet à chalonnaises, de forme carrée plus on moins haute, et, pardessus, une câline en paillaca, l’été ; la cape gauloise, l’hiver (cucullus) avec sa têtière ou capuchon, relevé ou rabattu: Mon Dieu! les femmes ainsi équipées plaisaient-elles moins, rendaient-elles moins heureux qu’elles n’ont fait depuis? Le large crochet d’argent auquel les plus riches suspendaient à leur ceinture leurs ciseaux et même leur couteau y ajoutait-il quelque chose?
Plus tard, que n’ont-elles pas essayé d’ajouter? Je renonce à le décrire; on pourra consulter, même pour la campagne, les gravures de mode du temps actuel; elles pénètrent dans le dernier village et y sont de plus ou moins près suivies. Le velours s’y porte ailleurs qu’au collier; la soie, la mousseline, l’organdy, le mérinos, l’alépine, l’orléance, la blonde, la dentelle... que sais-je, moi? La broderie, qu’elles apprennent dès l’école primaire, tout en continuant de l’appeler brodure, tout cela est aussi familier à nos artisanes (grisettes, en ville), qu’à nos grandes dames, et tout aussi bien porté par les unes que par les autres. Il n’y a plus que la coiffure qui les distingue; tête féminine maintient ses droits: les dames portent le chapeau; les artisanes, le foulard, le petit bonnet, ou bien le grand. C’est celui-ci qui, sérieusement, est une belle parure, à laquelle les Saintongeaises auraient bien tort de renoncer. C’est cher, et peu commode, peut-être; mais quelle fleur, d’apparence grandiose et légère, ou plutôt quelles grandes ailes de papillon blanc sur une fleur! Cet éventail aérien de dentelles, cette seconde taille répétant et idéalisant la première, et, entre les deux, un luxueux chignon de cheveux noirs, qui se montre, en paraissant vouloir se cacher; jamais la beauté et la coquetterie n’inventeront rien de plus favorable à leur entente.
L’habillement des hommes était jadis les guêtres longues, les culottes courtes; j’en ai vu, de mes yeux vu, qui s’attachaient encore avec des cabillots de bois (la fameuse aiguillette), au lieu de boutons. Le gilet de dessous tombant sur les cuisses; le gilet de dessus, ou la veste, toute ronde et à collet droit. Les bretelles commencèrent à gâter tout cela. Les cheveux se portaient, non pas à tous crins, comme en Limousin, mais taillés en rond sur les épaules, mode qui avait supprimé la queue, que la Titus est venue supprimer, et qui a failli revenir sous le nom de Jeune-France. Le chapeau était le pétase latin, le sombrero espagnol, rationnel en un mot, à larges bords et à forme ronde. J’ai à peine vu quelques grands habits, dits français, à la Henri IV, couronnés du tricorne, coiffure bizarre.
Un accessoire indispensable de la toilette du paysan était le bâton. «Homme sans bâton, homme sans raison,» disait le proverbe. Le proverbe songeait à la canne du seigneur.
Aujourd’hui, tout le monde porte la canne et les nuances d’extérieur se confondent chez nous entre les hommes, comme en Amérique. Non-seulement «on ne connaît pas le bon vin aux cercles,» mais on ne distingue même plus de quel bois est le tonneau. Où serait l’inconvénient? On tiendra davantage à se faire goûter.
Au goût, le Gemozacais était un petit peu âpre, peut-être: caché, défiant, concentré en soi et pour soi, partant volontiers, mais sans rien. dire, routinier, de peur d’être dupe, économe jusqu’à l’avarice; car alors il en avait be soin. Récemment affranchi de la glèbe, il traînait encore les vices du serf, l’exigence contre le faible, la souplesse extrême devant le fort, et il prenait souvent pour la dignité une fierté jalouse et mal entendue. L’éducation de toute une classe d’hommes ne se fait certes pas en un jour, et il reste bien encore quelques vestiges de l’ancien état de choses.
Il en reste plus que de l’ancienne gaîté, qui, à vrai dire, n’était guère que l’étourdissement d’une misère à laquelle les pauvres de l’ancien régime se sentaient condamnés sans ressource; ils se prenaient à jouer avec leur dégradation. Ainsi, à Gemozac, il y avait des ivrognes célèbres, dont c’était là, pour ainsi dire, la profession et la notoriété. On citait, par exemple, un certain Jacques Tesson, et ajouterai-je un dragon Mesnard, mon parrain, qui est mort trop tôt pour pouvoir me donner des leçons de ce genre? C’étaient des plus honnêtes gens du bourg, mais de rudes buveurs, d’autant plus qu’il y avait peu de vin. Jacques Tesson allait souvent à Saintes et faisait volontiers sa méridienne à mi-chemin, au beau milieu de la plaine de Thenac, sa précieuse tête reposée sur une antique borne que son poids et le temps avaient presque toute enfoncée dans la terre et creusée à l’extrémité de manière à ce que l’eau y séjournait. On appelait cela autrefois la pierre qui saute, vu, qu’à midi précis, mais si précis qu’on le manquait toujours, elle ne manquait pas, elle, de danser un branle sur les trésors que couvrait sa base; les bienheureuses stations de notre Gemozacais firent débaptiser cette pierre et lui valurent un nom plus juste, celui de Bénitier de Jacques Tesson.
L’habitude de boire du vin avec modération, la vie occupée et l’aisance ont à peu près banni l’ivrognerie. Si l’on chante et rit moins aux éclats, on jouit certainement davantage; une gaîté factice n’est point le bonheur; les prétendus bons vivants qui peuvent rester encore en savent bien quelque chose. Plût au ciel que des progrès analogues eussent totalement guéri les Gemozacais de deux autres défauts qui leur étaient reprochés, l’esprit processif et le penchant à faire l’usure, deux manifestations du même vice, une trop grande âpreté pour le gain! Eh! bien, oui, c’est comme pour le cabaret: la facilité croissante d’un gain légitime a diminué considérablement la fureur de plaider et l’abus de prêter en fraude de la loi. Nos paysans vous raconteront eux-mêmes l’histoire de cet avocat de Saintes qui, retiré des affaires, se fit édifier un bel hôtel et eut l’audace d’inscrire sur la façade: Maison bâtie de têtes de sots. Ils ajouteront l’histoire de ce procureur, toujours de Saintes, qui étant de son estoc Pierre Poinstaud, Procureur Plaidant, fit écrire quatre P sur sa porte pour lui servir d’enseigne; abréviations qu’un paysan gemozacais, attendant audience, lisait avec tant de justesse: Prends patience, pauvre plaideur... Et, néanmoins, il y a encore à Saintes beaucoup d’avocats et de procureurs, ou du moins d’avoués. Il y a même çà et là, dit-on, des prêteurs suspects et redoutables; mais c’est comme les sorciers et les devins: l’espèce se perd ou se métamorphose.
L’esprit gemozacais est positif, calculateur, industrieux, plutôt que brillant et varié. La contrée en est l’image, bocage fertile et peu pittoresque. Les organisations poétiques et surtout musicales y sont très-rares. Les chants rustiques, on ne peut dire pastoraux, toujours en mode mineur, sont traînants et monotones. Il en est tout autrement des bals, ou bourrées à danser: ce sont des motifs courts d’une prestesse et d’un accent remarquables; on dirait, en les comparant aux chansons, le médiocre vin du crû transformé en excellente eau-de-vie. Nous pourrons peut-être en donner quelques exemples.
Quant aux mœurs proprement dites, elles ne sont ni meilleures ni pires que dans une autre commune quelconque; partout le délit le plus grave est plus facile et plus fréquent que le délit moindre, les coups de canif au contrat plus nombreux que les bénédictions après grâces. Et à ce sujet il y a une remarque essentielle à faire sur l’étude des vieux registres de l’état-civil. Le lecteur qui suivrait, par exemple, les six années de 1749 à 1755 y relèverait 43 enfants naturels, soit un huitième des baptisés! Quelles moeurs, pourrait-il s’écrier! quel relâchement! Hélas! non, c’est tout autre chose: Les protestants n’avaient pas d’état-civil, les registres de mariages étant tenus par les curés; et, cependant, le baptême étant pour les protestants article de foi, ils venaient présenter leurs enfants au prêtre catholique, qui les inscrivait comme illégitimes, nés de parents adôués, et ajoutait en marge le mot bastard. Aussitôt que les pasteurs protestants furent tolérés, et dès les dix années suivantes, on voit le chiffre des enfants naturels descendre à un seul par année, c’est-à-dire à la proportion très-honorable d’un sur 75 naissance?. Ce n’est pas la moitié de la proportion ordinaire dans nos campagnes. Ils sont alors tout autrement désignés et spécifiés comme nés de père inconnu ou attribués par la mère (c’était alors chose permise) qui à un laquais de M. de Saint-Seurin, qui à tel notaire demeurant à Chaucrou. Une fille de chambre de Mme de La Porte figure aussi dans ces déclarations. Ainsi, la licence était moins indigène qu’importée, et descendait plutôt que de monter... En est-il bien différemment de nos jours?