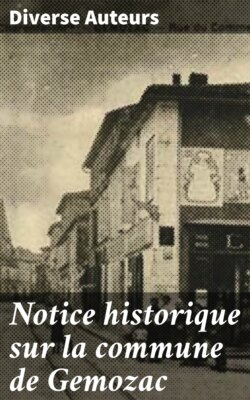Читать книгу Notice historique sur la commune de Gemozac - Diverse Auteurs - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PHILOLOGIE
ОглавлениеTable des matières
Quelques lignes sur le Langage local: le langage reflète et précise toutes les questions ci-dessus effleurées.
On parle à Gemozac, où du moins on parlait, un des plus francs dialectes de toute la Saintonge. Le j un peu espagnol (ine jhote), pour une joue, et aussi pour une hotte; Jhean-Jhacques; Jheudi, etc; le ch allemand (içhi, pour ici; çhellés çhillères, ces cuillères, çheu va-de-bonçhœur) y sont correctement, c’est-à-dire très-mollement, très-négligemment prononcés. Le caractère du patois saihtongeais et de laisser dans le gosier une bonne partie des consonnes, d’avaler ce que l’Anglais mange. Quant aux voyelles, que ce dernier siffle, le patient Saintongeais les laisse s’exhaler, si elles peuvent. Articuler n’est pas Son fort. C’est là ce qui le fait le plus différer du Français. Les étrangers qui l’écoutent pour la première fois n’entendent rien qu’une suite de voyelles peu sonores, de l’otaïtien con sordini, avec des sourdines; (on me passera ces deux mots italiens, car il y a beaucoup d’italien dans le saintongeais.) Eh! bien, je le répète sans crainte d’être contredit, le dialecte de Gemozac est un bon type. En veut-on une seule preuve? Il prononce bien les nasales, lesquelles diffèrent d’un canton à l’autre. On, par exemple, se prononce eun dans la Champagne de Pons (allez-vous à Peuns, meun beun?), se prononce an dans les environs de Cozes (disez danc, cambin campte-t-an d’içhi à Saujhan?), se prononce franchement on à Gemozac et dans tout le canton. In s’assourdit on ein à Meschers; on n’y a que du pein et du vein; c’est du pain et du vin à Gemozac, etc., etc. Nous pourrons peut-être donner dans les notes quelques échantillons de ce patois. (Voir notre Dictionnaire du Patois saintongeais).
Les plus précieux seraient ceux qui rappelleraient en même temps un fait local ou un usage particulier. J’avoue que j’en ai peu de ce genre ou plulôt que je n’en ai qu’un, et il n’est guère à l’honneur du pays; il constate un vieux délit de maraude: un certain Migeon attirait les canards des voisins, les prenait au collet à ripousse, et ce n’était mie pour les rendre. Un trouvère de la localité lui infligea ce bal, bien dansant en vérité et qui, «conduit par le chant», a passé de bouche en bouche à la postérité la plus reculée:
Les canets sont bons
Roûtit à la broche,
Les canets sont bons
Roûtit chez Migheon.
La mér, çhi les cou’
Qu’a’ vive, qu’a’ vive,
La mér’ çhi les cou’
Qu’a’ vive trejhou’ !
Il y avait bien encore une chanson satirique à propos de je ne sais quel scandale; mais je n’en ai retenu que ce lambeau:
l’ s’en alliant à la Bou’rie,
En Ghemozat dessus la rive.
La Bou’rie, c’est-à-dire la Bouverie, est en effet sur la Seudre, mais dans la commune de Viroliet. Les poètes n’y regardent pas de si près.
J’engage à remarquer Ghemozat pour Gemozac: le t final et servant de liaison, que le français n’admet que dans «viendra-t-il,» est un autre caractère du saintongeais: (on va-t-à Saintes; o y a-t-assez de temps). Ce caractère, cette signature locale existe dans la chanson: «Malbrough s’en va-t-en guerre» faite, dit-on, par une des berceuses de Louis XV.
D’usages tout à fait locaux, je n’en connais point. On naissait, on se mariait, on mourait à Gemozac comme dans toute la chrétienté. On donnait bien le charivari aux veufs et aux veuves qui convolaient en secondes noces; on faisait bien monter sur un âne, sens devant derrière, le plus proche voisin du mari qui s’était laissé battre par sa femme; on avait grand soin de ne pas épouser le mercredi, afin de n’être jamais Jean-Jeudi; on se livrait aux balivernes de la bûche de Noël, du poisson d’avril, etc., etc.; mais plût à Dieu que ces tristes et fades consolations contre le solennel ennui du moyen-âge eussent été spéciales à un pauvre endroit! Elles ne l’étaient pas même à la France!
Ce que je tiens à retrouver, et, si j’y arrive, je la donnerai en note, c’est la chanson quasi-sacramentelle qui se psalmodisait aux noces de village, non pas seulement à Gemozac, mais dans toute la Saintonge
En attendant, voici une vieille antienne de noces:
Après le souper, un quêteur et une ou deux quêteuses faisaient le tour de la table ou le demi-tour de la table, tenant un long roseau enrubanné, sans y oublier la jarretière de la mariée, et terminé par une bourse, freloche à monnaie pour la nouvelle ménagère, en paiement de sa jarretière; et l’on chantait:
Voici la bourse d’amourette.
N’y a pas d’arghent, i’faut en mettre.
Ne fasez pas les usuriers,
N’y mettez ni sous ni deniers;
Fasez les brave hounêtes ghens:
Mettez-y du bel arghent bllanc.
Cette exposition terminée, pour faire connaître un peu le lieu de la scène et les acteurs, je laisse la parole au brave curé Pouzaux, qui va nous raconter le drame. Je me permettrai seulement d’abréger quelquefois le texte ou d’y ajouter des observations. Tout ce que je supprimerai presque entièrement c’est l’histoire de France, d’Europe, du Monde, que le savent prêtre jugeait à propos de rattacher, en fort bons termes, du reste, à l’humble chronique de Gemozac.