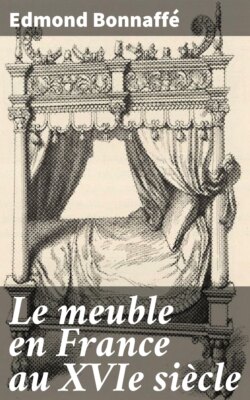Читать книгу Le meuble en France au XVIe siècle - Edmond Bonnaffé - Страница 3
INTRODUCTION
ОглавлениеL’ART du bois n’a pas encore trouvé son historien. A vrai dire, la tâche est laborieuse et demande un homme aux fortes épaules, patient et convaincu, tenacem propositi virum. Raconter l’histoire du bois, c’est-à-dire l’imagerie, la charpenterie, la menuiserie, l’ébénisterie, la tabletterie dans toutes leurs variétés, depuis les étonnantes créations des premières dynasties égyptiennes jusqu’aux boiseries des petits maîtres du dernier siècle; étudier en chemin les clôtures en sandal de la pagode de Perour et les portes de Somnath, la Diane d’Éphèse, qui était d’ébène, et la Juno Regina qui était de cyprès, l’opus intestinum des Romains et la chaire de Saint-Pierre, les charpentes de Westminster et les marqueteries de Fra Giovanni de Vérone, les portes de l’Alhambra, les stalles d’Amiens et celles de Gaillon, les meubles de Du Cerceau et la chapelle d’Urfé, les Grâces de Germain Pillon et le Saint François d’Alonso Cano, l’ébénisterie de Boulle et de Riesener, les décorations de Lepautre, d’Oppenordt et de Toro; montrer, en un mot, les applications du bois au bâtiment, au meuble, à la statuaire chez tous les peuples et dans tous les siècles; voilà, certes, un programme d’une belle envergure, et nos contemporains à courte haleine, grands amateurs de monographies, ont quelque raison de s’en effrayer.
Nous nous souvenons que jadis, dans les temps fabuleux où nous avions encore des illusions, la pensée nous était venue d’écrire un chapitre de la grande histoire, l’Histoire d’un morceau de bois. Issu d’un chêne druidique, dans une des vieilles forêts de la Gaule, nous le faisions tailler par un de nos ancêtres, charpentier de la grande cognée, pour garnir des palissades et défendre la patrie contre César. La poutre, grossièrement équarrie, passait ensuite dans une villa gallo-romaine, de là, dans un palais mérovingien, enfin, dans les combles d’une cathédrale romane. Bientôt, à demi consumée par un incendie, elle était débitée en poutrelles et servait à décorer la salle d’une riche maison bourgeoise. Au XIIIe siècle, la poutrelle, brisée par le temps, devenait panneau, se couvrait de peintures et rentrait toute pimpante à l’église, pour former une belle armoire de sacristie. Deux siècles plus tard, le panneau démoli, remanié, taillé par un sculpteur habile, était enclavé dans un coffre d’où, après de longues aventures, passant du coffre dans une chaire, de la chaire dans une armoire, il arrivait enfin au règne de Louis XIII. Là, dépouillé de ses ornements, raboté et plané, il servait à supporter un brillant placage en ébène. Plus tard, il entrait dans l’atelier de Boulle, passait dans celui de Riesener, enfin chez Jacob, tour à tour revêtu d’écaillé et de cuivre, de bois colorés et d’acajou. En dernier lieu, l’infortuné débris, rogné, aminci, vermoulu, allait échouer chez un fabricant de vieux meubles, enchanté de l’incorporer dans un fauteuil moderne, qu’il pourrait ainsi faire passer pour ancien.
Chemin faisant, notre héros racontait les belles choses qu’il avait vues, la corporation, le cloître, l’atelier, les procédés de chacun; admis dans la maison, il nous montrait sa place, son rôle, son voisinage, sa vie intime, celle de ses maîtres:
Il disait: J’étois là, telle chose m’avint.
Et le jour où, vendu à un amateur à la mode, il se retrouvait parmi ses vieux camarades, le glorieux invalide chantait encore les beaux souvenirs de la jeunesse et les triomphes du passé.
Ce petit roman archéologique n’était pas né viable; il avait un certain parfum littéraire assez compromettant, tranchons le mot, il n’était pas sérieux. On est devenu très solennel en archéologie; les jeunes pontifes veulent qu’on célèbre avec majesté les augustes mystères et ne tolèrent pas les causeries dans le temple. Si Monteil ou Nodier revenaient au monde, on les engagerait poliment à faire des articles pour les demoiselles et des livres de jour de l’an. Nous étions prévenu, et l’Histoire d’un morceau de bois est prudemment restée dans les limbes. Dieu nous préserve de le regretter! La science fait chaque jour des pas de géant, et les programmes de la veille sont distancés le lendemain. L’histoire ne tient plus dans un cadre de chevalet; elle veut de l’espace et des grandes toiles. Les expositions rétrospectives ont mis au jour des trésors dont nos pères ne soupçonnaient pas l’existence; on a trouvé des filons inexploités, tracé des voies nouvelles, révélé des filiations inconnues. Une armée de collectionneurs, troupe jeune, remuante, passionnée, s’est lancée à la découverte; les uns, bataillon sacré du bois sculpté, ont envahi la Renaissance; les autres, voltigeurs du XVIIIe siècle, se sont jetés à la poursuite de Marie-Antoinette et de la Pompadour, pendant que les burgraves, fidèles au poste, colligeaient en silence et dans l’ombre les moindres reliques de leur cher Moyen-Age, et récoltaient pour la science un regain inespéré.
Ainsi les matériaux sont arrivés sur le chantier, plus abondants de jour en jour, et l’histoire du bois a pris des proportions imprévues. Il a fallu diviser la besogne, attaquer chaque partie en détail, la charpenterie, la statuaire, la décoration intérieure, le meuble. On s’est partagé les siècles, les pays; tous ont apporté leur pierre: celui-ci un compte rendu, celui-là une monographie, l’autre une conférence; on a dessiné, gravé, photographié ; chacun a fait sa page, en attendant le volume.
Un des chapitres les plus attrayants et les moins connus de cette étude est assurément l’histoire du bois appliqué au meuble, ou, pour mieux dire, l’histoire du meuble lui-même.
Le meuble est une des manifestations les plus sûres et les plus significatives de la vie privée. On ne connaît bien un peuple qu’en l’étudiant chez lui, dans sa maison, dans son costume et dans son mobilier. Ces trois expressions de la vie usuelle, différentes en apparence, ont des traits communs qui les rattachent l’une à l’autre. La maison est le vêtement extérieur et collectif de la famille, le costume est la maison personnelle de l’individu. Le mobilier participe de ces deux éléments: le gros meuble dérive de la maison par sa construction, son emplacement, son poids matériel; un lit, une armoire, un buffet sont, à certains égards, des immeubles par destination. Le menu meuble, au contraire, tient du costume, en ce sens qu’il nous touche de plus près par le maniement quotidien, le contact plus fréquent, plus immédiat.
Cette double nature prête au mobilier une physionomie plus expressive. La maison et le costume, étant l’enveloppe extérieure, ne remplissent qu’une fonction, ne représentent qu’un aspect de la vie privée. Le meuble a des destinations multiples, il se fractionne en une foule de variétés répondant à toutes les circonstances de la vie; les indications sont donc plus diverses, partant plus complètes. Les convenances personnelles, le goût, l’accointance journalière lui ont donné sa forme, sa couleur, sa place, son rôle; il s’élargit, se rétrécit, s’élève, s’abaisse, se fait souple ou résistant, solide ou délicat, suivant les attitudes familières, la toilette à la mode. Ainsi s’établit à la longue une affinité frappante entre le meuble et l’individu. Entrez pour la première fois dans un de ces intérieurs monotones et impersonnels de la maison moderne, un coup d’œil jeté sur les meubles vous laissera deviner les goûts, les habitudes, la vie familière du maître de la maison. Ces témoins de tous les jours portent son empreinte, ils ont tout vu, tout entendu, ils savent son secret. Il suffit de les faire parler.
Si l’on obtient ces inductions de l’ameublement moderne, composé d’un petjt nombre de patrons se répétant à l’infini, quel parti la science ne doit-elle pas tirer des anciens meubles, d’autant mieux que la plupart constituaient des objets isolés, d’une forme particulière et spéciale à chaque possesseur! A coup sûr la recherche vaut la peine d’être tentée; n’est-ce pas un charme d’entrer ainsi dans ces vieux logis d’autrefois, de s’asseoir au foyer, d’interroger ces meubles encore pleins de la poussière des aïeux, de leur faire raconter la vie au jour le jour, le roman de l’intimité ?
On nous dit que le meuble n’a rien de commun avec l’art, que c’est une œuvre industrielle qui relève du manuel de l’ébénisterie, pas davantage. — Nous n’aurons pas l’indiscrétion de demander ce qui distingue une œuvre d’art d’une œuvre d’industrie, si tant est que l’on se soit jamais mis d’accord sur ce point; mais, en admettant que le meuble moderne ne soit pas une œuvre d’artt comme l’entendent certaines gens, jadis il en était autrement.
Dans ces siècles privilégiés où l’on ne connaissait ni les beaux-arts, ni l’art industriel, ni l’art décoratif, mais l’art tout seul, sans épithète, on estimait que l’industrie, en se mêlant à nos usages de tous les jours, exerce une action directe et constante sur le goût, et que l’art, dans son propre intérêt, doit y avoir la main. Nous l’avons dit ailleurs, «la foule n’est pas assez riche pour s’instruire en achetant des tableaux et des statues. Si l’on veut faire son éducation, il faut nécessairement compter avec l’industrie; elle seule a ses entrées partout et nous enveloppe par les mille petits objets de la vie privée. Pour pénétrer jusqu’au public, l’art est donc obligé de se glisser avec elle, sinon il court le risque de rester à la porte; il devient une exception, et voilà précisément l’écueil que les anciens maîtres voulaient éviter à tout prix.» Ils fournissaient libéralement des patrons aux huchiers, aux orfèvres, aux ferronniers, etc.; l’objet le plus simple sortant du même atelier que le plus riche échantillon dérivait de la même inspiration, portait la même signature, ce qu’on appelle aujourd’hui le cachet d’une bonne maison. Les meubles étaient donc des objets d’art dans leur genre, et leur histoire est le complément d’une histoire de l’art. On ne juge pas une école seulement sur les chefs-d’œuvre achevés de ses architectes, de ses peintres, de ses sculpteurs; de même que nous étudions ces grands génies dans le moindre croquis échappé de leurs mains, il faut encore les suivre dans ces ateliers où se fabriquaient, sur leur initiative et d’après leurs dessins, tant d’ouvrages excellents.
Ainsi le meuble est un témoignage historique et un témoignage artiste d’une valeur incontestable, mais pour en tirer parti, pour voir clair dans cette innombrable variété de documents provenant de tous les siècles et de tous les pays, il importe de les grouper méthodiquement, d’établir la chronologie, en un mot de faire l’histoire du meuble.
L’histoire du meuble suppose tout d’abord un choix de types originaux photographiés ou dessinés d’après nature. Les anciens dessins, les peintures des manuscrits, les estampes des petits maîtres ne remplacent jamais le monument lui-même. Prenez le plus réaliste parmi les enlumineurs du Moyen-Age, il a son tempérament, ses préoccupations d’école, et les garde; soyez sûr qu’à un moment donné l’artiste montrera le bout de l’oreille et se laissera tenter par la folle du logis. Sa naïveté même, son ignorance ou son dédain de la perspective prêteront aux malentendus, soit qu’on veuille rectifier son dessin, soit qu’on le prenne au pied de la lettre. Quant aux vignettes du XVIe siècle, elles représentent des meubles héroïques, semi-romains, qui n’ont sans doute jamais vu le jour, et dont quelques-uns, tout au moins, sont inexécutables. Sans doute Du Cerceau et ses successeurs, Berain, Marot, Lepautre, etc., sont plus pratiques, ils gravent spécialement pour l’industrie; mais leur pensée, leur dessein, a besoin de passer par l’atelier du sculpteur ou de l’ébéniste pour y prendre corps. Jusque-là c’est un projet très arrêté, très précis, nous en convenons, mais destiné à des ouvriers libres, intelligents, comprenant les sous-entendus et sachant ce qui leur reste à faire pour mettre en œuvre la conception du maître, lui donner sa forme définitive. Nous qui vivons deux ou trois siècles plus tard, qui n’avons plus le mot, la tradition d’école, sommes-nous certains de notre interprétation?
Ce n’est pas qu’il faille dédaigner de parti pris les dessins du temps, ils sont utiles à leur heure et l’historien qui voudrait s’en dispenser rendrait sa tâche impossible. Les données sont si obscures à l’origine, les bois des premiers siècles tellement rares, qu’il faut bien s’accommoder des seuls témoignages contemporains qui nous restent: les miniatures, les sceaux, les bas-reliefs. Mais du jour où commence l’histoire certaine, l’histoire par les monuments, les anciennes images ne sont plus qu’un commentaire, un appoint; encore faut-il en user discrètement, à l’appui des textes, et les reproduire telles quelles. A tout prendre, nous préférons une lacune à une hypothèse dessinée.
Les amateurs du bois, tous ceux qui s’intéressent à cette histoire que chacun voudrait lire et que personne n’a faite, avaient compté sur l’Exposition de 1878 au Trocadéro; chacun espérait y trouver un ensemble de matériaux présentés d’une façon méthodique. En France, nous connaissons à peine nos richesses; malgré les injures du temps et des hommes, malgré les hécatombes périodiques de l’incurie, de l’ignorance, de la mode et des révolutions, malgré cette rage de destruction qui est la maladie séculaire du peuple français, Paris et la province ont encore sauvé des trésors incalculables. Le vieux sol gaulois produit en abondance le collectionneur à côté du ravageur, comme, en certains pays, l’antidote pousse à côté du poison. L’occasion était donc toute trouvée de mettre en lumière une partie des merveilles emmagasinées, depuis un demi-siècle, dans les collections privées. On avait annoncé que le Trocadéro serait une histoire de l’art, rien n’était plus facile que de tenir la promesse et de montrer, au moins pour l’art du bois, une suite chronologique des plus beaux spécimens connus. Est-ce à dire que l’amateur fût rempli d’enthousiasme et prêt à jeter ses trésors à nos pieds, comme les ambassadeurs d’Artaxerce aux pieds d’Hippocrate? L’amateur n’est pas si empresse; c’est un personnage réservé, craintif, temporiseur, comme le bonhomme d’Horace,
Dilator, spe lentus, iners, pavidusque futuri.
La province surtout manque d’entrain pour les expositions parisiennes. Confier ses merveilles aux mains barbares des emballeurs! Livrer aux brutalités du chemin de fer ces précieux cadavres vermoulus, friables, souvent rajustés et maintenus par «ce je ne sais quoi qui tient en l’air un édifice ruiné !» Quel crève-cœur, quel sacrifice! Mais la province, comme Iphigénie, connaît ses devoirs,
Elle sait, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas une tête innocente.
Pour peu qu’on insiste, elle capitule toujours; et, du Nord au Midi, de l’Est à l’Ouest, les grandes et les petites villes attendaient, résignées, les émissaires du Trocadéro chargés de transmettre l’ordre fatal:
Ma fille, il faut céder, votre heure est arrivée.
Explique qui voudra comment la province n’a reçu ni visites, ni émissaires, ni mot d’ordre, et naturellement s’est bien gardée de rien confier à l’emballeur ou au chemin de fer; nous ne nous chargeons pas de pénétrer le mystère. La province n’ayant pas été convoquée, Paris jugeant inutile de marcher quand la province restait au poste, l’exposition mobilière s’est trouvée réduite à quelques échantillons disséminés au hasard dans les salles et, de cette histoire de l’art qui promettait tant de révélations nouvelles, rien n’a survécu, pas un livre, pas un document, non, pas même un catalogue.
Nous n’avons pas la prétention de combler cette lacune; notre livre est une étude sur le meuble en France au XVIe siècle, une suite de monographies, un recueil de matériaux pour l’historien de l’avenir. Le Dictionnaire du mobilier français, de Viollet-le-Duc, s’arrête au début de la Renaissance; nous essayons, sous une autre forme, de le prolonger d’un siècle; réduite à ces proportions, la tâche suffit à nos épaules.
Paris, décembre 1886.