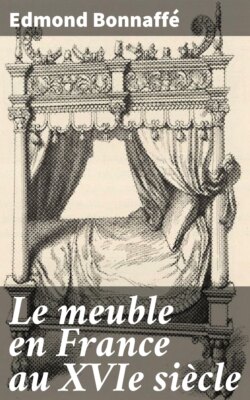Читать книгу Le meuble en France au XVIe siècle - Edmond Bonnaffé - Страница 7
L’ART DU MEUBLE EN FRANCE
ОглавлениеEN France, le bois est une matière de prédilection. Nous pratiquons à merveille l’art de recevoir; nous aimons le home plus que l’Anglais lui-même, bien que le mot lui appartienne; dès lors notre école s’est appliquée d’une façon spéciale à perfectionner l’outillage de la vie privée. Favorisés par une situation géographique exceptionnelle, recevant des Flandres la bise du nord déjà tempérée, de l’Italie les rayons de l’orient déjà attiédis; prompts à l’assimilation, empruntant avec mesure aux uns l’habileté de l’outil et les ressources de la pratique, aux autres le fini des ajustages et la solidité du travail, nos maîtres ont combiné discrètement toutes choses avec le goût traditionnel et le génie du terroir. D’une matière commune, ingrate, exposée à tous les agents de destruction, ils ont tiré un art très raffiné, très personnel, et doté la France d’une école sans rivale. On a dit que nous ne savions pas être riches, cela est vrai: notre langue est pauvre, sans accent; nos matières premières communes, sans éclat et sans valeur; mais nous avons le savoir-faire, l’ingéniosité, le goût et l’esprit des ajustements; peu de capital en somme, mais le talent de le faire valoir. Si bien que cette langue, maniée par nos écrivains, a créé des chefs-d’œuvre qui sont l’honneur de la littérature universelle, et que ces matériaux vulgaires, incolores, travaillés par nos artistes, ont produit l’émaillerie limousine, les porcelaines de Sèvres, les faïences de Palissy, les meubles de la Renaissance, l’ébénisterie métallique de Boulle, et les incomparables boiseries du XVIIIe siècle.
Un jour que M. de Laborde comparait deux boiseries sculptées, l’une française et l’autre italienne: «Elles ressemblent, disait-il, aux langues des deux pays. L’italien n’a que des syllabes sonores, le français est tempéré, adouci par son adorable e muet; voyez cette sculpture française, elle est toute remplie d’e muets.» La comparaison ne manque pas de justesse. Chez nous, l’architecture est comme les mœurs, avenante, mesurée, intime, élégante et polie; elle est pleine de nuances et de sous-entendus; elle a, elle avait du moins, de l’esprit. Au XIIIe siècle comme au XVIIIe, sous les Valois comme sous la Régence, elle cause; les arabesques font des confidences aux modillons, les chapiteaux et les consoles se disent mille choses dans leur langue, les colonnes bavardent avec les corniches, sans éclats, sans fanfares, comme entre gens bien élevés. La sculpture italienne fait des monologues et parle haut.
L’histoire du meuble en France comprend deux grandes périodes.
Au Moyen-Age, la vie est aventureuse et guerrière, la société nomade, le meuble essentiellement mobile. Quand le maître du logis abandonne sa résidence, il emporte avec lui la maison tout entière, meubles, tentures, ustensiles. Chaque objet, placé dans son enveloppe spéciale, voyage sur des chariots ou des sommiers. Ces usages déterminent la forme et la construction du meuble: tout devra se replier, se démonter, tenir peu de place. De là le petit nombre de gros meubles et l’abondance des coffres, des coussins pour garnir les sièges, etc.
A partir du XVIIe siècle, au contraire, la société s’est définitivement consolidée, le meuble devient fixe. Par suite, les grands coffres seront plus rares, la menuiserie plus délicate, les garnitures adhérentes. Le règne de Fébéniste et du tapissier commence.
Le XVIe siècle est le trait d’union entre ces deux périodes; il marque la fin de l’une et les débuts de l’autre, et participe de toutes les deux. Il convient donc de l’étudier sous ce double aspect.
La tâche n’est pas toujours facile. On rencontre en chemin des variétés intermédiaires, des espèces hybrides qui forment la transition d’un style à l’autre, et ne présentent pas les caractères distinctifs de leur famille. D’autre part, les ateliers contemporains ne marchent pas toujours du même pas: les uns sont en retard sur les autres. De là des défauts de concordance qui déroutent les classifications les mieux ordonnées. Un classement rigoureux, des catégories bien définies sont donc impossibles; il faut, quoi qu’il en coûte, négliger les sous-genres, ne pas chercher une précision introuvable et s’accommoder d’un type moyen. Ces réserves faites à l’adresse des critiques pointilleux, nous serons plus à l’aise pour aller de l’avant et retrouver notre chemin.
Le meuble du Moyen-Age est un ouvrage de charpente solidement bâti en chêne. La construction se compose d’ais massifs et de larges panneaux assemblés sans encadrement, les surfaces restant planes pour recevoir des peintures, des cuirs gaufrés, des ornements légèrement champlevés.
Une première révolution se produit au XVe siècle. Par suite de l’activité imprimée aux constructions civiles, les huchiers, qui correspondent à nos menuisiers de bâtiment, se sont détachés du corps des charpentiers pour former une communauté distincte. Le meuble sort de l’atelier du charpentier pour devenir exclusivement un ouvrage de hucherie, et sa construction se modifie en conséquence. L’aspect sera moins massif, moins robuste. Le maître huchier divise la surface en petits panneaux de largeur uniforme, qu’il encadre par des montants et des traverses à chanfrein, formant saillie et assemblés carrément. Le sculpteur commence à prendre une part importante dans la décoration; les panneaux sont ornés de nervures ogivales ou de parchemins plissés, les montants terminés par des bouquets ou revêtus de piliers à pyramides, la frise supérieure surmontée d’une crête à jour. Sous l’influence de la cour de Bourgogne, l’art du mobilier se perfectionne rapidement: le meuble devient un objet de grand luxe, couvert de sculptures, d’or et de couleurs. Français et Flamands réunis dans les ateliers de l’Ile-de-France, du Nord et de la Bourgogne, rivalisent de talent, d’adresse et d’ingéniosité. L’influence flamande se fait sentir dans le naturalisme des figures, les attitudes expressives, la tendance prononcée pour la satire et la caricature. Pendant un demi-siècle, l’école française, dont la destinée semble être d’osciller sans cesse entre les Flandres et l’Italie, penche du côté des Flandres. La réaction est proche, la Renaissance va entrer en scène.
LOUIS XII.
PANNEAU DE PORTE DE GAILLON.
(Musée du Louvre.)
La Renaissance se partage en deux périodes distinctes. La première présente ce caractère original que les deux écoles, l’ancienne et la nouvelle, se juxtaposent, se donnent la main, sans se confondre. L’ogive et le plein-cintre, la nervure flamboyante et l’arabesque, le balustre à fuseau et le pilier à pyramide, la frise à rubans et l’entablement romain se coudoient, s’entremêlent et s’entendent à merveille. Par quel artifice, par quels ménagements, quelles combinaisons ingénieuses, nos vieux maîtres sont-ils parvenus à concilier ces deux principes opposés, pour en tirer sans effort un art imprévu, pittoresque, plein de saveur et de jeunesse? nous n’avons pas à l’examiner ici, mais le problème vaut la peine d’être médité par nos contemporains en quête d’une formule nouvelle qu’ils cherchent encore sans la trouver.
L’arabesque et le pilastre sont les deux innovations caractéristiques de la première Renaissance. L’arabesque, empruntée aux Romains, consiste en un motif central, — tige de fleur, fût de candélabre, nœud de ruban, — d’où s’échappent symétriquement, de droite et de gauche, des cordons ou rameaux chargés de vases, de trophées, de figures, d’animaux, variés suivant le goût et le caprice de l’artiste. Ces délicates broderies grimpent le long des pilastres, s’épanouissent sur les panneaux, se mêlent aux cornes d’abondance, aux sirènes affrontées, aux médaillons de guerriers, d’empereurs ou de personnages à haut-relief qui semblent regarder curieusement dans la salle.
FRANÇOIS 1er. — DOSSIER DE CHAIRE. (Collection de M. Chabrières-Arlès.)
Le pilastre est la décoration obligée du montant. Orné d’arabesques ou de balustres rapportés, élégi de moulures en losange ou en demi-cercle, couronné d’un chapiteau très particulier et plein de grâce, le pilastre marque la division des façades et accuse les montants sur les coffres, les chaires et les dressoirs. C’est un ornement commode que la Renaissance allonge, diminue, élargit ou superpose à volonté.
En somme, l’art du meuble suit pas à pas les allures de l’architecture civile son aînée, d’autant mieux que celle-ci dérive du même principe, c’est-à-dire de la construction en bois, et que le meuble relève de la menuiserie de bâtiment. Tel meuble de cette époque, un dressoir par exemple, avec son coffre supérieur, sa ceinture formant tiroirs et ses piliers à jour, est l’image réduite d’une travée de la maison contemporaine à un étage, portant sur une galerie servant de promenoir.
Les dernières années du règne de François 1er marquent la fin de la Renaissance; l’ogive et ses accessoires ont disparu. Le gothique conserve pour un temps la structure générale, les pans coupés, la division par petits panneaux, les pénétrations, les bases multiples; mais ces derniers souvenirs du passé s’effacent rapidement. Seule, l’Église reste fidèle aux vieilles traditions du Moyen-Age; le mobilier religieux garde encore le caractère gothique fort avant dans le XVIe siècle.
La deuxième période de la Renaissance débute avec l’école de Fontainebleau (1530), mais ne se propage en France que depuis Henri II. Nous avons raconté jadis cette page de notre histoire; nous avons montré l’art national aux prises avec les Italiens, défendu par l’opposition de la province, sauvé par le génie de nos artistes, maître enfin de lui-même et s’épanouissant dans sa glorieuse maturité. La nouvelle école amenait en France l’ordonnance antique avec tout un bagage de cartouches, de guirlandes, de mascarons, de dieux et de héros, de nymphes et de saisons aux belles poses et aux grandes allures. C’était une révolution complète, non seulement dans les formes, mais dans l’art même du meuble.
En effet, pour soumettre le meuble aux règles de l’architecture antique, pour lui faire reproduire ses profils, ses frontons, ses colonnes, ses combinaisons et ses détails, il fallait nécessairement multiplier et subdiviser les parties, compliquer les coupes, traiter les ajustages et les assemblages avec une extrême précision, inventer une technique, des outils, des procédés nouveaux et perfectionnés; en un mot rompre avec le passé, détacher l’art du meuble de la menuiserie de bâtiment, pour en faire un art spécial, tel que nous le pratiquons aujourd’hui.
HENRI II. — PORTE D’ARMOIRE.
(Collection de M. Bonnaffé.)
De même, l’ornementation nouvelle avec ses bas-reliefs, ses figures nues et ses poses académiques, exigeait des aptitudes, un apprentissage particuliers, une éducation tout autre que celle des anciens imagiers, un talent moins naïf, moins sincère à coup sûr, mais plus délicat, plus raffiné, plus cherché. D’ailleurs, la polychromie disparaissant, le bois restait seul apparent, le sculpteur prenait une place prépondérante, au premier plan, et n’avait plus à compter que sur lui-même pour se faire valoir.
Ces modifications devaient avoir une autre conséquence. Déjà, depuis François Ier, l’ouvrier employait le noyer de préférence au chêne, pour certains meubles de prix. A partir de Henri II, les grands ateliers de l’Ile-de-France, de la Touraine, de la Bourgogne, du Lyonnais, de l’Auvergne et du Midi, remplacent, d’une façon presque générale, le chêne par le noyer. Son grain plus fin, ses pores plus serrés, se prêtent mieux aux délicatesses de l’outil; son épiderme est plus riche, plus coloré ; il prend un poli supérieur, et le temps lui donne une patine chaude et profonde qui s’harmonise à merveille avec les rehauts d’or.
HENRI III. — PORTE D’UN DRESSOIR.
(Musée du Louvre.)
Le meuble français du temps de Henri II est un modèle d’élégance et de correction. Il relève de Pierre Lescot par la distinction de la forme, la pureté des profils, l’équilibre et l’harmonie des parties; de Jean Goujon, par la grâce allongée des figures, le goût et l’esprit des ajustements. Originaire de Fontainebleau, remanié, refondu, transformé par nos maîtres, il nous appartient en propre et l’on chercherait en vain son rival en Italie ou ailleurs. Les bas-reliefs sont méplats, les arêtes nettement tranchées, les profils sobres et généralement vierges de tout ornement, les colonnes fines, unies ou légèrement cannelées; peu ou point de cariatides; les panneaux maintenus par des cadres à moulures, les bâtis assemblés d’onglet, les coupes traitées à perfection. Çà et là des touches d’or, des incrustations de pâte ou de marbre, égayent discrètement la tonalité un peu sévère du noyer.
HENRI IV. — PORTE D’UNE ARMOIRE.
(Musée du Louvre.)
Avec Charles IX et Henri III, le type reste excellent, mais plus riche, plus à l’effet. La sculpture est abondante, les moulures gravées, les ornements brettelés, les reliefs ont plus d’accent. C’est le règne des cariatides, des termes, des satyres et des chimères, que l’artiste multiplie avec une aisance, une imagination inépuisables. Du Cerceau dessine pour les ateliers des arrangements nouveaux, des combinaisons parfois singulières, mais toujours d’une grande ingéniosité. On prodigue la dorure et l’argenture: «Quant aux meubles de bois, écrit un contemporain , nous voulons qu’ils soient tous dorés, argentés et marquetés.»
L’industrie du meuble, arrêtée dans son essor par les guerres civiles et religieuses, reprend haleine sous Henri IV. Les échantillons sont un peu lourds et chargés, mais d’une grande tournure encore et d’une belle exécution. Les colonnes trop longues, unies ou entourées de feuillage et montant jusque sous la corniche, les panneaux à cavaliers, les termes à moustaches, les incrustations de nacre et de minces filets de cuivre appartiennent à cette période.
Au début du XVIIesiècle, Marie de Médicis nous amène les Italiens de la décadence, avec leur goût bizarre, leur abus des décorations théâtrales et compliquées, leur passion de l’ébène et des bois de couleur. Le mérite de l’ouvrage ne consistera plus dans le modelé des reliefs, la variété des plans et le jeu des ombres, mais dans la nuance et la rareté de la matière. L’art du meuble change complètement de physionomie: on renonce aux panneaux d’assemblage pour revenir aux surfaces planes qui permettent le placage en feuilles minces, ménagent les bois de prix et font valoir leur coloration. Délaissé par la mode, le meuble de noyer décline rapidement. Les profils s’empâtent, les beaux cuirs que la Renaissance découpait en agrafes solides, s’étalent détrempés, ramollis; la colonne antique, droite, ferme, élancée, se contourne et devient torse; le décor usé, banal, n’a plus ni nerf, ni jeunesse. Le sculpteur cède la première place au marqueteur, le menuisier devient ébéniste.
Nous venons d’accompagner la Renaissance depuis ses origines jusqu’à sa décadence, marquant le long du chemin chacune de ses étapes. Singulier rapprochement! c’est l’Italie qui nous apporte la Renaissance avec Charles VIII, c’est elle qui risque une première fois de la compromettre avec François 1er, et c’est encore elle qui mène son enterrement avec Marie de Médicis. La question de l’influence italienne sur l’école française du XVIe siècle a été souvent débattue et nous avons nous-même, dans le temps, dit notre mot à ce sujet . Mais quelles ont été ses conséquences au point de vue spécial qui nous occupe? En d’autres termes et pour préciser davantage, nos maîtres ont-ils commis une faute en appliquant au meuble les formes de l’architecture antique importée par les Italiens?
Interrogez les partisans du Moyen-Age à outrance, ils vous diront qu’une des maximes fondamentales de l’ancienne école était d’utiliser invariablement la matière en raison de ses qualités. Or, l’architecture est un système de construction et de décoration dérivant de la nature de la pierre et commandé par elle; plier le meuble, monument de bois, à des formes réservées aux monuments de pierre; lui faire parler une langue qui n’est pas créée pour lui, pour laquelle il n’est point fait; voilà, dit-on, un non-sens impardonnable que les tètes carrées du Moyen-Age se seraient bien gardées de commettre. D’ailleurs, que viennent faire dans l’intérieur du logis ces diminutifs d’arcs de triomphe, ces temples en miniatures, avec leurs frontons à deux égouts, leurs denticules qui supposent des chevrons absents, leurs frontispices et leurs portiques? Profusion inutile que tout cela, ornements déplacés, anguleux, incommodes. En renonçant aux vieilles traditions nationales, à l’harmonie logique entre la matière, la forme et la destination, la Renaissance préparait sa ruine irrémédiable et faisait courir l’école française à sa perte.
Ces critiques sont-elles fondées?
On nous dit que la forme architecturale, créée pour la pierre, doit être réservée exclusivement à la pierre. Mais alors appliquez le même principe à l’architecture du XIIIe et du XIVe siècle qui est essentiellement l’art de la pierre, et proscrivez, comme autant d’hérésies, les châsses, reliquaires, tabernacles, grilles, armoires, sièges, dressoirs, lutrins, qui reproduisent exactement en cuivre, en fer, en argent et en bois, les toits à double pente, les crêtes, les gables, les galeries, les colonnettes et les contreforts des monuments de pierre. Condamnez les stalles, les chaires et les boiseries du XVe siècle, avec leurs panneaux et leur décoration à jour imitant à s’y méprendre les fenêtres et les lucarnes à la mode, ou sinon admettez que l’architecture de cette époque dérivant des constructions de bois, le meuble contemporain a le droit légitime de lui emprunter des types qui sont aussi les siens.
Mais faut-il croire que les gens de la Renaissance, en transformant la technique du Moyen-Age, en aient répudié les sages principes?
Jadis l’ouvrier construisait son meuble avec du chêne. Préoccupé d’employer la matière en raison de ses qualités, il s’en tenait rigoureusement à son programme et faisait une œuvre de charpente ou de grosse menuiserie. Il utilisait le bois tel que le fournissait le débitage, les madriers pour former le bâtis, et les planches plus minces et plus larges pour remplir les vides. De là tout un système de décoration rationnelle, l’équarrissage du madrier motivant des chanfreins ou des moulures qui abattent les arêtes et adoucissent les angles, et la planche développant une surface tout indiquée pour une décoration peinte ou légèrement champlevée. Rien de mieux tant que l’ouvrier se servait du chêne. Mais du jour où la marche de la civilisation, le progrès des mœurs, le besoin de stabilité nécessitent des meubles plus légers, plus décoratifs, on remplace le chêne par le noyer qui répond mieux aux besoins de la société nouvelle. Dès lors, adieu l’ancien programme: le chêne disparaissant entraîne avec lui le charpentier et toute sa logique; c’est au tour du menuisier d’entrer en scène avec son bois et sa logique à lui, qui comportent le fractionnement des parties, la variété des coupes, la précision des assemblages, la délicatesse des ornements.
De même au XVIIe siècle, l’invasion de l’ébène et des bois de couleur amène encore un autre programme, le placage en feuilles minces, et un autre personnel, l’ébéniste et le marqueteur. En résumé, faire de la menuiserie fine avec du noyer ou faire de l’ébénisterie avec des bois précieux est tout aussi rationnel que faire de la charpente avec du chêne. Dans un cas comme dans l’autre, l’ouvrier utilise la matière suivant ses aptitudes et sa destination.
On dit encore que les meubles de la Renaissance sont incommodes. Sur ce point, notre opinion est faite depuis longtemps; nous restons convaincu que chaque siècle est le meilleur juge du confort qui lui convient. Les meubles sont faits pour les gens qui s’en servent et non pour les générations suivantes, qui ont d’autres poses familières, d’autres manières de s’asseoir, d’autres toilettes à loger dans les armoires et dans les coffres, d’autres tournures à faire tenir dans les profondeurs d’un fauteuil. L’armoire de Noyon remplit aussi bien ses fonctions de convenance que le cabinet de Henri II et le bonheur-du-jour de Marie-Antoinette. Ils ont tous leur raison d’être logique et sont en parfaite harmonie avec les mœurs des contemporains qui les ont fait faire. Sont-ils confortables? Pour eux, assurément, pour leurs usages, leurs modes, leurs goûts; sans quoi, ils les auraient commandés autrement.
Quant à chercher la formule du meuble-type, autant vaut chercher la formule de la maison-type. Comme la maison, le meuble échappe à toute réglementation, il ne relève que du goût et de la convenance, convenance de ceux qui doivent s’en servir, bien entendu. Il est l’expression des mœurs, «ondoyant et divers» comme elles; il sera robuste et puissant pour le Moyen-Age, élégant et païen pour la Renaissance, sombre et grave pour Louis XIII, magnifique et solennel pour Louis XIV, arrondi, sensuel et ventru pour la Régence, et ainsi de suite, chacun taillant son meuble à sa mesure, sur son patron, chacun comprenant le confort à sa manière.
Ne mesurons pas les anciens à notre aune. Que leurs meubles soient fort incommodes pour nous, c’est entendu; mais convenons humblement que nos meubles seraient fort incommodes pour eux.