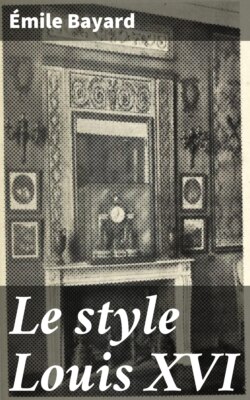Читать книгу Le style Louis XVI - Emile Bayard - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Considérations générales sur le style Louis XVI
ОглавлениеL’œuvre des artistes, interrompu par les uns, est repris par les autres tour à tour; il s’ensuit que nous assistons à des styles baroques, à des styles de fin de siècle, de transition, etc.
Aussi bien un grand nombre d’artistes sont pour ainsi dire «à cheval» sur plusieurs époques; il y en eut de si brèves, comparativement aux longs règnes de Louis XIV et de Louis XV, jusqu’à l’avènement de la seconde République! Avec quelle rapidité, en somme, la Révolution succéda à Louis XVI et le premier Empire à la Révolution!
De telle sorte qu’en architecture, qu’en peinture, qu’en sculpture, qu’en ébénisterie, etc., l’énumération des styles ne correspond pas, le plus souvent, à l’ordre chronologique, surtout aux époques précipitées que nous venons de dire.
C’est le cas notamment du Panthéon (église Sainte-Geneviève à Paris), commencé par Soufflot (1709-1780), sous Louis XV et terminé vers 1790, par Rondelet; c’est le cas de l’École de médecine, à Paris, due à Gondouin (1737-1818), pour l’architecture. En sculpture J.-A. Houdon (1741-1828), en peinture L. David (1748-1825), et combien d’autres, sont témoins de plusieurs régimes et la classification de leur art importe moins, après tout, que la date de leurs chefs-d’œuvre caractéristiques.
FIG. 19. — Motifs décoratifs Louis XVI.
Ainsi J.-A. Houdon (de même que Greuze, 1725-1805) personnifie-t-il essentiellement l’esprit du règne de Louis XVI (d’ailleurs, la Révolution, en mettant à l’écart la délicatesse de son génie, le lui fit bien sentir, el Greuze n’échappa pas davantage à la réaction impitoyable des enthousiasmes); qui oserait enfin séparer Louis David de Napoléon Ier?
FIG. 20. — Motifs décoratifs Louis XVI.
Du côté des ébénistes, même anomalie. Toutefois le style du mobilier s’imprègne davantage du goût d’une époque, il enregistre d’une façon plus brusque et plus sensible les tendances d’un régime, ce régime fût-il même des plus momentanés. Voyez le style Directoire, caractéristique en plein style Empire, voyez le style Empire décrété par Napoléon Ier.
Il n’empêche que Riesener, élève de Oëben, marquera aussi parfaitement son génie, dans deux formules différentes, sous Louis XV et sous Louis XVI, bien que le maître se réclame davantage du règne de Louis XVI, et il ne faut pas oublier encore que les merveilleux ciseleurs du premier Empire avaient été formés sous le précédent régime.
Dans l’énumération des styles, répétons-le, l’ordre chronologique surprend singulièrement les artistes en leur tâche et, quand on songe au grand nombre de ceux qui, contemporains des deux monarques, estampillèrent de leurs marques Louis XVI les meubles de l’époque de Napoléon Ier, il est permis de concevoir des doutes sur les décisions des experts.
C’est Papst, c’est Michel-Charles-Jacques-Urbain Lemarchand, c’est Alexandre, c’est Simon Mansion, c’est Jean-Antoine Bruns, ébénistes; c’est le célèbre orfèvre Thomire et tant d’autres dont la longue carrière embrasse à la fois les deux règnes, travaillant docilement dans le goût du vainqueur d’Iéna après avoir servi le caprice de la première victime de la Révolution.
FIG. 21. — Le Petit Trianon (façade sur le jardin), par Gabriel.
On a constaté que les plus belles pendules de style Empire avaient été exécutées sous Louis XVI; cela prouve la délicatesse transitive des deux manifestations qui, en somme, procèdent l’une de l’autre, d’après le modèle antique plus ou moins équitablement transfiguré.
Mais on sent déjà la décadence des styles dans cette équivoque. Les conceptions du Louis XVI, néanmoins, tranchent nettement sur celles du Louis XV; c’est là un signe de force. Le Louis XVI est une adaptation distinguée, un compromis grêle et élégant de la donnée classique, son originalité est évidente, tandis que le caractère du style de Napoléon Ier vise à la solennité du Louis XIV et il n’en réalise que la pesanteur.
Au surplus, le style Empire copie les meubles grecs et romains, Napoléon couche sans vergogne dans le lit de Brutus, alors que Louis XVI rougirait d’une telle compromission.
Il n’y a donc point à se méprendre sur le meuble, bien propre à chacun de ces styles, mais nous n’en dirons point autant des petits objets d’orfèvrerie qui, maintes fois, déroutent le connaisseur.
Il n’empêche que l’énigme des styles de transition, des styles chevauchants, est passionnante à déchiffrer. Par un rien, l’artiste s’est trahi. Comme à son insu, il a été impressionné à la fois par deux courants d’esthétique, et il mêle harmonieusement, souvent, cette double expression.
FIG. 22. — Escalier du Petit Trianon (palier du premier étage).
C’est le cas du bureau-secrétaire de Louis XV auquel travailla Riesener (au musée du Louvre) en compagnie d’Oëben, où certains détails, comme la galerie et le motif de la moulure (ruban), dans la partie supérieure du meuble, laissent percer le Louis XVI sous le style cependant bien Louis XV.
Quelle singulière et pénible destinée que celle de Riesener! Riesener triomphant à la fois sous Louis XV et sous Louis XVI, dédaigné par Napoléon auquel sa souplesse artistique eût sans doute procuré l’aubaine d’un pur style (il s’était bien déjà métamorphosé deux fois, pourquoi n’aurait-il pas transformé son talent une troisième fois?), consuma ses dernières années dans l’inaction.
Napoléon Ier aurait préféré à un de ses chefs-d’œuvre l’armoire à bijoux que Jacob Desmalter exécuta pour l’impératrice Marie-Louise; mais ce dédain inexplicable n’est rien à côté de celui dont Gouthière, l’incomparable ciseleur de l’époque de Louis XVI, fut victime.
Gouthière mourut dans la misère, à l’hôpital! Le grand artiste n’eut pas le don d’émouvoir le «petit Caporal» point davantage, d’ailleurs, que Louis XVI auparavant n’avait pu toucher le cœur de Louis David.
FIG. 23. — Départ de la rampe de l’escalier du Petit Trianon.
Au 10 août, comme ce pauvre Louis XVI ne reconnaissait aucune figure amie parmi les conventionnels, il aperçut tout à coup son premier peintre: «Eh bien! David, lui demanda-t-il d’une voix émue, quand finissons-nous mon portrait? — Je ne finis pas le portrait d’un tyran!» répondit durement l’auteur de Brutus.
Et David votera avec Lepelletier de Saint-Fargeau la mort de «Capet» et sera l’ami de Marat pour devenir ensuite le courtisan de Napoléon, après avoir siégé sur les bancs de la Convention.
A côté de la souplesse de l’art d’un Riesener servant merveilleusement deux régimes opposés, c’est là, de la part d’une conscience d’artiste, un exemple de souplesse moins savoureuse. 11 est vrai que quand David se mêle d’être intransigeant, il se montre sous une autre forme non moins détestable. C’est lui qui répondra à Carle Vernet, venu pour supplier son collègue, dont la haute influence aurait pu efficacement intervenir, de sauver la tête de sa sœur mariée à l’architecte Chalgrin, arrêtée comme suspecte: «J’ai peint Brutus, je ne solliciterai pas Robespierre!»
Et Mme Chalgrin sera exécutée malgré les implorations de son frère... Mais autant en emporte le vent du génie! Et Louis David, peintre des Sabines (formule doctrinaire) est aussi le peintre du Sacre (formule vivante); ainsi l’œuvre comme l’homme est-il à double face.
Louis David, petit-neveu de François Boucher. s’écriera, avant de suivre les conseils de Vien, «le restaurateur de l’art» : «N’est pas Boucher qui veut!» et, en même temps, il partira en guerre contre le peintre de Cupidon.
FIG. 24. — Escalier du Petit Trianon (vestibule).
Et la réponse du grand-oncle sera de faire agréer à l’Académie son impitoyable adversaire!
Aussi bien l’instabilité des enthousiasmes devait venger plus tard F. Boucher, l’école réactive de David se brisa en la personne de Ingres, digne continuateur du classicisme, contre l’école romantique représentée par Géricault et par E. Delacroix.
Les manifestations artistiques procèdent, non au nom du progrès, car les chefs-d’œuvre se valent, mais au nom des acceptions capricieuses de l’idéal à travers les courants de la mode et de l’esprit momentané.
Ainsi, à l’époque qui nous occupe, l’influence de la littérature ramena l’art à la sévérité et, comme nous le disions plus haut, c’est vers l’antique que l’on se tourna.
L’antique jouit de cette vertu singulière de tendre la perche au génie essoufflé ; ses mœurs bénéficient alors d’une curieuse immunité. L’antique est l’évangile des timides, et on bombe soudain le thorax à l’évocation des héros d’Homère; on a retrouvé l’aplomb défaillant à la vue d’un débris du ParThénon!
Nous savons, par la précédente récapitulation des styles, la haute assistance que l’antique leur prêta, mais nous n’ignorons pas davantage avec quelle flamme ils s’affranchirent et brodèrent sur leur glorieux modèle.
Nous n’avons pas oublié, d’autre part, la faillite qui, par une singulière coïncidence, guette au détour de leur apparente ou réelle indigence imaginative les styles esclaves de l’antique.
FIG. 25. — Palais de Bagatelle, par Bellanger.
Nous rappellerons maintenant qu’entre le style rocaille et le style Louis XV, il y eut un instant place pour un style Pompadour, et c’est une courtisane qui battit le rappel à l’art discipliné, au grand art comme aux grandes lignes et à leur pureté !
Au moins, sous Louis XVI, le retour vers l’antiquité avait été prêché par Jean-Jacques Rousseau, mais que penser de la Pompadour implorant Phryné !
«Depuis quelques années, écrit Grimm en 1761, on a recherché les ornements et les formes antiques; le goût y a gagné considérablement, et la mode en est devenue si générale que tout se fait aujourd’hui à la grecque. La décoration intérieure et extérieure des bâtiments, les meubles, les étoffes, les bijoux de toute espèce, tout est à Paris à la grecque. Ce goût a passé de l’architecture dans les boutiques de modes...»
Et, de fait, la marquise de Pompadour inaugure les meubles à la grecque pour réagir contre l’art convulsionné de la Régence.
Si Boucher fut son peintre, elle apprend à dessiner avec le sculpteur Bouchardon, le moins maniéré des artistes de son temps, et c’est Gay, enfin, qui lui montre à graver des camées dans la manière antique.
Mais, comme la fantaisie, l’étrangeté même, si chères à l’époque de Louis XV, ne veulent point abdiquer complètement devant la lubie d’une manifestation antique, le décor chinois figure de pair avec le grec encore timidement essayé ; ces «magots» que Louis XIV ne toléra sur ses vieux jours que sous le pinceau de Watteau, secouent un moment leurs nattes et leurs grelots à la barbe des héros d’Homère.
D’ailleurs, sous Louis XV, l’art est comme les mœurs, léréglé, et l’antique, prôné un instant par la Pompalour, n’est qu’un accès de vertu emporté dans le tourbillon des folies.
Poursuivons donc. Diderot sonne maintenant le glas: «Les modernes n’ayant d’autres projets que d’imiter servilement les anciens, ont tout gâté, tout perdu» ; mais le branle est donné, on n’attend plus que l’occasion du génie pour brûler ce qu’on a adoré ; c’est dans l’ordre des choses et, dégringolant d’antique en antique, les styles se sont tués.
FIG. 26. — Palais de Bagatelle (musée).
Aussi bien le style Louis XVI, répétons-le, a su conserver son originalité malgré sa tendance rétrograde. Il marque la limite de l’interprétation distinguée, il demeure français, tandis qu’après, sous le premier Empire, le gréco-romain est seulement apprivoisé pour quelque temps à nos mœurs.
L’histoire de la peinture, inséparable de l’antique (nous prenons particulièrement cet art comme exemple à cause de la couleur plus favorable) qui représente l’idéal classique, nous fournit la preuve d’une nature contrainte, en dehors de la vérité. Pour Nicolas Poussin, au XVIIe siècle, la beauté est exclusivement antique, les fenêtres de son atelier donnent sempiternellement sur la Grèce ou sur l’Italie. Voici un génie paralysé. David partagera cette obsession, mais néanmoins avec quelques échappées superbes vers la vie (Portrait de Mme Récamier, le Sacre, entre autres). Le maître se permettra enfin deux faces d’expression, l’une doctrinaire pour complaire au «grand art» selon la formule consacrée, l’autre affranchie, et cette dernière, seule, n’a pas vieilli.
Prud’hon, lui, bien qu’il ait subi un instant le joug du peintre de Napoléon, de même que Le Sueur (au XVIIe siècle) étudia seul, ne suivit aucune trace et arriva au génie sans presque le savoir. Il ne fut ni grec ni romain, il fut simplement de son temps, et toute sa gloire éternellement jeune vient certainement de là.
Mais, d’autre part, si l’on s’écarte trop du style des précurseurs, de leur probité surtout, on risque de vagabonder, et l’impressionnisme cher à nos jours ne puise son originalité que dans une regrettable indépendance qui étonnera le badaud sans convaincre le véritable connaisseur.
FIG. 27. — Ancienne Barrière de la porte Denfert, par Ledoux.
Aussi bien, sous Louis XVI, l’art ne fut pas seulement tempéré en ses audaces vers l’invraisemblance par les. philosophes, les archéologues s’en mêlèrent.
Le comte de Caylus entreprit la publication de recueils de peintures antiques «pour donner aux artistes quelques idées des belles formes et leur faire sentir la nécessité d’une précision dont le prétendu goût d’aujourd’hui et le faux brillant de la touche ne les écartent que trop souvent», et François Boucher reçut ainsi le coup de pied de l’âne du médiocre Vien, placé à la tête de la nouvelle école. Vien, le maître de L. David qui, à ses derniers jours, devait confesser avec plus d’amertume que de malice: «J’ai ouvert la porte; David l’a poussée» en faisant ainsi allusion au véritable réformateur de la fantaisie précédente.
Nous n’oublierons pas aussi, parmi les chefs du mouvement réactif: Watelet, l’auteur de l’Art de peindre (1760) et des Réflexions sur la peinture, Watelet, qui contribua, d’autre part, avec son Essai sur les jardins (1774), ainsi que Delille (Jardins), à répandre en France le goût des jardins paysagers dont nous parlerons plus loin.
D’autre part, c’est le peintre Dandre-Bardon exaltant le costume antique, avec plus de foi que d’exactitude, c’est le graveur Charles-Nicolas Cochin publiant ses Observations sur les antiquités d’Herculanum, c’est Winckelmann et Lessing, à l’étranger enfin, le premier avec son Histoire de l’Art, traduite en notre langue en 1766, le second avec le Laocoon, qui poursuivent âprement la réforme, à la suite, il faut le dire, des œuvres d’architecture.
FIG. 28. — Grand escalier du Théâtre de Bordeaux, par Victor Louis.
Aussi bien, pour conclure, nous admirerons sous Louis XVI, un mensonge délicieux d’après la nature,
— cette nature que l’on feignit de découvrir alors, à la remorque de Roucher, l’auteur des Mois, de Saint-Lambert, qui écrivit les Saisons, de Delille, rénovateur des Géorgiques de Virgile, — et la morale de ce temps, en somme, n’est qu’un masque séduisant à peine antique.