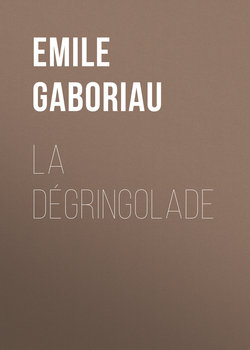Читать книгу La dégringolade - Emile Gaboriau, Emile Gaboriau - Страница 11
DEUXIÈME PARTIE
LE GÉNÉRAL DELORGE
VII
ОглавлениеIl faisait nuit depuis longtemps, lorsqu'avec le libre exercice de sa raison, Mme Delorge recouvra la faculté de souffrir.
Elle était couchée dans la chambre, dans le lit de son fils.
Une veilleuse brûlait sur la cheminée. Près du feu, dans un fauteuil, une femme de chambre sommeillait à demi…
Ce qui s'était passé depuis le moment où elle avait perdu connaissance, la pauvre femme le comprenait.
On l'avait fait revenir à elle, on l'avait couchée et elle s'était endormie de ce sommeil de plomb qui suit les grandes crises, faveur suprême de la nature.
Mais un grand apaisement s'était fait en son âme, si grand qu'elle s'en étonnait presque. Sans cesser d'être aussi profonde et aussi intense, sa douleur était devenue calme. Elle pouvait réfléchir, envisager froidement sa situation présente, et mesurer la grandeur des devoirs que lui réservait l'avenir.
Ainsi elle s'efforçait de voir clair en elle-même, quand, à un mouvement qu'elle fit, la femme de chambre se leva et s'approcha.
– Madame est éveillée?.. demandait cette fille; madame se sent-elle mieux?..
– Oui, bien mieux… Quelle heure est-il?
– Dix heures bientôt.
– Où sont mes enfants?
– Mlle Pauline est couchée. M. Raymond est avec M. Ducoudray dans le bureau de…
Elle hésita, et c'est en balbutiant qu'elle acheva:
– …Dans le bureau de défunt monsieur.
Elle avait tort d'hésiter. La douleur de Mme Delorge n'était pas de celles qui, mesquines et idiotes, dépendent d'un mot, que telle expression calme et que telle autre avive.
– Puisqu'il en est ainsi, dit-elle, donnez-moi ce qu'il me faut pour m'habiller.
– Quoi! madame veut se lever, malade comme elle l'est?..
– Je ne suis pas malade… Faites ce que je vous dis. Il faut que je remercie M. Ducoudray, et lui-même doit souhaiter me parler.
Elle ne se trompait pas, et c'était avec la plus vive impatience qu'en ce moment même le digne bourgeois attendait son réveil.
Il avait appris enfin les événements de la matinée, les mesures du coup d'État, et se demandait, non sans anxiété, quel avait pu être le résultat des recherches de Mme Delorge.
Cela le préoccupait si fort, qu'au lieu de courir à Paris, pour s'informer, pour voir, comme ç'avait été sa première inspiration, il était revenu, aussitôt l'enterrement, à la villa de la rue Sainte-Claire.
Cependant, la soirée s'avançait et il songeait à se retirer, lorsque Mme Delorge parut…
Il se dressa, mais les paroles expirèrent sur ses lèvres à la vue de la malheureuse femme.
Ses cheveux n'avaient pas blanchi en une nuit, comme il arrive fréquemment dans les romans, mais en vingt heures, elle avait vieilli de vingt années.
Élisabeth Delorge, la belle, l'adorée, l'heureuse épouse, n'était plus.
Celle qu'il voyait, pâle et glacée sous ses vêtements de deuil, le regard éteint et le visage immobile, c'était Mme veuve Delorge.
Cependant il ne tarda pas à se remettre de son étonnement, et clairement et brièvement, elle lui dit les événements de la matinée.
Il en était indigné, exaspéré, furieux…
Car il était libéral, ainsi qu'il s'en faisait gloire, passionnément libéral. Il avait toujours fait une opposition farouche au tyran Louis-Philippe, et avait même contribué, sans s'en douter, à le renverser, ce dont, matin et soir, dans le silence de son logis, il demandait pardon au bon Dieu.
Quant au reste, sans être aussi affirmatif que Mme Delorge, il partageait ses soupçons.
Que le général eût eu connaissance du complot, cela ne lui semblait pas douteux. On avait dû lui faire des ouvertures à brûle-pourpoint; sa loyauté s'en était indignée, il avait peut-être menacé de parler, et le négociateur n'avait pas hésité à le tuer, pour assurer le secret de la conspiration.
Mais ce meurtrier était-il vraiment M. de Combelaine?.. C'est ce dont M. Ducoudray n'était pas absolument persuadé, disant qu'un sourire sur les lèvres d'un homme ne prouve pas qu'il a commis un crime…
– Il l'a commis, j'en suis sûre! interrompit violemment Mme Delorge. Cet homme a été notre mauvais génie. Tous nos malheurs datent du jour où il est arrivé à Oran avec M. de Maumussy et M. Coutanceau. Déjà ils préparaient le coup d'État qui éclate aujourd'hui. Maintenant, je sais ce qu'ils avaient pu dire à mon mari, le jour où il les chassa de chez lui… Depuis, je n'ai pas revu M. de Maumussy, mais M. de Combelaine est venu ici deux fois… Allez, il est de ces pressentiments qui ne trompent pas: l'assassin, c'est lui!..
Malheureusement, les circonstances étaient étrangement contraires.
– Car, bien évidemment, disait M. Ducoudray, la mort de mon pauvre ami va passer inaperçue… Et quand le calme sera rétabli, quelle que soit d'ailleurs l'issue de la lutte, on l'aura oublié. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Obtiendrons-nous seulement une enquête? Et si nous l'obtenons, comment faire éclater la vérité? Où trouver des preuves, des témoins?..
Il fut interrompu par l'entrée brusque de Krauss, lequel arrivait, un papier à la main, criant:
– Ah! monsieur, si vous saviez!..
Mais il demeura béant en apercevant Mme Delorge, qu'il croyait encore couchée, et durant dix secondes il parut se demander s'il devait se taire ou parler.
Enfin, s'arrêtant à ce dernier parti:
– Je crains bien, reprit-il, que Marie, la cuisinière, n'ait fait une grosse sottise. Ce tantôt, pendant… l'enterrement, un homme s'est présenté, un homme qui voulait absolument parler à madame, pour une affaire très importante, à ce qu'il assurait, et qui concernait mon pauvre défunt maître… Madame dormait à ce moment, la cuisinière était seule à la maison, elle répondit qu'il n'y avait personne… L'homme parut désolé, et dit qu'il repasserait… Puis, se ravisant, il demanda du papier et un crayon et écrivit ceci…
Le papier que lui présentait Krauss, Mme Delorge le prit, le lut d'un coup d'œil, et le passa à M. Ducoudray, en disant:
– Vous demandiez des témoins, monsieur, que pensez-vous de celui-ci?..
Sur ce papier il y avait écrit, d'une mauvaise écriture:
«Laurent Cornevin, employé aux écuries de l'Élysée, à son domicile à Montmartre, rue Mercadet.»
Le digne M. Ducoudray avait bondi sur son fauteuil.
– C'est lui, s'écria-t-il, c'est certainement ce garçon d'écurie qui éclairait, m'a-t-on dit, le général et son adversaire. Cet homme sait la vérité, lui!.. Quel malheur que je n'aie pas été là quand il est venu!.. Pourquoi ne m'a-t-on pas remis cette adresse aussitôt mon retour?..
Le brave Krauss était désolé.
– Hélas! fit-il, elle n'y attachait aucune importance, la pauvre fille, et c'est bien par hasard qu'elle m'en a parlé. Elle comptait le remettre demain à madame.
Déjà le bonhomme Ducoudray avait pris une grande résolution.
– C'est un malheur aisément réparable, s'écria-t-il. Demain, avant huit heures, je serai rue Mercadet, et je verrai ce Cornevin. Il y aura peut-être quelque chose demain, mais je suis bourgeois de Paris, et une révolution ne me fait pas peur!..
A ce grand empressement du digne M. Ducoudray, il était certains mobiles dont il se gardait de souffler mot, mais qui diminuaient quelque peu son mérite.
Il avait fort réfléchi, depuis la veille.
Considérant la situation de Mme Delorge et la sienne, il s'était demandé pourquoi un bel et bon mariage ne réunirait pas, dans un avenir plus ou moins rapproché, selon les circonstances, leur double veuvage?
Pour sa part, il ne discernait aucun obstacle sérieux à ce projet flatteur.
Elle n'avait pas quarante ans, il est vrai, et il atteignait, lui, la soixantaine; mais si elle était belle encore, il était, lui, toujours vert, et une différence de vingt années entre la femme et le mari n'est pas rare dans les meilleurs ménages.
Le désespoir où il voyait Mme Delorge ne le décourageait aucunement.
Est-ce qu'il n'avait pas été désespéré, lui aussi, lors de la mort de sa pauvre défunte! Il s'était consolé. Elle se consolerait de même.
Est-il une douleur ici-bas qui résiste au lent travail du temps, à l'action dissolvante des semaines succédant aux jours, des années succédant aux mois?.. Non.
Donc, se voyant beaucoup de chances, il s'était tracé un plan de conduite.
Se découvrir en ce moment, laisser seulement entrevoir ses desseins et ses aspirations, eût été, il le comprenait, une insigne maladresse.
Risquer un mot, hasarder une allusion, c'eût été à tout jamais se fermer les portes de la villa.
S'imposer, au contraire, par les services rendus, s'insinuer, s'implanter petit à petit lui semblait un chef-d'œuvre de machiavélisme.
Et il avait résolu de jouer le rôle d'un vieil ami sans conséquence, jusqu'au jour où, sûr d'être indispensable, il démasquerait brusquement ses batteries.
Or, pouvait-il souhaiter une occasion plus admirable que celle qui s'offrait à lui pour ses débuts?
Qu'aurait à refuser Mme Delorge à l'homme qui l'aiderait à se faire rendre justice? Rien.
D'un autre côté, et toute question de sentiment à part, M. Ducoudray n'était pas sans une certaine satisfaction de se trouver mêlé à cette affaire. Le mystère l'attirait.
Qu'il courût, à s'occuper de cette affaire, un danger quelconque, il était à cent lieues de le soupçonner.
Pour lui, comme pour cent mille autres, le soir du 2 décembre 1851, la tentative du prince Louis-Napoléon ne pouvait aboutir qu'à un échec honteux…
N'importe! toutes ces idées qui grouillaient dans sa cervelle l'agitaient si fort, qu'il lui fut impossible de fermer l'œil de la nuit.
Dès sept heures, le matin du 3 décembre, le mercredi, il était debout, rasé. Et, à sept heures et demie, il franchissait le seuil de sa maison, lesté d'une tasse de café à la crème.
La matinée était sombre et pluvieuse.
Les boutiques, le long des rues de Passy, s'ouvraient lentement. La circulation était rare. Les ouvriers qui passaient par groupes, se rendant à leur chantier, avaient des physionomies singulières et parlaient bas.
Pourtant, ce n'est qu'en arrivant à la place de la Concorde que M. Ducoudray reconnut clairement la gravité des événements.
La première division de l'armée de Paris, sous les ordres du général Carrelet, reprenait ses positions de la veille dans les Champs-Élysées, sur la place et aux abords de l'Élysée et des Tuileries.
– Diable! grommela M. Ducoudray, voilà beaucoup de soldats!..
L'impression désagréable qu'il en ressentit devint décidément fâcheuse lorsqu'il se fut approché d'un groupe qui s'était formé au coin de la rue Castiglione, devant une affiche qu'on venait de placarder.
Un jeune homme, l'œil enflammé et la parole vibrante d'indignation, racontait ce qui était advenu la veille de la tentative de résistance des représentants réunis à la mairie du Xe arrondissement.
– Ils étaient au moins trois cents, disait-il… S'étant constitués, ils venaient de décréter la déchéance du président et de nommer le général Oudinot commandant en chef des troupes, quand un officier, un sous-lieutenant de chasseurs à pied, se présente et les somme de se disperser… Ils refusent, ils déclarent qu'ils ne céderont qu'à la force… Aussitôt la salle des délibérations est envahie par des agents et des soldats, qui empoignent les représentants du peuple et les traînent à la caserne du quai d'Orsay, où ils sont prisonniers…
Il fut interrompu par un sergent de ville, qui, d'une voix rude, cria:
– Dispersez-vous!.. Les rassemblements sont défendus!..
Cela indigna M. Ducoudray.
– Pourquoi donc colle-t-on des affiches, objecta-t-il, s'il est interdit de s'arrêter pour les lire…
– Vous, le vieux, prononça l'agent, je vous engage à filer, sinon!..
Sinon quoi? Il accompagnait sa menace d'un si terrible coup d'œil, que M. Ducoudray crut voir s'entr'ouvrir la porte des cachots…
Il fila…
Et, tout en hâtant le pas, il réfléchissait qu'il serait peut-être prudent de remettre à un autre jour sa visite à Montmartre…
Oui, mais que penserait Mme Delorge en le voyant revenir si vite, et que lui dirait-il?.. Ce n'est pas qu'un mensonge fût bien difficile à inventer; mais cette veuve d'un soldat renommé pour son courage devait priser la bravoure et être sensible à des dangers courus à son service.
Il continua donc sa route, et ne tarda pas à arriver au boulevard.
L'agitation y était sensible, bien que sourde encore et contenue. Beaucoup de boutiques n'étaient qu'entr'ouvertes, comme il arrive à Paris quand on s'attend à quelque chose.
De petites affiches manuscrites, appelant aux armes, étaient collées contre les arbres avec des pains à cacheter, et les passants s'arrêtaient pour les lire. Mais un sergent de ville passait, qui arrachait brutalement l'affiche, et tout était dit…
– C'est égal, pensait M. Ducoudray, ça chauffe… Ça sent la poudre!
Il ne se trompait pas.
Au moment où il arrivait à la hauteur de la rue Drouot, il fut croisé par plusieurs jeunes gens qui couraient en criant:
– Aux armes! On se bat au faubourg Saint-Antoine! Un représentant vient d'être tué!.. Aux armes!..
– Certainement ils ont raison! dit M. Ducoudray à un homme arrêté comme lui sur le boulevard…
L'autre ne répondit pas…
Un escadron de lanciers arrivait au grand trot du côté de la Madeleine… Bravement, M. Ducoudray se jeta rue Drouot.
Cette idée qu'on n'était peut-être pas en sûreté sur le boulevard lui rendait ses jambes de vingt ans, et c'est avec la rapidité d'une flèche qu'il franchit la rue Drouot, traversa le faubourg Montmartre et se mit à remonter les pentes roides de la rue des Martyrs et de la chaussée Clignancourt…
A mesure qu'il s'éloignait du centre, de ce forum sceptique et léger qu'on appelle le boulevard, l'émotion diminuait…
Les boutiquiers causaient sur le pas de leur porte, mais ils plaisantaient, riant d'un rire ironique. Les passants lisaient les affiches, mais ils haussaient les épaules…
Du moins, M. Ducoudray s'attendait à trouver Montmartre fort agité. Erreur. Jamais ce quartier, si impressionnable et si remuant, n'avait été plus calme. Et cependant, depuis le matin, Jules Bastide et le représentant Madier de Montjau couraient les ateliers et appelaient aux armes.
Cependant, M. Ducoudray arrivait rue Mercadet, à l'adresse indiquée par l'employé des écuries de l'Élysée…
C'était une vaste maison à cinq étages, qui, à en juger par le nombre des fenêtres, excessivement rapprochées les unes des autres, devait être divisée en une infinité de petits logements.
Un long couloir obscur et étroit, fort malpropre et très boueux, conduisait à la loge du portier, une véritable niche ménagée sous l'escalier.
Dans cette loge, une vieille femme était assise, surveillant l'ébullition d'un poêlon d'où s'échappaient des odeurs suspectes.
– Monsieur Laurent Cornevin, s'il vous plaît? demanda M. Ducoudray.
– Il ne doit pas être chez lui, répondit la portière, mais sa femme y est.
– Il est donc marié?
– Tiens! pourquoi donc pas? Oui, il est marié, et il a même cinq enfants, trois filles et deux garçons…
L'espoir que la femme saurait lui dire où trouver son mari décida le bonhomme.
– Indiquez-moi, s'il vous plaît, demanda-t-il, le logement de M. Cornevin.
– C'est au premier, répondit la portière… au premier, en descendant du ciel, bien entendu.
Et se penchant à la fenêtre de sa loge, qui ouvrait sur la cour:
– Ohé! m'ame Cornevin! cria-t-elle, d'une voix à érailler le crépi des murs, v'là un monsieur pour vous!
La précaution n'était pas inutile.
M. Ducoudray allait se perdre dans le dédale des corridors, lorsque Mme Cornevin arriva à son secours.
C'était une femme encore jeune, grande, bien faite, point jolie, mais en qui tout respirait la douceur et l'honnêteté.
Elle était pauvrement vêtue, mais très proprement, et tenait sur les bras un enfant de huit ou dix mois, joufflu et bien portant.
– Veuillez prendre la peine d'entrer, monsieur, dit-elle au digne bourgeois.
Il entra dans une petite pièce resplendissante de propreté, et alors seulement il s'aperçut que Mme Cornevin avait les yeux rouges de pleurs mal essuyés.
– Madame, commença-t-il, j'aurais à parler à votre mari pour une affaire de la plus haute importance et qui ne souffre aucun retard… Pouvez-vous me dire où je le rencontrerais?..
– Hélas! monsieur, je n'en sais rien moi-même.
M. Ducoudray tressaillit.
– Vous dites?.. fit-il.
– Je dis, monsieur, que je ne sais ce qu'il est devenu, répéta la pauvre femme.
Et incapable de maîtriser son chagrin:
– Il n'est pas rentré cette nuit, poursuivit-elle en fondant en larmes, et quoiqu'il ne fût pas de service, je n'étais pas très inquiète, pensant qu'il avait sans doute pris le tour d'un camarade. Cependant, dès qu'il a fait jour, j'ai couru à l'Élysée pour avoir de ses nouvelles. Ah! monsieur, ses camarades m'ont répondu qu'ils ne l'ont pas vu depuis trois jours!.. Un homme qui aime tant sa maison et ses enfants, si économe, si honnête, si bon!.. C'est la première fois qu'il se dérange depuis notre mariage!.. Mais non! ce n'est pas possible, il faut qu'il lui soit arrivé quelque malheur…
Le digne rentier était devenu plus blanc que sa chemise.
Entre la mort du général Delorge et la singulière disparition de Cornevin, seul témoin de cette mort mystérieuse, il découvrait un rapport frappant et peu fait pour rassurer.
Cependant, il s'efforça de dissimuler sa terrible émotion, et d'une voix qui n'était pas trop altérée:
– Voyons, voyons, ma chère dame, dit-il, ne vous désolez pas ainsi, que diable! Vous allez voir reparaître votre mari. Il se sera attardé avec quelque camarade.
– Impossible! monsieur. Tous ses camarades sont consignés depuis quarante-huit heures à l'Élysée…
– Alors, comment se fait-il qu'il se soit absenté?
– C'est justement ce que les autres se demandent…
M. Ducoudray se le demandait aussi, et il sentait en même temps un frisson courir le long de son échine. Un crime avait été commis… n'en avait-on pas commis un second pour cacher le premier?
– Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois, madame? interrogea-t-il.
– Hier matin. Nous avons déjeuné ensemble, et après, il s'est habillé en me disant qu'il avait une commission à faire du côté de Passy.
– Et il ne vous a pas dit quelle sorte de commission?
– Non. Je sais seulement qu'il voulait voir la femme d'un général, et que c'était pour quelque chose de très grave.
Elle fut interrompue par l'entrée de deux petits garçons, l'un de huit ans, l'autre de dix, qui arrivaient en chantant et en se bousculant, mais qui se découvrirent poliment dès qu'ils aperçurent un étranger.
C'étaient les deux aînés de Mme Cornevin. Elle parut fort surprise de les voir, et d'un air sévère:
– Que venez-vous faire ici à cette heure? demanda-t-elle. Comment êtes-vous sortis de l'école?..
– Le maître nous a renvoyés.
– Renvoyés! pourquoi?
– Ah! voilà! Il nous a dit comme cela: Allez-vous-en tous, et rentrez bien vite chez vous, parce qu'il va y avoir une révolution.
Mme Cornevin pâlit. Bien qu'elle fût allée à l'Élysée le matin, elle ne savait rien, on ne lui avait rien dit.
– Une révolution!.. murmura-t-elle. On va se battre et je ne sais pas où est Laurent!..
– S'occupait-il donc de politique? interrogea M. Ducoudray.
– Lui? monsieur! Ah! jamais de la vie! Il ne songeait, le cher homme, qu'à travailler pour les enfants et pour moi!..
De sa vie, le digne bourgeois ne s'était senti plus mal à l'aise. Mille appréhensions vagues et sinistres l'assaillaient. Ce logis lui semblait affreusement dangereux, le plancher lui brûlait les pieds.
– Je ne veux pas vous importuner davantage, dit-il à la pauvre femme, je repasserai demain, et croyez-moi, M. Cornevin sera rentré…
Mais comme de raison, elle lui demanda son nom, pour le répéter à son mari.
Il frémit à cette demande. Donner son nom!.. Ne serait-ce pas une imprudence énorme?
Il rentra donc son portefeuille d'où il s'apprêtait à tirer sa carte, et saisissant le premier nom qui se présenta à sa mémoire:
– Dites à votre mari, madame, répondit-il, que c'est M. Krauss qui est venu le visiter.
Ce n'était pas précisément héroïque, ce que faisait là le digne bourgeois, mais la tête n'y était plus.
Cette idée que peut-être Cornevin avait été supprimé parce qu'il possédait un secret dont lui, Ducoudray, se trouvait dépositaire, cette idée lui donnait la chair de poule.
Et tout en descendant l'escalier, il récapitulait tous les moyens connus de se débarrasser d'un homme, depuis le coup d'épée d'un spadassin bien payé jusqu'au poison subtilement glissé dans le potage par une cuisinière séduite à prix d'or.
– Brrr!.. faisait-il, brrr!..
Songeant qu'à la suite des grands meneurs du coup d'État, Morny, Maupas, Saint-Arnaud, Magnan, il avait entendu nommer le vicomte de Maumussy, le comte de Combelaine, et M. Coutanceau même, qui passait pour avoir mis sa fortune au service du prince-président.
Cependant, une fois hors de la maison, il respira plus librement, et le grand air, la marche et le mouvement de la rue produisant leur effet, il ne tarda pas à se reprocher d'avoir peut-être cédé à des craintes exagérées.
D'un autre côté, le succès du coup d'État ne lui semblait rien moins qu'assuré.
Plus il se rapprochait du centre de Paris, plus la fermentation s'accentuait. Les quartiers de la rue des Martyrs et du faubourg Montmartre, si calmes lorsqu'il les avait traversés, commençaient à s'agiter.
L'indignation succédait à la dédaigneuse indifférence du premier moment, et tout semblait annoncer une lutte prochaine.
On s'assemblait et on battait des mains devant les affiches des divers comités de résistance, affiches ardemment pourchassées par la police cependant, et qui toutes résumaient la même idée en des termes presque identiques:
«La constitution est violée… Louis-Napoléon s'est mis lui-même hors la loi… Aux armes!..»
Parfois, un homme passait, un fusil sur l'épaule, qui criait:
– Venez, citoyens, venez!.. On se bat rue de Rambuteau.
Au bruit de ces paroles, M. Ducoudray s'animait peu à peu, comme un vieux cheval au son de ses grelots.
– Décidément, ça marche, pensait-il, ça marche!..
Mais c'était bien autre chose vraiment sur le boulevard.
La foule, de moment en moment, y devenait plus compacte et plus animée. A tous les coins de rue, et jusque sur le milieu de la chaussée, des groupes se formaient. Sur les chaises des cafés, des orateurs improvisés montaient, qui lisaient le décret de déchéance prononcé par l'assemblée du Xe arrondissement, ou l'arrêt de mise en accusation de Louis-Napoléon Bonaparte par la haute cour de justice…
Des escouades de sergents de ville, l'épée à la main, circulaient à travers cette cohue, appuyés par des hommes de mauvaise mine, en bourgeois et armés de casse-tête et de bâtons…
Les mêmes cris les accueillaient partout:
– Vive la Constitution! A bas Soulouque!..
Sur la chaussée, les pelotons de cavalerie se succédaient.
La foule s'ouvrait pour laisser passer les chevaux, et se reformait derrière eux aux cris de:
– Vive la République! Vive l'armée!..
La fièvre commençait à gagner M. Ducoudray… Il n'avait plus peur; le bourgeois des glorieuses journées de Juillet se réveillait en lui. Il oubliait Passy, Mme Delorge, son ami le général et M. de Combelaine.
– Il faut que je voie la fin de tout ceci! se dit-il.
Et il entra pour déjeuner dans un café du boulevard des Italiens.
Là, les nouvelles affluaient; vraies ou fausses, absurdes parfois, mais toutes et toujours favorables à la résistance.
On affirmait que les meneurs du coup d'État commençaient à perdre la tête… que M. de Maupas tremblait de peur à la préfecture de police… que le général Magnan hésitait… que Lamoricière venait de s'évader et de se mettre à la tête de quatre régiments…
On assurait que dans les cours de l'Élysée, quatre voitures de poste venaient d'être attelées pour emporter bien vite et bien loin le président et ses complices… et quelques millions, ajoutaient les bien informés…
En vrai Parisien qu'il se vantait d'être, l'excellent M. Ducoudray buvait comme du lait toutes ces nouvelles, les tenant pour assurées, puisqu'elles flattaient ses espérances et ses instincts.
Et il n'était pas éloigné de croire le coup d'État décidément tombé dans l'eau, quand il sortit du restaurant, tout disposé à l'optimisme, tel qu'un homme qui, ayant bien déjeuné, vit en paix avec son estomac.
Il ne tarda pas à reconnaître son erreur.
Pendant le temps qu'il avait mis à prendre son repas, la mobile physionomie du boulevard avait changé.
La foule y était plus compacte, s'il est possible, mais grave, désormais, et presque silencieuse. Plus de rires, plus de quolibets. Plus de ces cris de: «A bas Soulouque!» qui avaient fait ouvrir de si grands yeux aux soldats de la ligne.
Évidemment, la situation s'était tendue.
On eût dit que chacun comprenait que l'instant décisif arrivait où les plus grands événements ne tiennent qu'à un fil, qu'on en était à cette minute suprême d'où dépendent les opérations les mieux combinées.
Les hommes à bâton, les décembrailliards, comme on les appelait alors, avaient disparu du trottoir. Mais les escadrons de lanciers étaient plus nombreux sur la chaussée. Ils ne cessaient d'aller et de venir de la Madeleine à la Bastille, maintenant en communication les troupes des Champs-Élysées et celles qui occupaient les quartiers du Temple et de l'Hôtel-de-Ville…
– Se bat-on quelque part? interrogeait de ci et de là M. Ducoudray.
– Oui. Il y a des barricades rue Transnonain, rue Beaubourg et rue Grenetat.
– Et c'est la police qui les fait faire, ajoutait un voisin.
Positivement l'estimable bourgeois commençait à ressentir quelque chose de son malaise du matin, lorsque tout à coup, vers quatre heures, circula à travers cette foule immense une rumeur profonde, rapide comme le frisson d'une décharge électrique.
– Qu'est-ce encore? demanda M. Ducoudray à deux jeunes gens qu'il coidoyait.
– La proclamation de Saint-Arnaud. L'avez-vous lue?
– Non. Où la lit-on?
– Au coin de toutes les rues, parbleu!
Le digne rentier se trouvait à la hauteur du faubourg Poissonnière. Il tourna la première rue qu'il rencontra, et, au milieu des clameurs indignées de deux cents personnes rassemblées devant une affiche, il lut:
«Habitants de Paris,
Le ministre de la guerre,
Vu la loi sur l'état de siège,
Décrète:
Tout individu pris construisant ou défendant une barricade, ou les armes à la main, sera fusillé.
Le général de division, ministre de la guerre,
LE ROY DE SAINT-ARNAUD.»
C'était bref, précis et significatif.
C'était en six lignes toute la politique du coup d'État du 2 décembre 1851.
– Oh! faisait M. Ducoudray consterné et révolté: oh!..
Et cependant, bien loin d'éteindre la résistance, cette menaçante proclamation semblait l'attiser.
– C'est ce qu'on veut, ricanait un homme à barbe blanche; il faut bien un prétexte pour engager les troupes!..
Presque au même moment, et comme pour lui donner raison, une violente fusillade pétilla dans la direction du quartier des Gravilliers.
Et peu après, un jeune homme passa haletant, qui criait:
– C'est rue Aumaire, et on se cogne dur, allez; je vais chercher un fusil.
Plus d'un devait avoir eu la même idée, car deux pas plus loin, M. Ducoudray vit un boutiquier fermer ses volets, et écrire dessus à la craie: «Armes données.»
Pourtant la nuit était venue, la fusillade s'éteignait peu à peu, on n'entendait plus que des coups de feu isolés…
A force de jouer des coudes dans la cohue qui roulait à plein trottoir, le digne rentier était arrivé au Château-d'Eau, lorsque soudain un cri terrible sortit de mille poitrines à la fois, immédiatement suivi d'un sourd roulement… et il se trouva entraîné par un irrésistible remous de la foule…
Une femme dont le chapeau avait été arraché, et qui traînait une petite fille, s'accrochait à lui désespérément en criant:
– Au nom du ciel! sauvez mon enfant!
Il essaya de lui porter secours, mais un choc violent le jeta contre un arbre, un tourbillon passa devant lui, et il vit luire au-dessus de sa tête l'éclair d'un sabre… Il ferma les yeux.
Quand il les rouvrit, plus rien.
Le terrain était vide autour de lui, la foule fuyait éperdue dans toutes les directions, et quelques hommes ramassaient les blessés restés sur le carreau.
Les lanciers avaient chargé.
– Ah! cela ne se passera pas ainsi, grondait le digne bourgeois en crispant les poings, et demain… demain!..
Tout, en effet, pour lui qui connaissait si bien son Paris, présageait pour le lendemain une journée de revanche.
Jamais mouvement révolutionnaire ne lui avait paru si accentué ni si puissant que celui qui se prononçait en cette soirée du 2 décembre 1851.
A tous les coins de toutes les rues qu'il traversait, des groupes se formaient, sombres, menaçants, d'où s'élevaient tantôt la voix d'un orateur, tantôt de véhémentes protestations. Et ce n'était plus seulement la bourgeoisie qui se révoltait, les blouses se mêlaient aux paletots, et les mains calleuses serraient les mains gantées. Puis, de distance en distance des ébauches de barricades s'élevaient…
Mais sa hâte était grande de retrouver Mme Delorge, et un fiacre étant venu à passer, vide, il le prit…