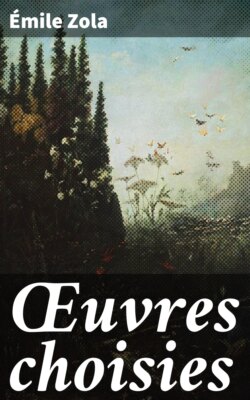Читать книгу Œuvres choisies - Emile Zola - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеQuinze jours plus tard, la famille Rostand partait pour la Blancarde. L’avoué devait attendre les vacances des tribunaux, et d’ailleurs le mois de septembre était d’un grand charme, au bord de la mer. Les chaleurs finissaient, les nuits avaient une fraîcheur délicieuse.
La Blancarde ne se trouvait pas dans l’Estaque même, un bourg situé à l’extrême banlieue de Marseille, au fond d’un cul-de-sac de rochers, qui ferme le golfe. Elle se dressait au delà du village, sur une falaise; de toute la baie, on apercevait sa façade jaune, au milieu d’un bouquet de grands pins. C’était une de ces bâtisses carrées, lourdes, percées de fenêtres irrégulières, qu’on appelle des châteaux en Provence. Devant la maison, une large terrasse s’étendait à pic sur une étroite plage de cailloux. Derrière, il y avait un vaste clos, des terres maigres où quelques vignes, des amandiers et des oliviers consentaient seuls à pousser. Mais un des inconvénients, un des dangers de la Blancarde était que la mer ébranlait continuellement la falaise; des infiltrations, provenant de sources voisines, se produisaient dans cette masse amollie de terre glaise et de roches; et il arrivait, à chaque saison, que des blocs énormes se détachaient pour tomber dans l’eau avec un bruit épouvantable. Peu à peu, la propriété s’échancrait. Des pins avaient déjà été engloutis.
Depuis quarante ans, les Micoulin étaient mégers à la Blancarde. Selon l’usage provençal, ils cultivaient le bien et partageaient les récoltes avec le propriétaire. Ces récoltes étant pauvres, ils seraient morts de famine, s’ils n’avaient pas pêché un peu de poisson l’été. Entre un labourage et un ensemencement, ils donnaient un coup de filet. La famille était composée du père Micoulin, un dur vieillard à la face noire et creusée, devant lequel toute la maison tremblait; de la mère Micoulin, une grande femme abêtie par le travail de la terre au plein soleil; d’un fils qui servait pour le moment sur l’Arrogante, et de Naïs que son père envoyait travailler dans une fabrique de tuiles, malgré toute la besogne qu’il y avait au logis. L’habitation du méger, une masure collée à l’un des flancs de la Blancarde, s’égayait rarement d’un rire ou d’une chanson. Micoulin gardait un silence de vieux sauvage, enfoncé dans les réflexions de son expérience. Les deux femmes éprouvaient pour lui ce respect terrifié que les filles et les épouses du Midi témoignent au chef de la famille. Et la paix n’était guère troublée que par les appels furieux de la mère, qui se mettait les poings sur les hanches pour enfler son gosier à le rompre, en jetant aux quatre points du ciel le nom de Naïs, dès que sa fille disparaissait. Naïs entendait d’un kilomètre et rentrait, toute pâle de colère contenue.
Elle n’était point heureuse, la belle Naïs, comme on la nommait à l’Estaque. Elle avait seize ans, que Micoulin, pour un oui, pour un non, la frappait au visage, si rudement, que le sang lui partait du nez; et, maintenant encore, malgré ses vingt ans passés, elle gardait pendant des semaines les épaules bleues des sévérités du père. Celui-ci n’était pas méchant, il usait simplement avec rigueur de sa royauté, voulant être obéi, ayant dans le sang l’ancienne autorité latine, le droit de vie et de mort sur les siens. Un jour, Naïs, rouée de coups, ayant osé lever la main pour se défendre, il avait failli la tuer. La jeune fille, après ces corrections, restait frémissante. Elle s’asseyait par terre, dans un coin noir, et là, les yeux secs, dévorait l’affront. Une rancune sombre la tenait ainsi muette pendant des heures, à rouler des vengeances qu’elle ne pouvait exécuter. C’était Je sang même de son père qui se révoltait en elle, un emportement aveugle, un besoin furieux d’être la plus forte. Quand elle voyait sa mère, tremblante et soumise, se faire toute petite devant Micoulin, elle la regardait pleine de mépris. Elle disait souvent: «Si j’avais un mari comme ça, je le tuerais.»
Naïs préférait encore les jours où elle était battue, car ces violences la secouaient. Les autres jours, elle menait une existence si étroite, si enfermée, qu’elle se mourait d’ennui. Son père lui défendait de descendre à l’Estaque, la tenait à la maison dans des occupations continuelles; et, même lorsqu’elle n’avait rien à faire, il voulait qu’elle restât là, sous ses yeux. Aussi attendait-elle le mois de septembre avec impatience; dès que les maîtres habitaient la Blancarde, la surveillance de Micoulin se relâchait forcément. Naïs, qui faisait des courses pour madame Rostand, se dédommageait de son emprisonnement de toute l’année.
Un matin, le père Micoulin avait réfléchi que cette grande fille pouvait lui rapporter trente sous par jour. Alors, il l’émancipa, il l’envoya travailler dans une tuilerie. Bien que le travail y fût très dur, Naïs était enchantée. Elle partait dès le matin, allait de l’autre côté de l’Estaque et restait jusqu’au soir au grand soleil, à retourner des tuiles pour les faire sécher. Ses mains s’usaient à cette corvée de manœuvre, mais elle ne sentait plus son père derrière son dos, elle riait librement avec des garçons. Ce fut là, dans ce labeur si rude, qu’elle se développa et devint une belle fille. Le soleil ardent lui dorait la peau, lui mettait au cou une large collerette d’ambre; ses cheveux noirs poussaient, s’entassaient, comme pour la garantir de leurs mèches volantes; son corps, continuellement penché et balancé dans le va-et-vient de sa besogne, prenait une vigueur souple de jeune guerrière. Lorsqu’elle se relevait, sur le terrain battu, au milieu de ces argiles rouges, elle ressemblait à une amazone antique, à quelque terre cuite puissante, tout à coup animée par la pluie de flammes qui tombait du ciel. Aussi Micoulin la couvait-il de ses petits yeux, en la voyant embellir. Elle riait trop, cela ne lui paraissait pas naturel qu’une fille fût si gaie. Et il se promettait d’étrangler les amoureux, s’il en découvrait jamais autour de ses jupes.
Des amoureux, Naïs en aurait eu des douzaines, mais elle les décourageait. Elle se moquait de tous les garçons. Son seul bon ami était un bossu, occupé à la même tuilerie qu’elle, un petit homme nommé Toine, que la Maison des enfants trouvés d’Aix avait envoyé à l’Estaque, et qui était resté là, adopté par le pays. Il riait d’un joli rire, ce bossu, avec son profil de polichinelle. Naïs le tolérait pour sa douceur. Elle faisait de lui ce qu’elle voulait, le rudoyait souvent, lorsqu’elle avait à se venger sur quelqu’un d’une violence de son père. Du reste, cela ne tirait pas à conséquence. Dans le pays, on riait de Toine. Micoulin avait dit: «Je lui permets le bossu, je la connais, elle est trop fière!»
Cette année-là, quand madame Rostand fut installée à la Blancarde, elle demanda au méger de lui prêter Naïs, une de ses bonnes étant malade. Justement, la tuilerie chômait. D’ailleurs, Micoulin, si dur pour les siens, se montrait politique à l’égard des maîtres; il n’aurait pas refusé sa fille, même si la demande l’eût contrarié. M. Rostand avait dû se rendre à Paris, pour des affaires graves, et Frédéric se trouvait à la campagne seul avec sa mère. Les premiers jours, d’habitude, le jeune homme était pris d’un grand besoin d’exercice, grisé par l’air, allant en compagnie de Micoulin jeter ou retirer les filets, faisant de longues promenades au fond des gorges qui viennent déboucher à l’Estaque. Puis, cette belle ardeur se calmait, il restait allongé des journées entières sous les pins, au bord de la terrasse, dormant à moitié, regardant la mer, dont le bleu monotone finissait par lui causer un ennui mortel. Au bout de quinze jours, généralement, le séjour de la Blancarde l’assommait. Alors, il inventait chaque matin un prétexte pour filer à Marseille.
Le lendemain de l’arrivée des maîtres, Micoulin, au lever du soleil, appela Frédéric. Il s’agissait d’aller lever desjambins, de longs paniers à étroite ouverture de souricière, dans lesquels les poissons de fond se prennent. Mais le jeune homme fit la sourde oreille. La pêche ne paraissait pas le tenter. Quand il fut levé, il s’installa sous les pins, étendu sur le dos, les regards perdus au ciel. Sa mère fut toute surprise de ne pas le voir partir pour une de ces grandes courses dont il revenait affamé.
Tu ne sors pas? demanda-t-elle.
–Non, mère, répondit-il. Puisque papa n’est pas là, je reste avec vous.
Le méger, qui entendit cette réponse, murmura en patois:
Allons, monsieur Frédéric ne va pas tarder à partir pour Marseille.
Frédéric, pourtant, n’alla pas à Marseille. La semaine s’écoula, il était toujours allongé, changeant simplement de place, quand le soleil le gagnait. Par contenance, il avait pris un livre; seulement, il ne lisait guère; le livre, le plus souvent, traînait parmi les aiguilles de pins, séchées sur la terre dure. Le jeune homme ne regardait même pas la mer; la face tournée vers la maison, il semblait s’intéresser au service, guetter les bonnes qui allaient et venaient, traversant la terrasse à toutes minutes; et quand c’était Naïs qui passait, de courtes flammes s’allumaient dans ses yeux de jeune maître sensuel. Alors, Naïs ralentissait le pas, s’éloignait avec le balancement rythmé de sa taille, sans jamais jeter un regard sur lui.
Pendant plusieurs jours, ce jeu dura. Devant sa mère, Frédéric traitait Naïs presque durement, en servante maladroite. La jeune fille grondée baissait les yeux, avec une sournoiserie heureuse, comme pour jouir de ces fâcheries.
Un matin, au déjeuner, Naïs cassa un saladier. Frédéric s’emporta.
— Est-elle sotte! cria-t-il. Où a-t-elle la tête?
Et il se leva furieux, en ajoutant que son pantalon était perdu. Une goutte d’huile l’avait taché au genou. Mais il en faisait une affaire.
— Quand tu me regarderas! Donne-moi une serviette et de l’eau. Aide-moi.
Naïs trempa le coin d’une serviette dans une tasse, puis se mit à genoux devant Frédéric, pour frotter la tache.
— Laisse, répétait madame Rostand. C’est comme si tu ne faisais rien.
Mais la jeune fille ne lâchait point la jambe de son maître, qu’elle continuait à frotter de toute la force de ses beaux bras. Lui, grondait toujours des paroles sévères.
— Jamais on n’a vu une pareille maladresse. Elle l’aurait fait exprès que ce saladier ne serait pas venu se casser plus près de moi. Ah bien! si elle nous servait à Aix, notre porcelaine serait vite en pièces!
Ces reproches étaient si peu proportionnés à la faute, que madame Rostand crut devoir calmer son fils, lorsque Naïs ne fut plus là.
Qu’as-tu donc contre cette pauvre fille? On dirait que tu ne peux la souffrir. Je te prie d’être plus doux pour elle. C’est une ancienne camarade de jeu, et elle n’a pas ici la situation d’une servante ordinaire.
Eh! elle m’ennuie! répondit Frédéric, en affectant un air de brutalité.
Le soir même, à la nuit tombée, Naïs et Frédéric se rencontrèrent dans l’ombre, au bout de la terrasse. Ils ne s’étaient point encore parlé seul à seule. On ne pouvait les entendre de la maison Les pins secouaient dans l’air mort une chaude senteur résineuse. Alors, elle, à voixbasse, demanda, en retrouvant le tutoiement de leur enfance:
Pourquoi m’as-tu grondée, Frédéric?. Tu es bien méchant.
Sans répondre, il lui prit les mains, il l’attira contre sa poitrine, la baisa aux lèvres. Elle le laissa faire, et s’en alla ensuite, pendant qu’il s’asseyait sur le parapet, pour ne point paraître devant sa mère tout secoué d’émotion. Dix minutes plus tard, elle servait à table, avec son grand calme un peu fier.
Frédéric et Naïs ne se donnèrent pas de rendez-vous. Ce fut une nuit qu’ils se retrouvèrent sous un olivier, au bord de la falaise. Pendant le repas, leurs yeux s’étaient plusieurs fois rencontrés avec une fixité ardente. La nuit était très chaude, Frédéric fuma des cigarettes à sa fenêtre jusqu’à une heure, interrogeant l’ombre. Vers une heure, il aperçut une forme vague qui se glissait le long de la terrasse. Alors, il n’hésita plus. Il descendit sur le toit d’un hangar, d’où il sauta ensuite à terre, en s’aidant de longues perches, posées là, dans un angle; de cette façon, il ne craignait pas de réveiller sa mère. Puis, quand il fut en bas, il marcha droit à un vieil olivier, certain que Naïs l’attendait.
— Tu es là? demanda-t-il à demi-voix.
— Oui, répondit-elle simplement.
Et il s’assit près d’elle, dans le chaume; il la prit à la taille, tandis qu’elle appuyait la tête sur son épaule. Un instant, ils restèrent sans parler. Le vieil olivier, au bois noueux, les couvrait de son toit de feuilles grises. En face, la mer s’étendait, noire, immobile sous les étoiles. Marseille, au fond du golfe, était caché par une brume; à gauche, seul le phare tournant de Planier revenait toutes les minutes, trouant les ténèbres d’un rayon jaune, qui s’éteignait brusquement; et rien n’était plus doux ni plus tendre que cette lumière, sans cesse perdue à l’horizon, et sans cesse retrouvée.
— Ton père est donc absent? reprit Frédéric.
— J’ai sauté par la fenêtre, dit-elle de sa voix grave.
Ils ne parlèrent point de leur amour. Cet amour venait de loin, du fond de leur enfance. Maintenant, ils se rappelaient des jeux où le désir perçait déjà dans l’enfantillage. Cela leur semblait naturel, de glisser à des caresses. Ils n’auraient su que se dire, ils avaient l’unique besoin d’être l’un à l’autre. Lui, la trouvait belle, excitante avec son bâle et son odeur de terre, et elle, goûtait un orgueil de fille battue, à devenir la maîtresse du jeune maître. Elle s’abandonna. Le jour allait paraître, quand tous deux rentrèrent dans leurs chambres par le chemin qu’ils avaient pris pour en sortir.