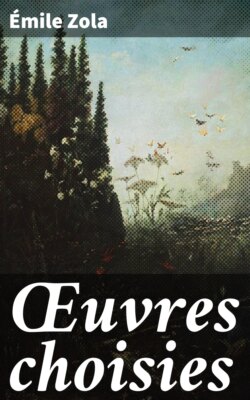Читать книгу Œuvres choisies - Emile Zola - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеSeptembre s’acheva. Après un violent orage, l’air avait pris une grande fraîcheur. Les jours devenaient plus courts, et Naïs refusait de rejoindre Frédéric la nuit, en lui donnant pour prétexte qu’elle était trop lasse, qu’ils attraperaient du mal, sous les abondantes rosées qui trempaient la terre. Mais, comme elle venait chaque matin, vers six heures, et que madame Rostand ne se levait guère que trois heures plus tard, elle montait dans la chambre du jeune homme, elle restait quelques instants, l’oreille aux aguets, écoutant parla porte laissée ouverte.
Ce fut l’époque de leurs amours où Naïs témoigna le plus de tendresse à Frédéric. Elle le prenait par le cou, approchait son visage, le regardait de tout près, avec une passion qui lui emplissait les yeux de larmes. Il semblait toujours qu’elle ne devait pas le revoir. Puis, elle lui mettait vivement une pluie de baisers sur le visage, comme pour protester et jurer qu’elle saurait le défendre.
— Qu’a donc Naïs? disait souvent madame Rostand. Elle change tous les jours.
Elle maigrissait en effet, ses joues devenaient creuses. La flamme de ses regards s’était assombrie. Elle avait de longs silences, dont elle sortait en sursaut, de l’air inquiet d’une fille qui vient de dormir et de rêver.
— Mon enfant, si tu es malade, il faut te soigner, répétait sa maîtresse.
Mais Naïs, alors, souriait.
— Oh! non, madame, je me porte bien, je suis heureuse. Jamais je n’ai été si heureuse.
Un matin, comme elle l’aidait à compter le linge, elle s’enhardit, elle osa la questionner.
— Vous resterez donc tard à la Blancarde, cette année?
— Jusqu’à la fin d’octobre, répondit madame Rostand.
Et Naïs demeura debout un instant, les yeux perdus; puis, elle dit tout haut, sans en avoir conscience:
— Encore vingt jours.
Un continuel combat l’agitait. Elle auraitvoulu garder Frédéric auprès d’elle, et en même temps, à chaque heure, elle était tentée de lui crier: Va-t’en! Pour elle, il était perdu; jamais cette saison d’amour ne recommencerait, elle se l’était dit dès le premier rendez-vous. Même, un soir de sombre tristesse, elle se demanda si elle ne devait pas laisser tuer Frédéric par son père, pour qu’il n’allât pas avec d’autres; mais la pensée de le savoir mort, lui si délicat, si blanc, plus demoiselle qu’elle, lui était insupportable; et sa mauvaise pensée lui fit horreur. Non, elle le sauverait, il n’en saurait jamais rien, il ne l’aimerait bientôt plus; seulement, elle serait heureuse de penser qu’il vivait.
Souvent, elle lui disait, le matin:
— Ne sors pas, ne vas pas en mer, l’air est mauvais.
D’autres fois, elle lui conseillait de partir.
— Tu dois t’ennuyer, tu ne m’aimeras plus. Va donc passer quelques jours à la ville.
Lui, s’étonnait de ces changements d’humeur. Il trouvait la paysanne moins belle, depuis que son visage se séchait, et une satiété de ces amours violentes commençait à lui venir. Il regrettait l’eau de Cologne et la poudre de riz des filles d’Aix et de Marseille.
Toujours, bourdonnaient aux oreilles de Naïs les mots du père: «Je le tuerai. Je le tuerai.» La nuit, elle s’éveillait en rêvant qu’on tirait des coups de feu. Elle devenait peureuse, poussait un cri, pour une pierre qui roulait sous ses pieds. A toute heure, quand elle ne le voyait plus, elle s’inquiétait de «monsieur Frédéric». Et, ce qui l’épouvantait, c’était qu’elle entendait, du matin au soir, le silence entêté de Micoulin répéter: «Je le tuerai.» Il n’avait plus fait une allusion, pas un mot, pas un geste; mais, pour elle, les regards du vieux, chacun de ses mouvements, sa personne entière disait qu’il tuerait le jeune maître à la première occasion, quand il ne craindrait pas d’être inquiété par la justice. Après, il s’occuperait de Naïs. En attendant, il la traitait à coups de pied, comme un animal qui a fait une faute.
–Et ton père, il est toujours brutal? lui demanda un matin Frédéric, qui fumait des cigarettes dans son lit, pendant qu’elle allait et venait, mettant un peu d’ordre.
–Oui, répondit-elle, il devient fou.
Et elle montra ses jambes noires de meurtrissures. Puis, elle murmura ces mots qu’elle disait souvent d’une voix sourde:
— Ça finira, ça finira.
Dans les premiers jours d’octobre, elle parut encore plus sombre. Elle avait des absences, remuait les lèvres, comme si elle se fût parlé tout bas. Frédéric l’aperçut plusieurs fois debout sur la falaise, ayant l’air d’examiner les arbres autour d’elle, mesurant d’un regard la profondeur du gouffre. A quelques jours de là, il la surprit avec Toine, le bossu, en train de cueillir des figues, dans un coin de la propriété. Toine venait aider Micoulin, quand il y avait trop de besogne. Il était sous le figuier, et Naïs, montée sur une grosse branche, plaisantait; elle lui criait d’ouvrir la bouche, elle lui jetait des figues, qui s’écrasaient sur sa figure. Le pauvre être ouvrait la bouche, fermait les yeux avec extase; et sa large face exprimait une béatitude sans bornes. Certes, Frédéric n’était pas jaloux, mais il ne put s’empêcher de la plaisanter.
— Toine se couperait la main pour nous, dit-elle de sa voix brève. Il ne faut pas le maltraiter, on peut avoir besoin de lui.
Le bossu continua de venir tous les jours à la Blancarde. Il travaillait sur la falaise, à creuser un étroit canal pour mener les eaux au bout du jardin, dans un potager qu’on tentait d’établir. Parfois, Naïs allait le voir, et ils causaient vivement tous les deux. Il fit tellement traîner cette besogne, que le père Micoulin finit par le traiter de fainéant et par lui allonger des coups de pied dans les jambes, comme à sa fille.
Il y eut deux jours de pluie. Frédéric, qui devait retourner à Aix la semaine suivante, avait décidé qu’avant son départ il irait donner en mer un coup de filet avec Micoulin. Devant la pâleur de Naïs, il s’était mis à rire, en disant que cette fois il ne choisirait pas un jour de mistral. Alors, la jeune fille, puisqu’il partait bientôt, voulut lui accorder encore un rendez-vous, la nuit. Vers une heure, ils se retrouvèrent sur la terrasse. La pluie avait lavé le sol, une odeur forte sortait des verdures rafraîchies. Lorsque cette campagne si desséchée se mouille profondément, elle prend une violence de couleurs et de parfums: les terres rouges saignent, les pins ont des reflets d’éineraude, les rochers laissent éclater des blancheurs de linges fraîchement lessivés. Mais, dans la nuit, les amants ne goûtaient que les senteurs décuplées des thyms et des lavandes.
L’habitude les mena sous les oliviers, Frédéric s’avançait vers celui qui avait abrité leurs amours, tout au bord du gouffre, lorsque Naïs, comme revenant à elle, le saisit par les bras, l’entraîna loin du bord, en disant d’une voix tremblante:
— Non, non, pas là!
— Qu’as-tu donc? demanda-t-il.
Elle balbutiait, elle finit par dire qu’après une pluie comme celle de la veille, la falaise n’était pas sûre. Et elle ajouta:
–L’hiver dernier, un éboulement s’est produit ici près.
Ils s’assirent plus en arrière, sous un autre olivier. Ce fut leur dernière nuit de tendresse. Naïs avait des étreintes inquiètes. Elle pleura tout d’un coup, sans vouloir avouer pourquoi elle était ainsi secouée. Puis, elle tombait dans des silences pleins de froideur. Et, comme Frédéric la plaisantait sur l’ennui qu’elle éprouvait maintenant avec lui, elle le reprenait follement, elle murmurait:
— Non, ne dis pas ça. Je t’aime trop. Mais, vois-tu, je suis malade. Et puis, c’est fini, tu vas partir. Ah! mon Dieu, c’est fini.
Il eut beau chercher à la consoler, en lui répétant qu’il reviendrait de temps à autre, et qu’au prochain automne, ils auraient encore deux mois devant eux: elle hochait la tête, elle sentait bien que c’était fini. Leur rendez-vous s’acheva dans un silence embarrassé; ils regardaient la mer, Marseille qui étincelait, le phare de Planier qui brûlait solitaire et triste; peu à peu, une mélancolie leur venait de ce vaste horizon. Vers trois heures, lorsqu’il la quitta et qu’il la baisa aux lèvres, il la sentit toute grelottante, glacée entre ses bras.
Frédéric ne put dormir. Il lut jusqu’au jour; et, enfiévré d’insomnie, il se mit à la fenêtre, dès que l’aube parut. Justement, Micoulin allait partir pour retirer ses jambins. Comme il passait sur la terrasse, il leva la tête.
Eh bien! monsieur Frédéric, ce n’est pas ce matin que vous venez avec moi? demanda-t-il.
Ah! non, père Micoulin, répondit le jeune homme, j’ai trop mal dormi. Demain, c’est convenu.
Le méger s’éloigna d’un pas traînard. Il lui fallait descendre et aller chercher sa barque au pied de la falaise, juste sous l’olivier où il avait surpris sa fille. Quand il eut disparu, Frédéric, en tournant les yeux, fut étonné de voir Toine déjà au travail; le bossu se trouvait près de l’olivier, une pioche à la main, réparant l’étroit canal que les pluies avaient crevé. L’air était frais, il faisait bon à la fenêtre. Le jeune homme rentra dans sa chambre pour rouler une cigarette. Mais, comme il revenait lentement s’accouder, un bruit épouvantable, un grondement de tonnerre, se fit entendre; et il se précipita.
C’était un éboulement. Il distingua seulement Toine qui se sauvait en agitant sa bêche, dans un nuage de terre rouge. Au bord du gouffre, le vieil olivier aux branches tordues s’enfonçait, tombait tragiquement à la mer. Un rejaillissement d’écume montait. Cependant, un cri terrible avait traversé l’espace. Et Frédéric aperçut alors Naïs, qui, sur ses bras raidis, emportée parun élan detout son corps, se penchait au-dessus du parapet de la terrasse, pour voir ce qui se passait au bas de la falaise. Elle restait là, immobile, allongée, les poignets comme scellés dans la pierre. Mais elle eut sans doute la sensation que quelqu’un la regardait, car elle se tourna, elle cria en voyant Frédéric:
— Mon père! mon père!
Une heure après, on trouva, sous les pierres, le corps de Micoulin mutilé horriblement. Toine, fiévreux, racontait qu’il avait failli être entraîné; et tout le pays déclarait qu’on n’aurait pas dû faire passer un ruisseau là-haut, à cause des infiltrations. La mère Micoulin pleura beaucoup. Naïs accompagna son père au cimetière, les yeux secs et enflammés, sans trouver une larme.
Le lendemain de la catastrophe, madame Rostand avait absolument voulu rentrer à Aix. Frédéric fut très satisfait de ce départ, en voyant ses amours dérangées par ce drame horrible; d’ailleurs, décidément, les paysannes ne valaient pas les filles. Il reprit son existence. Sa mère, touchée de son assiduité près d’elle à la Blancarde, lui accorda une liberté plus grande. Aussi passa-t-il un hiver charmant: il faisait venir des dames de Marseille, qu’il hébergeait dans une chambre louée par lui, au faubourg; il découchait, rentrait seulement aux heures où sa présence était indispensable, dans le grand hôtel froid de la rue du Collège; et il espérait bien que son existence coulerait toujours ainsi.
A Pâques, M. Rostand dut aller à la Blancarde. Frédéric inventa un prétexte pour ne pas l’accompagner. Quand l’avoué revint, il dit, au déjeuner:
— Naïs se marie.
— Bah! s’écria Frédéric stupéfait.
— Et vous ne devineriez jamais avec qui, continua M. Rostand. Elle m’a donné de si bonnes raisons.
Naïs épousait Toine, le bossu. Comme cela, rien ne serait changé à la Blancarde. On garderait pour méger Toine, qui prenait soin de la propriété depuis la mort du père Micoulin.
Le jeune homme écoutait avec un sourire gêné. Puis, il trouva lui-même l’arrangement commode pour tout le monde.
— Naïs est bien vieillie, bien enlaidie, reprit M. Rostand. Je ne la reconnaissais pas. C’est étonnant comme ces filles, au bord de la mer, passent vite. Elle était très belle, cette Naïs.
— Oh! un déjeuner de soleil, dit Frédéric, qui achevait tranquillement sa côtelette.