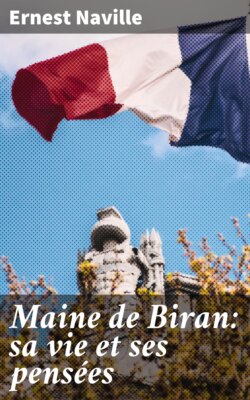Читать книгу Maine de Biran: sa vie et ses pensées - Ernest Naville - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Maine de Biran dans le département de la Dordogne. —1803 à 1812—
ОглавлениеRédaction de Mémoires couronnés par divers corps savants
de l’Europe.—Fonctions administratives.
Les débuts de M. de Biran dans la carrière de la publicité philosophique, et le coup dont il avait été frappé dans ses affections forment un point d’arrêt naturel dans le récit de ses destinées. Ces deux circonstances, de natures très-diverses, eurent un même résultat: elles contribuèrent l’une et l’autre à lui faire poursuivre avec une nouvelle ardeur ses études commencées. L’Institut venait de mettre au concours la question de la Décomposition de la pensée. L’auteur couronné du Mémoire sur l’habitude trouva dans un premier succès les encouragements nécessaires pour aborder un sujet capable d’effrayer une intelligence timide. D’autre part, son propre témoignage établit qu’en s’imposant un long et difficile labeur, il obéit au besoin de trouver dans des recherches sérieuses et ayant un but immédiat, une diversion à sa cuisante douleur. Un travail persévérant sur la question proposée développa ses vues personnelles au degré nécessaire pour lui faire comprendre qu’il était loin, en réalité, de suivre les traces des hommes qu’il avait nommés ses maîtres. Les germes déposés dans le Mémoire sur l’habitude avaient pris tout leur accroissement, et l’écrivain s’était compris lui-même plutôt qu’il n’avait changé de direction. C’était un changement toutefois, et, à ne pas regarder les choses de près, un changement complet. Les doctrines explicitement soutenues dans le Mémoire sur la décomposition de la pensée étaient de telle nature que Cabanis et Destutt de Tracy ne purent méconnaître dans l’homme qui ne cessait pas d’être leur ami, un philosophe prenant place au nombre de leurs antagonistes. Le Mémoire cependant remporta le prix, et bientôt après, le 1er frimaire an XIV (22 novembre 1805), l’auteur fut agrégé à l’Institut en qualité de membre correspondant de la classe d’histoire et de littérature ancienne; la classe des sciences morales et politiques venait d’être supprimée. Ainsi que l’a remarqué M. Cousin, il est honorable pour les juges qui, en 1802, avaient couronné leur disciple dans l’auteur du Mémoire sur l’habitude, d’avoir su, en 1805, rendre une justice éclatante «au nouveau mémoire qui sous les formes les plus polies leur annonçait un adversaire.»
Les idées fondamentales du Mémoire sur la décomposition de la pensée, remaniées dans une rédaction nouvelle, devinrent la base d’un Mémoire sur l’aperception immédiate qui obtint, en 1807, un accessit accompagné de la mention la plus honorable à un concours ouvert par l’Académie de Berlin. Ces mêmes idées, développées dans quelques-unes de leurs applications spéciales, fournirent un Mémoire sur les rapports du physique et du moral de l’homme, qui remporta, en 1811, un prix proposé par l’Académie de Copenhague.
Maine de Biran était exempt à un degré rare des séductions de la vanité littéraire. Fort sensible aux marques de bienveillance et à l’opinion que pouvaient avoir de lui les personnes avec lesquelles il se trouvait dans un contact immédiat, sa nature ne le portait pas à se préoccuper beaucoup de l’opinion à distance; l’affection et l’estime de ses alentours répondaient bien mieux aux inclinations naturelles de son cœur que les lointains échos de la gloire. Ses recherches philosophiques d’ailleurs avaient un caractère si parfaitement sérieux, si intime, si personnel, qu’elles demeurèrent toujours étrangères à la préoccupation d’un effet à produire au dehors. Il était trop bien en face de lui-même, lorsqu’il scrutait les secrets de notre nature, pour admettre en tiers, dans ses entretiens intimes, la pensée des jugements du public. Il est impossible cependant qu’il n’ait pas senti, et assez vivement, ce qu’il y avait de particulièrement flatteur dans ses succès répétés. Il avait été deux fois couronné par l’Institut de France; il remportait les suffrages du premier corps savant de l’Allemagne à une époque où ce pays, sons l’influence de Kant, était entré dans une voie qu’un abîme séparait de la culture intellectuelle de la France de Condillac; l’Académie de Copenhague lui offrait enfin, comme les Académies de Paris et de Berlin, un gage éclatant de son estime. Le suffrage commun de juges si divers ne pouvait s’expliquer ni par une faveur personnelle, ni par des sympathies acquises d’avance aux doctrines de l’écrivain; le succès obtenu n’était à aucun degré un succès de complaisance. On ne pouvait pas non plus en faire honneur au charme dont une plume particulièrement éloquente aurait su revêtir des idées d’une médiocre valeur. C’était donc bien le fond de sa pensée qui valait à M. de Biran l’approbation des philosophes français et étrangers; ce qu’on appréciait dans ses écrits, c’était bien ce qui en faisait le mérite à ses propres yeux: ses découvertes dans l’exploration de la nature humaine. Un penseur isolé qui voyait les méditations, filles de sa solitude, recevoir un semblable accueil dans les grands foyers de la culture scientifique de l’Europe, dut éprouver une vive et légitime jouissance. Mais ce que Maine de Biran désirait trouver avant tout dans ses couronnes académiques, ce n’était pas une satisfaction d’amour-propre, c’était la preuve que ses théories avaient des bases solides et une sérieuse part de vérité. L’approbation de tant de juges compétents était bien de nature à accroître sa confiance dans les motifs qui l’avaient porté à rompre avec l’école de Condillac. C’est cette rupture dont il convient de faire comprendre maintenant la nature et la portée.
Le dernier mot de l’école sensualiste française se trouve dans cette définition de Saint-Lambert: «L’homme est une masse organisée qui reçoit l’esprit de tout ce qui l’environne et de ses besoins.» Supprimez les impressions diverses qu’il doit aux sens extérieurs, et les appétits qui naissent du jeu des fonctions organiques, vous lui enlevez par là même toutes ses idées et toutes ses volontés. Tout ce qui est en lui est sensation pure ou sensation transformée. Considéré dans sa nature propre, il n’est rien qu’une table rase, une simple capacité de sentir. Telle est la thèse que M. de Biran attaquait déjà sans s’en rendre compte dans le Mémoire sur l’habitude, et qu’il combat expressément dans ses écrits postérieurs. Voici la marche générale de son argumentation.
Je conviens, dit-il à ses adversaires, que les impressions faites sur les organes des sens sont une condition indispensable de la connaissance du monde extérieur. Pour qu’un objet soit vu, il faut bien qu’il se trouve à portée de notre regard; un corps n’est touché que lorsqu’il est pressé par nos mains: ceci n’est pas matière à contestation. Je vous accorde bien aussi, ou plutôt je m’empresse de constater avec vous que nos besoins, nos désirs, nos penchants vont se rattacher, comme à leur origine première, soit aux fonctions de la machine organisée, soit à l’attrait que peuvent nous inspirer des objets extérieurs qui sont devenus pour nous des causes de jouissance. J’ai mangé, sous l’empire de la faim, un fruit dont la saveur est agréable; je vois un fruit pareil,—je le désire, je me meus pour m’en emparer; le plaisir que j’éprouve de nouveau redouble le penchant développé déjà par une première expérience. Il y a bien dans ces faits et dans tous les faits analogues un ensemble parfaitement coordonné d’impressions, d’appétits et de mouvements; il y a bien là une vie toute passive dans son principe; mais cette vie est-elle la vie totale de l’homme? Vous l’affirmez; je le nie.
Commençons par les faits relatifs à la connaissance. Je trouve dans mon esprit des pensées qui n’ont pu manifestement me parvenir par l’intermédiaire des sens. Je vois de mes yeux un corps changer de place, et j’entends de mes oreilles le bruit qu’occasionne son mouvement; mais ni la vue ni l’ouïe ne peuvent être l’origine de l’idée de cause que j’associe à ce fait, lorsque je dis et sais que le mouvement dont je suis le témoin a très-certainement une cause. Bien d’autres idées sont dans le même cas. Sans prendre mes exemples dans les sciences métaphysiques, que vous traitez de chimères, tout géomètre saura vous dire que le triangle dont il démontre les propriétés est un triangle que l’esprit conçoit, mais qui ne tombe pas sous les sens. Outre les idées qui se rapportent aux objets sensibles, il est donc une foule d’autres idées dont vous chercheriez en vain, dans votre point de vue, à expliquer la nature, bien que vous soyez réduits à en faire usage comme nous, en dépit de votre théorie. Mais voici le point capital. A vous entendre, il suffit qu’un objet soit devant nos yeux pour être vu, qu’un son frappe notre oreille pour être entendu. J’observe cependant que je vois plus ou moins, toutes les circonstances restant les mêmes au dehors, en vertu d’un fait purement intérieur. Si je donne toute mon attention, je vois distinctement. Mon regard devient-il indécis? ma vue est vague. Tombé-je dans une rêverie profonde? je ne vois plus, et les mêmes tableaux cependant continuent à se peindre sur ma rétine. La sensation et l’impression organique, qui en est pour vous la condition unique et suffisante, sont donc bien loin d’expliquer le fait de la connaissance, puisque la connaissance même du monde matériel défie vos explications.
Votre théorie de la volonté a le même sort. Le besoin et le plaisir que nous avons éprouvés créent en nous des désirs, et ces désirs nous sollicitent à agir pour les satisfaire; qui en doute? Mais c’est bien vainement que vous pensez trouver dans cette sollicitation l’origine de la volonté. La volonté cède souvent au désir, mais parfois aussi elle lui résiste; et, soit qu’elle lui cède, soit qu’elle lui résiste, elle n’en est pas moins une force autre, une force absolument différente. Est-ce un attrait, né des jouissances sensibles, qui relient sur un brasier ardent la main de Mucius Scévola? Comment vous accorder que la jouissance qui porte à braver la douleur est de la même nature que l’entraînement naturel qui nous pousse à l’éviter? Ne parlons pas des héros. La vie de l’homme de bien n’est-elle pas une lutte prolongée contre la sollicitation des joies sensibles? Après vous être mis hors d’état d’expliquer l’origine de la connaissance, vous vous rendez encore incapables de rendre compte des actions d’un honnête homme.
Vous parlez sans cesse d’une sensation qui se transforme. Mais quel est, je vous prie, le principe transformateur? L’animal voit, entend, goûte comme nous; comme nous il éprouve la faim et la soif. Pourquoi donc ses sensations ne se transforment-elles pas comme les nôtres? N’est-il pas évident que sous ce terme vague de transformation vous admettez au fond une sorte de vertu magique qui modifie, à l’usage de l’homme exclusivement, le résultat de ces impressions organiques qui lui sont communes avec l’animal? Il manque donc à votre analyse de la nature humaine un élément et un élément capital. Vos transformations, que rien n’explique, ne sont qu’un moyen de masquer la lacune énorme de votre théorie. Quand le jour paraît, les ténèbres ne se transforment pas en lumière, mais le soleil se lève. Il doit y avoir aussi quelque soleil intérieur, quelque principe méconnu par vous, qui d’un être purement sensitif fait un homme.
Ce principe, je le cherche, et une observation attentive me le fait découvrir. Aussi longtemps que je me sens exister, que j’ai la conscience de moi-même, j’ai, en même temps, la conscience d’exercer une action. J’agis et j’agis continuellement: c’est même parce qu’il est continuel, et, en conséquence, voilé par une habitude profonde, que ce fait fondamental de ma nature m’était d’abord caché. Mais, en y regardant de plus près, je m’aperçois qu’une activité dont je me sais le principe, une activité dont je dispose librement, est le fond même de mon existence. L’action des objets extérieurs tend sans cesse à me faire oublier mon action propre, mais je ne vois pas sans regarder en quelque mesure, je n’entends pas sans écouter jusqu’à un certain point, je ne me connais, je ne suis moi que par mon activité, et, comme je me sens intimement uni à un organisme qui m’obéit en me résistant, mon activité est toujours un effort[23]. L’effort baisse-t-il en degré? la conscience que j’ai d’exister devient plus faible; en même temps les impressions des objets deviennent vagues, et je cède de plus en plus aux sollicitations des causes étrangères de peine ou de plaisir. L’effort est-il entièrement suspendu? je tombe dans l’état de sommeil; une vie obscure persiste, les impressions des objets extérieurs se révèlent encore par les mouvements instinctifs qu’elles suscitent; mais le moi, la personne intelligente et morale, a disparu pour faire place à l’animal qui demeure seul[24]. L’activité, en se réveillant, réveille la conscience, et plus l’effort croît en énergie, plus les connaissances deviennent claires et distinctes, plus aussi les penchants rentrent sous le joug de la volonté.
Il y a donc dans l’homme deux éléments parfaitement distincts, et non un seul élément qui se transforme. Vous essayez inutilement de rapporter à une source unique les faits de deux vies diverses, l’une passive, l’autre active. L’activité, voilà le principe transformateur qui vous manque. Ne me demandez pas quelle est l’essence de l’homme considéré dans la totalité de son être, puisque l’homme est profondément double à mes yeux, puisque sa vie complète est pour moi le résultat de deux forces différentes. Cependant, s’il me fallait répondre à cette question, je n’hésiterais pas à dire que l’essence de l’homme est la volonté, et non point une simple capacité passive, une pure réceptivité. A titre d’être sensitif, l’homme possède tous les éléments de l’animalité, mais ce n’est qu’en tant qu’il agit, qu’il veut, qu’il est homme: là est l’élément vraiment caractéristique de sa nature spéciale. Le sens commun et le langage déposent ici en ma faveur: lorsque nous disons moi, c’est avec notre volonté que nous nous identifions, et la formule, si souvent usitée en parlant d’un penchant: «Cela est plus fort que moi», exprime très-nettement la séparation de cet élément passif qui fait partie de notre nature, et de l’élément actif qui nous constitue expressément.
C’est à cet élément, c’est à l’effort qu’il faut rapporter, comme à leur source commune, la science et la moralité.
Sans l’attention qui distingue et classe les faits confusément présents à nos sens, nous ne connaissons réellement rien. Or, l’attention n’est autre chose que la volonté même en exercice. Il y a plus: la science vraie n’est pas tant celle des phénomènes qui se succèdent autour de nous, changent et varient sans cesse, que la science des causes qui les produisent; des lois unes qui président à leur variété infinie. Or, les idées de cause, d’unité, et toutes les notions immatérielles ne procèdent pas du dehors; nous les trouvons en nous-mêmes. J’accorde que ces notions ne sont pas innées, elles supposent une expérience, mais une expérience purement intérieure, celle de notre existence personnelle. Je suis cause de mes actes, je demeure un et identique dans la puissance propre qui me constitue au sein des mille modifications de la nature sensitive: c’est à cette source, c’est dans le fait du moi causal, un, identique, que nous puisons, pour les appliquer ensuite au dehors, ces notions fondamentales, base de toute science. Toute idée supra-sensible ne vient pas du monde à l’homme, mais est puisée dans l’homme intérieur qui en est le type primitif, pour être transportée dans le monde. Il en résulte que c’est en nous séparant des impressions sensibles, par une réflexion qui a la volonté pour principe, que c’est en rentrant dans le sanctuaire intérieur de la conscience, que nous sommes en présence des éléments réels d’une science digne de ce nom.
La moralité a la même condition. Suivre toutes les impulsions de la sensibilité, s’abandonner à tous ses instincts, à tous ses penchants, c’est se dégrader, c’est se ravaler au rang de l’animal; lutter, au contraire, contre les sollicitations du dehors, en triompher par l’énergie de la volonté, c’est accomplir sa destinée, c’est faire son métier d’homme. La science et la vertu sont au prix d’une même lutte; la lutte de la puissance proprement humaine contre les impulsions d’une nature animale.
Telles sont les pensées développées par M. de Biran dans divers mémoires. Fortement indiquée déjà dans le travail sur la Décomposition de la pensée, sa lutte contre le sensualisme devient plus nette et plus ferme à mesure qu’il avance. Aucun des écrits couronnés à Paris, à Berlin et à Copenhague ne fut donné au public[25]. L’auteur avait reçu à cet égard les invitations les plus flatteuses. Mais avant de produire ses doctrines au grand jour de la publicité, il voulait les exposer avec tout le soin possible, et sous la forme la plus propre à les faire accepter. Dans cette intention, il s’affranchit des barrières que lui avaient imposées les questions mises au concours par les corps savants auxquels il avait adressé ses mémoires, et résolut de compléter et de refondre ses rédactions précédentes, dans un écrit qui fût l’expression directe et libre de sa pensée.
L’amitié lui vint en aide dans ce travail. Ampère, dont le nom est si grand dans la science de la nature, cultivait avec une prédilection marquée l’étude de l’homme et les recherches métaphysiques[26]. Il avait formé avec M. de Biran des relations, qui existaient déjà en 1805, et prirent bientôt le caractère d’une solide et vive affection. Une correspondance suivie s’établit entre eux, et les lettres d’Ampère témoignent de l’intérêt presque passionné avec lequel il abordait et approfondissait sans relâche les problèmes de la psychologie. Lorsqu’il a dû, pour un moment, entretenir son ami de quelque autre sujet, il se hâte d’écrire: Revenons maintenant à notre science chérie; et ses lettres s’allongent alors et prennent les proportions de véritables mémoires. C’est bien le même homme qui, malade à Lyon, et recevant la visite de son ami Brédin, s’aperçut que celui-ci, par ménagement pour une santé affaiblie, voulait éloigner la conversation de tout sujet abstrait, et s’écria: Ma santé! Il doit bien être question de ma santé; il ne doit être question entre nous que de ce qui est éternel. Lorsque M. de Biran entreprit la rédaction du livre dans lequel devaient se coordonner tous ses écrits antérieurs, Ampère, tenu au courant de ses travaux, lui adressa des observations, discuta les principaux points de sa théorie, lui conseilla des lectures à faire, mit, en un mot, à sa disposition tous les secours que peut offrir le plus utile des collaborateurs: un critique ami.
L’ouvrage, résultat de tant de travaux, est demeuré inédit jusqu’à ce jour, bien qu’il soit presque entièrement terminé; il a pour titre: Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de la nature. Après avoir posé les bases de sa théorie, l’auteur se livre à des analyses étendues, ayant pour but de démontrer que tous les faits qu’on peut observer dans l’homme s’expliquent par les combinaisons diverses de la vie animale et de l’activité personnelle. Il réduit ces combinaisons à quatre principales qu’il nomme Systèmes; chaque système est caractérisé par le degré de déploiement de la volonté, dans ses rapports avec les éléments involontaires de la vie affective. Au bas de l’échelle se trouve l’homme réduit à l’animalité, soit que la conscience n’ait pas encore reçu l’éveil, soit qu’elle se trouve éteinte; à l’autre extrémité apparaît l’homme élevé par la réflexion au-dessus de toutes les impressions sensibles, et contemplant dans les profondeurs de sa conscience les éléments de l’ordre intellectuel et de l’ordre moral, pris à leur source même. Tel est le cadre dans lequel doivent rentrer tous les modes réels de notre existence normale, et dans lequel aussi doivent trouver place les cas de suspension, d’altération ou de manifestation extraordinaire de nos facultés: le sommeil, le délire, la folie, le somnambulisme, etc.
Pour se faire une idée équitable de la valeur de l’Essai et de l’intérêt qu’offre sa lecture, il faut savoir que c’est surtout dans la finesse et la profondeur des développements que se manifestent les qualités les plus éminentes de l’esprit de M. de Biran. Ces qualités ne peuvent être mises en évidence dans un extrait sommaire; l’exposition qui précède suffit toutefois à établir quel chemin avait parcouru l’ancien disciple de Condillac.
A la doctrine qui débute en faisant de l’homme une simple capacité de sentir, et conclut inévitablement en niant sa liberté, on ne pouvait opposer une doctrine plus contraire que celle qui fait de la liberté, non pas une thèse démontrée, mais un axiome élevé au-dessus de toute contestation. Or, dans la théorie de M. de Biran, l’activité et la liberté sont partout identifiées, et toute attaque livrée, au nom de la raison, à la réalité du libre arbitre, est écartée par une fin de non-recevoir. Nous ne pensons que sous la condition d’agir; contester, au nom de l’intelligence, la réalité de notre puissance, c’est donc révoquer en doute un fait sans lequel l’intelligence ne serait pas; c’est nier par le moyen du raisonnement le principe même de la faculté de raisonner; c’est obscurcir la source de toute évidence. La liberté, en effet, n’est pas seulement un fait de sens intime, c’est le fait de sens intime par excellence, puisque c’est la condition de la conscience que chacun a de soi. L’homme est libre par essence, puisqu’il n’est homme que par la volonté. Mais il est sollicité sans cesse de céder aux impulsions sensibles, d’abdiquer devant des forces étrangères; telle est la conséquence de sa double nature. Qu’il agisse donc, qu’il fasse effort, qu’il réalise, en triomphant de toutes les impulsions de la vie animale, cette indépendance souveraine à laquelle il est appelé, et sa destinée sera accomplie. Tel est, s’il est permis de le dire, le mot d’ordre de M. de Biran dans sa lutte contre l’école qui fut celle de sa jeunesse.
Ce mot d’ordre, il se l’était donné, il ne l’avait pas reçu. Son développement philosophique fut individuel et spontané au plus haut point. «Nul homme, nul écrit contemporain n’avait pu modifier sa pensée; elle s’était modifiée elle-même par sa propre sagacité[27]. Habitant une province reculée, vivant plus avec ses pensées qu’avec les livres, il marcha toujours dans le sentier de ses propres réflexions. Les grandes bases de sa théorie étaient arrêtées déjà lorsque la France, sortant de l’isolement intellectuel auquel la révolution l’avait condamnée, commença à ressentir l’influence des écoles philosophiques de l’Écosse et de l’Allemagne. Les vues de M. de Biran portent d’ailleurs en elles-mêmes la preuve non équivoque de leur caractère spontané. A la vérité, lorsqu’il oppose aux thèses du sensualisme la présence dans notre esprit d’idées non sensibles par essence, lorsqu’il cite en exemple la géométrie et ses démonstrations, il ne fait que reproduire les arguments dont l’école spiritualiste a fait usage depuis le temps de Pythagore, et il serait puéril de prétendre qu’il dut à ses seules réflexions des vérités dont il avait souvent trouvé l’énoncé explicite dans les pages de Descartes et de Leibnitz. Mais l’existence des idées supra-sensibles, bien qu’elle tienne une place dans la polémique de M. de Biran, est très-loin d’y jouer le premier rôle; c’en est plutôt le côté le plus faible, ainsi qu’on le verra plus loin dans ces pages, et il faut chercher ailleurs ce qui fait la valeur propre de sa pensée.
Cette valeur résulte d’abord, ainsi qu’il vient d’être dit, de la position faite à la volonté. La volonté libre, la vraie volonté, paraît ici sur le premier plan, tandis que l’histoire de la philosophie établit que cette force constitutive de l’homme a presque toujours été méconnue. La plupart des philosophes ont donné une attention trop exclusive aux faits de la sensibilité ou à ceux de l’intelligence, et la liberté a été niée en dernier résultat, dans l’école de Descartes et de Leibnitz, tout autant que dans celle de Condillac. Or, M. de Biran ne se borne pas à signaler la volonté comme un élément à côté d’autres éléments, à revendiquer en sa faveur une place un peu plus large, il en fait le fond même de l’existence de l’homme, la montre dans tous les modes de cette existence, cherche à démontrer qu’elle est la base commune de tout ce qui est humain. C’est là ce qui caractérise son œuvre en premier lieu. Ce qui donne encore à cette œuvre une physionomie spéciale, c’est la théorie des rapports du physique et du moral de l’homme. Toute action de l’âme y est présentée comme un effort, et un effort dans lequel le corps apparaît à titre d’élément qui résiste. Ce n’est pas du dehors et par le moyen d’une observation extérieure, à la manière des physiologistes, que M. de Biran constate le rôle du corps dans notre vie; c’est à la conscience seule, à une connaissance purement intérieure qu’il en appelle pour établir ce point de doctrine. Il ne lui est pas difficile d’établir que pour être inaperçue, par une suite de l’habitude, la résistance musculaire est aussi réelle dans nos mouvements les plus aisés que dans ceux que la fatigue rend pénibles. Il va plus loin, et il affirme que dans l’exercice de la pensée la plus pure en apparence le sentiment de l’organisme est toujours là et se révèle à une observation attentive: nous ne nous connaissons à titre de pur esprit dans aucun des modes de notre existence, car si nous ne pouvons mouvoir nos membres sans triompher de la résistance que les muscles opposent à notre volonté, nous ne pouvons penser sans éprouver de la part des organes du cerveau une résistance qui, pour être plus obscure, n’en est pas moins réelle. D’un autre côté, l’organisme est le siége, non-seulement de douleurs ou de jouissances matérielles assez vives pour fixer notre attention, mais d’une foule de sentiments vagues, confus, qui, bien qu’ils échappent à une observation superficielle, n’en contribuent pas moins à déterminer la teinte de notre imagination, la direction de nos pensées et l’état de notre humeur. Nous sommes donc et continuellement dans un double rapport avec l’organisme: nous agissons sur lui par une action qui dure autant que l’état de veille, puisque cette action est la condition de la conscience; nous subissons constamment son influence dans les modes divers de notre sensibilité, et cette influence détermine notre caractère et exerce un empire prononcé sur notre intelligence.
M. de Biran s’arrête avec une complaisance marquée sur les considérations de cet ordre. C’est sur ce terrain qu’il bat les sensualistes d’autant plus sûrement que, plus il a fait une large part au physique et à tous les éléments passifs de notre nature, mieux il est placé pour constater l’existence et revendiquer les droits de cette libre puissance avec laquelle l’homme s’identifie, et dont la mission est de triompher d’une nature inférieure et animale, et non de subir sa loi. Or, cette vue nette et vive du lien intime qui unit les deux éléments qui nous composent, M. de Biran ne la devait qu’à lui-même; il ne pouvait l’emprunter ni à la psychologie cartésienne, ni aux physiologistes de l’école de Cabanis. C’est ici que l’influence de sa nature personnelle se fait le plus vivement sentir. C’est bien son propre portrait qu’il a tracé dans les lignes suivantes: «Il est des hommes d’une certaine organisation ou tempérament, qui se trouvent sans cesse ramenés au dedans d’eux-mêmes par des impressions affectives d’un ordre particulier, assez vives pour attirer l’attention de l’âme. De tels hommes entendent, pour ainsi dire, crier les ressorts de la machine; ils les sentent se monter ou se détendre, tandis que les idées se succèdent, s’arrêtent et semblent se mouvoir du même branle[28].»
La révolution accomplie dans l’esprit de M. Biran, depuis l’époque où dans ses premières ébauches il suivait les traces de Condillac, s’effectua en dehors de toute prévention pour une doctrine philosophique préconçue, et non moins en dehors de l’influence de toute croyance religieuse proprement dite. Rétablir le rôle de la volonté dans l’homme fut pour lui le résultat d’une observation simple et directe; les conséquences morales et religieuses des systèmes, qui occupent une certaine place dans les fragments de 1794, n’en ont plus aucune dans ses travaux subséquents. Il fixa son regard sur les faits intérieurs de notre nature intellectuelle; ces faits lui parurent altérés dans la doctrine régnante; il les rétablit tels qu’il les voyait. Il est permis de croire cependant qu’en dehors de ce point de vue strictement psychologique, l’expérience de la vie et des observations dont son état moral fournissait la matière, contribuèrent pour leur part à la modification profonde de ses pensées. Les documents de sa vie intime, très-rares malheureusement pour cette période, jettent cependant quelque jour sur ce sujet.
On a vu le jeune solitaire de Grateloup demander le bonheur aux jouissances passives que des causes étrangères peuvent déposer dans l’âme. Les joies de cette espèce sont bien fugitives. Attendre sa félicité du calme des sens ou de la satisfaction des désirs qu’ils éveillent; avoir pour son idéal le plus élevé les impressions vivifiantes d’une matinée de printemps, ou cet état de calme et d’énergie qui résulte du jeu régulier de toutes les fonctions vitales, c’est se mettre à la merci de la maladie, du vent qui souffle, des variations de la température, de tous les caprices d’une imagination tantôt riante et tantôt sombre; c’est se condamner à n’atteindre, à de rares intervalles, le but auquel on aspire, que pour le voir échapper aussitôt. Fussions-nous, par exception à la règle commune, favorisés d’impressions constamment agréables, un sentiment de vide viendrait encore décolorer nos joies. Tout change au dehors, tout se modifie incessamment dans notre organisation; s’attacher aux objets extérieurs, s’abandonner aux influences des états variables du corps, c’est accepter une mobilité continuelle pour l’état fondamental de notre âme. Cette âme, cependant, si mobile et si légère qu’elle soit, réclame quelque chose qui demeure, un sentiment fixe au sein de la variété. Entourez-la de joies sans cesse renouvelées, mais diverses et fugitives; en la privant d’un but constant, d’une affection permanente, vous la frappez, au sein même des plaisirs, d’un sentiment douloureux. L’instabilité de tout ce qui l’environne et la fluctuation perpétuelle dans laquelle elle se trouve, lui sont un supplice, supplice que l’étourdissement peut suspendre, sans avoir la puissance de le détruire. Un double enseignement résulte donc, pour un esprit sérieux, du simple cours de la vie: les joies sensibles sont un appui trop fragile pour le bonheur, puisqu’elles périssent au moindre choc; et, fussent-elles continuellement renouvelées, elles ne sauraient encore nous rendre heureux parce qu’elles varient incessamment, et que nous avons besoin de donner une base fixe à notre vie. Les résultats de cette double expérience sont fortement exprimés dans ces paroles de M. de Biran, qui datent de 1811, époque où la seconde forme de sa pensée philosophique atteignait l’apogée de son développement: «Je ne suis plus heureux par mon imagination.... Ma vie se décolore peu à peu........» «Y a-t-il un point d’appui et où est-il?» Le point d’appui qui ne se trouve pas au dehors, c’est au dedans, c’est dans la puissance intérieure de l’âme qu’il faut le chercher. Se roidir contre les impressions variables, au lieu de s’y abandonner; se retirer dans le sanctuaire intérieur de sa conscience, et braver de là la souffrance et la maladie, aussi bien que les coups de la fortune; se rendre maître de soi et chercher sa joie dans cette possession, dans le sentiment de sa dignité, dans l’orgueil d’une bonne conscience.... telle est la voie qui s’ouvre assez naturellement aux hommes qui, sans avoir renoncé à trouver le bonheur, ont constaté que ce bonheur ne saurait découler pour nous de sources qui nous sont étrangères. Cette voie, M. de Biran y entre et s’y avance. Il est comme poursuivi par le besoin de l’unité, par le besoin de trouver une base ferme et une règle qui ne varie pas, au sein de la mobilité des choses du dehors et des états intérieurs de l’âme. Dans ce but il veut s’appuyer sur sa force personnelle; ne pouvant plus se jeter aux appuis étrangers, comme il le dit en empruntant des paroles de Montaigne, il se propose de recourir aux propres, seuls certains, seuls puissants à qui sait s’en armer. «Il faut voir, dit-il encore, ce qu’il y a en nous de libre ou de volontaire et s’y attacher uniquement. Les biens, la vie, l’estime ou l’opinion des hommes ne sont en notre pouvoir que jusqu’à un certain point: ce n’est pas de là qu’il faut attendre le bonheur; mais les bonnes actions, la paix de la conscience, la recherche du vrai, du bon, dépendent de nous, et c’est par là seulement que nous pouvons être heureux autant que les hommes peuvent l’être[29].»
Ces lignes sont fortement marquées de l’empreinte du stoïcisme, et celui qui les traçait n’ignorait pas que ses réflexions l’avaient conduit sur un terrain dès longtemps exploité par une école célèbre; il le reconnaît expressément: «L’art de vivre consisterait à affaiblir sans cesse l’empire ou l’influence des impressions spontanées, par lesquelles nous sommes immédiatement heureux ou malheureux, à n’en rien attendre, et à placer nos jouissances dans l’exercice des facultés qui dépendent de nous, ou dans les résultats de cet exercice. Il faut que la volonté préside à tout ce que nous sommes. Voilà le stoïcisme. Aucun autre système n’est aussi conforme à notre nature[30].» Maine de Biran retrouve sa propre pensée dans la distinction si nettement établie par les disciples du Portique entre les affections et les désirs d’une part, et la volonté de l’autre; il applaudit à ces maximes dont la tendance uniforme est de séparer des sens et de tous les phénomènes du dehors l’âme renfermée dans le sentiment de sa dignité et de sa force, comme dans une forteresse inexpugnable. Plus d’une fois il commente avec amour les paroles de Marc-Aurèle, et se montre disposé à admettre qu’il a été donné aux disciples de Zénon d’apercevoir la vérité tout entière. Ce ne sont là sans doute que des aperçus; on ne serait pas en droit d’affirmer que M. de Biran ait fait, à une époque quelconque de sa carrière, une profession positive de la doctrine des stoïciens, mais il eut, par moments au moins, une tendance assez marquée à résoudre la question du bonheur dans le même sens que ces philosophes.
Il existe un parallélisme marqué entre les deux théories philosophiques que nous avons vues se substituer l’une à l’autre et les jugements contradictoires successivement portés par l’auteur sur les conditions de la vie heureuse. Vouloir être heureux par les impressions agréables de la sensibilité, c’était bien mettre en pratique les conséquences morales du sensualisme. Il appartenait d’autre part au restaurateur de la doctrine de la volonté, de demander ses jouissances au libre développement de l’activité intérieure: les pensées du philosophe et les expériences de l’homme se présentent ici en harmonie et dans une dépendance mutuelle. Il n’en est pas toujours ainsi. Les systèmes métaphysiques étant souvent une production de l’intelligence seule, demeurent en quelque sorte étrangers à celui-là même qui les a conçus. Lorsqu’on ne fait qu’enchaîner logiquement des idées, sans confronter les résultats auxquels on parvient avec les besoins divers de l’âme, et sans se demander si on s’avance sur le terrain solide des réalités, ou si on se perd dans le vide des abstractions, on retrouve, en rentrant dans son cabinet d’études, une série de pensées qu’on avait oubliées en en sortant: le système suit une voie, l’existence réelle en prend une autre. Ce n’est pas là certes une des moindres causes des aberrations des esprits systématiques: c’est parce qu’on a fait du raisonnement une sorte de jeu, grave à la vérité, mais dépourvu d’un sérieux réel, qu’on a vu d’honnêtes gens ériger en théorie la négation absolue du devoir, et des hommes qui obéissaient comme les autres à la foi naturelle du genre humain, prêcher dans leurs écrits le scepticisme le plus absolu. Les vues scientifiques de M. de Biran présentent un tout autre caractère. Comme il observe beaucoup plus qu’il ne raisonne, et cherche moins à faire une théorie sur la nature humaine, qu’à rendre compte de ce qu’il éprouve en lui-même, sa pensée est toujours près de sa vie, et sa vie agit incessamment sur sa pensée. On peut dire de lui, en modifiant une parole célèbre, ce qu’on peut dire avec vérité d’un si petit nombre de métaphysiciens, que le système c’est l’homme.
Les travaux qui se résumèrent dans les trois mémoires couronnés à Paris, Berlin et Copenhague, et vinrent se coordonner dans l’Essai sur les fondements de la psychologie, se placent entre 1803 et 1812 environ. Suffisants, semble-t-il, pour avoir rempli ces neuf années, ils ne furent toutefois que les délassements studieux d’une carrière administrative. Le 22 ventôse an XIII (13 mars 1805), Maine de Biran avait été nommé par un décret impérial conseiller de préfecture du département de la Dordogne; un nouveau décret impérial l’appela le 31 janvier 1806 au poste de sous-préfet de Bergerac. Ni ses facultés ni ses goûts ne semblaient le destiner à des fonctions administratives. Toutefois, s’il dut sentir, par moments, quelque désaccord entre la direction naturelle de son esprit et les devoirs de sa charge, il eut au moins le bonheur d’échapper à un sentiment pénible que plus d’un homme de lettres, après des succès tels que les siens, aurait senti se glisser dans son cœur. Il n’accusa pas sa destinée parce que, après avoir réussi à conquérir les suffrages des premiers corps savants de l’Europe, il se trouvait placé dans une petite ville de province à la tête d’une administration de troisième ordre. Jamais on ne l’entendit grossir le nombre de ces plaintes que la vanité blessée se plaît à mettre sur le compte du génie méconnu. Il écrit, il est vrai, dans son journal: «Lorsqu’on est tombé des hauteurs de la philosophie dans la vie commune, il est difficile de remonter des habitudes de la vie commune à la philosophie;» mais ce n’est pas à Bergerac qu’il trace ces lignes, c’est à Paris, en 1818, lorsque, mêlé au mouvement social de la capitale, appelé à prendre part aux plus grandes affaires de la monarchie, il avait une position dont une vanité assez exigeante aurait pu s’accommoder. Au lieu de s’abandonner à des plaintes stériles sur les obstacles que pouvaient apporter à ses recherches philosophiques les occupations d’une sous-préfecture, il sut mettre à profit ses moments de loisir pour continuer ses travaux. Des veilles prolongées lui firent trouver un temps qu’il aurait eu de la peine à dérober aux occupations du jour, mais contribuèrent probablement à altérer sa santé et à rapprocher le terme de sa vie.
L’isolement intellectuel est assez généralement le partage d’un homme qui cultive, dans une petite ville de France, les lettres ou la philosophie. A cet égard encore, on voit M. de Biran agir au lieu de se plaindre, et lutter contre les inconvénients de sa situation. Parmi les hommes qui l’entouraient, les médecins lui parurent ceux avec lesquels il pouvait entretenir le plus utilement quelques relations scientifiques. Il fonda, sous le nom de Société médicale, une réunion périodique dont l’objet devait être l’étude de l’homme. En même temps qu’il adressait des mémoires à Berlin et à Copenhague, il composait des écrits importants pour cette modeste réunion[31]. Se plaçant sur le terrain de la physiologie: l’observation des phénomènes de notre nature physique, il partait de là pour s’élever à des considérations d’un autre ordre, et s’efforçait surtout de maintenir la réalité des faits supra-sensibles contre les prétentions du matérialisme. Il est à présumer que les collègues de M. de Biran n’étaient guère que ses auditeurs, et que la Société médicale ne renfermait pas dans son sein les éléments d’une controverse philosophique bien active. Cette société toutefois se maintint pendant plusieurs années; elle ne manqua donc pas absolument son but, et son fondateur y rencontra, sinon des émules ou des contradicteurs compétents, au moins ce contact personnel et immédiat avec d’autres intelligences qui conserve sa valeur dans tous les cas. La correspondance lui rendait un service analogue. Ampère était, comme on l’a vu, son correspondant principal. Des lettres de Destutt de Tracy et de Cabanis, restés les amis de leur disciple infidèle, venaient aussi de temps à autre le chercher dans sa retraite. Ancillon adressait de loin au lauréat de l’Académie de Berlin les témoignages d’une sincère admiration et d’une cordiale sympathie. Le philosophe de Bergerac fut toutefois un penseur solitaire: il lui manqua le mouvement d’un centre scientifique qui élargit l’horizon de la pensée, et la discussion fréquente et sérieuse qui rend l’expression plus nette, la parole plus ferme et plus incisive. Ces circonstances produisirent dans son développement des lacunes dont lui-même se rendit compte plus tard. Sous l’empire trop exclusif de certaines préoccupations, il semble passer à côté de questions importantes sans en entrevoir toute la portée. Aussi M. Cousin a pu dire, avec justice, non de la pensée de M. de Biran, dans la totalité de son développement, mais de la théorie du sous-préfet de Bergerac, qu’elle est profonde mais étroite[32]. C’est là le résultat assez naturel des méditations d’un solitaire. Mais tout a ses inconvénients; et une pensée qui s’étend dans toutes les directions, qui embrasse tous les problèmes, sous les excitations d’un grand centre intellectuel, risque de ne s’étendre qu’en surface. On voit tout superficiellement lorsqu’on regarde trop de choses à la fois; on finit par ne posséder aucune conviction arrêtée lorsque, dans le contact continuel des hommes, on se laisse entraîner à émettre au dehors et sur tous les sujets des opinions à peine formulées dans l’intérieur de la conscience. Il arrive aussi que lorsque c’est le public qui excite les méditations du philosophe, le philosophe pense pour le public, et non plus pour la vérité, et cet écueil est pire que celui de la solitude. Maine de Biran dut aux habitudes d’esprit qu’il contracta dans la retraite de conserver intactes la parfaite sincérité qui préside à ses recherches et l’exquise bonne foi qui fait le caractère spécial de ses vues scientifiques.
La fondation de la Société médicale ne fut pas le seul effort tenté par M. de Biran, pour faire circuler la vie intellectuelle et morale dans l’arrondissement remis à ses soins. Membre, ou même président de la loge maçonnique de la Fidélité, il s’efforça d’imprimer à cette réunion une tendance utile, de lui donner un but élevé de bien public et d’active bienfaisance. La réputation de Pestalozzi commençait à franchir les frontières de la patrie de cet ardent ami de l’humanité. Maine de Biran apprécia hautement l’esprit général de la nouvelle méthode, à la base de laquelle il rencontrait des vues assez semblables aux siennes sur le rôle et l’importance du principe actif dans la vie humaine. Approuver théoriquement un principe d’éducation était l’affaire du philosophe; l’administrateur ne s’en tint pas là. Une école gratuite fut instituée à Bergerac, une correspondance ouverte avec Pestalozzi, et un jeune maître vint utiliser sur les rives de la Dordogne le résultat d’études faites à Yverdun.
Un sous-préfet tel que M. de Biran était peu propre, sous plus d’un rapport, à être l’un des agents du grand homme de guerre, de l’administrateur puissant, de l’ennemi des idéologues qui gouvernait alors la France; aussi ne voit-on pas qu’il ait eu des chances d’avancement sous le gouvernement impérial. Il reçut à la vérité la croix de la Légion d’honneur en mars 1810, après avoir été chargé de complimenter l’empereur à l’occasion de la paix de Vienne; mais une telle distinction était alors trop commune pour être une faveur. C’est par une autre voie que le sous-préfet devait arriver à une position plus haute dans la hiérarchie officielle. La conscience qu’il apportait à l’accomplissement des devoirs de sa charge et la parfaite obligeance qui le distinguait, et dont il eut sans doute bien des occasions de donner des preuves, lui avaient concilié l’affection et l’estime de ses administrés; en 1809, il fut envoyé au corps législatif à la presque unanimité des votes. Ce choix modifia profondément son genre de vie. Il conserva pendant quelque temps encore sa sous-préfecture, mais le 24 juillet 1811, M. Delaval le remplaça à Bergerac, et dans le courant de 1812, laissant ses enfants en Périgord aux soins d’une parente, il vint se fixer à Paris, où devait être dès lors sa résidence habituelle.