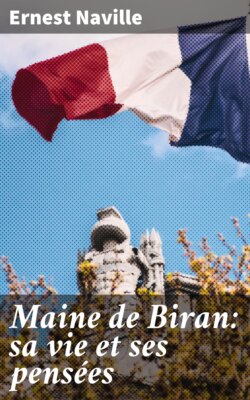Читать книгу Maine de Biran: sa vie et ses pensées - Ernest Naville - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Jeunesse de Maine de Biran et ses débuts en philosophie. —1766 à 1803—
ОглавлениеTable des matières
François-Pierre Gonthier de Biran[13], fils d’un médecin qui pratiquait son art avec quelque distinction, naquit à Bergerac, le 29 novembre 1766. Après la première éducation reçue dans la maison paternelle, il fut envoyé à Périgueux pour y suivre les classes dirigées par les Doctrinaires. Tout ce qu’on sait de son enfance, c’est qu’il parcourut le champ des études avec facilité, et fit preuve surtout d’une aptitude marquée pour les mathématiques. Il avait hérité de ses parents une constitution délicate et un de ces tempéraments nerveux caractérisés d’ordinaire par la vivacité et la mobilité des impressions. Toute sa vie il subit au plus haut degré les influences du dehors; le vent qui change modifie ses dispositions; l’état de son âme varie avec le degré du thermomètre. Le Journal intime renferme des notes souvent très-détaillées sur la température, l’état du ciel, l’humidité ou la sécheresse de l’atmosphère. Vous croiriez avoir affaire à un physicien. Rien cependant de plus éloigné des goûts et des habitudes de l’auteur que l’observation scientifique des faits de la nature. Si ces faits attirent ainsi son attention, c’est uniquement par leur rapport avec ses impressions personnelles. Un temps humide ou sec, un air agité ou tranquille, se traduisent immédiatement dans telle disposition particulière de son être intellectuel et moral: chaque saison, chaque état de l’atmosphère le retrouvent, en se reproduisant, triste ou gai, confiant ou découragé, enclin à des méditations paisibles ou attiré par les distractions du monde. Si ses dispositions intérieures varient ainsi avec tout ce qui change au dehors, elles ne varient pas moins avec les états divers de son organisation physique. C’est dans une circulation du sang lente ou rapide, dans une digestion facile ou laborieuse, bien plus que dans des événements extérieurs, qu’il faut chercher le plus souvent la cause de ses espérances ou de ses craintes, du regard serein ou sombre qu’il jette sur le monde et sur les hommes.
On ne peut contester que ce tempérament délicat n’ait exercé une très-vive influence sur la direction des études de M. de Biran. Une constitution si mobile et si faible contribua pour beaucoup à diriger son attention sur les faits intérieurs dont l’âme est le théâtre.
«Quand on a peu de vie ou un faible sentiment de vie,» écrit-il en 1819, «on est plus porté à observer les phénomènes intérieurs; c’est la cause qui m’a rendu psychologue de si bonne heure[14].» Plus de vingt années auparavant, il traçait déjà les lignes suivantes, dans lesquelles il semble envisager comme la condition normale du philosophe cet état de maladie que Pascal considérait comme l’état naturel du chrétien: «Le sentiment de l’existence devient insensible, parce qu’il est continu. Lorsqu’on ne souffre pas, on ne songe presque pas à soi; il faut que la maladie ou l’habitude de la réflexion nous forcent à descendre en nous-mêmes. Il n’y a guère que les gens malsains qui se sentent exister; ceux qui se portent bien, et les philosophes mêmes, s’occupent plus à jouir de la vie qu’à rechercher ce que c’est. Ils ne sont guère étonnés de se sentir exister. La santé nous porte aux objets extérieurs, la maladie nous ramène chez nous.» On serait d’autant moins fondé à revoquer en doute la justesse de ces observations, que Cabanis expliquait, comme M. de Biran, l’origine physique des succès de ce penseur dans l’étude de la psychologie. La nature,» lui écrit-il[15], «vous a donné une organisation mobile et délicate, principe de ces impressions fines et multipliées qui brillent dans vos ouvrages, et l’habitude de la méditation dont elles vous font un besoin ajoute encore à cette excessive sensibilité.» Un savant qui oublie les faits pour construire une théorie, peut se proposer d’expliquer l’homme tout entier par le jeu de la machine organisée; il peut, suivant une voie contraire, perdre de vue, dans un idéalisme abstrait, le rôle très-positif que joue la matière dans notre existence; il peut enfin parler de l’âme et du corps comme de deux êtres simplement juxtaposés et presque sans relations entre eux. Un observateur attentif et de bonne foi arrivera à des conclusions bien différentes, et reconnaîtra qu’il n’est peut-être pas un seul des modes de notre vie, si purement physique ou si uniquement moral qu’il puisse paraître au premier abord, qui ne soit le résultat de deux forces différentes, dont l’une procède de l’âme et dont l’autre vient du corps. C’est une des gloires de M. de Biran d’avoir solidement établi cette vérité dans la science. En opposition aux vues exclusives du matérialisme et de l’idéalisme, il a déterminé avec une grande profondeur d’analyse, la vraie nature du problème des rapports du physique et du moral de l’homme. Il a dû sans doute ses vues sur ce sujet à la patience de ses recherches et à une bonne méthode; mais, on ne peut le méconnaître, ses recherches furent facilitées, sa méthode lui fut comme imposée par sa nature personnelle. Le besoin de réflexion qui le dominait ne devait pas lui permettre de confondre longtemps les phénomènes sensibles avec les réalités intérieures; tandis que, d’un autre côté, il était trop accessible à toutes les impressions du dehors, et ressentait trop vivement l’influence des moindres modifications de ses organes pour méconnaître la large part de l’élément matériel dans les faits de notre double nature. Son tempérament particulier lui servit de préservatif contre plus d’une illusion: une santé plus forte, une constitution plus énergique, auraient altéré peut-être son analyse de la nature humaine, et il le savait bien.
Ces considérations seraient prématurées si M. de Biran ne nous apprenait lui-même que sa curiosité philosophique s’éveilla presque au début de sa vie. «Dès l’enfance, dit-il, je me souviens que je m’étonnais de me sentir exister; j’étais déjà porté, comme par instinct, à me regarder au dedans pour savoir comment je pouvais vivre et être moi[16].» Cette question, sitôt posée par l’écolier de Périgueux renfermait tout son avenir scientifique. Se regarder en dedans, se regarder passer, comme il le dit ailleurs, ce fut toujours le besoin le plus impérieux de sa nature intellectuelle.
Parvenu au terme des études qu’il pouvait faire dans sa province, le jeune de Biran entra dans les gardes du corps en 1785, cédant aux sollicitations de quelques-uns de ses parents qui suivaient la même carrière. A cette époque de sombres nuages s’amoncelaient déjà sur l’horizon politique de la France. La royauté n’avait pas cependant perdu tout son éclat; et les salons de la capitale réunissaient encore une société aimable et frivole. Le jeune garde du corps se produisit dans le monde; il était fait pour y réussir. Une figure charmante, à laquelle il attachait du prix, ce qu’il se reprocha souvent dans la suite, un esprit aimable, le goût et le talent de la musique étaient pour lui des éléments de succès. Mais ce succès tenait plus encore à son caractère. Cette même faiblesse d’organisation qui lui faisait subir l’influence des variations de la température, tendait aussi à le placer sous la dépendance des personnes avec lesquelles il entretenait des rapports. Il ne pouvait supporter sans peine des marques de froideur; un regard hostile le troublait, la pensée d’être en butte à des sentiments haineux bouleversait son âme. La bienveillance d’autrui était comme une atmosphère en dehors de laquelle sa respiration morale devenait pénible. Aussi était-il porté à prévenir chacun de ceux qu’il rencontrait, à se placer sur le terrain où il se trouverait en sympathie avec ses interlocuteurs, à se faire tout à tous, pour que l’affection générale le plaçât dans le milieu que sa nature lui rendait nécessaire. Tout cela se faisait sans effort, sans l’apparence de calcul. Il désirait la bienveillance du plus humble de ses semblables comme celle de l’homme le plus haut placé. On comprend qu’une disposition pareille contribue à faire trouver dans le monde un accueil favorable. Cette disposition chez M. de Biran s’unissait à une vraie bonté de cœur. Tout contribuait donc à le rendre d’une parfaite obligeance dans les relations sociales. Il devait à la nature un besoin de plaire qui coûta par la suite plus d’un gémissement au philosophe; il dut à la fréquentation du monde cette politesse exquise, cette parfaite urbanité qui distinguèrent la société française dans des temps qui ne sont plus. Au sein de la civilisation nouvelle qui sortit du chaos révolutionnaire, Maine de Biran demeura, pour l’amabilité des formes et l’élégance des manières, l’un des représentants de la civilisation détruite; l’étranger même qui ne le voyait qu’en passant en faisait la remarque.
L’élève des doctrinaires avait passé sans transition des études de sa jeunesse à une période de dissipation assez complète. L’enseignement religieux qu’il dut recevoir de ses instituteurs paraît n’avoir laissé qu’une faible trace dans son âme. En l’absence de toute conviction arrêtée, il n’avait d’autre préservatif contre les écarts des passions qu’un goût naturel pour les convenances, et un très-vif instinct d’honnêteté. Cette vie d’étourdissement ne fut pas de longue durée: l’an 89 arriva. Aux journées des 5 et 6 octobre, M. de Biran eut le bras effleuré par une balle. Demeuré sans état par suite du licenciement de son corps, il forma le projet d’entrer dans le génie militaire, et reprit, à cette occasion, l’étude des mathématiques. Il a dit plusieurs fois par la suite qu’il considérait les habitudes intellectuelles qu’il avait contractées, ou plutôt confirmées à cette époque, comme une des causes de ses succès en philosophie. Cependant, sa qualité d’ancien garde du corps étant un obstacle à tout avancement dans la carrière qu’il avait en vue, il dut renoncer à ses projets, et, nul motif ne le retenant plus dans la capitale, il se décida à regagner ses foyers. Pendant son séjour à Paris, la mort lui avait enlevé son père, sa mère et deux de ses frères. Un frère et une sœur étaient les seuls membres de sa famille qui survécussent.
Le décès de ses parents l’avait mis en possession de la terre de Grateloup, domaine de sa famille maternelle, situé à une lieue et demie de Bergerac. Cette habitation isolée s’élève, entourée de bouquets d’arbres et de prairies, vers le sommet d’une éminence. Au pied de la colline un cours d’eau serpente dans un paisible vallon. De la terrasse du château la vue s’étend sur un terrain accidenté couvert de riches cultures, ou planté d’arbres vigoureux, qui sans offrir les beautés grandioses des contrées alpestres, ne manque ni de charme, ni de variété. C’est un aspect qui porte à l’âme de douces impressions: il ne rappelle que l’éternelle majesté de la nature et les paisibles travaux des habitants des campagnes.
Tel fut l’asile où M. de Biran passa les lugubres années qui couvrirent la France de crimes, de sang et de deuil. Triste et découragé, comme un jeune homme sans vocation pour le présent et sans espoir prochain pour l’avenir, il avait encore le cœur oppressé par les malheurs qui affligeaient ou menaçaient sa patrie. Le récit des attentats révolutionnaires venait, dans sa solitude, remplir son âme d’une douloureuse terreur. Sa position et son caractère lui interdisant également de prendre un rôle actif dans un drame aussi terrible, il éprouvait le besoin de se mettre à l’écart et d’oublier, autant que possible, des calamités pour le soulagement desquelles il ne pouvait rien entreprendre. Il se remit à l’étude «avec une sorte de fureur,» c’est ainsi qu’il s’exprime, et ce fut alors que, pour citer encore ses propres paroles, «il passa d’un saut de la frivolité à la philosophie.» L’étude ne trompa pas son attente. Le travail intellectuel et un contact journalier avec les sereines beautés de la nature, lui procurèrent un calme aussi grand qu’il pouvait l’espérer en des jours pareils. «Dans les circonstances actuelles,» écrit-il à un ami, «et vu ma manière de penser, la vie que j’ai adoptée est la seule qui puisse me convenir. Isolé du monde, loin des hommes si méchants, cultivant quelques talents que j’aime, moins à portée que partout ailleurs d’être témoin des désordres qui bouleversent notre malheureuse patrie, je ne désire rien autre chose que de pouvoir vivre ignoré dans ma solitude.» Ce désir fut satisfait dans les limites du possible. Il est vrai que, dans toute l’étendue du pays, il n’existait alors aucun refuge assuré contre la soif du sang et du pillage; mais le Périgord était une province relativement paisible, et la vie retirée de M. de Biran, la douceur de son caractère, la modicité de sa fortune surtout, lui valurent de n’être pas troublé dans sa retraite. Il n’échappa pas cependant aux inquiétudes dont, au sein d’une commotion immense, nul ne peut être exempt. Tantôt il craint d’être obligé de fermer ses livres et d’abandonner sa retraite pour aller à la frontière grossir les rangs des armées de la révolution; tantôt il aperçoit dans les populations qui l’entourent des symptômes de sinistre augure, et des craintes pour sa sûreté personnelle viennent se joindre dans son cœur agité à la douleur du deuil public. «Je m’étais flatté pendant quelque temps, écrit-il, de pouvoir vivre ignoré dans ma solitude, mais je commence à perdre cette espérance. Les agitateurs soufflent dans tous les coins de la France le tumulte et la discorde; leur haleine empoisonnée se fait sentir partout, et mon pays commence à participer à la contagion. S’il en est ainsi, je ne vois plus où fuir, et il ne me reste d’autre parti que d’apprendre à souffrir et à mourir s’il le faut.» Il ne fut pas appelé à cette épreuve. Les flots soulevés par la tempête révolutionnaire se brisèrent autour de lui sans l’atteindre. Mais s’il n’assista qu’à distance aux spectacles de la terreur, il n’en conserva pas moins des événements de cette époque une impression que rien ne put effacer, et qui exerça une influence décisive sur la ligne politique qu’il devait adopter plus tard.
Il est deux manières de juger les événements: on peut ou les envisager dans leurs conséquences, ou fixer son attention sur leur nature, sur la valeur morale des agents qui les ont accomplis. Ces deux jugements font nécessairement partie de l’appréciation complète d’un fait. Le premier appartient à la raison de l’historien, appelé à discerner le rapport qui unit le passé au présent, un acte à ses résultats; le second est le verdict immédiat de la conscience. Souvent ils peuvent différer, puisqu’il est manifeste qu’une action mauvaise peut, dans des circonstances données, et contre l’intention de celui qui en est l’auteur, avoir des conséquences favorables et inattendues; l’histoire en fournirait des preuves au besoin. Dans un cas pareil, il est indispensable de faire des parts distinctes à deux éléments profondément divers; de reconnaître avec gratitude l’intervention d’une Providence miséricordieuse qui sait tirer le bien même de nos intentions perverses, sans que cette considération atténue en rien le jugement de condamnation porté sur des actes criminels. Dieu pense en bien ce que nous avons pensé en mal; Dieu est bon, sans que l’homme en demeure moins mauvais. Autrement il faudrait que les sages remerciassent dans leur cœur les meurtriers de Socrate, de leur avoir fourni l’exemple d’une mort si belle, et que les Chrétiens vouassent un culte de reconnaissance aux Juifs qui élevèrent la croix de Golgotha.
Ces distinctions, élémentaires pour qui croit à la liberté de l’homme et à l’action souveraine de Dieu, ne disparaissent que trop souvent sous la plume de l’historien. Comment, par exemple, les faits de la révolution française sont-ils appréciés par plus d’un auteur contemporain? Ne voyons-nous pas absoudre les plus grands coupables en considération des résultats heureux que l’on attribue à leurs actes? Parce que certains abus qui frappaient tous les regards avant 89 n’ont pas reparu dès lors, ne nous propose-t-on pas d’élever presque au rang des bienfaiteurs de l’espèce humaine des hommes dont le nom ne devrait inspirer que l’horreur et l’épouvante? N’entendons-nous pas, pour atténuer, pour justifier même les plus horribles attentats, invoquer les intérêts de la cause révolutionnaire comme une sorte de nécessité suprême que se bornaient à subir ceux qui élevaient la guillotine et versaient le sang à flots? Suivez la pensée de ces historiens, poussez-la à ses conséquences dernières, vous voyez l’homme et Dieu disparaître, pour ne laisser à leur place qu’une sorte de loi inexorable, qu’accomplissent avec toute la précision de la fatalité des agents irresponsables, parce qu’ils sont destitués de libre arbitre. Une raison licencieuse élève ainsi un système dans lequel tout ce qui a été devait être, et la conscience se tait, car sa voix ne trouve plus de place où se faire entendre.
Une semblable théorie peut séduire l’homme de cabinet, qui ne voit les événements que de loin, surtout s’il aspire à cette triste impartialité qui nous élève au-dessus de la sphère où l’on approuve et s’indigne tour à tour. La condition des contemporains est autre. Le crime leur apparaît dans sa réalité saisissante; les sentiments de leur âme ébranlée jettent tout leur poids du côté du jugement de la conscience; la perversité morale que supposent les faits dont ils sont témoins, les spectacles de douleur qui passent sous leurs yeux, absorbent leur attention, et, tout entiers au présent, il leur est difficile d’ouvrir leur âme au lointain espoir que la main réparatrice du Dieu qui gouverne le monde saura faire porter quelques fruits heureux à l’arbre empoisonné des crimes et des folies des hommes. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si M. de Biran fut exempt de toute disposition à atténuer le caractère odieux des scènes de la terreur. Pour lui, comme pour Royer-Collard «ces hommes, que nous avons depuis transformés en Titans fantastiques et providentiels, restèrent de la canaille pure et simple[17].» Il ne se dissimulait ni les plaies de l’ancienne société, ni la destruction définitive d’un ordre de choses qui, dans plusieurs de ses éléments, ne devait jamais reparaître; mais il ne trouvait pas de paroles assez fortes pour rendre l’indignation qu’excitaient en lui les scènes de violence, d’oppression et d’anarchie dont il était le triste spectateur.
«Le sang précieux versé par les tyrans de la patrie infortunée» lui paraît suffire «à effacer la mémoire de tous les bûchers allumés par la féroce inquisition[18],» et il exprime constamment son horreur profonde pour le principe que le salut du peuple justifie tous les crimes et transforme en actes licites les plus odieux attentats.
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que les pages dans lesquelles il consignait, à cette époque, ses réflexions de chaque jour offrent la preuve qu’il entrevoyait déjà le lien qui unit l’incrédulité du XVIIIe siècle aux excès de la révolution Les théories d’Helvétius et de Raynal lui paraissent une des causes déterminantes des malheurs de la patrie; il s’élève avec une certaine énergie contre «ces philosophes qui ont répandu le mépris d’une religion si consolante pour les gens de bien, si nécessaire pour arrêter le bras du méchant;» enfin, dans un projet d’adresse à ses concitoyens, rédigé à l’occasion du rétablissement de la liberté des cultes, on voit percer un sentiment vif du droit des consciences et du rôle social de la religion. Mais ce ne sont là que des impressions. Son christianisme paraît se borner, à cette époque, à la maxime «qu’il faut une religion au peuple,» ou à quelqu’une de ces vagues rêveries qui, faisant errer l’imagination sur les confins de ce monde invisible où la foi seule donne entrée, peuvent tout au plus tromper, l’instinct religieux du cœur.
Les travaux dans lesquels M. de Biran cherchait l’oubli des malheurs publics étaient de diverses natures. Les mathématiques, les sciences naturelles, les écrivains classiques occupaient tour à tour ses loisirs. Mais l’étude qui, plus que toute autre, le captivait, c’était l’étude de lui-même. Seul, en face de sa pensée, il aime surtout à analyser ses sentiments, à se rendre compte de ses impressions, à rechercher dans les circonstances du dehors ou dans l’état de sa santé la cause de ses mouvements alternatif de joie ou de tristesse, d’espérance ou de découragement. Il se trouva ainsi conduit tout naturellement sur le terrain propre des recherches qui ont la nature humaine pour objet. Pour bien comprendre la carrière philosophique de M. de Biran, il ne faut jamais oublier qu’il ne fut pas conduit à la philosophie par le désir de connaître les secrets de l’univers, ni même par le désir d’acquérir la science de l’homme en général, mais par le besoin de se rendre compte de son propre moi. Le connais-toi toi-même, avant d’être pour lui une règle de méthode scientifique, fut tout d’abord un instinct.
Cet instinct le conduisit immédiatement à la question qui s’offre la première à un homme ainsi disposé: Où est le bonheur, et que pouvons-nous pour l’atteindre? Cette question se lia tout de suite dans son esprit à un problème plus général: Que pouvons-nous? Qu’est-ce qui dépend et ne dépend pas de notre volonté? La tendance générale de la première solution que M. de Biran donna à ce problème, n’est pas douteuse. Le bonheur ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, dans la fortune, dans la puissance, dans les mouvements violents des passions; il consiste dans un état de bien-être qui ne se rencontre que dans le calme, et provient, avant tout, de l’équilibre et du jeu régulier des diverses fonctions de la vie. Pour atteindre à ce bonheur, tout ce que nous pouvons se borne à fuir les excès en tout genre et à rechercher les causes qui produisent en nous des sensations douces; et comme l’énergie de notre volonté dépend elle-même de dispositions involontaires, ce que nous pouvons véritablement se réduit, si ce n’est à rien, du moins à peu de chose. Telle est la première face sous laquelle la nature humaine se présenta à Maine de Biran. La direction de son esprit n’est nulle part plus nettement marquée que dans un passage où il recommande la pureté de la conscience et l’exercice de la bienfaisance comme contribuant à «cet état physique dans lequel il fait consister le bonheur.[19]» L’idéal qu’il poursuit, c’est le calme de l’imagination et de la pensée, provenant de ce calme des sens que favorisent l’air pur de la campagne, le spectacle d’une belle soirée, et une santé en équilibre. En présence d’un état intérieur semblable il demande:
S’il est vers le bonheur une autre route à suivre
Et si l’art d’être heureux n’est pas tout l’art de vivre.
C’est à ce résultat que devait arriver facilement un homme d’un tempérament délicat, sans occupation extérieure, et employant les heures de sa solitude à analyser ses sensations, lorsque cet homme était dépourvu des convictions qui auraient pu lui révéler des sphères plus hautes dans la vie humaine et une autre espèce de bonheur: il faut le dire surtout: C’est là que devait arriver un novice en philosophie, vivant en France, à la fin du XVIIIe siècle.
Le condillacisme régnait alors, et ses partisans n’hésitaient pas à le considérer comme le dernier mot de la pensée humaine. Il était donc admis que l’image la plus fidèle de l’homme est une statue animée, qui reçoit du dehors, et par le canal des sens physiques, tous les éléments de sa vie, tant intellectuelle que morale. L’esprit humain est un vase où la connaissance se dépose, sans qu’il y ait dans la pensée même un principe d’activité qui lui appartienne en propre; toute science réelle est renfermée dans les résultats de l’observation sensible; le reste est vaine fantaisie de l’imagination: voilà pour la théorie de l’intelligence. La volonté est un agent presque mécanique qui cherche les occasions de jouissance et fuit les causes de douleur; le bien et le mal ne sont que d’autres manières de désigner le plaisir et la peine: voilà pour l’ordre moral. La manière dont Maine de Biran était porté à résoudre le problème du bonheur se trouvait dans une harmonie parfaite avec cette théorie, et il n’est pas facile de dire dans quelle mesure son point de vue résultait de ses observations personnelles, et dans quelle mesure il provenait de l’influence de l’école philosophique de l’époque. Quoi qu’il en soit, il se sait en accord avec les penseurs de son siècle et de son pays, et nomme Condillac, Locke et Bacon, comme les chefs dont il révère la mémoire et suit fidèlement les traces. A la vérité, lorsqu’il se heurte contre les doctrines de Hobbes et d’Helvétius, il recule devant cette négation si expressément formulée de toute liberté, de tout ordre moral, et fait entendre des réclamations, parfois assez vives, en faveur de la liberté humaine. Mais n’oublions pas que nous sommes en présence, non pas d’un système mûrement médité, mais des premiers tâtonnements d’une pensée qui s’essaie et cherche son chemin. Cette réserve faite, on peut affirmer, que le sensualisme fut la doctrine à laquelle M. de Biran donna son adhésion, lorsqu’il aborda pour la première fois l’étude de l’homme sous la forme scientifique. Cette adhésion est explicite et complète. Si l’on voit la théorie fléchir dans ses conséquences extrêmes, devant les exigences du sens moral, c’est qu’un bien petit nombre d’esprits réussissent à éviter les inconséquences, et que, malgré ce qu’il pouvait y avoir de personnel à M. de Biran dans sa première conception du bonheur, le système sensualiste, comme système formulé et exclusif, ne fut toutefois pour lui qu’un vêtement d’emprunt. Sa pensée, dans son développement naturel, devait bientôt faire éclater sur plus d’un point cette enveloppe artificielle et la rejeter enfin entièrement.
Cette transformation ne devait pas s’accomplir sur-le-champ, et au sein de la retraite où l’époque de la terreur avait jeté notre jeune philosophe. Des jours plus calmes commençaient à luire pour la France, et quelques-uns des hommes que le régime de 1793 avait exclus de toute participation aux affaires du pays, commençaient à reparaître sur la scène politique. Le 25 floréal an III (14 mai 1795), Maine de Biran fut nommé administrateur du département de la Dordogne, par le représentant du peuple Boussion. Il se concilia dans l’exercice de ses fonctions la confiance de ses administrés, car le 24 germinal an V (13 avril 1797), il fut envoyé au conseil des Cinq-Cents. Les manuscrits politiques et administratifs de cette première période de sa carrière publique, établissent que, dès qu’il fut en position de le faire, il agit avec une grande énergie contre les tendances révolutionnaires. Aussi son élection fut annulée à la suite du coup d’État du 18 fructidor (4 septembre 1797). Les commotions politiques le laissaient une seconde fois sans position officielle; mais les circonstances étaient très-différentes de celles dans lesquelles il se trouvait en 1789. Un mariage, selon son cœur, l’avait uni depuis quelque temps à une femme qui faisait le charme de sa vie[20]. Le bonheur domestique était mieux d’accord avec les facultés aimantes de son cœur et les qualités de son esprit que les émotions de la politique et les délibérations tumultueuses d’une assemblée parlementaire. Ce fut donc avec joie, qu’après être resté quelques mois à Paris pour y profiter des cours publics, il retourna dans ses foyers. Le garde du corps licencié était rentré tristement dans une demeure presque déserte; le député destitué ramenait avec lui une compagne aimée qui devait embellir sa solitude en la partageant. Ce fut le 13 messidor an VI (1er juillet 1798), qu’il établit de nouveau son domicile à Grateloup.
Le jeune penseur avait été mûri par les années. Rendu à ses études par la cessation de ses fonctions administratives et politiques, il se sentit assez fort pour produire au dehors le résultat de ses méditations. Une question posée par l’Institut sur l’influence de l’habitude éveilla son intérêt, et un succès des plus flatteurs lui apprit que le travail opiniâtre auquel il s’était livré n’avait pas été perdu. Le Mémoire sur l’habitude, couronné en 1802, à l’unanimité des suffrages, fut imprimé en 1803. Cet écrit eut un succès d’estime des plus prononcés, il n’eut pas un succès de vogue; la nature du sujet ne le comportait pas, et le mode de rédaction de l’ouvrage s’y serait d’ailleurs opposé. Le style du Mémoire sur l’habitude (et cette remarque s’applique à toutes les productions métaphysiques de l’auteur) porte l’empreinte de la réflexion seule, et d’une réflexion solitaire. Non-seulement l’écrivain se tient en garde contre les suggestions de tout sentiment un peu vif, mais on voit qu’il lui suffit de bien s’entendre lui-même. Uniquement préoccupé du désir de se rendre compte de sa propre pensée, il songe peu à mettre ses idées en relief, dans une exposition qui en facilite à tous l’intelligence. De là un style qui donne lieu parfois au reproche d’obscurité, et ne se prête pas mieux que le fond même de la pensée à un succès populaire; ainsi que l’a fort bien observé M. Damiron, «M. de Biran n’est pas un écrivain, c’est un penseur qui se sert des mots comme il l’entend et sans songer au lecteur.»
Lorsqu’on connaît l’avenir qui était réservé à l’auteur du Mémoire sur l’habitude, il n’est pas difficile de découvrir dans ce premier écrit, en germe, mais très-distinctement, plusieurs des vues qui le conduisirent plus tard à rompre avec l’école de Condillac. Mais l’écrivain n’a pas conscience de sa position véritable. Son but n’est autre que d’appliquer les principes généralement admis à la solution d’une question de détail. Il fait ouvertement et avec bonne foi profession de fidélité à la doctrine régnante, et il appelle ses maîtres les hommes qui venaient alors de prendre avec éclat le sceptre de l’école sensualiste: Cabanis et de Tracy. Maine de Biran devint l’ami de ces deux écrivains, il eut sa place marquée dans les rangs des idéologues, et on le considéra, autant que pouvait le permettre son séjour habituel en province, comme un membre de la société d’Auteuil[21].
A la même époque où il jetait ainsi les bases de sa réputation; le lauréat de l’Académie fut atteint par l’épreuve la plus cruelle. La compagne de sa vie, la mère de trois enfants qui étaient venus animer et réjouir sa demeure, fut retirée de ce monde le 23 octobre 1803[22]. La blessure fut profonde et ne se cicatrisa jamais entièrement. Le temps fit son œuvre; la mélancolie succéda à la douleur amère, mais le souvenir du bonheur perdu était placé dans cette région de l’âme que l’indifférence ou l’oubli ne sauraient atteindre. Ce souvenir demeura jusqu’à la fin l’une de ces tristesses précieuses qu’on ne changerait pas contre les joies les plus brillantes de ce monde. D’autres lieux, d’autres circonstances, d’autres affections, rien ne put l’effacer. Le 23 octobre demeure une journée à part, une journée triste et douce qui ramène souvent dans le Journal intime quelque mention, telle que celle-ci: «Hier (23 octobre 1814) fut le jour anniversaire de la mort de Louise Fournier, ma bien-aimée femme. Ce jour me sera triste et sacré toute ma vie. Semper amarum, semper luctuosum habebo.»