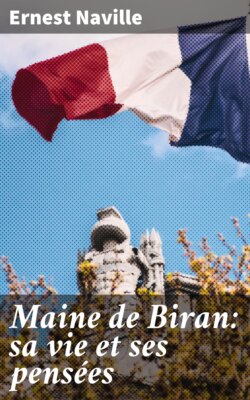Читать книгу Maine de Biran: sa vie et ses pensées - Ernest Naville - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Maine de Biran à Paris. —1812 à 1824—
ОглавлениеCirconstances extérieures.—Opinions politiques.
Les événements sinistres, avant-coureurs de la fin du régime impérial, se déroulaient rapidement. Maine de Biran fut appelé par la confiance de ses collègues au corps législatif, à prendre part à un acte diversement apprécié, mais assez important aux yeux de tous pour avoir inscrit le nom de ceux qui en furent les auteurs dans les annales de l’histoire politique.
A la fin de 1813, Napoléon, qui voyait de mémorables revers succéder à des succès inouïs, leva trois cent mille soldats nouveaux pour repousser l’étranger qui de toutes parts envahissait l’empire, et réclama dans ce moment de crise le concours de tous les pouvoirs de l’État. Le corps législatif saisit cette occasion pour faire entendre au général vaincu des vérités trop longtemps dissimulées à l’empereur victorieux. Maine de Biran siégea avec MM. Lainé, Raynouard, Gallois et Flaugergues dans la fameuse commission qui demanda qu’avant de déclarer la guerre nationale, l’assemblée fit entendre au monarque les plaintes et les vœux du pays, et réclamât des garanties sérieuses pour la paix de l’Europe, et la liberté des citoyens français. Il était uni à M. Lainé par les liens d’une étroite amitié, et tout devait le porter d’ailleurs à s’associer à la démarche dont cet homme d’Etat fut le principal instigateur. Les événements étaient de nature à réveiller les espérances des royalistes, et c’est en qualité de royaliste que M. de Biran avait été exclu de la représentation nationale à la journée de fructidor. Sa nature personnelle ne le prédisposait pas à la fascination que la gloire de l’empereur faisait éprouver à d’autres; homme de paix et de théorie, il ne crut pas qu’on dût sacrifier la liberté des individus à l’indépendance de la nation et le bonheur à la gloire. Il accepta donc pleinement la séparation établie par les alliés, dans la déclaration de Francfort, entre la France et l’homme qui venait de présider à ses destinées. Les conséquences que devait entraîner un nouveau triomphe de Bonaparte lui semblaient beaucoup plus à craindre que l’humiliation passagère d’une conquête. «On craint d’être pillé, ruiné, brûlé par le cosaque,» écrit-il en février 1814, «cette crainte absorbe tout autre sentiment, et on ne se souvient pas de la cause première de tant de maux; on ne prévoit pas ceux que la même cause doit entraîner encore, si on la laisse subsister. On fait des vœux pour les succès du tyran, on s’unit à lui pour repousser l’ennemi étranger, on oublie que l’ennemi le plus dangereux est celui qui restera pour nous dévorer, pendant que les autres passeront.» La violence dont usa Bonaparte, la saisie du rapport de M. Lainé, la clôture de la salle des séances, l’ajournement indéfini de la législature, et la hautaine arrogance avec laquelle l’empereur déclara que «c’était lui seul qui représentait la France,» que «la nation avait plus besoin de lui qu’il n’avait besoin de la nation;» tous ces souvenirs encore récents expliquent l’amertume des paroles qu’on vient de lire, paroles qui sont loin d’être les plus acerbes de celles qu’on trouve à cette époque dans le Journal intime.
Dans la position de la France, à la fin de 1813, applaudir à la chute de Bonaparte et appeler de ses vœux le retour de la dynastie des Bourbons, ce n’était guère que les deux faces d’une même pensée. Maine de Biran, depuis cette époque, demeura toujours attaché à la politique royaliste; il fut jusqu’à la fin inébranlablement fidèle à cette cause. La dissolution du corps législatif l’avait momentanément rendu à la solitude; ce fut dans sa campagne du Périgord qu’il assista de loin à l’invasion toujours plus complète du territoire, et à la première chute de l’empire. Il contracta à cette époque un second mariage qui ne lui donna pas d’enfants[33]. La restauration le rappela à Paris; il reprit, pour la forme, l’habit de garde du corps dans la compagnie Wagram et fut immédiatement appelé à la chambre des députés; les fonctions de questeur lui furent confiées le 11 juin. Il se reposait à Grateloup des travaux de la première session, lorsque la nouvelle du débarquement de Bonaparte vint le jeter dans une agitation fiévreuse. Il part en hâte pour Paris, où ses fonctions réclament sa présence. Le départ du roi décidé, il reprend avec M. Lainé le chemin du midi. Rentré dans sa retraite, dès qu’il est un peu remis du choc de tant d’impressions diverses, il se décide à joindre à Bordeaux la duchesse d’Angoulême et M. Lainé qui s’était rendu auprès de cette princesse. Parvenu un peu au delà de Libourne, il trouve les passages interceptés par les troupes impériales, et doit regagner ses foyers. Des avis menaçants lui parviennent: sur les instances de sa famille, il abandonne sa demeure que la gendarmerie cerne et visite. Sa position de fugitif lui devient promptement à charge; il forme la résolution de se mettre lui-même aux mains des autorités, et après deux entretiens successifs dans lesquels il fait connaître au préfet et au général commandant à Périgueux ses sentiments et ses intentions, il est rendu à la liberté et au repos.
La courte période de la première restauration aurait suffi pour lui inspirer un attachement sincère à la personne du roi, et ses affections avaient ainsi donné un appui nouveau à ses principes politiques. Pendant les Cent-Jours nulle pensée de faiblesse ne vint aborder son âme; aussi, malgré l’extrême sévérité des jugements qu’il portait sur lui-même, il put écrire, en récapitulant ses impressions et ses actes de cette époque: J’ai été assez content de moi. L’idée de se rallier de nouveau au régime qui semblait renaître ne paraît pas même avoir effleuré son esprit; étranger désormais à des événements sur lesquels il ne peut exercer d’influence, son seul désir est de s’enfermer dans sa solitude, de demander encore une fois aux travaux de l’esprit une diversion à sa profonde tristesse. Le journal intime de cette époque le montre en effet se livrant avec ardeur à la philosophie, et donnant le reste de ses journées à la vie de famille, à la société de ses voisins, et même à sa harpe longtemps délaissée. Il ne réussit pas toutefois à détourner sa pensée des grands événements qui viennent de s’accomplir. L’empire de Bonaparte relevé, c’est à ses yeux la révolution, qui reprend son cours, la guerre au dehors, l’oppression et la souffrance à l’intérieur, c’est enfin l’avilissement de la nation française qui, oubliant tant d’expériences récentes, se livre elle-même à son oppresseur. A ces pensées, l’indignation et le découragement se partagent son âme, et la lecture du Journal intime prouve que la préoccupation de la chose publique lutte souvent avec avantage contre son désir de renouer en paix le fil de ses recherches métaphysiques. Nulle expression ne lui semble assez forte pour rendre les sentiments qui l’animent; il emprunte au livre de Job ses plaintes les plus amères, au prophète Isaïe ses plus redoutables menaces, et c’est avec les mélancoliques paroles qu’inspiraient à Jérémie les désolations de Jérusalem, qu’il pleure les malheurs auxquels la France lui semble réservée. Les citations de l’Ancien Testament abondent alors sous sa plume et prouvent que dès cette époque il lisait fréquemment le volume des saintes Ecritures.
Les événements se pressent; la nouvelle de Waterloo arrache le philosophe à ses travaux à peine repris. L’espoir rentre dans son cœur, mais l’inquiétude le balance. «Le parti républicain s’agite en ce moment,» écrit-il le 27 juin, «personne n’a encore prononcé le nom de Louis XVIII et des Bourbons. La France semble dans la stupeur, le cri national se fera-t-il bientôt entendre? Vive le roi! sans le roi légitime point de salut.» Ses désirs furent exaucés, et, le 20 juillet, il venait occuper de nouveau au palais Bourbon l’appartement du questeur.
A partir de ce moment, la vie de M. de Biran revêt à l’extérieur un caractère très-uniforme. Sauf pendant la session de 1817, il siégea jusqu’à sa mort à la chambre des députés[34]. En octobre 1816, il fut nommé conseiller d’État en service ordinaire, attaché à la section de l’intérieur; il prit enfin une part assez active aux travaux du comité d’Instruction primaire que le préfet de la Seine avait constitué en 1815 pour l’introduction de l’enseignement mutuel. Passant seul à Paris la plus grande partie de l’année, il allait chaque automne en Périgord auprès de sa famille. En 1816 et 1819, sa santé toujours faible et quelquefois chancelante le conduisit aux eaux des Pyrénées. Une seule fois il sortit de France; ce fut pour parcourir, en 1822, quelques-uns des cantons suisses. Dans cette rapide excursion, il vit M. de Fellemberg à Hoffwyll, et fit à Yverdun la connaissance personnelle de Pestalozzi. Tels sont, avec les recherches philosophiques toujours poursuivies, les principaux éléments d’une existence assez peu accidentée.
Bien que siégeant à la Chambre et au conseil d’État, jamais, depuis 1813, M. de Biran n’apparaît sur le premier plan. Les succès oratoires lui étaient interdits; sa voix était si faible qu’il avait peine à se faire entendre dans une assemblée nombreuse; souvent il était obligé de faire lire le développement écrit de ses opinions par quelqu’un de ses collègues. Il était toujours près de perdre contenance lorsqu’un grand nombre de regards se fixaient sur lui; c’est avec angoisse que, dans des occasions assez rares, il monte lui-même à cette redoutable tribune, comme il l’appelle, et plus d’une fois, en en descendant, il forme le projet de ne jamais y reparaître. Toutes ses qualités d’ailleurs étaient précisément l’inverse de celles qui font l’orateur. Le besoin de creuser toujours en profondeur au lieu de s’étendre en surface, l’habitude de repousser, comme autant d’obstacles dans la recherche de la vérité, les élans de l’imagination et les suggestions des sentiments passionnés: c’étaient là les dispositions directement contraires à celles que réclament les luttes des assemblées parlementaires, et ces brillants tournois de paroles dans lesquels les conseils d’une raison sévère ne sont trop souvent que des armes émoussées. Mais la disposition qui, plus que toute autre, éloignait Maine de Biran des succès de la tribune, comme aussi de l’ambition d’un homme d’État, c’était l’absence d’un intérêt vrai pour cet ordre de choses: une grande position dans le monde politique ne répondait pas mieux à ses facultés et à ses goûts que l’administration d’une sous-préfecture. De loin en loin le succès de tel de ses collègues, la place éminente occupée par son ami Lainé, éveillaient en lui quelques germes d’émulation; mais ce n’étaient là que des mouvements fugitifs, durant peu et disparaissant sans laisser de traces. Par instinct, par habitude, par réflexion, il plaçait ailleurs que dans la politique ce qui fait le prix de l’existence. Ses impressions à cet égard se traduisent par cette formule qui revient souvent sous sa plume: «J’erre comme un somnambule dans le monde des affaires.» Ses papiers sont là pour établir que, sauf dans des moments de commotion extraordinaire, une puissance presque irrésistible détournait son esprit du théâtre orageux des affaires publiques pour le conduire dans le paisible domaine de la spéculation. Un cahier qu’il destinait à recueillir des notes sur l’histoire contemporaine revêt bientôt le caractère prédominant d’une série d’ébauches sur la nature humaine; ses carnets présentent quelques notes assez rares relatives aux délibérations du conseil d’État, perdues au milieu de réflexions psychologiques. Il fallait que le sentiment du devoir vînt incessamment le soutenir dans une carrière où les mobiles ordinaires lui faisaient défaut. C’est sous l’empire de ce sentiment qu’il traçait les lignes suivantes sur son agenda de poche de 1815: «Je vais faire partie d’une assemblée qui doit décider du sort de la France. Quel rôle suis-je appelé à y jouer? Je mettrai de côté toute vanité, tout sentiment personnel; je serai de bonne foi dans l’assemblée. Qu’importe ce qu’on pensera de moi, si j’ai rempli le devoir pour lequel je suis envoyé?» On serait heureux de rencontrer de telles paroles dans les papiers d’un grand nombre d’hommes d’État.
Les circonstances amenèrent M. de Biran à être un homme politique, les liens de l’habitude l’enchaînèrent à cette carrière, mais jamais il ne la poursuivit avec une volonté réfléchie. Ce n’est pas à dire qu’il ne se laissât préoccuper et inquiéter par les émotions journalières, nées des événements. Si l’intérêt dans le calme est la condition du bonheur, c’était une position malheureuse que celle d’un homme qui s’agitait pour des choses qui, dans le fond, lui demeuraient indifférentes. Aussi Maine de Biran s’afflige de cet entraînement qu’il subit sans y consentir; il tourne des regards d’envie vers ces temps heureux de la monarchie, où les débats de la Chambre et les séances du conseil d’État n’arrachaient pas les hommes de lettres à la solitude du cabinet; il forme des plans de retraite, il médite de rompre tous les liens qui l’enveloppent et de se remettre exclusivement à ses études chéries. Rien de plus simple, semble-t-il, que l’exécution de ces projets. Le moment propice arrive: le temps des réélections à la Chambre est venu; le philosophe se rend en Périgord; un mot à ses électeurs va suffire; ses chaînes tombent, et il est rendu à la liberté. Ce mot, vous l’attendez en vain; l’habitude l’emporte, les impressions du moment étouffent tous les désirs antérieurs; Maine de Biran est presque aussi préoccupé de sa réélection qu’un ambitieux pourrait l’être. Ce désaccord pénible entre le genre de vie qu’il s’imposait lui-même, et cependant malgré lui, et la vie à laquelle il se savait réellement propre, redouble lorsque les préoccupations deviennent plus intenses. En décembre 1818, une crise ministérielle éclate; Maine de Biran trace les lignes suivantes: «J’ai passé tout mon temps au ministère de l’intérieur, occupé de causeries sur le sujet du jour. Que me font tous les changements de ministres et toutes les tracasseries des hommes avides de pouvoir, tous ces mouvements orgueilleux et insensés de petits hommes qui croient chacun commander au destin dont ils sont les instruments? Pourquoi ne me tiens-je pas tranquille, borné au rôle d’observateur qui me convient uniquement, triste témoin des déchirements et de la dissolution de notre patrie que je ne puis servir autrement que par des vœux impuissants, le ciel m’ayant refusé l’énergie de corps et d’âme nécessaire pour influer sur les hommes et sur le temps et le lieu où l’on vit? Cette vérité de sens intime devrait me rendre tranquille, et pourtant je m’émeus, je m’agite avec tout le monde, oubliant la véritable place qui me convient et mon rôle passif d’observateur, aspirant quelquefois à influer comme les autres. Fatigué de ces efforts inutiles, je perds toute contenance, tout aplomb, et je suis averti par la conscience intérieure de la platitude de mon rôle, chose dont les autres hommes ne s’aperçoivent pas. Quousque?»
Le rôle d’observateur était véritablement celui qui lui convenait, et c’est l’appréciation des événements publics, et non le récit de circonstances particulières et peu connues qui fait l’intérêt de la partie politique du Journal intime[35].
M. de Biran était royaliste. Ce fait est suffisamment établi parce qui précède; ce qui reste à constater, c’est dans quel sens et par quels motifs il consacra sa carrière publique tout entière à la défense des droits et des prérogatives de la couronne.
Le repos, l’ordre: telle est en matière politique son invariable devise. L’observateur le plus superficiel saisira la relation de cette tendance de son esprit avec sa constitution physique et morale. Impressionnable comme il l’était, ressentant dans le trouble de ses sentiments et même dans le désordre de son organisation, le contre-coup douloureux des commotions extérieures, il ne pouvait contempler qu’avec effroi le spectacle des tempêtes politiques. D’autres ont besoin des excitations du dehors pour se sentir exister; il leur faut de fortes secousses pour préserver de la langueur une nature qui s’affaisse dans le calme. Il portait, lui, dans ses nerfs agités, dans les mille variations d’une sensibilité presque fébrile, une source de mouvement qui n’était que trop abondante. Une base fixe, un point d’appui constant, tel était, nous l’avons vu, le premier désir de son âme; lorsqu’il portait sa pensée sur les faits sociaux, ce désir se manifestait avec autant d’énergie qu’en toute autre occasion. Il n’est pas rare qu’on souhaite la paix au dehors, avec d’autant plus de vivacité qu’on la trouve moins au dedans de soi. Les vues de M. de Biran sur la marche des sociétés se rattachent donc par un lien assez étroit à sa nature personnelle. On ne saurait toutefois, sans faire injure à sa mémoire, expliquer uniquement par les faits de cet ordre la ligne de conduite qu’il adopta. Une politique qu’on pourrait nommer politique d’instinct, trouva une base plus ferme dans ses opinions réfléchies.
On ne peut pas établir entre la théorie de l’Essai sur les fondements de la psychologie, et les votes du questeur de la chambre, un lien direct et immédiat. Il n’est pas impossible, cependant, de découvrir une tendance commune à la politique de M. de Biran et à sa philosophie. En métaphysique, il avait restauré les droits de la volonté, qui fait la personne. C’est encore dans la valeur accordée à la personne humaine, qu’est le point de départ de sa doctrine sociale. Si sa vie se fût prolongée, nul n’eût été mieux préparé à combattre, au nom de la vraie science, au nom de l’observation réelle des faits, ces modernes théories qui sacrifient le citoyen à l’État, l’homme à l’humanité; le socialisme, sous toutes ses formes, n’eût pas rencontré de plus ardent adversaire, puisque le socialisme n’est autre chose, dans son principe, que la négation de la valeur et des droits de la liberté personnelle. Aux yeux de M. de Biran, la seule fin légitime de l’état était de placer chaque individu dans un milieu convenable pour son développement normal. «Il m’est bien évident, écrit-il, que le seul bon gouvernement est celui sous lequel l’homme trouve le plus de moyens de perfectionner sa nature intellectuelle et morale et de remplir le mieux sa destination sur la terre.[36]» Dans cette destination, il ne faisait pas entrer l’idée de l’exercice des droits politiques: un homme, à ses yeux, pouvait être un homme complet sans avoir à déposer son suffrage dans l’urne électorale. Il considérait l’état politique, non comme un but à réaliser, mais comme un simple moyen pour la réalisation du vrai but: le bien véritable de chacun des membres du corps social. Que demander dès lors à l’état politique d’une nation? Non pas d’être conforme à tel ou tel système, mais de fournir à chaque citoyen la garantie de ses intérêts de toute nature: l’ordre qui assure le repos.
Le repos réclamé par les intérêts matériels des peuples est réclamé encore par des intérêts d’une nature plus élevée. Dans les temps de crise, l’ordre politique, qui ne doit jamais être qu’un moyen, devient un but. Influer, parvenir, est alors le mobile universel; chacun s’absorbe dans une action purement extérieure, et au sein de préoccupations passionnées, néglige les intérêts de son développement intérieur, les seuls véritables; les événements du jour font oublier le monde invisible. Ces dangers qui sont la condition habituelle des hommes d’État, se généralisent et atteignent toutes les classes de la société lorsque la préoccupation politique devient universelle. Il y a plus: les commotions sociales excitent des passions basses et cupides, et fournissent à l’orgueil, à la vanité des aliments continuels. Les crises publiques allument les haines et placent les hommes en face de leur semblables comme des ennemis ou des rivaux; l’ambition, la jalousie, le besoin de parvenir, l’esprit de révolte et l’esprit de domination, toutes ces dispositions funestes que les troubles civils excitent ou fortifient sont directement contraires à la véritable culture des âmes. Cette culture est la vraie liberté, la liberté à laquelle une créature raisonnable doit attacher le plus haut prix; c’est donc en se plaçant au point de vue le plus élevé qu’on peut dire que «le repos est le plus grand besoin de la société[37].»
Ce repos, comment y parvenir? Ce n’est pas, répond M. de Biran, à la souveraineté du peuple qu’il faut le demander. Sans parler de ces exemples odieux qui n’établissent que trop que la souveraineté du peuple est souvent le manteau dont se recouvre un despotisme abject, comment chercher une base fixe dans les impressions fugitives, dans les caprices de la foule? La multitude, cédant aux émotions qui l’animent tour à tour, obéit un jour à une généreuse impulsion, mais applaudit le lendemain à la violence et à l’injustice. On ne construit rien de solide sur le sable mouvant des opinions populaires; vouloir puiser l’ordre social à cette source serait agir comme un homme qui cherche le repos en s’abandonnant à toutes les impressions de ses sens, à toute la mobilité de ses désirs. «La souveraineté du peuple correspond en politique à la suprématie des sensations et des passions dans la philosophie et la morale[38].» Le repos de la société qu’on ne peut attendre de la souveraineté du peuple, il ne faut pas l’attendre non plus du règne de la force matérielle, du despotisme d’un seul. Le despotisme n’est le repos qu’en apparence; la contrainte n’est pas le calme. D’ailleurs, comme le but dernier de l’ordre social est la protection du libre développement de chacun, un gouvernement qui ne maintient une paix extérieure que par la destruction violente de toute liberté individuelle, manque par cela même au premier but de son institution. Il faut donc trouver une voie moyenne entre le despotisme et la souveraineté du peuple, qui n’est encore que le despotisme sous une autre forme. Cette voie moyenne est l’existence d’une autorité élevée par une adhésion unanime et traditionnelle, au-dessus de toute contestation. Un pouvoir appuyé sur la foi politique des peuples et non sur la force des armes ou sur les passions de la multitude, assure seul à la société cet ordre véritable, qui est le juste mélange de la puissance du gouvernement et de la liberté des citoyens. Or, l’idée de la légitimité est éminemment propre, par les sentiments qu’elle inspire, à atteindre ce but; car elle obtient soumission volontaire pour le présent et confiance pour l’avenir. La succession à la couronne ne peut être interrompue que par une puissance qui se place de fait au-dessus de l’autorité royale. Cette puissance est celle d’une foule insurgée ou celle d’un usurpateur; dans les deux cas le règne de la force se substitue à celui de l’adhésion traditionnelle et paisible des peuples. «Hors de la légitimité je ne vois qu’anarchie ou despotisme[39].»
Telles sont les vues politiques de M. de Biran, résultat assez naturel des dures expériences par lesquelles il avait passé. Après les excès de la révolution qui condamnaient sans retour à ses yeux la théorie de la souveraineté du peuple, après l’empire qui lui avait appris à redouter la main de fer du despotisme militaire, il demandait à la paisible puissance du trône le repos, l’ordre et la garantie de toutes les libertés. S’il ne crut pas au droit divin des Bourbons, il crut à la nécessité sociale de la dynastie. Il eût accepté volontiers pour le résumé de ses opinions ces brèves et sentencieuses paroles que Royer-Collard adressait en 1816 aux électeurs de la Marne: Le roi c’est la légitimité, la légitimité c’est l’ordre, l’ordre c’est le repos. Maine de Biran, tout préoccupé de la restauration de la puissance royale, faisait assez bon marché des pouvoirs et des prérogatives de la chambre; il aurait consenti volontiers à voir ce corps réduit au rôle d’un conseil de la couronne, fait pour éclairer le monarque et jamais pour le dominer. L’état moral de la réunion des députés de la France lui cause souvent de l’irritation: «Dans nos grandes assemblées, tout est pour la vanité, rien pour la vérité,» écrit-il en 1816; et en 1820, après une plus longue expérience: «Passions, intérêts personnels, mensonges perpétuels, comédie... voilà le gouvernement représentatif.» Ces appréciations sévères ne sont pas les motifs les plus sérieux de son opposition à l’extension de la puissance parlementaire. Le pouvoir de la chambre, c’est le pouvoir démocratique, toujours envahissant de sa nature et qui ne peut s’étendre sans menacer les bases mêmes de la monarchie. Les députés de la nation cessent-ils de faire preuve de ce respect de l’autorité, de cette fidélité au monarque dont ils doivent donner l’exemple? Veulent-ils gouverner eux-mêmes, au lieu de prêter leur concours au gouvernement du roi? Dès lors les rôles sont intervertis, la base de l’ordre politique est ébranlée, et la révolution recommence. L’état particulier de la France ajoute un nouveau poids à ces considérations. Sur ce sol si cruellement labouré, deux partis et comme deux peuples se trouvent en présence, animés de passions hostiles prêtes à reprendre au moindre souffle leur redoutable énergie. A ces partis en lutte il faut un médiateur; or, ce n’est pas dans une assemblée que la puissance médiatrice peut résider. Cette assemblée en effet est composée d’hommes des deux factions entre lesquelles le pays se divise; née de la lutte des partis, elle les représente. L’assemblée gouverne-t-elle au gré d’une majorité changeante? le pays est condamné à passer tour à tour de la domination d’un parti à la tyrannie d’un autre. La force médiatrice doit venir du dehors et du plus haut; c’est dans le monarque seul qu’elle peut résider. «On aurait tout accordé au roi, on aurait subi sa loi telle quelle, mais la domination d’une majorité d’assemblée froisse, irrite tous les amours-propres: on ne consent pas à céder à ses égaux. Pour terminer la révolution, il ne fallait pas d’assemblée délibérante, mais un pouvoir dictatorial qui aurait uni à la bonté, à la clémence, beaucoup d’énergie et de fermeté. Nous sommes encore dans l’ornière révolutionnaire[40].»
Il fallait donc que le monarque fût puissant, et, pour être puissant, il fallait qu’il fût libre. Il ne devait pas plus subir le joug des amis de la monarchie que celui des hommes qui pouvaient regretter la république; sa cause, enfin, devait être nettement séparée de la cause à jamais perdue de l’ancien régime et des priviléges de la noblesse. Un double danger menaçait la couronne: le triomphe des libéraux, qui ne la voulaient pas, ou ne la voulaient pas sérieuse; le triomphe des ultra, qui cherchaient surtout à revenir aux abus d’un autre temps, ou à satisfaire un aveugle instinct de vengeance. Ces deux factions avaient en leur faveur toute la fougue des passions; il fallait opposer avec une égale insistance, à leurs prétentions rivales, les conseils d’une saine raison et les vrais intérêts de la France; il fallait amener les parties belligérantes à déposer les armes et à s’abriter ensemble sous la puissance bienfaisante du trône.
Fidèle à ce point de vue purement royaliste, M. de Biran siégea successivement dans deux parties opposées de la chambre, sans cesser d’obéir à la même conviction. Il avait accueilli la première restauration comme une délivrance inespérée. En réfléchissant sur les événements des Cent-Jours, il n’avait pu méconnaître que les propos imprudents de la noblesse, en inquiétant le peuple dans ses intérêts et la bourgeoisie dans sa vanité, avaient beaucoup contribué à préparer cette mémorable péripétie. Dans cette chambre introuvable, de 1815, que Louis XVIII dut dissoudre, la couronne lui parut surtout menacée par les ultra-royalistes qui, sous prétexte de zèle, voulaient forcer la main au monarque, et tendaient ainsi à anéantir la prérogative royale: il siégea donc sur les bancs de la minorité.—De retour dans son département, il manifesta hautement son opinion, et, comme les électeurs avaient besoin d’un représentant qui partageât leur fureur réactionnaire, il ne fut pas renvoyé à la chambre. Ce fut alors que le gouvernement, comme pour réparer une injustice commise, l’appela au conseil d’État. Un esprit plus modéré prévalut en 1817, et il fut revêtu de nouveau des fonctions de député, que dès lors il ne devait plus abandonner. Bientôt il dut constater que les dangers, sans changer de nature, avaient changé d’origine. Il écrit au mois de juillet: «Je m’agite depuis quelque temps avec autant d’inquiétude et d’impatience contre les ultra-libéraux que je le faisais il y a un an contre les ultra-royalistes. Je vois le danger d’un côté opposé à celui où je le voyais alors; je lutte contre ce qui m’environne en faveur de la monarchie, et je vois avec inquiétude que les sentiments, les habitudes monarchiques sont tout à fait détruits. Dans les hommes d’aujourd’hui, la tendance est toute républicaine. Qu’arrivera-t-il de là? Le présent est gros de révolutions[41].» Ces lignes signalent le moment où l’auteur se sépare de l’opposition libérale dans les rangs de laquelle il avait siégé à une précédente législature. Elles établissent aussi très-clairement les motifs de ce changement de position, qui n’était que la conséquence de la fidélité à un principe. L’homme qui n’avait d’autre but que de maintenir intacte la puissance royale, devait se porter sur les points où cette puissance était le plus directement menacée, sans considérer s’il conservait ou non les mêmes compagnons d’œuvre. Maine de Biran, du reste, ne cessa de constater jusqu’à la fin ce qu’il y avait de funeste dans les exagérations du parti royaliste. Comprenant bien que le désir de restaurer les anciens priviléges ne pouvait conduire qu’à une catastrophe, il déplorait un esprit de réaction aveugle; il s’indignait surtout de voir le roi paralysé dans son action par des hommes qui se disaient ses partisans. Il écrit, en 1821: «Nous sommes dans le faux en toutes choses... les plus ardents royalistes sont ceux qui portent les plus terribles coups au pouvoir monarchique, en prétendant le maîtriser, le diriger à leur manière. La république est au moins autant du côté droit que du côté gauche[42].» Cependant, tout en voyant le danger des deux côtés, il estima que la puissance hostile, qui seule créait des dangers sérieux, se trouvait dans le parti libéral; les excès du royalisme ne lui paraissaient guère à craindre qu’en vue de la réaction qu’ils devaient provoquer.
Des convictions de cette nature étaient pour le questeur de la chambre la source de vives inquiétudes. En présence de l’esprit révolutionnaire à peine éteint, et déjà prêt à se rallumer, partagé entre les lugubres souvenirs qui se retraçaient à sa mémoire et les noires prévisions dont il était assiégé, il disait avec Chimène:
Le passé me tourmente et je crains l’avenir.
Ses prévisions s’assombrissent d’année en année. Dans mainte page du Journal intime, des commotions nouvelles sont ici vaguement entrevues, là clairement prophétisées. La révolution du Piémont, succédant aux autres révolutions du midi de l’Europe, vient mettre le comble aux inquiétudes de l’auteur et lui inspire les réflexions suivantes: «Cet état des sociétés est nouveau et n’a d’exemple que dans l’histoire du Bas-Empire, lorsque les soldats disposaient de tout et que les peuples étaient plongés dans l’incurie et l’avilissement. Mais la civilisation, les lumières de l’esprit étaient alors bien en arrière de ce qu’elles sont aujourd’hui. Que doit-il arriver de cette combinaison d’un état de civilisation aussi avancé que l’est celui des sociétés actuelles de l’Europe, ou plutôt de la grande société européenne, avec l’absence ou le discrédit de toutes les institutions politiques et religieuses qui ont paru jusqu’ici les plus propres à donner de la stabilité aux nations ou à maintenir l’ordre social? Dieu le sait et le temps nous l’apprendra. Ce qu’il y a de certain, c’est que les trônes ne sont plus entourés de la force et de la majesté nécessaires pour pouvoir protéger efficacement l’ordre public des sociétés où ils sont établis: ils ne peuvent plus communiquer aux institutions émanées d’eux la permanence, la force et le respect qui leur manquent. Il faut pourtant que les sociétés soient gouvernées ou qu’elles se gouvernent elles-mêmes. N’est-ce pas précisément par les mêmes causes qu’elles sont aujourd’hui si difficiles à être gouvernées et impuissantes à se gouverner elles-mêmes? Il n’y a point d’amour de liberté et d’égalité sans élévation de caractère moral, sans désintéressement de soi-même. Jamais ce désintéressement ne fut plus rare, jamais les hommes, plus concentrés dans leurs intérêts propres, ne furent moins gouvernés par des idées ou des sentiments expansifs. On a comparé le mouvement actuel des sociétés en Europe à celui qui eut lieu à l’époque de la réformation religieuse. Mais c’étaient alors des idées et des sentiments qui entraînaient les esprits; l’ordre social demeurait assis sur ses bases, la réformation ne prétendait pas s’étendre jusque-là. Ici ce sont des barbares armés qui ont en haine l’ordre qui les protége et n’aspirent qu’à le renverser violemment[43].»
De semblables craintes attristèrent jusqu’à sa fin celui qui avait tracé ces lignes. Mort en 1824, il ne vit pas s’accomplir les événements qu’il avait prévus. On peut apprécier ces événements de différentes manières; on ne saurait méconnaître que ce qu’il avait craint et annoncé est précisément ce qui s’est passé sous nos yeux.